Plusieurs recherches ont traité la question en
déterminant le poids de chaque déterminant dans la santé
d'une population ou d'un individu. Notamment l'étude de G. E. Alan Dever
en 1975183, en étudiant les causes de mortalités en
Géorgie (États-Unis), il a défini la part de chaque
facteur dans les causes de mortalité des individus. Selon son
étude, le premier facteur d'ordre biologique n'est responsable que de
27%, le mode de vie de 43%, l'environnement de
183 G. E. Alan Dever, « An Epidemiological Model for Health
Policy Analysis », Social Indicators Research 2,
no 4 (mars 1976): 453-66,
https://doi.org/10.1007/BF00303847.
19% et l'organisation du système de soin de 11%. Bien
évidemment, ces statistiques peuvent être différentes en
fonction du milieu étudié et de son évolution dans la
transition épidémiologique184. Ce que l'on peut
retenir de cette étude de Dever, c'est qu'elle illustre
précisément le poids et l'ampleur de chaque déterminant
dans la santé d'une population ou d'un individu. Elle remet en question
l'idée communément admise, que la santé relève
systématiquement du système médical. Ainsi elle nous
interroge également, sur l'hégémonie du
tout-médical (système de soins) (Cf. figure n°11).
Figure n° 11: La poids de chaque facteur dans la
santé
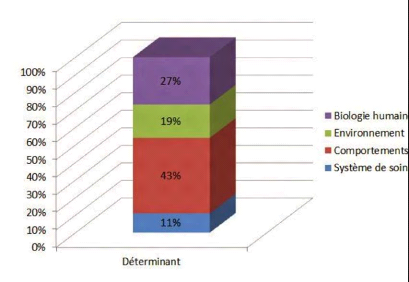
Source : : déterminants de
santé | Le club des médecins blogueurs (
clubdesmedecinsblogueurs.com)
Tiré de : G. E.
Alan Dever, « An Epidemiological Model for
Health Policy Analysis », Social Indicators Research 2, no 4
(mars 1976): pp453-466
Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une
démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?
5 8 | 1 4 8
184 Picheral, « Géographie de la transition
épidémiologique ».
Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une
démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?
5 9 | 1 4 8
Nous allons donc faire un éclairage sur chaque facteur
déterminant la santé185 (186 187 188 189):
> Le premier facteur est d'ordre biologique, psychologique
et physiologique (âge, sexe, taille) qui font référence
à l'organisme individuel à sa résistance (immunité)
et à sa temporalité. Ils sont généralement
liés à l'hérédité et ils sont non
modifiables. L'état de santé d'un individu dépend en
partie de ces éléments individuels. Ils peuvent combattre,
être résilients ou non face à une maladie. Ainsi
l'avancement dans l'âge peut expliquer certaines fragilités du
corps humain et le rendre vulnérable et sujet à certaines
pathologies liées uniquement à la vieillesse. (Comme le cancer,
l'Alzheimer, le diabète, les maladies cardiovasculaires etc). Ce facteur
peut interagir avec d'autres déterminants, selon leurs qualités,
d'une manière négative ou positive.
> Le deuxième facteur lié au mode et aux
habitudes de vie personnels est relatif aux comportements individuels, lesquels
peuvent influencer positivement ou négativement l'état de
santé. Cela s'explique par notre alimentation, nos passe-temps, nos
choix de moyens de transport, nos consommations, notre hygiène et nos
activités quotidiennes. Ainsi, par exemple, la consommation de tabac
augmente les risques de contracter certaines maladies non transmissibles comme
le cancer pulmonaire et des problèmes cardiovasculaires chez les
adultes. Une trop grande consommation de sel favorise l'hypertension
artérielle alors que l'excès de sucre augmente les risques
d'obésité et de diabète de type 2.
> Le troisième facteur lié à la vie
en société : le milieu familial, l'appartenance à un
groupe, l'estime de soi, la relation avec les autres, le milieu d'habitation
(voisinage etc.), les relations humaines (amis, collègues de travail et
de sport, etc.). Tous ces éléments créent des interactions
sociales. Ils ont une influence sur l'état psychique et
185 Cette partie est tirée des travaux de : Dr Sylvain
FEVRE, Erwan Le Goff, Anne Roué le Gall, Dr Erold Joseph etc. :
186 « déterminants de santé | Le club des
médecins blogueurs », consulté le 26 octobre 2021,
https://www.clubdesmedecinsblogueurs.com/category/determinants-de-sante/.
187 Erwan Le Goff, « Erwan Le Goff. Les
Villes-Santé en Bretagne : quels choix de gestion et
d'aménagement des espaces ?. Géographie. Université Rennes
2, 2012. Français. ffNNT : 2012REN20051ff. fftel-00772443 »
(2012).
188 Roué Le Gall, « «Agir pour un urbanisme
favorable à la santé, concepts & outils » ; Guide
EHESP/DGS, ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc et CUZIN
Ysaline, 2014. »
189 « COMPRENDRE LA SANTÉ AUTREMENT (Suite) Le
Décès Du Petit Gabo Troisième Partie Par Dr Erold JOSEPH
1/11/19 »,
lenational.org/, consulté
le 23 septembre 2021,
https://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3510.
Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une
démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?
6 0 | 1 4 8
sur l'état de santé en général
d'un individu. Ils peuvent être positifs ou négatifs pour la
santé.
> Le quatrième facteur est lié aux
différentes conditions : sociaux-économiques, culturelles et
environnementales. Ce facteur est relatif à un ensemble
d'éléments influençant l'état de santé d'un
individu :
· Socio-économique : cet environnement est
relatif à la situation sociale et économique de l'individu, de sa
ville et de son pays. Un pays riche a plus de possibilités d'offrir une
situation socio-économique favorable à sa population
(Système de soin de qualité et accessible à tous, la
recherche biologique, alimentation de qualité, la
sécurité, un niveau de revenus convenable pour subvenir aux
besoins, une éducation et une formation de qualité, des
équipements de qualité, des logements décents, des emplois
de qualité, etc. Par conséquent, ce facteur peut se traduire par
le développement du phénomène des
inégalités sociales de santé. Comme nous l'avons
évoqué précédemment, ce phénomène
résulte du niveau social et économique de l'individu. Plus une
personne a un niveau de vie élevé, une place importante dans la
hiérarchie sociale et plus sa probabilité d'être en
meilleure santé augmente. L'inverse est aussi vrai : plus une personne a
des revenus faibles et une place au bas de l'échelle sociale, moins il a
de chances d'être en bonne santé. Ce facteur conditionne, dans la
majorité des cas, le mode et le style de vie des gens.
· Culturelles : cet environnement lié à la
culture de l'individu, sa vision du monde et sa façon
d'appréhender les choses. Ainsi les habitants d'un pays où les
croyances sont prédominantes où se développe l'idée
de la santé étant relative à des pratiques ancestrales
transmises par les coutumes et les traditions. L'évo-lution de la
technologie peut également bouleverser les cultures et influencer la
santé des individus. On assiste à l'évolution de la
télémédecine (consultation en ligne).
> Environnementales : ce facteur fait
référence à deux catégories d'environnements :
· L'environnement naturel lié à
l'écosystème et à la nature : la trame verte et la trame
bleu, la faune et la flore. Il peut influencer la santé par son
état : sain ou pollué, végétalisé ou non,
protégé ou non.
· L'environnement bâti lié à la
nature de l'ensemble des éléments bâtis par l'Homme : il
s'agit de l'urbanisation et de l'aménagement de l'espace (habitat,
aménagement de l'espace publique, constructions d'équipements
économiques et sociales, les routes, les autoroutes, les transports etc.
leur qualité peut avoir un impact important dans l'état de
santé d'un individu.
La santé reste donc un état dynamique
dépendant de l'ensemble de ces déterminants dont les interactions
entre eux demeurent évidentes et complexes. Cependant, l'affectation des
ressources au système de la santé demeure incohérente au
regard du poids de chaque déterminant de santé. En effet, nous
observons dans les pays développés, en particulier aux
États-Unis (selon G. E. Alan Dever), que le
système de soin représente plus de 90% des dépenses de
santé tandis que seulement 11% de ces dépenses sont
affectés à la réduction de la mortalité et de la
morbidité et moins de 2% des dépenses sont liés au
comportement (mode de vie) et à l'environnement social,
économique et environnemental alors que ces derniers permettraient de
réduire de pratiquement 50% la mortalité et la
morbidité190.
Malgré la clarification du poids de chaque
déterminant dans l'état de santé, l'étude de Dever
montre la disproportionnalité dans les dépenses pour la
santé (Cf. figure n° 12 & 13).
Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une
démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?
6 1 | 1 4 8
190 « déterminants de santé | Le club des
médecins blogueurs », consulté le 26 octobre 2021,
https://www.clubdesmedecinsblogueurs.com/category/determinants-de-sante/.
Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une
démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?
6 2 | 1 4 8
Figure n° 12 : Affectation des
dépenses de santé aux États-Unis (G.E. Alan Dever)
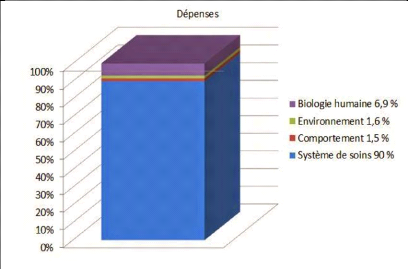
Source : déterminants de
santé | Le club des médecins blogueurs (
clubdesmedecinsblogueurs.com)
Tiré de : G. E. Alan Dever, « An Epidemiological Model
for Health Policy Analysis », Social Indicators Research 2, no
4 (mars 1976): pp453-466
Figure n° 13 : Le poids de chaque facteur
dans la santé et les dépenses y affectées
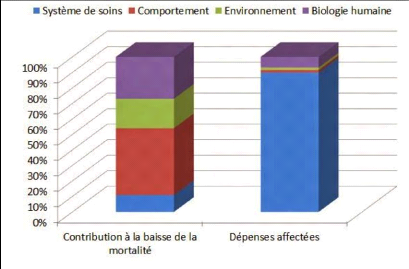
Source : déterminants de santé
| Le club des médecins blogueurs (
clubdesmedecinsblogueurs.com)
Tiré de : G. E.
Alan Dever, « An Epidemiological Model for
Health Policy Analysis », Social Indicators Research 2, no 4
(mars 1976): pp453-466
Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une
démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?
6 3 | 1 4 8
En outre, l'environnement au sens large du terme n'a jamais eu
autant d'influence sur la santé que de nos jours. En 2005, une
étude a été dirigée par l'Institut Canadien de
Recherche Avancée et publiée en 2010 par l'Institut National de
Santé publique du Québec (INSPQ). Elle nous informe que pendant
le siècle dernier, au Canada, l'espérance de vie a
augmenté de trente ans. Cette évolution sociale a
été rendue possible grâce à un changement positif
radical de l'environnement à 60% (50% lié à
l'environnement social et économique, 10% à l'environnement
physique)191. Cette étude ne tient pas compte du mode et
habitudes de vie. En effet, cela nous renvoie à l'idée
Wébérienne, selon laquelle, notre comportement et notre mode de
vie sont un choix dicté par notre situation sociale192.
Nous sommes d'accord avec le fait que l'amélioration
des environnements au sens large développe le bien-être. Ainsi
plusieurs études ont démontré que plus la
réalisation et la satisfaction de l'ensemble des déterminants est
effective, plus la santé et le bien-être deviennent accessibles
pour les populations.
Pour aller plus loin dans cette approche populationnelle de
la santé, il est judicieux d'aborder les déterminants de
santé d'un point de vue de la psychologie des individus. Le paradigme de
la médecine holistique conçoit l'être humain comme un tout
et segmente le corps en plusieurs éléments et établit le
lien entre l'esprit (psychique) et le corps (physique). Ainsi un mal être
psychique peut se répercuter sur le physique193. Nous
développons cette conception par l'approche de Harold Maslow avec sa
théorie de la motivation. Nous considérons donc que tout
individu, pour être en bonne santé, doit en partie avoir un esprit
sain. Il a donc besoin de s'épanouir, de se réaliser et
d'être bien psychologiquement. Pour ce faire, il doit satisfaire certains
besoins qui impactent fortement sa santé mentale. Nous empruntons donc
la pyramide de Maslow et nous l'appliquons aux déterminants de la
santé d'un individu dans un milieu urbain. (Cf figure 14).
191 « COMPRENDRE LA SANTÉ AUTREMENT (suite) »,
RHJS (blog), 24 février 2020,
https://rhjs.ht/2020/02/24/comprendre-la-sante-autrement-suite-2/.
192 Yves Laberge, « Sociologie du corps en bonne
santé : sur quelques théories américaines
émergentes en sociologie médicale », Recherches
sociologiques et anthropologiques 45, no 2 (1
décembre 2014): 185-93,
https://doi.org/10.4000/rsa.1333.
193 Thierry Janssen, « Lien entre physique et psychique
», Futura, consulté le 27 octobre 2021,
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-sante-solution-interieure-705/page/2/.
Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une
démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?
6 4 | 1 4 8
Figure n° 14: La pyramide de Maslow : l'urbanisme et les
besoins pour la santé
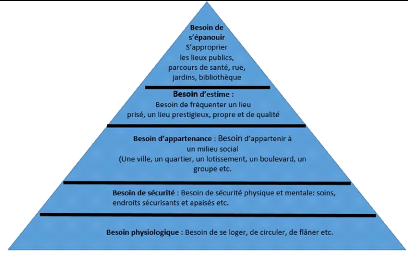
Source : création personnelle
La figure illustre les besoins pouvant influencer la
psychologie d'un individu et par conséquent sa santé physique. Un
besoin qui n'est pas satisfait ou présente des complexités peut
entrainer une perturbation psychologique et qui peut se traduire dans le temps
par une dégradation de la santé physique. Nous partons du
principe que la santé physique et mentale sont étroitement
liées (physique et mentale). Elles sont indissociables et
nécessitent de fortes actions sur les environnements extérieurs.
Il est donc nécessaire d'interroger ces facteurs externes et leurs
interactions complexes. Car la santé et le bien-être s'obtiennent
généralement par l'action combinée de tous ces besoins, de
manière hiérarchique.



