2.2. La perception de la génération Z
2.2.1. Par elle-même
Selon Camous (2011), les adolescents d'aujourd'hui cherchent
à obtenir un nouveau statut aux yeux des adultes, à être
reconnus comme étant capables de prendre des décisions
réfléchies et de manière autonome.
D'après l'étude de PR Newswire (2014), la
génération Z se considère en premier lieu créative
à 57%, ouverte d'esprit à 54%, ayant de nouvelles perspectives et
idées à 52%, intelligente (44%), et pensant différemment
(41%).
10
Le graphique ci-après de l'étude « La
Grande InvaZion » (2015), montre qu'ils se considèrent
passionnés : 84,5% disent choisir leur métier non pas par raison
mais par passion et même si la majorité d'entre eux « ne
pense pas pouvoir s'épanouir en entreprise », ils tenteront
d'accéder à des solutions alternatives (Sachot-Moirez &
Urmès, 2015).
GRAPHIQUE 3 : LES ATOUTS DE LA GENERATION Z, D'APRES
SACHOT-MOIREZ ET URMES
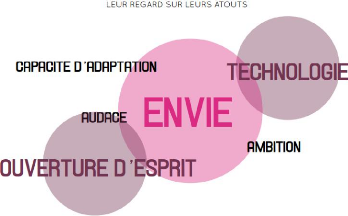
Les Z sont également très conscients de leurs
défauts, et le graphique ci-dessous le montre :
GRAPHIQUE 4 : LES DEFAUTS DE LA GENERATION Z, D'APRES
SACHOT-MOIREZ ET URMES
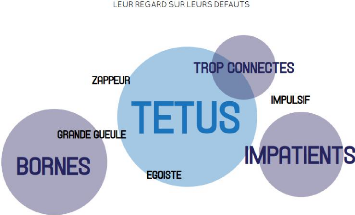
De plus, un tiers de la generation Z pense qu'elle manque de
concentration et 32% affirment qu'ils sont focalisés sur eux-mêmes
(Newswire, 2014).
11
2.2.2. Par les managers
Les managers perçoivent cette génération
d'une manière différente ; en effet d'après l'étude
de Newswire (2014), les 5 stéréotypes (positifs comme
négatifs) associés à cette génération par
les Y sont la paresse à 45%, l'ouverture d'esprit à 41%, la
créativité à 38%, le centrage sur soi à 25%.
De plus, certaines images collent à la peau de cette
jeune génération : plusieurs articles, et notamment celui du
Figaro en 2012 intitulé « Génération Z» :
des connaissances superficielles », explique que cette
génération passe la majorité de son temps à «
échanger, s'amuser, flirter via les réseaux sociaux, à
naviguer au hasard », et « brassent l'information plus qu'ils ne la
comprennent ». Cela montre bien que certaines personnes des
générations passées pensent encore que les jeunes sont
incompétents et les dévalorisent, peut-être sans raison
réellement fondée (Clément, 2014). De même, Didier
Pitelet dans son livre de 2013 « Le Prix de la confiance »,
les décrit comme des utopistes ayant des exigences en terme de
management entrepreneurial qui devra être à leur image, selon lui.
En effet il annonce que ces jeunes souhaitent que leurs managers mettent en
place des modèles éducatifs, structurants et psychologiques. Il
les perçoit comme des personnes qui confondront leur maison et leur lieu
de travail, afin de s'y sentir bien, à condition de trouver un sens
à leur travail ainsi qu'un intérêt (Clément, 2014).
Ils manqueraient aussi de respect envers leur aînés, et
n'accepteraient pas les discours moralisateurs (Camous, 2011).
Lorsqu'il est alors demandé à la
génération Z ce qu'elle pense de ces préjugés, elle
explique qu'elle en a assez qu'on la croit fainéante, « je m'en
foutiste » et désintéressée ; un autre
stéréotype les agace, celui selon lequel ils seraient
connectés au point d'être déconnectés : selon eux,
leur génération est née dans l'ère du
numérique et s'instruit grâce à ça, contrairement
à ce que peuvent penser les générations d'avant
(Clément, 2014).
Cependant, cette vision assez négative de la
génération Z est différente selon les personnes : en effet
certaines managers et entrepreneurs prennent sa défense, en
précisant que ces jeunes pensent d'une manière « plus
latérale » et peuvent transformer la société
grâce à son collectivisme, son imagination et sa
flexibilité (Sachot-Moirez & Urmès, 2015).
| 


