IV.1.L'ordre linéaire
Le premier cas, c'est l'ordre
linéaire. Celui-ci est tout simple. Le récit commence au
début (la croix rouge dans le schéma) et va jusqu'à la fin
de l'intrigue sans quitter sa ligne temporelle de vue. Cela correspond à
la majorité des histoires : elles commencent par le début et se
terminent par la fin.
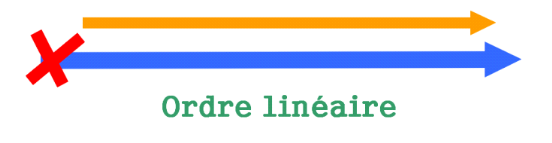
IV.2. L'anticipation ou
prolepse
Le deuxième cas, c'est l'ordre in
mediasres. L'auteur annonce à l'avance un
événement qui va avoir lieu plus tard dans la narration
(contraire de l'analepse). L'histoire peut commencer au milieu de l'intrigue,
généralement dans un prologue où l'on découvre le
personnage principal dans une situation compliquée (1). L'histoire
retourne ensuite au tout début de l'intrigue (2) et se déroule
ensuite linéairement (3) jusqu'à l'événement
décrit au début du texte. On découvre ensuite ce qui se
passe après.

Les anticipations, ou prolepses, se rencontrent moins
fréquemment que les retours en arrière. Les récits qui s'y
prêtent le mieux sont les Mémoires ou les autobiographies tant
réelles que fictifs. Ici, le narrateur, en racontant ce qui s'est
passé, connaît évidemmentl'avenir et fait parfois usage de
ce savoir.
Considérons l'exemple suivant:
« La raison du plus fort est toujours la
meilleure »
Ici, le narrateur annonce qu'il va bouleverser l'ordre de
présentation chronologique des événements. Il annonce
déjà la fin en tout début de récit.
Cette prolepse a une fonction d'annonce ; elle concoure
à établir la cohérence à long terme du
récit. De façon plus générale, en disant maintenant
(dans R) ce qui adviendra plus tard (dans H), la prolepse fait peser sur le
récit un certain poids destinal. L'intérêt du lecteur se
déplace: la fin (misérable) de l'histoire lui étant
connue, ce n'est plus le désir simple de savoir la suite qui le meut,
mais une curiosité plus complexe, et sans doute plus
mélancolique: celle de connaître les rouages inflexibles d'une
intrigue de prédestination.
IV.3.Le retour en
arrière, le flash-back ou l'analepse
Le troisième cas, c'est l'ordre de type
récit picaresque. Le récit picaresque retrace la vie
d'un personnage de ses débuts à son ascension sociale, du point
de vue du personnage lui-même des années plus tard. De ce fait,
l'histoire commence à la fin, à une époque où le
héros est heureux (1). Il y a généralement un prologue
où celui-ci explique ce que le lecteur va lire, puis le récit
redémarre au début de l'intrigue (2) et suit ensuite une
continuité linéaire (3) jusqu'à la fin.

Une analepse, c'est le retour en arrière dans le temps,
la déchronologie, ou encore toute évolution après coup
d'un événement antérieur au point de l'histoire où
l'on se trouve, et qui joue, le plus souvent, la fonction explicative,
permettant ainsi de donner de l'information et d'éclaircissement sur des
situations passées. L'auteur revient ainsi sur un épisode
passé de l'histoire afin de mieux expliquer l'action ou afin de
compléter le portrait d'un personnage. L'analepse suspend le rythme du
récit. Les récits de façon générale usent
beaucoup d'analepses.
L'analepse ou la prolepse peut être interne ou externe.
Les anachronies narratives peuvent aider à
définir certains genres. Leur principale caractéristique est
qu'elle montre que le narrateur connaît bien l'histoire qu'il raconte.
Comme toutes les composantes narratives, analepse et prolepse ne sont pas
fortuites. Elles jouent diverses fonctions dans le texte narratif:
- L'analepse peut avoir une fonction
explicative: elle comble dans ce cas une lacune du récit. Elle peut
aussi avoir une fonction rythmique.
- La prolepse, elle, peut avoir une fonction
prédictive. Dans tous les cas, elle brise pour un temps l'effet de
suspens tant entretenu par le narrateur.
Pour découvrir les anachronies narratives, il importe
de bien noter les changements de temps verbaux et les époques qu'ils
traduisent: les adverbes de temps, les conjonctions de coordination, la mise en
page, les marques graphiques; les indications temporelles.
Pour chaque anachronie narrative, on peut déterminer ce
qu'on appelle la portée et
l'amplitude.
- La portée c'est la distance
temporelle qui sépare le moment de l'histoire où le récit
s'interrompt et le moment de l'histoire où commence l'anachronie.
- L'amplitude, elle, désigne la
durée de l'histoire couverte par le récit anachronique. C'est le
temps couvert par la digression.
Ce ne sont bien sûr pas les trois seuls qui existent.
On retrouve parfois par exemple des textes sans intrigue ou avec une intrigue
à reconstruire (comme dans les hypertextes papiers ou en ligne par
exemple, ou dans Les livres dont vous êtes le
héros !), ou alors avec des allers et retours du passé
au présent (le premier tome
du Sorceleur d'AndrejSapkowski, par exemple, en est un
très bon exemple). De plus, ces ordres de récits sont très
classiques, c'est à vous de vous amuser par la suite à les
modifier et à en faire quelque chose de nouveau.
| 


