4 .3.3. Troisième niveau
Le troisième niveau est celui de l'analyse
systémique le milieu international est considéré comme un
système et on analyse les questions de la stabilité
internationale et du rôle de l'acteur universel comme l'ONU. Il est
important de noter que le champ des R.I. s'observe dans deux processus
contradictoires, qui sont la guerre ou conflit/crise et la
coopération/intégration. Ce niveau comprend aussi outre le
système global le système partiel ou régional autour
desquels se poses problèmes d'interdépendances ou de
globalité/de coordination / solidarité.
Le premier niveau de l'arbre de la théorie
générale des relations internationales est déterminant. Il
est même primordial. Il alimente les relations internationales. Ce niveau
permet aux acteurs privilégiés de prendre les décisions
unilatérales qui les mettent en relation au second niveau où se
déroulent les relations de puissance. Les relations de puissance que les
Acteurs Unitaristes de Pouvoir entretiennent au second niveau engendrent un
nouveau cadre de concertation multilatérale que nous appelons
organisations internationales. Celles-ci ont une personnalité juridique
internationale distincte des Etats qui les composent. En réalité,
ces organisations sont le résultat de la rencontre des volontés
des Etats au seuil de l'interaction entre puissances. Les relations
internationales africaines se déroulent aussi bien au niveau de la
relation (R), qu'au niveau systémique (S). Ces trois niveaux (A, R, S)
constituent l'objet international28.
27 Kadony Nguway, K., Op.cit., p.31.
28 Idem, p.34.
[28 ]
? La compréhension par la « grammaire
»
On peut aussi se servir de la règle de grammaire pour
comprendre de manière théorique l'objet international (A, R, S).
C'est aussi une façon simplifiée de présenter
schématiquement la théorie fondamentale des relations
internationales.
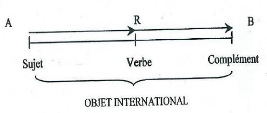
Fig. 5. Compréhension de l'objet
international par la règle de grammaire
Source : Kadony Nguway, K., Une
introduction aux Relations Internationales Africaines, Paris, L'harmattan,
2007, p.34.
Les acteurs privilégiés des relations
internationales constituent le sujet de l'objet international. C'est de la
rencontre des volontés des Etats (A) au seuil du centre (R), le - verbe,
que naît le système considéré comme
complément de l'objet international.
Les considérations théoriques
développées ci-dessus nous ont permis de comprendre les
mécanismes des relations internationales africaines avant de brosser son
aperçu historique.
La détermination de l'un des cas des niveaux d'analyse
constitue la première étape méthodologique pour tout
chercheur en Relations Internationales d'analyse (de recherche) avant de
procéder (passer) à la seconde étape celle en rapport avec
la formulation des hypothèses de travail.
Max Gounelle, estime pour sa part que l'analyse des relations
internationales est possible à travers une analyse macroscopique et
microscopique. C'est le niveau de système et acteurs :
1) Ce niveau privilégie l'explication des relations
internationales au niveau de la totalité et revient à postuler
qu'il existe un système international, susceptible d'une analyse au
macroscope. Les méthodes d'analyse systémique fournissent alors
ici d'utiles grilles d'analyse ;
2) On peut également choisir d'analyser les relations
internationales au niveau des parties composantes c'est-à-dire utiliser
un microscope pour étudier les acteurs du système
[29 ]
international. Parfois on arrive à la combinaison de ces
deux niveaux d'analyse dans les relations internationales (Micro et macro comme
en sciences économique).
En deuxième lieu, il fait état d'un niveau
Relationnel et Institutionnel des / relations internationales par l'analyse
relationnelle, les Relations Internationales étaient entreprise À
entre les seuls Etats afin d'assurer leur sécurité, elle
permettait de décrire et de comprendre les rapports entre les
entités également souveraines, entendus comme les rapports de bon
voisinage, de concurrence ou de conflit armé.
L'analyse institutionnelle a été rendu
nécessaire en relations internationales à la suite de
l'intensification et la diversification des rapports internationaux,
l'apparition et le développement des relations internationales.
La complémentarité de ces deux modes d'analyse
est possible en Relations internationales contemporaines. Les deux approches
sont une fonction explicative de la réalité. L'utilisation d'une
seule entre elles tronquerait substantiellement l'analyse des
phénomènes internationaux d'un aspect important.29
Ainsi, cette étude se situe au troisième niveau
d'analyse des Relations Internationales, à savoir le système
social (avec le sous-système). Partant du niveau d'analyse des Relations
Internationales, le recours à la méthode systémique dans
l'explication s'avère légitime par le fait de l'ONU, le PNUE, et
la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques,
disposent d'organes qui entrent en interaction pour répondre aux
aspirations de la population au niveau global pour lutter contre ou
atténuer les effets néfastes du réchauffement climatique.
La RDC étant une composante du système international qui doit
connaître les interventions de l'ONU pour la lutte contre le
réchauffement climatique, constitue un système de par
l'interdépendance de ses provinces.
29Barrea, J., Théories
des Relations Internationales, Bruxelles, Cinco editor, 1978 cité
par Ngoie Tshibambe, G., Cours des Relations Internationales 1
(Introduction), G1 R.I., U.O.B., 2009-2010, Inédit, p.26. ; Kadony
Nguway, K., Op.cit., 2007, pp.30-35 ; Munenge Mudage, F.,
Séminaire de Méthodologie en Relations Internationales,
L1 RI, UOB, 2012-2013, pp.8-10, Inédit.
[30 ]
| 


