2.1.2 Des offres de l'Etat qui basculent d'un
extrême à un
autre
La deuxième raison de la naissance des transports
alternatifs se rapporte à la situation des offres publiques formelles
dans les villes-capitales. En effet, après un timide démarrage
pendant les périodes des indépendances, les modèles de
transport public se sont emballés dans la plupart des Etats en
développement au cours de la période 1970-1980. Selon les
différents schémas adoptés, on note une
variété de modèles de transports urbains. Sur ce plan, les
situations des transports urbains des agglomérations de Dakar et de
Brazzaville apparaissent tout à fait similaires à celle de la
ville d'Abidjan. D'abord, parce que dans ces trois capitales, on retrouve la
même prétention au monopole de l'offre de l'Etat. Ensuite, les
réponses apportées relèvent de principes identiques.
En effet, dans ces trois villes-capitales, les offres de
transport urbain étaient caractérisées au départ
par une option de monopole de sociétés publiques, mais avec le
temps, elles ont toutes glissé vers un schéma de cohabitation,
puis d'alternance, voire même de domination totale des offres dites
informelles. À Abidjan, si la SOTRA subsiste toujours, on remarque
toutefois que le secteur des transports urbains est largement dominé par
le secteur privé dit informel qui représente environ plus de 65%
du marché des offres de transports collectifs de la ville (AGETU 2007),
(voir graphique suivant).
209
Graphique 3 : Part des différents modes de
transport à Yopougon
(Abidjan)
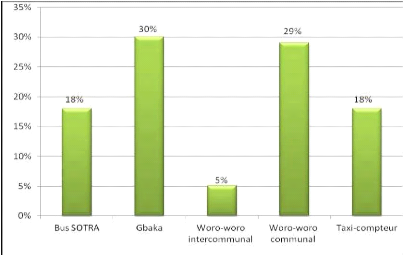
Source: AGETU-DEP/Service Etudes et Prospective,
2007
À mesure que l'économie des villes se
dégrade sous les effets de la crise, les gbaka et les woro-woro pour
Abidjan, les «foula-foula» et les «taxis 100-100» à
Brazzaville, les «cars rapides» ou autres «ndiaga
ndiaye» de Dakar qui avaient été interdits
précédemment réapparaissent, se multiplient et se
généralisent pour se positionner comme un transport de
substitution sous l'égide des autorités officielles qui tentent
de les organiser. À défaut de pouvoir apporter des
réponses adéquates à la demande sociale de
mobilité, les autorités publiques tolèrent les initiatives
locales de mobilités, autrefois combattues.
En près de cinquante ans, la SOTRA (1960) à
Abidjan, la RTS à Dakar (1962) et la RMTB (1963) à Brazzaville
sont passées d'une situation de pure forme d'exclusion des modes
hérités de la période coloniale à une situation
de
99 Étude régionale sur l'organisation, le
financement et la rentabilité des micro-entreprises de transport urbain
en Afrique subsaharienne Tome IV: Le cas de Harare.
210
cohabitation ou de domination des modes dits informels. On
observe la même situation à Harare, au Zimbabwe avec la Zimbabwe
United Passenger Company (ZUPCO). En effet, selon une étude de la Banque
mondiale99, du temps de son monopole légal (avant 1988), la
ZUPCO rentabilisait bien son contrat dans son périmètre de
franchise. Mais après, elle a été fortement
concurrencée par les nombreuses unités du secteur informel (les
emergency taxis et les commuter buses), qui l'ont jetée dans une
période de déclin (BM 2001). Pour ce qui est des villes comme
Lima au Pérou, Cotonou au Bénin selon (Haeringer 1986; Noukpo and
Agossou 2004), on parlera d'acceptation totale de l'initiative privée
assortie d'une volonté de régulation de l'Etat à travers
une affectation des itinéraires par une
coopération/négociation. À Kinshasa au
Congo, il y prévaut une situation de complémentarité de
fait entre public et privé quand, à Santiago au Chili, on tend
vers une situation de privatisation complète des transports urbains
(Haeringer 1986).
À partir des exemples de ces quelques villes, on peut
retenir que dans pratiquement toutes les villes-capitales, la
nécessité urgente de mettre en place un système de
transport public pour permettre le déplacement des populations, s'est
manifestée souvent très tôt avec les indépendances.
Les États s'étaient employés à créer des
régies et sociétés paraétatiques de grands bus
selon la définition moderne mais surtout occidentale du transport
public. Mais le piège classique de la croissance démographique
couplé à l'étalement urbain incontrôlé a fini
par faire plonger la quasi-totalité de ces entreprises publiques de
transport dans une léthargie totale. Nombre de sociétés
formelles qui ont connu des moments de gloire ont disparu. C'est dans ces
circonstances que le secteur dit informel traditionnel qui existait
déjà, mais combattu ou négligé dès les
indépendances par les autorités, prend de l'ampleur en
complément ou en concurrent ou même en remplacement des services
structurés formels. Aujourd'hui, ces modes de transport sont des
réalités communes à toutes les villes-capitales du
tiers-monde.
211
Mais, la discrimination à ce niveau repose souvent sur
la nature des moyens utilisés (véhicules motorisés, deux
roues motorisées, transports non motorisés). La mesure du
phénomène montre également des différences entre
les villes, qu'il s'agisse de l'emprise spatiale du phénomène
(transport urbain ou périurbain dans les métropoles d'Afrique,
d'Amérique latine, en Asie du Sud-est) ou surtout des populations qui
l'initient et le développent. C'est sur ce dernier point que nous
déclinons notre analyse comparative dans le paragraphe suivant pour
comprendre les similitudes et les différences entre les
différents groupes d'entrepreneurs qui sont au coeur de la dynamique
d'émergence de ces modes de transport dans les pays en
développement. Sur ce plan, la place des Malinkés en Côte
d'Ivoire et des Mourides du Sénégal, dans ces transports offre
des perspectives d'analyse intéressantes pour comprendre l'apport des
facteurs socio-culturels dans l'émergence des réponses
alternatives de mobilité.
| 


