Chapitre II : LE MILIEU PHYSIQUE ET HUMAIN
Ce chapitre traite le milieu physique et humain de la zone
d'étude. En d'autres termes il sera question ici de montrer les
différentes configurations physiques du terrain et les individus qui
constituent la population de cette partie de la République
centrafricaine.
I- LE MILIEU PHYSIQUE
1 - Le Relief
La Sous-préfecture de M'baïki est située
entre 16°20' et 18°30' de Longitude Est et entre 3°20' et
4°40' de Latitude Sud. Cette région se présente comme une
plate forme et se situe à la limite nord du grand bassin du Congo
.Cette plate forme est constituée de divers éléments
orographiques visibles sur la carte du relief de cette localité. Elle
est le témoin du vieux socle précambrien dont certains
éléments affleurent par endroit et constituent la surface
d'aplanissement que l'on observe dans cette Sous-préfecture. Les
altitudes moyennes sont constituées par les glacis cuirassés et
les collines du Nord - Est.
La Sous-préfecture de M'baïki appartient au Bassin
Versant Oubanguien et au Bassin Congolais. La topographie est en relation avec
les différentes formes géologiques .Les quartzites
présentent une topographie plus accidentée , constituée
souvent de grandes collines en pentes assez douces et ayant une forme convexe.
On y observe des plateaux entrecoupés de larges vallées souvent
marécageuses.
Les grés offrent un relief tabulaire que l'on peut
également observer dans la Sous- Préfecture de M'baîki. Un
plateau qui s'étant depuis le Village Bombekiti sur l'axe
M'baïki-Boda jusqu'à la frontière Congolaise. Il est couvert
par les grés de Carnot. Son altitude varie de 500 à 600
mètres.
C'est un site accidenté. La colline de Jean Baker
à l'entrée de la ville ( 5 km ) et la colline de Wakombo
à la sortie de la commune de M'Baïki , sur l'axe Boda et celle de
Ndala , sur les axes SCAD et M'bata ,illustrent bien cette
réalité orographique.
L'action de l'eau dans le modelé de ces collines est
essentielle, du fait que le réseau hydrographique comprend une
hiérarchie bien tranchée. Ces collines ont des sommets bien
arrondis, des versants moins accidentés. Leurs pentes sont
fréquemment convexes en leurs parties inférieures et se
raccordent brutalement au fond des vallées principales.
Au niveau de M'Baïki, ils se présentent sous forme
de hautes terres, presque des bourrelets. Les altitudes sont de l'ordre de 598
mètres à Tobalet près de Boukoko à 527
mètres à Gbokombo et à M'Baïki, 512 mètres
à Wakombo. La ville de M'Baïki à un site accidenté,
à cause d'un ensemble de quartzites qui émergent partout du
manteau d'altérites .Ces filons de quartzites ont été
mis en relief grâce à l'érosion différentielle qui a
creusé des rigoles et des ravins dans la localité de Lazaret et
à Ndéya, près de la ville de Mbaïki.
La platitude du Centre et de l'Est de la ville de M'Baïki
s'explique par la présence de la plaine alluviale de l'Oubangui. Le lac
Fonota qui se trouve entre Bouchia et Bokanga est une immense rivière.
Pendant la saison sèche ces eaux tarissent et le Lac diminue de
diamètre et de profondeur.
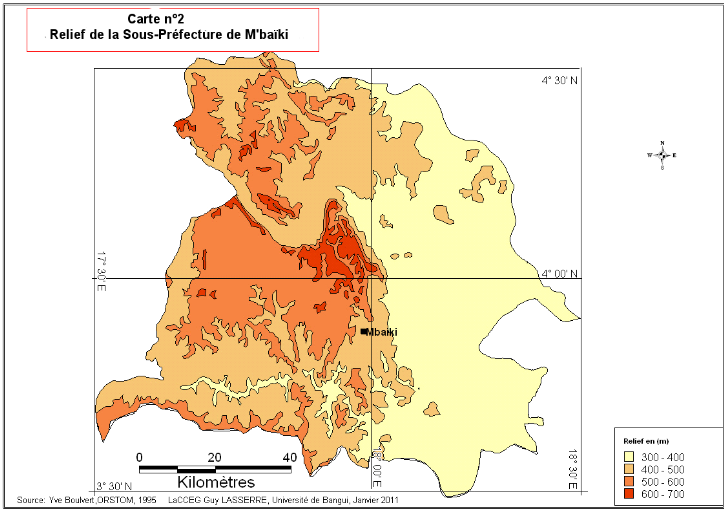
Source: LACCEG Guy LASSERE,
Université de Bangui, 2011
Des pseudo karts très réduits, avec des
dépressions fermées, s'observent aux environs des villages
Mbalé, Lobé, Bouaka et Bogayé. Les éléments
physiques
jouent un rôle de premier plan dans l'organisation de
l'espace, d'une part en raison de leurs caractères propres d'autre part
en raison de l'influence qu'ils exercent sur la répartition spatiale.
La ville de Mbaïki connaît un sérieux problème
d'urbanisation car pendant la saison pluvieuse, le travail d'érosion
est beaucoup plus prononcé.
2- Le Climat
La Sous- Préfecture de M'baïki jouit d'un climat
du type équatorial chaud et humide .Ce type de climat comprend deux
saisons: une saison des pluies caractérisées par des
précipitations abondantes qui s'étendent de mi-mars à
mi-novembre et une saison sèche plus courte que la
précédente, mi- novembre à mi - mars (J.Serre : Histoire
de la R.C.A .sd . P35). En 1986, le total des précipitations
était de 1970 mm (JB. Mboko, 1983 .p2). A la station de Boukoko
située à onze (11) kilomètres de M'Baïki on relevait
les chiffres suivants : 1448 mm de hauteur d'eau annuelle minimale et 2418 mm
d'eau maximale de pluie (JB Mboko idem .p2).
Les températures connaissent une forte variation de 25
à 28° C. L'amplitude thermique annuelle est de 20 ° C pour le
mois de février et un maxima de 23° C pour le mois d'août. Le
climat équatorial est caractérisé par des pluies qui
s'étendent pratiquement sur toute l'année. Une
pluviométrie de 1,5 à 2 mm/an et une température moyenne
de 26° C. La Préfecture de la Lobaye dans laquelle M'baïki
fait partie, connaît à chaque période de l'année des
manifestations climatiques.
Les centres d'Actions
Au point de vue géographique, la Lobaye est soumise
à trois (3) groupes de perturbations atmosphériques :
*Les vents pluvieux viennent de l'Ouest et apportent l'eau sur
les monts du Sud Cameroun ; ils donnent un temps orageux et pluvieux au
Cameroun (Douala, Yaoundé) nuageux ou brumeux en Pays Gbaya (Batouri,
Boda) et beau plus à l'Est (M'baïki et Bangui).
* En conséquent, les perturbations de l'Est de la
Lobaye apportent un temps pluvieux continu (août et septembre).
* En outre, les perturbations venant du Sud du Bassin de
Congo sont pour la plupart orageuse. Au changement de saison (mars et
novembre), certains orages éclatent '' à sec '' sans pluie.
Le vent qui souffle peut provoquer des déracinements désastreux
des arbres surtout en novembre car le sol est détrempé.
Ces deux systèmes pluvieux Sud et Est
interfèrent dans la Lobaye et les dépressions suivent les
vallées .Il est donc difficile de savoir lequel des deux centres pour
la Lobaye est prépondérante au cours de la saison des pluies
.Toutes les perturbations sont dirigées à partir de la Sainte
Hélène centre d'action Sud et celui de Libye au Nord. Le premier
donne les vents d'Ouest avec un ciel peu nuageux et du beau temps. Il se fait
sentir durant toute la saison sèche et sporadiquement en saison des
pluies. L'action combinée de l'anticyclone de Sainte
Hélène et celui de Libye (tous deux périodiques)
déterminent le passage des perturbations atmosphériques jusque
dans la Lobaye et aussi les saisons sèches et humides.
3- Le Sol et la Végétation
Dans la Sous-préfecture de M'baïki, les types de
sols sont différenciés par la couleur et la texture, indiquant le
taux et la nature de l'humus, par l'évolution latéritique et par
le sous sol sous-jacent ou alluvial. Partout ailleurs, on retrouve les sols
férralitiques appauvris avec des intrusions de sols hydro morphes;
(KAKPEKALA Edgard, 1998). Ils présentent un profil bien
développé, profond permettant une bonne pénétration
radiculaire. Leur texture sableuse en surface devient argile en profondeur.
Leur couleur devient brun ocre et rouge sur le plateau.
Dans les vallées, ils sont gris à gris beige
avec des tâches d'oxydoréduction. On trouve ces sols dans la ville
de M'baïki et dans la vallée de la Lobaye.
Les sols férralitiques remaniés associés
à des sols férralitiques indurés appauvris.
Ils se caractérisent par la faible profondeur des profils,
l'apparition de l'horizon égravillonnais à de faible profondeur
et l'induration de l'horizon égravillonnai. Ces sols sont
observés au niveau de la périphérie à savoir: la
commune de Pissa et quelques villages de M'baïki centre (Ndéya,
Zanga, etc...).
Au niveau du centre de la ville de M'baïki, le plateau de
« Ouambangana » a une grande influence sur la
formation des sols par la grande manifestation d'érosion où
lorsqu'il pleut, toute la quantité de pluie ruisselle vers les ruisseaux
et les marigots laissant apparaître ces différents types de sols
que sont :
- au sommet des collines on trouve des sols rocailleux
constitués des éléments détritiques arrachés
de plateau « Ouambangana » par le travail de
l'érosion.
- au fur et à mesure que l'on descende, on trouve des
sols férralitiques. Ces sols sont généralement
vulnérables à l'action de l'érosion.
Lorsqu'on descende vers les ruisseaux et les marigots, on est
en présence des sols
hydro morphes. Le climat et le sol influencent la
végétation.
La localité de M'baïki est à la limite
même de la grande forêt équatoriale et de la savane. Sous
l'influence de la culture, des clairières se dessinent, s'anastomosent,
puis donnent naissance à des savanes de plus en plus vastes dès
que l'on s'éloigne vers le Nord. Dans cette zone en damier, la
forêt prédomine sur la savane au Sud et c'est là que se
regroupe la population car les cultures se font uniquement sur
défrichement forestier.
Les groupements végétaux forestiers ne portent
que sur la forêt secondaire ancienne. Le long des ruisseaux et des
rivières s'allonge la « rain forest » qui
s'étend au confluent des vallées ou dans les zones assez larges.
En général, elle forme un étroit ruban de 20 à 50 m
de large dans les vallées encaissées. Jusqu'ici elle est peu
abattue sauf exception au Sud de la route M'baïki-Boda, ou s'étend
une vaste forêt couvrant les sommets et les pentes avec quelques
modifications floristiques suivant les lieux. Elle enveloppe des
vallées. C'est son habillage qui constitue chaque année la base
des terrains de cultures.
Les savanes sont circulaires ou allongées et de petites
étendues un (1) à cent (100) hectares. On peut distinguer :
- La savane à Panicum Maximum avec
Bauhinia Thonningü, Annona Senegatensis et Lophira
Alata, Hymenocardia Acida et Borassus OEthiopum: espèces
des grandes savanes à micro- climat relativement plus sec;
- La savane à Sissongo (Penisetum
Purpureum), qui occupe d'anciennes clairières
forestières.
Les groupements forestiers évoluent sous l'effet de la
culture.
4- L'Hydrographie
Le réseau hydrographique de la Sous-préfecture
de M'baïki est maigre et se caractérise par une densité de
marigots. La Lobaye, affluent droit de l'Oubangui demeure le principal cours
d'eau. Elle prend sa source dans le massif du Yadé près de Bouar.
Longue de 500 km environ, la Lobaye est encombrée au niveau de son cours
moyen de rapides. Elle se jette dans l'Oubangui au Nord de Mongoumba à
environ quatre kilomètres de Bangui, (MBALANGA. A, 1984). La Lobye est
la seule voie navigable de la région. Elle revête d'une valeur
historique et économique capitale. Historiquement, la Lobaye a servi de
voie à la pénétration coloniale et à
l'évangélisation de celle-ci et des régions voisines.
Économiquement, elle constitue
un terrain favorable pour la pêche et aussi la voie de
communication entre les populations qui longent son cours.
| 


