CHAPITRE V: SYNTHESE DES RESULTATS
ET DISCUSSION
V.1. Résultat des missions
de terrain
Les misions de terrains effectuées ont eu pour
but :
§ de vérifier si les limites des lots constituant
certains projets de regroupements, sont ouvertes ;
§ de prendre des points GPS des extrémités
des permis pour voir s'il y a concordance avec les données des
cartes.
Il ressort de ces missions, que la majorité des limites
ne sont pas ouvertes, du moins pour certains lots situés dans le Sud
Estuaire et faisant partie d'un projet de regroupement. Par ailleurs, dans les
rares cas où nous avons observé des limites ouvertes, les points
GPS relevés à certains endroits de ces limites, ne correspondent
pas à leur positionnement sur la carte. L'annexe 10 permet d'illustrer
ce contraste qui existe entre les données des cartes et la
réalité sur le terrain.
V.2. Synthèse du
procédé d'élaboration de l'actuel fichier des permis du
MEFEPA
L'actuel fichier cartographique du MEFEPA qui sert de
référence en matière de gestion de l'espace foncier
attribué aux concessionnaires forestiers, est aujourd'hui source de
nombreuses difficultés. Des maux dont nous avons voulu connaître
l'origine et surtout ressortir les conséquences y relatives. C'est dans
cette optique qu'a eu lieu, l'entretien avec le service cartographie du
MEFEPA (annexe 3) et dont la teneur est ci-dessous donnée.
En ce qui concerne les outils de travail, que le service
cartographie utilise, il y a le logiciel MapInfo choisi (par rapport
à Arcview) et utilisé depuis fort longtemps, vu que c'est le
même qu'utilisait l'INC quand il positionnait encore les permis
forestiers. Raison donc d'harmonisation. Aujourd'hui le service cartographie
travaille également avec le logiciel Arcgis dont la licence a
été octroyée par le WRI. Mais les études relatives
aux textes d'attribution à valider se font encore sous MapInfo.
Actuellement le datum utilisé est le WGS84 et la projection est
l'UTM.
Pour les fonds cartographiques de référence, le
service cartographie fait usage aussi bien des fonds rasters que vectoriels au
1/200 000, même s'il faut reconnaître que certains d'entre eux
n'existaient pas avant. Toujours dans le souci de se conformer à ce qui
était fait avant, l'échelle de digitalisation est le 1/200 000,
et cette digitalisation se fait aujourd'hui à l'écran et non plus
sur table à digitaliser. Pour le calcul des surfaces il est fait en mode
cartésien.
Certains permis sont définis à partir d'une
confluence de cours d'eaux parce que les confluences sont naturelles et moins
soumises à de quelconques influences anthropiques, contrairement aux
bornes géodésiques qui peuvent être déplacées
par les populations. Le choix de l'origine d'un permis n'obéit pas
à un critère spécifique, tout dépend de la
proximité soit de la confluence de cours d'eau, soit de la borne
géodésique.
Concernant les moyens humains, le service cartographie
dispose de compétences et n'a besoin aujourd'hui que de 2
ingénieurs de techniques biens formés.
Dans le cadre des prochaines adjudications le service
cartographie a utilisé une méthode inverse à ce qui se
faisait auparavant. Ainsi, la délimitation des permis s'est
effectuée de la manière suivante:
§ segmentation (choix) des lots;
§ définition sur MapInfo et Arcgis;
§ impression;
Par contre lorsque la demande de permis venait du futur
titulaire et ce avant 2002, le positionnement des permis se faisait à
l'INC. En fait, on dessinait le permis sur un papier calque en utilisant un
support de carte au 1/200 000. Par la suite, on encadrait le polygone
dessiné par les quatre (4) croisillons les plus proches. On
scannait le calque et on l'enregistrait au format image. Ensuite, sur MapInfo
où il était importé, le permis était calé
suivant les coordonnées en longitude/latitude des croisillons puis
digitalisation du polygone. La définition du texte d'attribution qui
avait lieu au Ministère se faisait à l'aide d'une règle et
d'un rapporteur.
Pour l'aspect de mise à jour du fichier actuel de
permis, il faut dire que le fichier est le même depuis longtemps, mais ce
sont les permis qui sont juste ajoutés ou retirés (quand il y a
retour aux domaines par exemple). Néanmoins, un travail de
redéfinition de tous les PI a été initié, mais ce
dernier demeure toujours sans suite du fait des longues procédures
administratives.
Concernant les litiges entres titulaires, il faut dire qu'ils
peuvent être liés à deux types de faits: soit le
chevauchement (une partie du permis se trouve dans un autre), soit la
superposition (lorsqu'un permis est complètement défini
à l'intérieur d'un autre) de permis. Mais la
réalité c'est que la plupart des exploitants n'ont jamais ouvert
les limites et par conséquent ne peuvent pas savoir si leur permis
chevauche avec un autre ou pas. Cependant, lorsque c'est le cas, la
procédure est la suivante:
1. saisie de l'administration forestière par un des
titulaires des permis litigieux;
2. vérification des limites et superficies de chacun
des permis mis en cause par le service de la cartographie;
3. diminution de la superficie du permis le plus grand. En
effet, on n'augmente jamais la superficie du plus petit permis à pareil
situation;
4. Au cas où les superficies des permis litigieux sont
égales, on regarde alors l'antériorité (savoir lequel
a été attribué avant l'autre) des permis.
V.3. Synthèse de l'entrevue avec
l'INC.
La rencontre avec
l'Institut National de Cartographie était principalement axée sur
les Bases de Données topographiques. En effet, il n'existait que les
fonds rasters auparavant, en Clarke1880. Mais lors du Projet Forêt et
Environnement, il y a eu nécessité de données
vectorielles pour mieux assoir la stratification forestière.
La Base de Données
vectorielles (version 1) a été obtenue à partir des
images radars et des couches d'altimétrie (courbes de niveau et
points cotés), puis complétée par des informations de
terrain (villages, villes...).
Les logiciels utilisés étaient
Geoview (pour le traitement d'images et l'assemblage des coupures) et
Freehand (pour le dessin). Ensuite, les données ont
été mises au format « dxf » permettant le
passage vers MapInfo et Arcview.
La différence entre
la Base de Données Vectorielles version 1 (BD V1) et la BD V2 vient
essentiellement du fait que la dernière citée a été
densifiée en réseau hydrographique (hydro secondaire et
tertiaire) en utilisant les fonds rasters recalés. En effet, la BD V1
répond surtout aux besoins du PFE avec une densité hydrographique
au 1/1000 000. Par contre, la BD V2 est densifiée au 1/200 000.
Pour ce qui est du
décalage entre bornes, il faut d'abord dire que sur les fonds rasters,
on a des bornes astronomiques, alors que les bornes géodésiques
sur les fonds vectoriels ont été obtenues à partir des
points GPS et sont plus précises. En outre, plus la borne astronomique
est loin par rapport au premier point de définition d'un permis
forestier, moins la précision (en termes de position) de ce dernier
est bonne.
V.4. Fiabilité
des variables étudiées et des méthodes de positionnement
des permis forestiers.
V.4.1. Les variables
Cette synthèse ne reprend nullement les
interprétations déjà faites plus haut, mais s'atèle
plutôt à étayer ces dernières en vu de
déterminer les variables fiables pour les travaux liés à
la cartographie forestière et particulièrement la
définition des limites de permis. Pour ce qui concerne la variable
projection, l'étude n'a pas eu uniquement pour but, de rechercher
celle dont les superficies seraient proches des superficies textes, mais
à la rigueur savoir la projection la plus fiable. Et cette
fiabilité rime avec :
§ adaptabilité par rapport à
l'évolution technologique et à la nature des
besoins ;
§ réduction des
irrégularités (distorsions et autres types
d'altérations liées aux projections) ;
§ niveau de précision plus adéquat quant
aux travaux cartographiques réalisés à l'échelle
nationale ;
§ suppression des aléas dus aux fuseaux
géographiques;
§ réduction des disparités entre
superficies des entités géographiques selon qu'elles sont
situées au Nord ou au Sud de l'équateur.
Aujourd'hui la projection ayant tous ces atouts à la
fois, est le GTM qui doit ainsi faire l'objet d'une utilisation
récurrente dans les différents projets cartographiques
initiés par les acteurs de la gestion forestière à
l'échelle nationale. En effet, contrairement à ce que de nombreux
adeptes de la cartographie pensent, l'UTM est encore beaucoup utilisé.
Ce qui pose évidemment un problème d'harmonisation de
données si on s'en tient uniquement aux projections.
Pour les échelles de digitalisation, le 1/25 000
est nettement plus précis par rapport aux autres échelles
ayant servies à cette étude. En effet, de ce qui est de la
digitalisation sur écran, la probabilité de commettre des erreurs
est relativement faible au 1/25 000, vu qu'on est presqu'au seuil de
discernement des pixels.
Concernant les fonds cartographiques, il est mieux
aujourd'hui de travailler avec les fonds vectoriels, du moins pour ce qui
concerne la délimitation des permis forestiers. Et ce pour des raisons
purement pratiques telles que :
§ l'utilisation de l'information utile pour le
cartographe (les fonds rasters étant le plus souvent
surchargés) ;
§ la densité et la précision du
réseau hydrographique notamment dans la BD V2 ;
§ la légèreté des fichiers par
rapport au raster ;
§ l'existence des données sur tout le territoire
national contrairement à la BD raster.
V.4.2.
Les méthodes de positionnement de permis.
Il s'agit ici de dire la méthode de positionnement des
permis qui présente moins d'erreurs et par conséquent la plus
précise possible. Le positionnement des permis tel qu'il était
pratiqué avant (lorsque la demande venait du titulaire), faisait
intervenir des biais à plusieurs niveaux :
§ d'abord lors du scan du permis, où la
résolution du scanner avait une grande influence sur le calcul des
superficies. En effet, plus la résolution était grande, plus la
précision à la digitalisation était bonne. Aussi, les
superficies avaient tendance à être
élevées ;
§ sur la table à dessin, il pouvait aussi avoir
une erreur d'appréciation liée à la lecture du rapporteur
(erreur de parallaxe) pour la détermination des angles;
§ au niveau du calcul de la superficie survenait un autre
niveau d'erreur, car les superficies étaient obtenues à la main,
par triangulation du lot faite sur le scan, tel qu'illustré dans la
figure suivante.
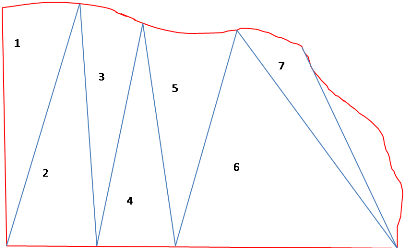
Figure 25: Exemple de triangulation
pour le calcul de la superficie d'un permis.
A ces erreurs s'ajoutent les pressions de l'environnement
extérieur. En effet, bien que les faits mentionnés ci-dessus
soient assez problématiques, mais peut être justifiables quant
aux techniques utilisées à l'époque; beaucoup de permis
attribués n'ont pas suivis ou ne suivent toujours pas les
procédures d'instructions de dossiers conformes.
En outre certaines différences peuvent résulter
du fait que c'est le service cartographie qui instruit les définitions
alors que c'est une autre direction qui les saisit dans les textes
d'attributions.
La méthode par triangulation biaisait le calcul lorsque
le polygone n'avait pas une forme géométrique
parfaite (rectangle, carré, trapèze, triangle...), car les
arcs étaient extrapolés en segments (triangles 1,3,5,7). Par
ailleurs, il pouvait avoir des petites parties non prises en compte dans le
calcul.
Aujourd'hui, le dessin se fait directement à
l'écran et la superficie est obtenue automatiquement en double-cliquant
sur le polygone. Les paramètres à surveiller étant
évidemment l'échelle de travail et la projection du fond
cartographique sur lequel est positionné le lot. En outre, l'erreur
commise est négligeable, car les distances entre deux points et l'angle
d'orientation sont obtenus à partir d'outils appropriés dans
MapInfo. L'autre avantage de la méthode actuelle est qu'on peut
décider d'attribuer des permis à géométrie unique
(mais n'ayant pas de côté à digitaliser) et donc de
même superficie pour toute une région par exemple.
| 


