CHAPITRE 3. RESULTATS
Les résultats de la population d'étude (n=504)
concernaient la morbidité et la mortalité
hospitalière ; le taux d'exhaustivité (réponse)
étant de 90% (504/560 : 56 dossiers exclus).
3.1. Morbidité
Ce volet a analysé les dossiers de 252 patients (sous
groupe de la population d'étude) dont 126 drépanocytaires
SS (63 de sexe M et 63 de sexe F) et 126 témoins AA (63 sexe M
et 63 de sexe F). L'age moyen était de 10,1#177;5,5 ans (extrêmes
1 an et 20 ans ; médiane :10 ans).
3.1.1. Données
anamnestiques
Le nombre moyen de transfusion sanguine
bénéficié par 236 patients était de 35 #177; 6
transfusions (extrême 1 et 34 transfusions sanguines).
Ces 236 patients sont repartis selon le groupe de transfusion
sanguine dans la figure1.
n= 72 = 63
=45 =56
Groupe de transfusion
Effectif
%

Figure 1. Répartition de 236 patients selon les groupes de
nombre de transfusions sanguines.
3.1.2. Données
hématologiques
Le tableau 1 résume les valeurs moyennes de l'Hb, des
GB, des neutrophiles et des lymphocytes selon l'hémogramme
réalisé à l'admission.
Tableau 1. Données hématologiques
à l'admission dans la population d'étude
|
Variables
|
Moyennes #177; ET
|
Extrêmes
|
|
Hémoglobine (g%)
|
7,9 #177; 2,4
|
2,2 - 15,6
|
|
Globules blancs (éléments/mm3)
|
13123 #177; 8351
|
2800 - 84000
|
|
Neutrophiles (%)
|
58,7 #177; 17,3
|
6 - 90
|
|
Lymphocytes (%)
|
39,7 #177; 17
|
8 - 94
|
3.1.3. Tableau clinique
Le tableau relatif à la phase critique comprenait
différentes entités morbides propres à la
drépanocytose homozygote : crise vaso-occlusive
ostéoarticulaire chez 80 patients, crise hyperhémolytique chez 60
patients, crise abdominale chez 15 patients , syndrome mains pieds chez 9
patients ,syndrome thoracique aigu chez 8 patients, accident vasculaire
cérébral chez 5 patients.
Le tableau clinique était caractérisé par
les infections et affections accompagnant la phase critique des
drépanocytaires SS et l'hospitalisation des témoins AA .
Principalement le paludisme simple et compliqué (n=150),le sepsis(n=42),
la fièvre au long cours (n=39), la bronchopneumonie (n=34), la
pneumonie(n=30), la méningite (n=17), l'infection urinaire (n=17) ,la
tuberculose (n=15), l'ostéomyélite (n=15), la bronchite (n=13),
l'entérite fébrile (n=10), la fièvre thyphoide (n=10),
l'insuffisance cardiaque (n=10) et l'hépatite virale (n=8).
3.1.4. Globules blancs et
morbidité
3.1.4.1. Variations des globules
blancs
3.1.4.1.1. Moyennes des globules
blancs
Les taux sanguins des GB variaient de manière
très significative (ANOVA, test de Kruskall-Wallis ;p< 0,00001)
entre les différents types de morbidité ; le taux le plus
élevé étant observe chez les drépanocytaires
homozygotes SS en phase critique, le taux intermédiaire chez les
drépanocytaires SS en phase intercritique, et le taux le plus bas chez
les témoins AA (Figure2).
GB/mm3

Figure 2. Variations très inégales
des taux sanguins des globules blancs entre les différents groupes des
patients.
3.1.4.1.2. Quartiles des globules
blancs et types de morbidité
Les pourcentages des patients drépanocytaires en phase
critique augmentaient de manière très significative(p<0,00001)
du Quartile I au Quartile IV des GB (présence d'un gradient biologique)
(Figure3).
QI
QII QIII
QIV
SS en phase critique
%
Quartiles des GB/mm3

Figure 3. Relation effet-dose dépendant
entre les proportions des drépanocytaires SS en phase critique et les
taux sanguins des globules blancs.
Il existait une variation inégale mais très
significative (p<0,00001 sans effet dose dépendant) des pourcentages
des drépanocytaires SS en phase post critique entre les
différents Quartiles des globules blancs (Figure 4).
Quartiles des GB/mm3
QI
QII QIII
QIV
SS en phase post critique critique
%
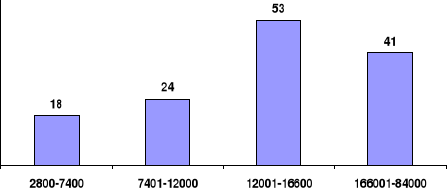
Figure 4. Variations inégales des
proportions des drépanocytaires SS en phase post-critique entre les
quartiles des globules blancs.
Par contre, les proportions des témoins AA diminuaient
très significativement (p<0,00001 avec relation inverse ou
négative) du Quartile I au Quartile IV des Globules blancs (Figure5).
Témoins AA
Quartiles des GB/mm3
QI
QII QIII
QIV
%
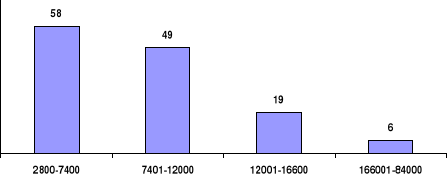
Figure 5. Relation inversement proportionnelle
entre la répartition des témoins AA et les Quartiles des globules
blancs.
3.1.4.1.3. Manifestations
critiques et Quartiles des globules blancs
Il y avait respectivement plus des cas de syndrome mains pieds
et des crises abdominales (Figure 6) dans les groupes Quartiles III et IV que
dans les groupes Quartiles I et II : variations significatives (p<0,05)
des cas des syndromes mains pieds entre les Quartiles des globules blancs et
variations très significatives (p<0,0001) des cas de crises
abdominales entre les Quartiles.
Quartiles des GB
%
Effectif

Figure 6. Répartition des cas de syndrome
mains-pieds ( ) et de crises abdominales ( ) entre les Quartiles
des globules blancs.
Les proportions des cas d'AVC, de Syndrome thoracique aigu, de
crise hyperhémolytique ne variaient pas (p>0,05) et de manière
respective entre les Quartiles des globules blancs (résultats non
présentés).
Par contre il était observé une augmentation
directement proportionnelle et de manière respective des cas des crises
vaso-occlusives (p<0,01) et des crises hyperhémolytiques (p<0,01)
(Figure 7).
Quartiles des GB
Effectif
%
%
Effectif

Figure 7. Relation respective avec effet-dose
dépendant entre les crises vaso-occlusives ( ), les crises
hyperhémolytiques ( ) et les Quartiles des globules blancs.
3.1.4.2. Infections
bactériennes et sepsis
Les taux de méningite, de sepsis, de pneumonie,
d'ostéomyélite, d'hépatite, d'infection urinaire et
neuropaludisme ne montraient aucune variation significative (p>0,05) et
respectivement entre les différents Quartiles des GB au sein de la
population totale (résultats non présentés).
3.1.4.3. Paludisme,
sévérité de la drépanocytose et globules blancs.
Chez les drépanocytaires SS toutes phases confondues,
une relation curvilinéaire en forme de U et significative (p<0,05)
était démontrée entre le taux de paludisme grave et les
Quartiles des GB (Figure8).
Quartiles des GB/mm3
QI
QII QIII
QIV
Paludisme grave
%

Figure 8. Relation en U entre le paludisme
grave et les quartiles des globules blancs chez les drépanocytaires SS
toutes phases confondues.
Mais la relation linéaire était négative
et très significative (p<0,001) entre le taux de paludisme grave et
le taux sanguin des globules blancs chez les témoins AA (Figure 9).
Quartiles des GB/mm3
QI
QII QIII
QIV
Paludisme grave
%

Figure 9. Relation inversement
proportionnelle entre les taux de paludisme grave et les taux sanguins des
globules blancs chez les témoins AA.
Il y avait respectivement moins de cas de paludisme grave chez
les drépanocytaires SS en phase critique que chez les
drépanocytaires SS en phase post critique (p <0,001) et chez les
témoins AA (p<0,0001) ; les taux de paludisme grave des
témoins et des drépanocytaires SS en phase critique étant
identiques (p>0,05) (Figure 10).
NS
p<0,00001
p<0,001
Paludisme grave
%
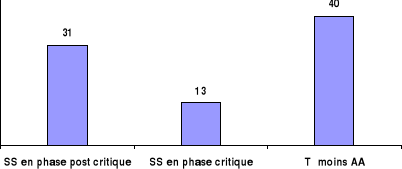
Figure 10. Comparaison des taux de paludisme
grave par types de morbidité.
Les taux de paludisme grave des drépanocytaires en
phase critique et des drépanocytaires SS en phase post critique
étaient respectivement identiques (p>0,05) aux Quartiles I - III des
GB ; mais il y avait moins des cas (p<0,01) de paludisme grave chez
les drépanocytaires SS en phase critique que les drépanocytaires
SS en phase post critique au Quartile IV des GB (Tableau 2).
Tableau 2. Taux de paludisme grave selon la
phase de la drépanocytose SS et les quartiles des globules blancs.
|
Quartiles des globules
blancs/mm3
|
SS en phase critique
%
|
SS en phase post-critique
%
|
p
|
|
QI 2800 - 7400
|
22
|
41
|
NS
|
|
QII 7401 - 12000
|
0
|
14
|
NS
|
|
QIII 12001 - 16600
|
12
|
29
|
NS
|
|
QIV 16601 - 84000
|
17
|
41
|
<0,01
|
Quelque soit les Quartiles des globules blancs
considérés, les drépanocytaires SS en phase critique
souffraient moins (p<0,05 et p<0,01) de paludisme grave que les
témoins AA (Tableau 3).
Tableau 3. Taux de paludisme grave des
drépanocytaires SS en phase critique et des témoins AA selon les
quartiles des globules blancs.
|
Quartiles des globules
blancs/mm3
|
SS en phase critique
%
|
Témoins AA
%
|
p
|
|
QI 2800 - 7400
|
22
|
46
|
<0,05
|
|
QII 7401 - 12000
|
0
|
28
|
<0,01
|
|
QIII 12001 - 16600
|
12
|
41
|
<0,05
|
|
QIV 16601 - 84000
|
17
|
60
|
<0,05
|
Ainsi la protection très significative des
drépanocytaires SS en phase critique vis-à-vis du paludisme
était plus élevée, plus forte en comparaison avec les
témoins AA( p<0,00001) qu'en comparaison avec les
drépanocytaires SS en phase post critique(p<0,0001) (Figure 11).
Risque élevé
Protection ou moindre risque
SS en phase critique versus SS en phase post-critique
SS en phase critique versus Témoins AA
0,41
0,22
0 0,12 0,17 0,33 0,62
OR avec
IC95%
1
Référence
Pas de risque
Figure 11. Protection des
drépanocytaires SS en phase critique vis-à-vis du paludisme.
Cette protection des drépanocytaires SS en phase
critique vis-à-vis du paludisme grave et en comparaison avec les
témoins AA, augmentait très significativement avec l'augmentation
des taux sanguins des GB (Figure 12).
Risque élevé
Protection ou moindre risque
Quartile IV 16601 - 84000
0,14(0,02 - 0,9)
Quartile III 12001 - 16600
0,20 (0,03-0,90)
Quartile II GB 7401 - 12000
0 (0 - 0,38)
Quartile I Gb 2800 - 7400
0,32 (0,10 à 0,97)
0 1 OR
Référence (IC95%)
Figure 12. Influence de l'augmentation des
taux sanguins des globules blancs sur la protection des drépanocytaires
SS en phase critique vis-à-vis du palud isme grave en comparaison avec
les témoins AA.
3.1.4.4. Infections, sepsis et
globules blancs
3.1.4.4.1. Drépanocytaires
en phase critique versus drépanocytaires en phase post critique
Les taux de pneumonie de bronchopneumonie de tuberculose
pulmonaire et de fièvre typhoïde étaient identiques
(p>0,05) entre les drépanocytaires SS en phase critique et les
drépanocytaires SS en phase post critique (résultats non
présentés).
Par contre, il y avait plus des cas de sepsis, de
méningite aigue, d'entérite fébrile et moins d'infection
urinaire chez les drépanocytaires SS en phase critique que chez les
drépanocytaires SS en phase post critique (Tableau 4).
Tableau 4. Sepsis, méningite
aiguë, entérite fébrile et infection urinaire selon la
phase de la drépanocytose SS.
|
Variables
|
SS en phase critique
n (%)
|
SS en phase post-critique
n (%)
|
p
|
|
Sepsis
|
31 (24,6)
|
14 (11,1)
|
<0,01
|
|
Méningite aiguë
|
9 (7,1)
|
0 (0)
|
<0,01
|
|
Entérite fébrile
|
5 (5)
|
0 (0)
|
<0,05
|
|
Infection urinaire
|
1 (1)
|
12 (12)
|
<0,001
|
3.1.4.4.2. Drépanocytaires SS en phase critique versus
témoins AA
Comparés aux témoins AA, les
drépanocytaires SS en phase critique présentaient autant de cas
de méningite aiguë, d'hépatite aigue virale, de
bronchopneumonie, d'entérite fébrile, de tuberculose pulmonaire
(résultats non présentés), mais plus de cas de sepsis,
d'ostéomyélite, de pneumonie et moins de cas d'infection urinaire
(Tableau 5).
Tableau 5. Sepsis,
ostéomyélite et infection urinaire chez les
drépanocytaires SS en phase critique et les témoins AA.
|
Variables
|
SS en phase critique
n (%)
|
Témoins AA
n (%)
|
p
|
|
Sepsis
|
22 (17,5)
|
2 (1,6)
|
<0,0001
|
|
Ostéomyélite
|
7 (5,6)
|
0 (0)
|
<0,01
|
|
Infection urinaire
|
1 (1)
|
9 (8,9)
|
<0,01
|
|
Pneumonie
|
32 (25,4)
|
6 (4,8)
|
<0,00001
|
3.1.4.4.3. Drépanocytaire
SS en phase post critique versus témoins AA
Les drépanocytaire SS en phase post critique
(intercritique) et les témoins AA présentaient des taux
identiques (p>0,05) des méningites aiguës, de pneumonie, de
sepsis, de broncho-pneumonie, d'entérite fébrile, d'infection
urinaire, de tuberculose pulmonaire et de fièvre typhoïde
(résultats non présentés).
3.1.4.4.4. Influence des
globules blancs sur la susceptibilité aux sepsis
ostéomyélite , pneumonie et infection urinaire
En considérant les Quartiles des GB, les variations du
taux de sepsis entre les différents types de morbidité
était seulement significative (p<0,05) au regard du Quartile I des GB
(le taux le plus bas), le taux de sepsis montrant une variation égale
entre les différents types de morbidité au regard des Quartiles
II- Quartile IV (Tableau 6).
Tableau 6. Diminution des globules blancs et
susceptibilité au sepsis chez les drépanocytaires SS en phase
critique
|
Quartiles des globules
blancs/mm3
|
SS en phase critique
%
|
SS en phase
postcritique
%
|
Témoins AA
%
|
p
|
|
QI 2800 - 7400
|
22
|
6
|
4
|
<0,05
|
|
QII 7401 - 12000
|
20
|
14
|
7
|
NS
|
|
QIII 12001 - 16600
|
27
|
10
|
6
|
NS
|
|
QIV 16601 - 84000
|
28
|
14
|
20
|
NS
|
L'augmentation des GB ne montrait pas de différence
significative sur les variations respectives des taux
d'ostéomyélite pneumonie et d'infection urinaire entre les
différents types de morbidité (résultats non
présentés).
Comparés respectivement aux drépanocytaires SS
en phase intercritique et aux témoins AA, les drépanocytaires SS
en phase critique présentaient un risque élevé ou une
protection moindre devant ces différentes affections avant et
après stratification avec les groupes des globules blancs (Tableau 7) et
(tableau 8).
Tableau 7. SS en phase critique versus SS en
phase intercritique : susceptibilité aux infections
|
Risque ou protection devant les affections
|
OR
(IC95%)
sans pondération
|
OR
(IC95%)
pondéré avec groupes des globules
blancs
|
|
Fièvre au long cours
|
13,3****
(4,3 - 56,2)
|
12,5****
(3,6 - 43,4)
|
|
Pneumonie
|
0,7
(0,4 - 1,1)
|
|
|
Paludisme compliqué
|
0,3***
(0,2 - 0,7)
|
0,3***
(0,2 - 0,6)
|
|
Sepsis
|
2,6**
(1,3 - 5,3)
|
2,6**
|
Tableau 8. Susceptibilité des SS en
phase critique versus Témoins AA
|
Risque ou protection de
|
OR
(IC95%)
sans pondération
|
OR
(IC95%)
pondéré avec groupes des globules
blancs
|
|
Pneumonie
|
6,8****
(2,8 - 18,4)
|
6,95****
(2,6 - 18,4)
|
|
Fièvre au long cours
|
13,3****
(4,3 - 56,2)
|
18****
(4,8 - 67,9)
|
|
Paludisme compliqué
|
0,2****
(0,1 - 0,4)
|
0,16****
(0,1 - 0,4)
|
|
Sepsis
|
5,5****
(2,4 - 14,1)
|
4,4****
(1,8 - 11,9)
|
|
Méningite
|
1,1
(0,4 - 3,2)
|
|
|
Neuropaludisme
|
0,12***
(0,02 - 0,5)
|
|
3.1.4.5. Hémoglobine,
anémies et globules blancs
Il existait une relation négative significative entre
les taux sanguins des GB et d'Hb chez les témoins AA (r=-0,264 ;
p<0,05). Mais il n'existait aucune relation significative( p<0,05) entre
les taux sanguins des GB et d'Hb chez les drépanocytaires SS tant en
phase critique qu'en phase post critique stable.
Au regard des Quartiles I et II des GB, le taux
d'anémie était identique (p>0,05) entre les différents
types de morbidité ; mais au Quartile III des GB, le taux
d'anémie était le plus élevé chez les
drépanocytaires SS en phase critique alors qu'il l'était au
Quartile IV chez les témoins AA (Tableau 9).
Tableau 9. Anémie et globules
blancs
|
Quartiles des globules
blancs/mm3
|
SS en phase critique
%
|
SS en phase
postcritique
%
|
Témoins AA
%
|
p
|
|
QI 2800 - 7400
|
17
|
6
|
7
|
NS
|
|
QII 7401 - 12000
|
20
|
5
|
7
|
NS
|
|
QIII 12001 - 16600
|
15
|
0
|
6
|
<0,01
|
|
QIV 16601 - 84000
|
19
|
0
|
20
|
<0,01
|
Chez les drépanocytaires SS en phase critique, les
anémiques et les non anémiques présentaient des taux
sanguins identiques (p>0,05) des GB. Il en était de même chez
les témoins AA (Figures 13 et 14).
NS
Anémie
GB/mm3

Figure 13. Taux sanguins de globules blancs
en présence et en absence d'anémie chez les
drépanocytaires SS en phase critique.
NS
Anémie
GB/mm3

Figure 14. Taux sanguins de globules blancs
en présence et en absence d'anémie chez les témoins AA.
Par contre, chez les drépanocytaires SS en phase
postcritique et stable, le taux sanguin moyen des globules blancs des
anémiques était plus bas (p<0,05) que celui des non
anémiques (Figure 15).
p<0,05
Anémie
GB/mm3
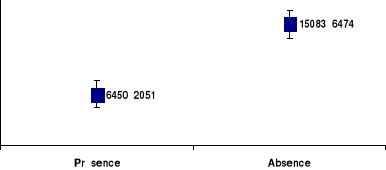
Figure 15. Taux sanguins de globules blancs
en présence et en absence d'anémie chez les
drépanocytaires SS en phase post-critique et stable.
| 


