CHAPITRE I
PRÉSENTATION DE LA RÉGION D'ÉTUDE.
1. Cadre géographique
La région de Saïda se trouve dans la zone
Nord-occidentale de l'Algérie et dans le Sud du Tel, le bassin versant
de l'Oued Saïda fait partie du grand bassin de la Macta qui s'étend
au Nord-Ouest de l'Algérie, il est formé par les monts de
Tlemcen, de Daya et de Saïda, Il est situé entre
l'extrémité des monts de Daya au Nord et la région des
hauts plateaux au Sud. Il est entouré par les monts de Daya à
l'Ouest (Sidi Ahmed Zeggai), au Sud par la montagne de Sidi-Abdelkader à
l'Est par les monts de Saïda avec entre autre le Djebel Tiffrit qui
culmine à 1200m. Le bassin versant occupe la partie Sud-Est de la Macta,
(Figure 1)

Figure 1 : Situation du bassin versant de
l'Oued Saïda (ABH O.C.C 2006).
Le bassin versant de Saïda prend naissance au Sud de Ain
El Hdjar où il est alimenté par l'Oued Tebouda (prés de
Moulay Abdelkrim), il est alimenté surtout après Saïda par
plusieurs petits Oueds sur les deux rives, tels que : Oued Tagment, Oued Bou
Hemmar, Oued Massil, Oued Nazreg.
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
7
2. Développement du réseau
hydrographique
Le réseau hydrographique est l'une des
caractéristiques les plus importantes du bassin versant, il se
définit par l'ensemble des cours d'eau naturels ou artificiels,
permanents ou temporaires, qui participent à l'écoulement. Les
facteurs principaux qui influencent le réseau hydrographique sont :
- La géologie : la lithologie de substratum qui influence
évidement sur la forme du réseau. - La pente : les pentes sont de
bons indicateurs pour la phase d'érosion ou sédimentation.
- Climat : la densité de réseau hydrographique
variée selon le climat, dense dans les régions
humides et disparaitre dans les régions
désertiques.
- Cour d'eau : Dans les zones plus élevées, les
cours d'eau participent à l'érosion de la roche sur laquelle
l'écoulement est présent. Par contre les plaines les cours d'eau
s'écoulent sur un lit où la sédimentation
prédomine.
Nous avons représenté le développement du
réseau hydrographique du bassin versant de Saïda à l'aide de
la Figure 2 ; ce qui nous a permis de procéder à l'estimation des
principaux paramètres physiographiques caractérisant le bassin
versant considéré.
2.1. Densité de drainage
La densité de drainage (Dd) est le rapport de la somme des
longueurs des cours d'eau d'un bassin versant (?L) à la superficie du
bassin (A), elle est donnée par la formule suivante :
???
Dd = ??
Où : Dd : densité de drainage
(Km/Km2).
?L : la somme des longueurs des cours d'eau (Km). A : la surface
du bassin versant (Km2).
La densité du bassin étudié est environ de
2.29 Km/Km2.
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
8
2.2. Rapport de confluence
Le rapport de confluence et égal au quotient du nombre
de talwegs du même ordre par celui des talwegs d'ordre supérieur,
il est défini par la relation suivante :
Nn
Où : Rc : rapport de confluence.
Nn : Nombre de cours d'eau d'ordre n.
Le rapport de confluence dans ce bassin est de 2.19.
2.3. Rapport des longueurs
Rapport des longueurs est calculé par la relation
suivante :
Où : RL : rapport de longueurs.
Ln : nombre des cours d'eau d'ordre n.
La valeur de rapport des longueurs du bassin versant est de 1.47.
2.4. Fréquence des cours d'eau
Fréquence des cours d'eau elle correspond au nombre de
cours d'eau par unité de surface. Elle est obtenue à partir du
rapport du nombre de cours d'eau à la surface totale du bassin. Elle est
calculée par la relation suivante :
N
Où : Fs : fréquence des cours d'eau.
N : nombre de talweg.
A : surface du bassin (Km2).
La valeur de la fréquence des cours d'eau du bassin
versant est de 0,59.
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
2.5. Coefficient de torrentialité
Coefficient de torrentialité est le produit de la
densité de drainage par la fréquence des talwegs
élémentaires :
????= ???? . F1
Où : Ct : coefficient de torrentialité.
Dd : densité de drainage.
N1
N1 : nombre des cours d'eau d'ordre 1.
A : la surface du bassin versant.
Le coefficient de torrentialité de ce bassin est 1.62.
2.6. Temps de concentration
Temps de concentration c'est le temps que met une particule d'eau
provenant de la partie du bassin la plus éloignée pour parvenir
à l'exutoire, il se calcule par la formule suivante :
4(A + 1.5??)
1
0.8(???????? - ????????) 2
1
2
Tc=
9
Où : Tc : temps de concentration (heure).
A : superficie du bassin versant (km2).
L : longueur du cours d'eau principal (km).
Hmoy : altitude moyenne du bassin versant.
Hmin : altitude minimale du bassin versant.
Le temps de concentration de ce bassin est de 7h28mn.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
10
Figure 2 : Réseau hydrographique du
bassin versant de Saïda. (ANRH) 3. Caractéristiques
morpho-métriques
Les caractéristiques physiographiques d'un bassin
versant influencent fortement à sa réponse hydrologique, et
notamment le régime des écoulements en période de crue ou
d'étiage (Musset, 2005). Parmi ces caractéristiques
morphologiques :
3.1. La surface
La surface du bassin versant qui est de 522.8 km2 et
un périmètre de 151 Km (déterminer par logiciel MapInfo
Professional 7.5).
3.2. La forme
La forme du bassin qui est relative à l'indice de
compacité de Gravelius qui est donnée par la formule suivante
:
KG= 0.28 ?? v??
Où : KG : Indice de compacité de Gravelius. P :
Périmètre du bassin versant (Km). A : Surface du bassin versant
(Km2).
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
11
Dans notre cas, la valeur du coefficient de compacité
KG = 1,61 indique que le bassin est de forme plutôt allongée.
3.3. Les altitudes
Les altitudes maximale et minimale, elles sont obtenues
directement à partir de carte topographique, L'altitude maximale
représente le point le plus élevé (1150m dans notre cas)
du bassin tandis que l'altitude minimale considère le point le plus bas
(520m dans notre cas).
L'altitude moyenne se déduit directement de la courbe
hypsométrique ou de la lecture d'une carte topographique. On peut la
définir comme suit :
Ai . hi
A
Hmoy= ?
Où : Hmoy : altitude moyenne du bassin (m).
Ai : aire comprise entre deux courbes de niveau (Km2).
hi : altitude moyenne entre deux courbes de niveau (m). A : superficie totale
du bassin versant (Km2).
L'altitude moyenne du bassin versant de Saïda est environ
850m tandis que les parties voisines baissent jusqu'à environ 650m dans
la partie Nord-Est de la région prospectée.
La Figure ci-dessous (Figure 4) englobe le modèle
numérique de terrain (M.N.T) du bassin versant de l'Oued Saïda.
Elle donne un aperçu quant à la répartition des altitudes
dans le bassin et confirme par ailleurs les informations données par la
courbe hypsométrique ci-dessous (Figure 3) :
|
Tranches d'altitudes
|
Ai (jm2)
|
Ai cum (jm2)
|
Ai (%)
|
Ai cum (%)
|
|
1150 - 1100
|
3,60
|
3,6
|
0,66
|
0,66
|
|
1100 - 1050
|
41,70
|
45,3
|
7,67
|
8,33
|
|
1050 - 950
|
118,50
|
163,8
|
21,82
|
30,15
|
|
950 - 850
|
109,17
|
272,97
|
20,10
|
50,25
|
|
850 - 750
|
118,8
|
391,77
|
21,87
|
72,12
|
|
750 - 650
|
95,10
|
486,87
|
17,51
|
89,63
|
|
650 - 550
|
37,37
|
524,24
|
6,92
|
96,55
|
|
550 - 520
|
18,76
|
543,0
|
3,45
|
100
|
Tableau 1 : Répartition
hypsométrique du bassin d'Oued Saïda.
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.

% Surface cumulée
1150 - 1100
1100 - 1050
1050 - 950
950 - 850
850 - 750
750 - 650
650 - 550
550 - 520
0 5 10 15 20 25 30 35 40
% Surface
25 50 75 100
12
Figure 3 : Courbe hypsométrique et
histogrammes des fréquences altimétriques du bassin.
La courbe hypsométrique, montre des pentes faibles vers
les hautes altitudes ce qui indiquant la présence de zones abruptes en
amont du bassin, favorisant ainsi un écoulement torrentiel. Les pentes
de la courbe sont importantes vers les basses altitudes et expriment que l'Oued
Saïda termine sa course au niveau d'une zone pénéplaine et
les risques d'inondation ne sont pas à exclure. L'Oued Saïda,
présente bien l'état d'équilibre du bassin, offrant un
potentiel érosif moyen à faible.

Figure 4 : Model numérique du terrain
du bassin versant de Saïda.
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
13
3.4. La pente
Indice de pente du bassin versant est établi à
partir de la formule suivante :
??h . ?? . 100
|
P % =
Où : Lh : longueur des courbes de niveau. d :
dénivelée.
S : surface du bassin versant.
|
|
|
??
|
La pente du bassin en pourcentage est de 9.5% environ, elle
permet un faible ruissellement des eaux pluviales donc une infiltration
importante dans les terrains perméables, alors un contact direct avec la
nappe et dans le cas de présence d'un polluant (rejets industriels,
décharges...) il provoque une contamination rapide et directe.
On peut aussi calculer la pente moyenne de l'Oued d'après
la formule suivante :
|
I =
|
?????????????? - ????????
X 1000
??????????
|
Où : Hsource : altitude de la source. Hemb : altitude de
l'embouchure. LOued : longueur de l'Oued.
La pente de l'Oued étant très faible 1%; elle
permet au cours des périodes des averses le transport de matières
polluantes de l'amont à l'aval ainsi que leur infiltration au passage
sur les terrains perméables.
La carte des aspects ci-dessous montre l'orientation des
pentes par rapport au Nord et leur degré de pente dans le bassin versant
considéré.
3.4.1. Carte des aspects
La carte des aspects (Figure 5), donne une orientation du
relief (pente) par rapport au Nord et conduit à évaluer
l'influence de l'orientation de la pente sur le comportement hydrologique du
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
14
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
bassin. Elle montre les orientations de la pente en
degrés par rapport au Nord pour le cas du bassin
étudié.
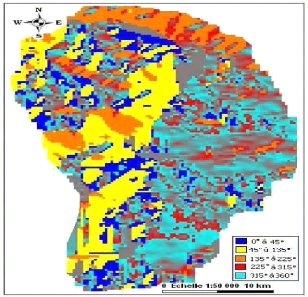
Figure 5 : Carte des aspects du bassin versant
de l'Oued Saïda (Yeles, 2014).
4. Conclusion
D'après l'étude des caractères
morpho-métriques et le calcul des paramètres hydrographiques du
bassin versant de Saïda, nous avons réuni au tableau ci-dessous
(tableau 2) l'ensemble des résultats obtenus.
Il s'avère que le bassin versant est bien drainé
selon les valeurs de la densité de drainage et la fréquence des
cours d'eau, et que le réseau hydrographique est bien organisé
d'après le rapport de confluence. La faible valeur du coefficient de
torrentialité indique que les précipitations sont faibles et
irrégulières où encore une perméabilité
importante des formations géologiques centrées à
l'échelle du bassin versant.
Enfin, le temps de concentration se constate assez important
en raison de la forme et du relief qui caractérisent le bassin.
15
|
Caractéristiques
|
Paramètres
|
Symbole
|
Unités
|
Valeurs
|
|
La densité de drainage.
|
Dd
|
Km/km2
|
2.29
|
|
Le rapport de confluence.
|
Rc
|
-
|
2.19
|
|
Réseau
|
|
|
|
|
|
hydrographique
|
Rapport de longueurs.
|
RL
|
-
|
1.47
|
|
Fréquence des cours d'eau.
|
Fs
|
-
|
0,59
|
|
Coefficient de torrentialité.
|
Ct
|
-
|
1.62
|
|
Temps de concentration.
|
Tc
|
Heure
|
7h.28min
|
|
Surface
|
A
|
Km2
|
522.8
|
|
Morphologie du
|
Périmètre
|
P
|
Km
|
151
|
|
bassin versant
|
Coefficient de Gravelius
|
KG
|
-
|
1.61
|
|
Altitude maximale
|
HMax
|
m
|
1150
|
|
Altitude minimale
|
HMin
|
m
|
520
|
|
Relief
|
Altitude moyenne
|
HMoy
|
m
|
850
|
|
Pente du bassin versant
|
P
|
%
|
9.5
|
|
Pente de Oued
|
I
|
%
|
1
|
Tableau 2 : Résultats des
paramètres hydrographiques et morpho-métriques du bassin
étudié. 5. Cadre géologique
La région de Saïda appartient à la zone la
plus externe de la chaine alpine Nord MAGHERÉBINE, C'est une zone
monotone peu déformée appartenant à la Meseta Oranaise,
elle est constituée de deux grands domaines structuraux :
1) Un socle autochtone d'âge Hercynien qui affleure dans
la région de Tiffrit.
2) Une couverture formée par des formations du Trias
jusqu'au Quaternaire actuel, cet ensemble forme les monts de Daïa.
La connaissance de la géologie d'un bassin versant est
très importante pour savoir leur influence sur l'écoulement de
l'eau souterraine et sur le ruissellement de surface.
CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE.
16
6. Étude Litho-stratigraphique
Elle est basée surtout sur les travaux effectués
par AUCLAIR D. et BIECHLER J (1965), l'étude est réalisée
par des sondages ainsi que les observations et l'étude sur les
formations affleurantes.
A. Primaire
1. Socle calédonien
Il est composé par des roches fortement
métamorphisées
2. Socle hercynien
Il est constitué par un complexe de roches faiblement
métamorphisées représentées par des grés,
schistes argileux et de schistes calcareux, ce complexe de roches a
été aussi en évidence par les sondages effectués
sur la région étudiée.
| 


