3. Les principes systémiques de la voie de la
décroissance
Une fois ce <<risque >> potentiel de
dérives identifié, quels sont les grands axes retenus pour la
définition d'une société de décroissance ? Nous en
proposons quelques uns issus des divers travaux sur la question, et notamment
des <<8 R >>134 développés par Serge
LATOUCHE, qui constituent ce qu'il appelle <<le cercle vertueux de la
décroissance È.
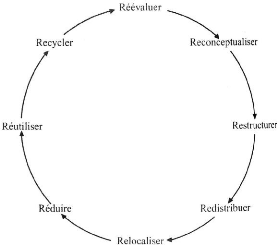
Figure 4 : Les << 8 R >> du cercle vertueux de la
décroissance, d'après Serge LATOUCHE, 2006
1 3 3 Qui désigne la mise en place de systèmes
politiques autoritaires afin de protéger l'environnement et/ou les
ressources. 134 Le pari de la décroissance, op. cit., p 156
a. Reevaluer
La reevaluation consiste à decoloniser notre imaginaire
et nos schemas axiologiques « systemiques » - au sens des valeurs
imposees par le systeme (LATOUCHE, 2006). Il est largement admis que les
valeurs fondamentales de la decroissance sont assimilables à l'Humanisme
et aux Lumieres, et qu'en ce sens la decroissance constituerait « une
critique moderne de la modernité
» (ibid). Notons neanmoins quelques
modifications axiologiques souhaitables - et probableme nt
necessaires, telles que substituer :
· la cooperation à la competition
· la qualite à la quantite
· l'autonomie à l'heteronomie
· l'equilibre dynamique à la domination de la
nature
· la vie sociale à la consommation ou le relationnel
sur le materiel
· la convivialite à la competitivite
· le plaisir du loisir à l'obsession du travail
· le raisonnable au rationnel
· le local ou le regional au global
· le bien commun à la
vénalisation
b. Reconceptualiser
« Le changement des valeurs implique un autre regard
sur le monde et donc une autre façon d'appréhender la
réalité » (ibid). Sont notamment souhaitees les
redefinitions :
· de la richesse et de la pauvrete
· de l'abondance et de la rarete
· de l'idee de progres
c. Restructurer
Il s'agirait d'adapter l'appareil productif et les rapports
sociaux et à l'espace en fonction du changement de paradigme. Cela
consisterait notamment à tendre vers :
· des modes de gestion de l'entreprise issues de l'economie
sociale, solidaire et cooperative .
· un management environnemental fonde sur
l'ecologie industrielle135 et la « durabilité
» des produits
· une reduction de la taille des
entreprises136 vers des logiques locales et/ou regionales et une
« déconcentration des activités »
(CHARBONNEAU, 2010), peut-titre basee sur des Systemes Productifs Locaux
(PECQUEUR, 2000)
1 3 5 Ou « economie circulaire »,
c'est-à-dire articulee autour du recyclage. 136 Notamment et
surtout des plus grandes.
137 138 139
· une agriculture paysanne et/ou
agroécologique (RHABI) et/ou biologique .
· une substitution de l'industrie automobile et
aéronautique par des activités de recherche et de
développement de technologies liées à la mobilité
douce et à l'éco-efficience.
d. Redistribuer
La redistribution des richesses, des ressources, de
l'empreinte écologique et du travail entre les individus et les
territoires est une très forte préconisation de la
décroissance. Celle-ci relève largement des politiques de
redistribution, mais on peut voir également que la restructuration
entraine de facto une redistribution. Par exemple, le passage à une
agriculture paysanne, outre qu'elle permet une très forte
réduction de l'empreinte écologique au Nord140 et
à la faveur du Sud, redistribuerait le travail et le capital de
l'industrie pétro-chimique vers l'agriculture, en augmentant
considérablement le nombre d'emplois agricoles. Dans cette dynamique, il
s'agirait probablement, à un moment ou la France - à peu
près dans la moyenne européenne - dépasse le seuil des 80%
d'urbains, de redistribuer la population sur le territoire à la faveur
des espaces ruraux, plutôt que de <<s'entasser dans les villes
>>, selon la formule d'Elisée RECLUS141 .
e. Relocaliser et reterritorialiser
Le mouvement de relocalisation s'imposerait d'abord à
l'économie, au sens oü l'enjeu de produire et consommer localement
- et si possible avec des capitaux locaux142 - tout ce qui peut
l'être est primordial. Les <<circuits courts >>, qui
tendent à se développer dans le domaine agricole - via les AMAP
notamment, devraient être généralisés et
s'étendre à d'autres. Mais pour << relocaliser la
vie>> (LATOUCHE, 2007), il faut également
relocaliser la culture, les services et surtout inventer une véritable
<<démocratie écologique locale>> (ibid.).
L'objectif est ainsi de permettre un investissement <<
multidimensionnel >>143 du territoire comme lieu
d'épanouissement individuel et collectif, avec comme concept clés
la qualité, la coopération, la soutenabilité et
la convivialité.
1 3 7 Voir l'article <<Pour une agriculture paysanne
È, Groupe du Chêne, Entropia n°7, septembre
2009
138 Voir aussi A. WEZEL et al, 2009, <<Agroecology as a
science, a movement or a practice. A review >>, Agronomy for
Sustainable Development, Disponible en ligne.
139 Marc DUFUMIER rappelle qu'une étude de la FAO a
démontré qu'il était possible de nourrir l'ensemble de la
planète gr%oce à l'agriculture biologique. Voir Rapport de la
Conférence Internationale sur l'Agriculture Biologique et la
Sécurité Alimentaire, FAO, Rome, mai 2007
140 Voir les travaux sur la <<dette
écologique>> des pays du Nord à l'égard des pays du
Sud du fait du <<pillage des ressources et de l'externalisation massive
de déchets toxiques >>. Voir en particulier ATTAC, <<
Pauvreté et Inégalité, ces créatures du
néolibéralisme È, Milles et une nuits, Paris, 2006,
p.44
141 Du sentiment de la Nature dans les sociétés
modernes , 1866, 9p.
142 Il existe sur ce point beaucoup de débats et
d'expérimentation autour des monnaies locales et ou fondantes, et bien
sur les Systlmes d'Echanges Locaux (SEL) et les Association pour
le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP). Voir respectivement sur ce
point Mundler, 2006 et Bernard LIETAER, 2005, Des monnaies pour les
communautés et les régions biogéographiques : un outil
décisif pour la redynamisation régionale au XXIe siècle,
extrait de BLANC J., dir (2006) Exclusion et liens financiers :
Monnaies sociales, Rapport 2005-2006, Paris: Économica, 547 p.
143 Nous empruntons par métaphore ce terme à Ivan
ILLICH, qui oppose l'homme multidimensionnel à l'homo-oeconomicus
et l'animal laborans.
Cet epanouissement local, dans un environnement naturel et
social « dbmarchandisé » et libere de l'obsession du
temps gagne, pourrait permettre, sur les bases de la simplicite volontaire,
Ç dÕhabiter en poète »144 le
territoire. Les savoir-faire Ç du passé »,
revisites sur une base moderne, pourraient etre rehabilites, non pas comme
element du folklore touristique, mais en ce que les pratiques anterieures
à l'energie fossile bon marche etaient necessairement sobres. Dans un
prolongement humaniste et poetique vers le « re-enchantement du
local », le rTMle favorable de la nature doit être valorise
à travers sa presence, jardinee ou sauvage, dans les espaces du
quotidien et dans les paysages naturels et culturels de l'arriere plan. Ces
derniers se devraient ainsi d'etre preserves de l'agression publicitaire et des
infrastructures superflues, resultant des desirs que celle-ci aura pu
engendrer.
En complementarite à l'utopie, les aspects concrets des
problematiques de gestion concertee des espaces, qu'ils soient agricoles,
naturels, ruraux ou urbains, constitueraient, par la participation citoyenne,
des experiences favorisant l'ouverture sur les problematiques cosmopolitiques
(CHARTIER&RODARY, 2008) globales. Cette gestion operee sur la base de la
notion de reliance, developpee par Olivier TURQUIN145 et
definie comme « le partage des solitudes acceptées et
l'échange des différences respectees »146,
contribuerait à « lÕharmonie sociale » et
à la qualite democratique locale. Mais, cet enracinement local
multidimensionnel doit s'accorder avec une organisation de l'espace invitant au
voyage et à l'itinerance, sur la base d'une « mobility douce
» et peut-etre de systemes d'accueil d'itinerants « chez
lÕhabitant », sur le principe des Ç banques du
temps ».
f. Reduire
Outre la reduction des inegalites et la reduction de
l'empreinte ecologique - notamment le recours aux energies
fossiles147, la reduction du temps de travail et, par là
meme, du chTMmage, constitue un point central du projet de la decroissance. La
reduction de l'amenagement, de l'artificialisation et de la marchandisation
s'imposerait egalement et en coherence avec l'equation professee par Ernst
BLOCH « Temps Libre = Espaces Libres »148.
Est egalement preconisee la reduction des mobilites, notamment
celles des marchandises, mais aussi de la Çjunk mobility »
(BOURDEAU & BERTHELOT, 2008), largement liee au tourisme de masse
international. Cette reduction de la mobilite passe d'abord par la reduction de
l'emprise de la voiture sur l'espace ainsi qu'en matiere d'amenagement du
territoire. Il s'agit par exemple de generaliser les liaisons douces -
reservees à un usage non motorise, de renoncer à tout nouvel
amenagement autoroutier ou routier d'importance, et a contrario de rehabiliter
et remettre en service un certain nombre d'infrastructures
ferroviaires149 . En France, les 80% de la population residants
aujourd'hui en
1 44 Selon l'expression de Jean Claude BESSON-GIRARD,
« Habiter en poete », Entropia n°8, Territoires de la
decroissance, printemps 2010
1 45 Le meme Olivier TURQUIN developpe les concepts de
« bergestionnaire » et « dÕagrinature
», interessants en ce qu'ils deconstruisent les discours et renouvellent
les imaginaires.
146 TURQUIN O. (dir.), 2000, Gestion
concertée dans les espaces ruraux. Guide repère , CEDAG,
Ministere de l'Agriculture et de la Peche (Direction de l'Espace Rural et de la
Forêt), Paris,
147 Qui a comme prealable la construction d'une
societe de « l'apres-petrole ».
148 Cite par Philippe BOURDEAU
149 « On sait qu'un vehicule se deplacant sur des rails
consomme 3 à 5 fois moins d'energie que sur une route. Le cout
de
maintenance et d'entretien est par ailleurs beaucoup plus faible que le
reseau routier à usage equivalent, ce qui signifie que Ç
le
espace urbain n'auraient aucune difficulté à se
déprendre de cette emprise de l'automobile dans la perspective d'une
restructuration des réseaux de mobilité et de l'urbanisme, dans
le but de réduire radicalement la distance domicile-travail.
Sur un autre registre, la réduction des
risques150, notamment sanitaires et liés à un
environnement dégradé151, s'accompagnerait d'une
réduction de l'emprise des biotechnologies et du recours
systématique à la technique pour résoudre les
problèmes sociaux ou environnementaux152.
Ainsi ce <<programme>> des <<8 R
>>153, qui n'a pas vocation à servir de cahier des
charges, permet plutôt de mobiliser la pensée de la
décroissance comme une <<matrice autorisant un foisonnement
d'alternatives>> (LATOUCHE, 2006).
Des traductions opérationnelles de ces
<<principes >> se retrouve dans le cas des AMAP, des SEL
154 , des créatifs culturels, de certains
écovillages ou éco-hameaux155 ou
à bien des égards à l'approche de <<
l'écorégionalité>> d'Emmanuel BAILLY. Ces
initiatives restent pourtant très marginales.
| 


