3.2.2. Logiques et stratégies d'acteurs
nationaux
L'objectif de cette sous section, c'est de mettre en
lumière et d'analyser les logiques des acteurs nationaux, externes et
internes a la Gécamines qui interviennent dans la gestion de cette rente
minière ou dans la gestion et l'exploitation de cette industrie
minière.
1. La gestion étatique de la rente minière de
1'U.M.H.K./ Gécamines
Au budget de l'Etat congolais, l'industrie cuprifère a
notablement contribué (66 % en 1970) et a fourni aux pouvoirs publics un
excédent utilisable pour le 2inancement de développement. Si nous
prenons comme cadre de référence la période
antérieure a la nationalisation de l'U.M.H.K., nous relevons le fait que
dès l'origine, l'Etat colonial s'était réservé la
moitié des béné2ices sur la base de sa contribution au
capital de l'U.M.H.K. 123L'importance des 2lux monétaires de
l'industrie du cuivre que l'Etat colonial gérait sous formes
d'impôts, de taxes et de redevances peut se lire a travers le tableau
ci-après :
Tableau n° 7: UTILISATION DES RECETTES DE L'U.M.H.K.
(Recettes des années 1945 a 1952)
|
Répartition des recette
(en milliards de 2rancs belges
|
Parts relatives aux
recettes totales
(en %)
|
|
Chiffre d'a22aires
|
45
|
100
|
|
Frais de production
|
20
|
44
|
|
Impôts et redevances
|
10
|
23
|
|
Dividendes nets
|
6
|
13
|
|
Dépenses de premierétablissement
|
7
|
16
|
|
Participations et accroissement d'avoirs en Banque
|
2
|
4
|
Sources: NYEMIBO Shabani, op. cit.,p. 141.
Le tableau 7 témoigne de l'importance des 2lux
monétaires que l'Etat colonial tirait de l'industrie du cuivre durant la
période considérée, soit 23 % des recettes totales
représentant les impôts et dividendes. ~l s'avère aussi,
comme nous l'avons montré au chapitre 2, que l'Etat colonial
était actionnaire de l'U.M.H.K. Par conséquent, il faut aussi
considérer, outre les impôts, les dividendes percus en
rémunération des concessions comme signalé en note.
D'après l'analyse de Nyembo S., l'Etat colonial
occupait une place prépondérante parmi les différents
actionnaires. C'est ainsi que la part du bénéfice qui lui
revenait dépassait largement la moitié des dividendes que la
société exploitante répartissait entre ses actionnaires
privés. Dès lors, si le surplus économique
distribué a ces derniers était régulièrement
important, la part de l'Etat était de loin la plus
élevée124.
Dès lors, l'injection des revenus procurés par
l'exportation minière tant a l'intérieur de l'économie
nationale que dans l'entreprise exploitante, retient notre attention dans le
cadre de cette étude. Par rapport au tableau n° 7, les 44 % des
frais de production comprenaient les dépenses afférentes a
l'entretien du matériel, aux investissements sociaux tels les logements,
l'éducation, la santé, etc., le paiement des fournisseurs et
entrepreneurs locaux ainsi que la rémunération du personnel.
Nonobstant le fait qu'une partie des revenus et dividendes est
transférée a l'étranger, remarquons que méme avant
la nationalisation de l'U.M.H.K., les flux monétaires diffusés
dans les circuits intérieurs ne sont pas négligeables. Entre 1932
et 1946 par exemple, les flux monétaires que l'U.M.H.K. avait
diffusés dans les circuits intérieurs sous la forme d'achat des
biens et services locaux avaient augmenté de plus de douze fois, passant
de 21 millions a 263 millions de francs congolais de
l'époque125. De méme, sur les 19.350 millions de
francs belges de recettes totales de l'U.M.H.K. dans les années 1951-52,
la rémunération du capital travail représentait 2.193
millions (soit 11,3 %) contre 5.202 millions (26,8 %) des impôts, taxes
et dividendes des actions émises en rémunération des
concessions et la redevance au Comité Spécial du Katanga.
Fort de ces paramètres, Nyembo S. est arrivé
dans ses analyses a considérer en son temps que la nationalisation des
avoirs de l'U.M.H.K. aurait dü permettre au Trésor public
d'augmenter considérablement le surplus économique qu'il retire
de l'exploitation des mines du Katanga. C'est ce qui l'a conduit a conclure que
l'industrie cuprifère congolaise constitue un pole de
développement en considérant le role prépondérant
de ses apports en tant que facteurs d'intégration économique et
de transformation des structures. Ses analyses, c'était sans compter
avec la gestion publique de la Gécamines de ces deux dernières
décennies.
Au lendemain des indépendances, note L. Wells,
l'industrie minière a été tributaire du sentiment de rejet
envers l'ancienne métropole a la fin de la colonisation. Si certaines
des sociétés minières nationalisées exploitant le
cuivre ont connu une expansion de longue durée en l'occurrence la
société nationale d'exploitation du cuivre en Indonésie,
reconnaIt-il, par contre
124 Nyembo S. note que l'exercice 1956, qui est l'année
la plus prospère de l'industrie du cuivre a l'époque coloniale, a
permis de distribuer aux actionnaires privés un revenu net de 1.900
millions de francs belges tandis que le Trésor public devait encaisser
une somme d'environ 4.500 millions, soit 2,3 fois la première. Cf.
NYEMIBO S., op. Cit., pp. 141-142.
125 A. CHAPELIER, Elisabethville. Essai de géographie
urbaine, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, Classe des
sciences naturelles et médicales, Tome VI, fasc. 5, 1957, p. 158,
cité par NYEMIBO S., op. cit., p. 147.
d'autres ont connu des résultats négatifs, a
l'instar des sociétés nationales de la Bolivie et du
Chili126. Ce qui a de plus captivé notre attention dans sa
réflexion, c'est la conclusion a laquelle Wells aboutit: <<Sans
pour autant méconnaltre le role de l 'Etat, propriétaire des
ressources naturelles, il est reconnu a l 'unanimité que l 'industrie
minière est une activité compétitive et non
un monopole naturel >>127.
Le cas d'espèce de la Gécamines est illustratif
de la caractéristique des sociétés minières,
nationalisées, jouissant d'un monopole naturel et dans laquelle l'Etat
s'est assuré le plus grand contrôle. Depuis les lendemains de
l'indépendance en effet, les stratégies de l'Etat congolais
consistaient en une politique systématique de participation dans
l'économie, nous l'avons vu. La gestion publique de la Gécamines
qui va suivre la nationalisation de l'U.M.H.K. présente une
spécificité qui ne pouvait qu'entraIner une faillite de
l'entreprise. Elle ne pouvait pas s'en sortir autrement dans la mesure oü
elle a été incorporée dans un système de gestion,
caractéristique de ce que l'on a nommé "le mal zairois". Pour
expliquer le mécanisme du système de gestion publique congolaise,
J. -M. Wautelet note que "la grande partie de la spécificité du
système zaIrois réside dans une articulation particulière
entre le pouvoir présidentiel, le parti unique, l'élite
politique, le monde des affaires et le capital étranger, rythmée
par les grands mouvements de la conjoncture économique
extérieure."128 Pouvons-nous dès lors comprendre
comment une entreprise minière, connaissant une tendance
séculaire a la baisse et appelée a être compétitive,
pouvait-elle évoluer dans un tel système clientéliste?
Le tableau n° 8 qui suit permet de montrer
l'évolution de la capacité d'intervention de 'Etat congolais
avant et après la nationalisation de l'U.M.H.K
Tableau n° 8: CAPACITE FINANCIERE D'INTERVENTION DE L'ETAT
CONGOLAIS A DIFFERENTES EPOQUES DE L'HISTOIRE ECONOMIQUE DU PAYS (1)
|
1958/1959
|
1973/1974
|
1988/1989
|
1996et 1998
|
|
moyenne annuelle (en millions de dollars de 2000)
|
|
Recettes publiques a partir des ressources propres
|
1.200
|
2.050
|
1.200
|
330
|
|
Contribution de la Gécamines en %
|
20
|
50,2
|
39,5
|
0
|
|
Total de ressources publiques non- remboursables(2
|
1.230
|
2.380
|
1.500
|
non
disponibles
|
|
Dépenses publiques courantes
|
1.5 10
|
2.390
|
1.360
|
360
|
|
Total des dépenses publiques (3)
|
2.370
|
3.820
|
1.800
|
370
|
|
Recettes publiques propres par habitant en $ US
|
88
|
97
|
34
|
7
|
|
Dépenses publiques courantes par habitant
|
111
|
113
|
42
|
8
|
|
Dépenses publiques totales par habitant
|
174
|
18051
|
|
9
|
(1) Les chiffres présentés dans ce tableau sont
des ordres de grandeurs
(2) Y compris les aides publiques étrangères
sous formes de dons
(3) Comprend outre les dépenses courantes, les
dépenses d'investissement financées par l'Etat et par les aides
publiques extérieures qui ne passent pas directement par les comptes du
Trésor
Source: Tableau 2, annexe 1, Rapport du groupe
d'expertise congolaise de Belgique, op. cit., p. 54.
En effet, depuis la nationalisation de cette entreprise
minière, sa contribution aux recettes publiques a plus que doublé
en proportion a la décennie 1970 pour commencer a infléchir a
partir de la décennie 1980. A la décennie 1990, elle est
méme devenue insignifiante, si pas nulle. Tout aussi intéressant
d'observer c'est le fait que les recettes publiques a partir des ressources
propres ainsi que les dépenses publiques varient dans les mémes
sens et quasi-proportionnellement a l'évolution de la contribution de la
Gécamines dans le budget. La figure 9 ci-dessous qui met en
évidence la part contributive de la Gécamines dans
l'évolution de la capacité financière de l'Etat congolais
depuis la décennie 1970 en donne un bon aperçu.
Figure 9. EVOLUTION DE LA CAPACITE FINANCIERE DU GOUVERNEMENT
ZAIROIS, 1978-1998
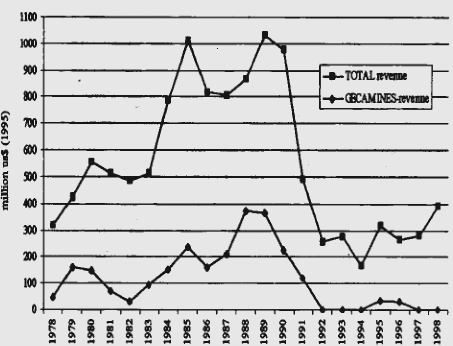
Source: Tom De HERDT, "Democracy & The Money
Machine in Zaire", Review of African Political Economy, No. 93/94, Vol. 29,
September/December 2002, p. 448.
La préoccupation intéressante a ce niveau
d'analyse est de chercher établir les usages que l'Etat congolais a
faits de ces revenus miniers de la Gécamines depuis la nationalisation
de l'U.M.H.K.
Des avis de différents analystes129, cette
rente minière n'était pas réorientée dans le
secteur minier comparativement a la période coloniale que nous venons
d'analyser, pour entretenir les actifs, acquérir de nouvelles
technologies et motiver le personnel, et enfin soutenir la croissance. Pour
Nyembo S., les investissements que l'industrie du cuivre du ZaIre a
effectués n'ont pas résolu le problème économique
essentiel du pays130. Pourtant, "c'est a l'Etat
129 Banque Mondiale, "Zaire: Orientations stratégiques
pour la reconstruction économique", Washington,
DC, novembre 1994 ; J-Ph. PEEMANS, Crise de modernisation
etpratiques populaires au Zaire et en
Afrique, op. cit., p. 23; MULUMBA Lukoji, "La Gécamines:
situation présente et perspectives", in
NOTESDE CONJONCTURE, n°24, Kinshasa, aoüt 1995, pp.
19-22.
130 Problème économique essentiel, c'est utiliser
une partie des flux monétaires qu'apporte l'exportation cuprifère
a la création d'entreprises industrielles qui pourront, en fin de
compte, produire un courant de
qu'incombe, en premier chef, cette mission d'investir des
capitaux dans les secteurs non miniers de l'économie nationale qui, au
bout d'un certain temps, devront se substituer au secteur minier en tant que
producteurs et répartiteurs des revenus."131 Pour J. -M.
Wautelet, il faut ajouter a ce qui précède que ces revenus ont
facilité également certaines dépenses somptuaires du
régime Mobutu. Cette rente a été ainsi gaspillée au
détriment de la formation interne du capital, du relèvement de la
productivité moyenne du travail dans l'ensemble de l'économie, et
de la diversification des secteurs d'activité.
| 


