2. le fonctionnement du secteur agricole sous
économie administrée
Avant à la libéralisation agricole, la politique
de l'Etat dans le secteur des cultures pérennes était d'apporter
un encadrement gratuit aux planteurs. Celui ci concernait toute la
chaîne, de la production à la commercialisation et en passant par
le financement. Le traitement des plantations contre les fléaux des
cultures cacaoyères était donc assuré par l'Etat. En ce
sens, les planteurs bénéficiaient de l'assistance technique des
agents de vulgarisation de la société de développement du
cacao (SODECAO). Le rôle de la SODECAO consistait à offrir des
services en vue de garantir la qualité de la production. La
commercialisation du cacao et du café étaient assurés par
l'office national de commercialisation des produits de base (ONCPB) ; son
rôle consistait à centraliser l'offre camerounaise des produits de
base et de négocier la vente au meilleur prix. Il y avait un
système de fixation national du prix au producteur. Ceux-ci devaient
déposer leurs produits au centre de collecte de la coopérative la
plus proche au niveau départemental. La coopérative
établie faisait partie d'un réseau de coopératives
représentées au niveau national au sein du Centre National des
Entreprises de Coopératives (CENADEC). Le fonctionnement des
coopératives obéissait à une logique administrative.
Depuis 1987, les directeurs de coopératives étaient
désignés par le pouvoir politique et les responsables
étaient des notables cooptés. Le planteur n'était en rien
concerné par ce dispositif. Sous réserve du contrôle de
qualité, la coopérative devait payer au producteur le prix
fixé par l'ONCPB selon un barème de qualité. Les paiements
des coopératives étaient effectués sur fonds d'emprunt
obtenus auprès des banques et garantis par la banque centrale (BEAC).
Les produits ainsi achetés étaient confiés aux
transporteurs privés agréés par zones d'achat par l'ONCPB.
Ceux-ci étaient chargés du transport, du conditionnement et de
l'embarquement depuis le port de Douala des commandes passées à
l'ONCPB par les acheteurs mondiaux. La rémunération des
prestations offertes par les
transporteurs privés était versée par
l'ONCPB. L'ONCPB tirait ses ressources des opérations de stabilisation.
L'écart entre le prix versé au producteur et le prix obtenu sur
le marché mondial constituait la source des financements de la caisse de
stabilisation. L'avantage que représentait ce système consistait
pour les pouvoirs publics à pouvoir dégager à travers
l'ONCPB des ressources nécessaires pour offrir aux planteurs
l'assistance technique et financière requise pour le
développement de leurs activités. Le tableau suivant fait
ressortir l'évolution du différentiel prélevé par
la caisse de stabilisation au Cameroun en ce qui concerne le cas du
café.
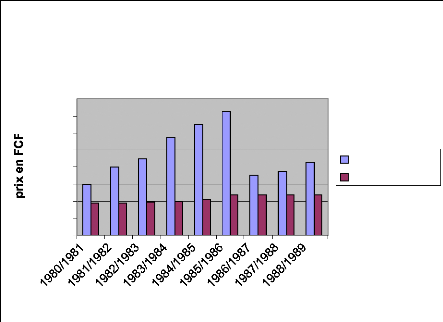
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Différentiel entre cours mondiaux et prix
au
producteur sous le régime de la caisse
de
stabilisation
Années
Cours mondiaux Prix planteur
L'écart était suffisamment grand mais ces
ressources permettaient de garantir le soutien aux planteurs par des
subventions diverses à la production (distribution des insecticides et
pesticides ; financement de l'achat des intrants et accès aux micro
crédits.
Le secteur des cultures vivrières
bénéficiait d'un dispositif spécifique. Celui de la
Mission de développement des cultures vivrières (MIDEVIV). Il
s'agissait d'une société publique dont la mission était
d'assurer les fonctions de commercialisation et d'assistance à la
production des cultures vivrières. La MIDEVIV assurait par ailleurs
l'approvisionnement des planteurs en semences améliorées ; c'est
dans ce cadre qu'en 1980 un plan national semencier élaboré avec
le concours de la FAO a été confié à la MIDEVIV. Ce
projet permettait aux paysans d'avoir accès à moindres
coûts aux semences améliorées. Par ailleurs, le dispositif
de la MIDEVIV permettait
notamment d'assurer le transport des produits vers les zones
urbaines aux fins de commercialisation dans des centres créés. Il
permettait d'éviter le désordre actuel qui a lieu dans le secteur
de la commercialisation des produits vivriers. La MIDEVIV centralisait l'offre
et veillait à la qualité des produits proposés sur le
marché de la consommation. En 1990 dans le cadre de l'ajustement
structurel et à cause de ses coûts le Gouvernement a pris la
décision de dissoudre la MIDEVIV et de libéraliser la production
et la commercialisation des semences vivrières.
| 


