Nous
contre je : des pronoms pour un système politique
Nous allons analyser les
pronoms personnels en tant que révélateurs de la conception
du pouvoir. Les pronoms personnels se présentent-t-ils comme un outil
commun aux différents Premiers ministres ? Ceux-ci seraient
probablement tentés de différencier leur discours de celui de
leur prédécesseur en le personnalisant à outrance.
À l'inverse, ils pourraient s'inscrire dans le même type de
rapport au destinataire, soit proche (je) soit plus globalisant
(nous). L'étude des pronoms de la première personne va
nous permettre de dresser un parallèle entre leur emploi et le
système politique.
Graphique n°14 :
Fréquences relatives de l'utilisation de la première personne du
singulier et du pluriel par les Premiers ministres.

Le graphique ci-dessus fait
état de l'emploi des pronoms de la première personne en associant
les discours québécois et français. Nous pouvons ainsi
comprendre comment le locuteur se situe dans chaque pays. Le premier constat
à établir relève presque de l'évidence : le
discours d'ouverture au Québec mobilise la première personne du
pluriel alors que la déclaration de politique générale
fait une sur-utilisation de la première personne du singulier.
Le premier lien que nous
effectuons tient au système politique. Au Québec, le Premier
ministre n'est pas un gouvernant solitaire imposant ses vues à tous ses
confrères députés. Dans le système parlementaire,
c'est un parti politique et son idéologie qui sont
plébiscités et non un homme. La gouvernance s'effectue dans le
cadre d'un Cabinet avec une solidarité ministérielle forte, les
membres du Conseil des ministres ne sont pas constitutionnellement
séparés les uns des autres144(*). Nous conviendrons pour l'instant que c'est la
collégialité du pouvoir qui place la première personne du
pluriel à la base du discours.
À l'inverse, le
discours en France est très marqué par la personnalité du
Premier ministre avec une sur-utilisation de la première personne du
singulier. Dans le système politique français, le Premier
ministre n'est pas un membre à part entière du gouvernement mais
il en est son unique moteur. « Dans l'ordre normatif, la
suprématie constitutionnelle du Premier Ministre est écrasante.
Il domine la procédure législative. L'article 21 lui attribue le
pouvoir règlementaire en annonçant qu' « il assure
l'exécution des lois » et « exerce le pouvoir
règlementaire145(*) ». Par ailleurs, il travaille sous la
coupe du Président de la République ; ainsi cette
personnalisation de la gouvernance peut dans certaines circonstances s'analyser
comme un contrepoids face à la domination du chef de
l'État.
Au Québec, c'est Jean
Charest qui utilise le plus la première personne du pluriel. En 2003,
nouvellement élu, il se trouve dans une situation où il doit
légitimer sa position et affirmer son leadership (je veux,
j'aimerais, je cite, j'assume ce nouveau rôle...). Le pronom
personnel je est d'ailleurs renforcé par le suremploi de
moi et me. À l'inverse, en 2001, Bernard Landry doit
maintenir son hégémonie au sein du PQ malgré de fortes
dissensions. C'est lui-même qui a poussé Bouchard à
démissionner par une bataille interne, alors il doit s'imposer en tant
que rassembleur, c'est pourquoi son propos n'est pas très
éloigné des caractéristiques françaises car il
produit une alchimie entre les deux pronoms.
Corinne Gobin146(*) souligne que nous
est un élément intéressant car « cette forme
lexicale joue un rôle essentiel en politique : le nous
rassembleur de l'union ou le nous qui distingue soit des
autres ». La première personne du pluriel est en effet
polyréférentielle : nous les députés
libéraux, nous les députés péquistes,
nous l'Assemblée nationale, nous les
Québécoises, nous les Canadiens, ou encore un
nous de majesté. Ce pronom offre une vision plus
collégiale de la gouverne, et va au-delà de l'Assemblée.
De plus, il permet d'inclure le peuple dans les propos. Ainsi le Premier
ministre libéral utilise principalement le nous les
libéraux qui « se montreront digne de la
confiance », qui « seront à
l'écoute » de la population. Les propositions gouvernementales
ne sont pas personnalisées mais attribuées à nous le
gouvernement libéral.
Nous pouvons émettre
un second raisonnement, car il ne faut pas oublier que le discours
québécois relève quelque peu de la polémique par
son inscription dans un contexte d'opposition parlementaire directe. On peut
estimer que le recours à nous permet de présenter une
majorité forte et unie, sans dissension aucune et qui avance dans un
seul sens. Nous considérons qu'il s'agit d'un moyen de se
protéger de la réplique qui a tendance à fustiger
uniquement le symbole institutionnel du Premier ministre.
Afin d'apporter un panorama
complet de l'utilisation des pronoms, nous tenons à souligner les
caractéristiques des répliques officielles. Il s'agit cette fois
des pronoms on et vous147(*). Les propos des chefs de l'opposition ont
toujours tendance à être polémiques, et cela ressort par le
pronom personnel vous désignant le gouvernement nouvellement
institué. Il est ici notable que la critique ne s'adresse pas
personnellement au Premier ministre mais à son discours ; nous
rejoignons ici la thèse de Bernard Cohen148(*) selon laquelle les discours
d'assemblée sont des
« métadiscours », « on
discourt sur le discours ». Ce pronom sert également
à s'adresser à l'auditoire ou au Président de
l'Assemblée. Le pronom impersonnel on est majoritairement
utilisé dans les répliques. Il représente 23,24% du total
des pronoms en 1999, 24,87% en 2001, et 18,97% en 2003. Il s'agit du second
pronom le plus utilisé après nous. Son utilisation
permet d'avancer un argument sans en définir le locuteur, et il est un
outil puissant dans une situation polémique afin de renforcer son
discours comme si l'on parlait à partir de lieux communs.
Les
spécificités sont très instructives à cet
égard, et il existe une réelle situation de miroir entre les
vocables français et québécois. L'emploi du singulier dans
le discours français présente un écart de +12 par rapport
à l'ensemble du corpus, et le pluriel québécois un
écart de +40 (voir graphique page suivante).
Graphique n°15 :
Spécificités des vocables je, j' et
nous pas pays.
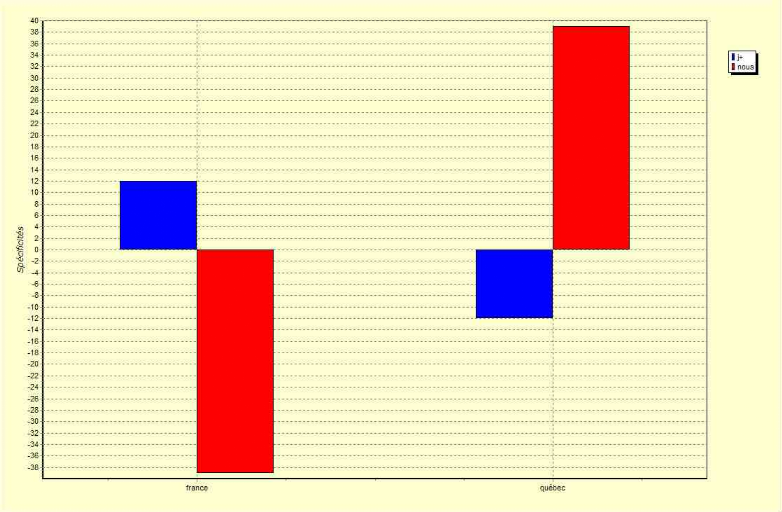
En France, comme dans le
discours gouvernemental italien149(*), le je « prédomine au
détriment de l'impersonnel «le gouvernement» ».
Mais il n'est pas toujours employé plus fréquemment que son
pluriel. Prenons comme point de départ la situation personnelle des
locuteurs. Alain Juppé, dauphin légitime du Président,
bénéficie déjà d'une aura au sein de la droite
française qui ne demande qu'à se confirmer. Lionel Jospin, leader
de la gauche plurielle doit imposer son style dans la perspective des
présidentielles de 2002. Jean-Pierre Raffarin, président de
région jusqu'à sa nomination, est un réel serviteur de
l'État ayant appliqué la ligne politique de son supérieur
hiérarchique. Par contre Dominique de Villepin doit s'imposer comme
homme de terrain avant l'échéance présidentielle de 2007.
On peut remarquer que les Premiers ministres dont l'avenir personnel va se
jouer autour d'une échéance électorale vont personnaliser
énormément leurs propos, mais ne négligent pas pour autant
le pluriel car ils doivent rassembler leurs partisans. À l'inverse,
Jean-Pierre Raffarin va utiliser davantage un nous la droite, et un
nous englobant sa propre personne et le Président de la
République, duquel il tire sa réelle légitimité. Sa
fonction d'exécution des principaux engagements de Jacques Chirac va le
conduire à adopter un style qui apparaît non conformiste face
à la tradition de la Ve République.
À l'issue de ce
dernier chapitre, nous bénéficions de nouveaux
éléments qui nous permettent de prendre de la distance avec la
thèse de la proximité des discours. Nous venons de
démontrer que c'est du point de vue du contenu que se
différencient nos corpus. Par ailleurs, l'usage des pronoms a
apporté un élément majeur dans l'analyse de la perception
de la gouvernance.
* 144 Sharon L. Sutherland
et G. Bruce Doern, La bureaucratie au Canada : contrôle et
réforme, Commission royale sur l'union économique et les
perspectives de développement au Canada, 1986, pages 1 à 59.
* 145 Stéphane
Rials, Le Premier Ministre, Paris, Presses Universitaires de France,
collection Que sais-je ?, 2ème édition, 1985,
page 73.
* 146 Corinne Gobin,
« Un survol des discours de présentation de
l'exécutif européen (1958-1993) » in Le
« programme de gouvernement », un genre discursif,
Lexicométrica - Mots n°62, mars 2000, 7 pages.
* 147 Cf. annexes, graphique
n°6, page 21.
* 148 Bernard Cohen,
« Un cas de situation de discours : le parlé
d'assemblée », in École Nationale
Supérieure de Saint-Cloud, Actes du 2ème colloque
de lexicologie politique, Colloque organisé à Saint-Cloud du 15
au 20 septembre 1980, Paris, Librairie Klincksieck, Institut national de
la langue française, Volume 2, 1982, pages 377 à 389.
* 149 Sergio Bolasco,
Déclarations et répliques gouvernementales dans le discours
parlementaire italien, deux genres discursifs, in Le
« programme de gouvernement », un genre discursif,
Lexicométrica - Mots n°62, mars 2000, 18 pages.
| 


