2.8) Télédétection
La Télédétection est définie comme
la « technique qui, par l'acquisition d'images, permet d'obtenir de
l'information sur la surface de la terre sans contact direct avec celle-ci. La
télédétection englobe tout le processus qui consiste
à capter et à enregistrer l'énergie d'un rayonnement
électromagnétique émis ou réfléchi, à
traiter et à analyser l'information, pour ensuite mettre en application
cette information » (Centre Canadien de
Télédétection, 1999). Nous pouvons alors dire que la
télédétection contribue à une meilleure
bienveillance des processus de l'univers. Les données de
télédétection permettent de saisir d'un coup d'oeil de
parties superficielles. Les prises de vue répétées de la
même zone avec le capteur constituent une source d'information unique
pour les activités de suivi et de détection des changements. Les
technologies d'observation de la Terre jouent un rôle majeur dans
l'étude, la modélisation et le suivi des phénomènes
environnementaux. Selon (Bonn et Rochon, 2000), la
télédétection est une discipline scientifique qui regroupe
l'ensemble des connaissances et des techniques utilisées pour
l'observation, l'analyse, l'interprétation et la gestion de
l'environnement, à partir des mesures et d'images obtenues à
l'aide de plateformes aéroportés, spatiales, terrestres ou
maritimes. Elles s'appuient sur des échelles spatiales et temporelles
variables et sur une base objective, exhaustive et permanente. Cette
télédétection connaît véritablement son
développement dans les années 1970-1980 (Bonn et Rochon,
1992), permettant alors de mieux appréhender
l'évolution des états de surface et de mieux interpréter
leurs modifications spatio-temporelles, leurs vulnérabilités et
les phénomènes associés Tidjani et al. (2009)
cité par Do (2014).
Ces technologies ouvrent ainsi la voie à la mise en
place de systèmes d'alerte précoce, et permettent aux politiques
et décideurs de définir des stratégies adéquates
dans le cadre d'un développement durable (Begni et al.
(sd)).
Page | 10
3) Revue de la littérature
Wolf E. et Delbart V. (2002) ont fait une analyse de
l'évolution urbaine de la ville de Kinshasa sur leur article «
Extension urbaine et densité de la population de Kinshasa : contribution
par la télédétection spatiale ». Une évolution
très soutenue depuis les indépendances et aussi marquée
par une forte densification de l'espace habitée. A cela s'ajoute, la
difficulté de l'accès à la donnée, composante
principale à ces études.
Dans son article, Ndiaye .I (2015), a analysé le
processus de l'étalement urbain de la ville de Dakar et ses
débuts datant de l'époque coloniale. Cet étalement se
manifeste par une différentiation de l'habitat urbain. La stratification
de l'habitat témoigne de la volonté depuis le départ d'une
volonté de ségrégation et discriminatoire. Ce faisant,
l'encombrement de la ville de Dakar pousse à la recherche de nouvelles
réserves foncières poussant à l'horizontalité de la
ville
Toujours dans cette même dynamique, Demaze et Trebouet
(2008) se sont intéressés à l'évaluation et au
suivi de la dynamique spatio-temporelle de la ville de Mans dans l'ouest de la
France. Ils ont fait usage des images multi date de SPOT de résolution
de 20m pour faire une classification et en ressortir une cartographie de
l'étalement urbain de la ville.
Diallo (2016) a traité de la dynamique de l'occupation
du sol à Malika. Il a analysé via les SIG et la
télédétection l'évolution urbaine et a
essayé d'en dégager les principales causes. Mais aussi, il a fait
ressortir les conséquences de cette évolution que sont entre
autres : la pression foncière, la dégradation des
écosystèmes et de la biodiversité et aussi la
réduction des espaces agricoles urbains
Comme Diallo, Mbaye C A B (2015), dans son mémoire
Utilisation de la Télédétection et du SIG pour le
suivi de l'évolution urbaine de Touba, Sénégal
fait une analyse spatio-temporelle de la ville de Touba. A travers des
images Landsat, il analyse l'évolution de la ville et son
développement qui sont à l'origine des différentes
pressions sur l'environnement et la saignée massive des populations
environnantes vers la ville. Néanmoins, l'étude reste trop
simpliste dans l'approche adoptée et manque d'indice palpable dans
l'étude du phénomène en question.
(Belguidoum, 2008), quant à lui dans son article
La ville en question - analyse des dynamiques urbaines en
Algérie Penser la ville - approches comparatives,
a traité de la dynamique urbaine en Algérie. Elle a
analysé ici, l'évolution sous un angle plutôt sociologique
de l'urbanisation
Page | 11
Abd. Rahman As-Syakur et al (2012) in
Enhanced Built-up and Bareness (EBBI) index for mapping Built-up and bare land
in urban area, ont utilisé un indice pas tellement
usité dans l'analyse de l'évolution du bâti et des sols
nus. L'indice amélioré du bâti et des sols nus (Indice de
développement et de nudité) est un indice qui utilise les bandes
spectrales proches infrarouge NIR, le moyen infrarouge SWIR et l'infrarouge
thermique TIR. L'étude a été réalisée sur la
ville de Denpasar (Bali, Indonésie) et fait une comparaison entre
différents indices liés aux bâtis et aux sols nus.
L'utilisation de l'EBBI a permis une meilleure précision dans la
cartographie du bâti et sols nus
(Oloukoi, Oyinloye, & Yadjemi, 2014), font une
étude sur l'étalement de la ville de ILE IFE en faisant recours
à la télédétection et les SIG. A travers une
approche multi-date, ils ont évalué l'urbanisation de la ville
à l'aide d'image Landsat et Ikonos. Mais aussi, les indices et taux
permettant d'avoir des statistiques fiables sur cet état de fait.
Cependant, la seule utilisation des images peut donner une vue globale de
l'étalement mais reste confrontée aux problèmes de
fiabilité et de précision.
Dans son mémoire La question de l'expansion
urbaine au Sénégal : l'exemple de la commune de Keur Massar,
(Ba, 2015) a fait une analyse de l'évolution urbaine de la
ville de Keur Massar. Il essaie de faire un diagnostic de l'expansion urbaine
de la ville et tente de le situer dans le temps. Bien que l'étude soit
assez théorique et non corrélée à des outils
permettant de quantifier la lancinante question de l'expansion urbaine.
(Fall, 2015) quant à elle a fait une analyse de la
dynamique urbaine de la ville de Keur Massar. L'étude a
révélé le caractère très irrégulier
dans la grande majorité de l'expansion de la ville. En effet, elle a
essayé de mettre en rapport aussi la dite évolution aux besoins
des populations en terme d'infrastructures et services de base. Mais aussi,
elle a passé en revue les différents défis auxquels les
pouvoirs publics et la population se heurtent face à une expansion
grandissante et un besoin croissant en termes de logement. Son mémoire
intitulé Dynamiques urbaines et recompositions territoriales :
cas de la commune de Keur Massar fait un diagnostic un tant soit peu
exhaustif de la dynamique urbaine et ses corollaires sur l'environnement, le
milieu naturel etc.
Chapitre 2 : Cadre géographique de l'étude
2.1) Situation géographique
La Commune de Keur Massar est située entre les
latitudes 14°45'4"N et 14°48'48"N puis entre les longitudes
17°17'20"W et 17°20'40"W. Elle a été
créée en 1996 par le décret n° 96 - 745 du 30
août 1996 portant création des communes d'arrondissement dans les
villes de Pikine, Dakar, Guédiawaye et Rufisque. Keur Massar compte
officiellement 128 quartiers et est l'une des 16 communes du département
de Pikine.

Figure1: Situation géographique de la
commune de Keur Massar 2.1.1) Sols et relief
La topographie à l'instar de celle de la région
est plate avec des pics autour de 16m par rapport au niveau de la mer. On note
la présence de deux cuvettes au nord-est. La pédologie de la zone
est constituée essentiellement de sol Dior (sols ferrugineux non
lessivés) propice à l'agriculture et à l'habitat.
Cependant il existe une zone marécageuse aux environs du lac Mbeubeuss
autour duquel les sols sont salés et hydro morphes.
Page | 12
Page | 13
La géologie dans la zone de Keur Massar est surtout
caractérisée par la présence de dunes rouges Ogoliennes
correspondant à des sables.
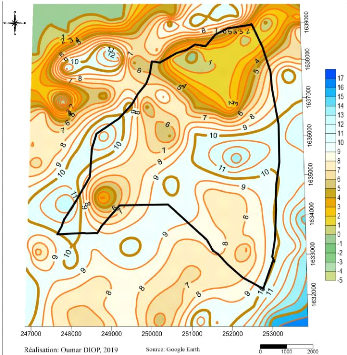
Figure 2: Vue 2D du relief de la commune de
Keur Massar
2.1.2) Climat
Le climat de Keur Massar étant dit "de steppe", les
précipitations sont faibles toute l'année. La moyenne des
précipitations sur la période des trente dernières
années s'élève à 397mm (19892018).
La variation des précipitations entre le mois le plus
sec et le mois le plus humide est de 172 mm. Sur l'année, la
température varie de 5.9 °C. Avec une température moyenne de
28.4 °C, le mois d'Octobre reste le plus chaud de la série de 1989
à 2018 et inversement, Février est le mois le plus froid de
l'année avec 21,5°C.
La température est marquée par un alizé
maritime de décembre à juin, caractérisé par une
isotherme moyenne annuelle de 25°C pour une amplitude thermique diurne
annuelle de l'ordre de 10°C. Les maxima interviennent en aout, septembre
et octobre pendant la saison des pluies
Page | 14
et les minima sont observés en décembre janvier
durant l'hiver. Elle dépend largement de celle de la région tout
entière de Dakar laquelle l'humidité est particulièrement
influencée par la clémence des températures à Dakar
et sa proximité avec la mer.
|
Température °C
|
35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
|
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct
Nov Déc
TX TN
|
Graphique 1:Evolution moyenne mensuelle de la
température à Dakar de 1989 à 2018
? TX température moyenne maximale
? TN température moyenne minimale
? AM Amplitude moyenne =TX-TN
? TM température moyenne = TX+TN/2
La station de Dakar est marquée par un climat doux sur
presque toute l'année. Les températures maximales ne
dépassent que de rarement les 30°C sur la série 1989-2018.
Les mois les plus chauds se rencontrent pendant l'hivernage. Ainsi, la
température moyenne en dit long sur son caractère de
presqu'ile.
Pour la pluviométrie, l'isohyète moyen annuel
s'établit entre 400 et 500 mm/an pour une saison pluvieuse de trois
mois. La zone de Keur Massar appartient au domaine climatique de type
plutôt sahélo-soudanien où deux (2) saisons peuvent
être distinguées en fonction du critère
pluviométrique : une longue saison sèche et une courte saison
pluvieuse.
Les mois d'aout et de septembre concentre la
quasi-totalité des précipitations avec respectivement 172mm et
136mm. Cependant, le climat de la région est relativement doux et ceci,
en raison notamment de sa position géographique
"privilégiée" et des influences océaniques.
P(mm)
160
120
80
40
0
J F M A M J J A S O N D
T°C
Pluvio Tmoy
Page | 15
Graphique 2: Diagramme ombrothermique de la
commune de Keur Massar de 1989 à 2018
L'analyse du graphique ci-après montre une saison
pluvieuse qui peut durer 3 à 4 mois avec un maximum de 2mois humides sur
la série.
| 


