II.2. Méthodes
Elle est une démarche utilisée dans la collecte
des informations (chiffrées ou non). Cette démarche se fait
à travers des techniques et méthodologie bien définies.
II.2.1. Techniques
Pour récolter les données, nous avons fait recours
aux techniques suivantes :
+ L'interview qui par elle, nous a permis
d'entrer en contact avec certains personnels cibles de l'entreprise pour des
amples informations liées à notre thème ;
+ L'audit qui est un instrument de prise de
décision et nous a permis d'investiguer sur la gestion de risques en
station-service.
+ La documentation nous a permis de consulter
certains ouvrages, rapports et articles
qui contiennent des informations nécessaires pour mener
à bien cette investigation; + Le questionnement nous a
permis de constituer une série des questions, et les adresser
aux personnels des Stations-service.
+ Méthode APR (Analyse
Préliminaire des Risques)

31
Identification et Gestion des Risques dans les
Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service
Bocom NDOGPASSI 3
à Douala
II.2.2. Méthodologie de travail
Pour cette étape cruciale de notre étude, la
méthode de diagnostic et l'APR ainsi que celle
d'hypothético-déductive ont été
utilisées pour identifier et évaluer les risques bruts. Ce sont
des méthodes statistiques qui nous ont permis, non seulement de
quantifier et chiffrer les résultats de la recherche ; mais aussi de
résumer ces derniers sous forme des tableaux et les expliquer. Cette
méthodologie est illustrée par le schéma synoptique tel
que présenté sur la figure 7 ci-dessous.
Méthodes Objectifs Résultats
Mise en oeuvre
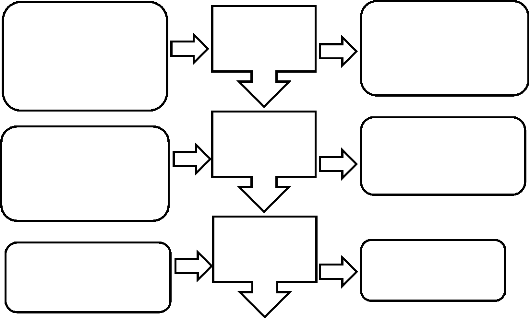
? Analyse préliminaire des
risques
? Cotation des risques
? Matrice de criticité
? Diagramme d'Ishikawa
? Observation
? diagnostic
? Questionnement
? Interview
? Suivi du fonctionnement
de la station-service
? Mise en place des nouvelles mesures de contrôle
Etat de lieu et
identification des
risques
Evaluation et
hiérarchisation
des risques
Maitrise des risques
? Obtenir des risques résiduels
? Déterminer la criticité ? Prioriser les
risques
? Classer les risques par degré de priorité
? Identifier les secteurs d'activité
? Identifier les événements redoutés
? Identifier les risques bruts
Figure 7: Schéma synoptique de la
méthodologie du travail
II.2.2.1. Identification des risques
Dans cette première étape de l'étude des
risques une descente sur le terrain a été faite. Nous avons
commencé par repartir la station par secteur d'activité (la
piste, la baie de graissage, la boutique, le rack à gaz et la laverie).
Après cette répartition des secteurs d'activité, nous
avons procédé à l'observation des installations, les
questionnements, les interviews et les audits internes qui nous ont permis non
seulement d'établir la liste des risques potentiels mais de

32
Identification et Gestion des Risques dans les
Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service
Bocom NDOGPASSI 3
à Douala
distinguer aussi les risques importants d'un côté
et les moins importants d'un autre côté. Cette liste nous a permis
de faire une corrélation avec les risques du Document Unique de
l'entreprise.
II.2.2.2. Cotation des risques
Pour coter ces risques, une assise a été faite au
sein de l'entreprise précisément dans le
service QHSE où il a été attribué
les cotes de 1 à 4 pour la gravité et de 1 à 4 pour la
fréquence d'occurrence.
? Pour la gravité nous avons attribué les cotes
en fonction de l'impact sur la vie, la santé humaine, les biens et la
santé de l'environnement. Ceci est illustré dans le tableau 3
suivant :
Tableau 3. Cotation de la gravité
|
Gravité
|
Caractéristique de la gravité
|
|
Personne
|
Bien
|
Environnement
|
|
Gravité mineure
(G1)
|
Pas de blessé
|
Pas de
dommage
|
Pas d'effet
|
Gravité moyenne
(G2)
|
Blessures légales
|
Dommage
légers
|
Atteinte sérieuse mais
réversible
nécessitant une dépollution
légère
|
Gravité moyenne
(G3)
|
Blessures graves
(arrêt de travail)
|
Dommage
significatifs
|
Atteinte critique nécessitant une
dépollution
lourde
|
Gravité majeur
(G4)
|
|
Plusieurs décès
|
Dommage
énormes
|
Atteinte irréversible
|
|
? Pour la fréquence chaque cause correspond à la
fréquence d'apparition des risques identifiés, comme
indiqué dans le tableau 4 ci-dessous :
Tableau 4. Cotation de fréquence
|
Fréquence
|
Caractéristique de la fréquence
|
|
F1
|
Rare
|
|
F2
|
Possible
|
|
F3
|
Fréquent
|
|
F4
|
Très fréquent
|

33
Identification et Gestion des Risques dans les
Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service
Bocom NDOGPASSI 3
à Douala
De ces deux tableaux précédents découle la
matrice de criticité illustrée dans le tableau 5 ci-dessous
Tableau 5: Criticité des risques (matrice de
Prouty)
|
Gravité
|
|
Environnement
|
Pas d'effet
|
Atteinte sérieuse mais réversible
nécessitant une dépollution légère
|
Atteinte critique
nécessitant
une
dépollution
lourde
|
Atteinte
irréversible
|
|
Biens
|
Pas de
dommage
|
Dommage léger
|
Dommage
significatif
|
Dommage
énormes
|
|
Personne
|
Pas des blessés
|
Blessures légères
|
Blessures
graves (arrêt
de
travail
prolongé)
|
Plusieurs
décès
|
|
Fréquence
|
G1
|
G2
|
G3
|
G4
|
|
Rare
|
F1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Possible
|
F2
|
2
|
4
|
6
|
8
|
|
Fréquent
|
F3
|
3
|
6
|
9
|
12
|
|
Très
Fréquent
|
F4
|
4
|
8
|
12
|
16
|
|
Priorité 3
|
risque acceptable
|
|
Priorité 2
|
risque tolérable
|
|
Priorité 1
|
risque inacceptable
|

34
Identification et Gestion des Risques dans les
Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service
Bocom NDOGPASSI 3
à Douala
Le tableau 5 nous présente une grille de cotation qui
est la combinaison de la gravité et de la fréquence, c'est un
tableau à double entrée codé par les couleurs qui nous ont
permis de prioriser les risques en fonction de leurs effets sur l'homme, les
biens et l'environnement. A cet effet nous avons :
- La couleur verte caractérise la
priorité 3, tous les risques qui se trouvent dans ces
cases sont acceptables donc nous pouvons ne pas traiter ces risques car ne vont
pas causer de dommage pour l'entreprise lorsque les risques se réalisent
;
- La couleur jaune qui caractérise la
priorité 2 est la marge où tous les risques qui
s'y trouvent sont tolérables donc à traiter car en cas de non
maitrise ces risques se présentent comme un danger ;
- La couleur rouge qui caractérise un
danger représente les risques de priorité 1. Ce
sont des risques inacceptables et la maitrise est nécessaire à
l'immédiat. Ces risques peuvent influencer sur la
pérennité de l'entreprise.
II.2.2.3. Évaluation des risques
Dans cette étape, grâce à la
méthode APR et le tableau 5 de criticité, nous avons
évalué les risques en fonction de leur gravité,
déterminer leur impact potentiel et l'étendue des
préjudices y afférents. Cette évaluation a
été faite dans un tableau où nous avons ressorti les
mesures de contrôle qui étaient en place comme illustre le tableau
6.
Tableau 6: Evaluation des risques
|
Identification des risques
|
Evaluation des risques initiaux
|
|
Zone
|
Type de
risque
|
Risque
|
Cause
|
Conséquence
|
Mesure de
contrôle
actuellement
en
place
|
Gravité
|
Fréquence
|
Criticité
|
|
Piste
|
chimique
|
fuite
|
Panne de
pistolet,
mauvais état
du flexible
|
Perte de
produit,
dégradation
de sol
|
sol dallé
|
3
|
2
|
6
|
|
électrique
|
électrocution
|
Câble nu,
absence de
mis à terre
|
Blessure, mort
|
Aucune
|
4
|
3
|
12
|
Identification et Gestion des Risques dans les
Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service
Bocom NDOGPASSI 3
à Douala
II.2.2.4. Classification et hiérarchisation des
risques
Il était question, d'abord de catégoriser les
risques de la check-list, liées à la mauvaise ou au manque
d'application des aspects QHSE. Ensuite, de faire correspondre chaque risque
à l'une des familles de 5M (Matière, Matériel, Main
d'oeuvre, Milieu et Méthode). Ainsi, non seulement le classement des
risques de la check-list aboutissant aux 5M s'est fait, mais aussi l'identifier
de la famille des 5M le plus important. La figure 8 ci-dessous,
dénommé diagramme d'Ishikawa est une méthode qui a permis
de classer les risques aboutissant à un effet en cinq familles :
- Matière : celle-ci renvoie aux
matières utilisées et entrant en jeu, et plus
généralement aux entrées du processus ;
- Matériel : il s'agit de
l'équipement, des machines, du matériel informatique, des
logiciels et des technologies ;
- Méthode : on retrouve ici, le mode
opératoire, la logique du processus et la recherche ; -
Main-d'oeuvre : elle renvoie aux interventions humaines ;
- Milieu : on regroupe ici l'environnement, le
positionnement, le contexte.





Effet
Main-d'oeuvre
Milieu

35
Figure 8: Aperçu du Diagramme d'Ishikawa
| 


