CHAPITRE I : CADRE DE L'ETUDE
1.1. La zone d'étude
La province de la Kompienga comprend trois départements
qui sont : Pama, Kompienga et Madjaori (Figure 8). Elle a une superficie totale
de 6.998Km2 dont environ 1/3 est occupé par les réserves
forestières alors que les réserves de faune occupent un total de
41 7.000ha. Les visites ont concerné chacun des départements.
Dans chaque département, les villages où la production
cotonnière est effective ont été visités.
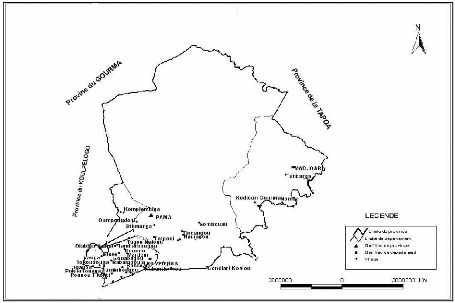
Figure N°8 : Localisation des sites
d'étude
1.2. Justification du choix du site
L'exploitation durable des ressources naturelles à des
fins agricoles est confrontée à des contraintes d'ordre
socio-économique mais aussi technique. Ainsi, au regard des besoins sans
cesse croissants des communautés en terre, en eau, en ressources
forestières animales etc., les techniques et les approches se
révèlent de plus en plus inadaptées ou sont mises à
rude épreuve et il s'impose d'entreprendre des actions pour contribuer
à atténuer les effets préjudiciables sur
l'environnement.
Pour la présente étude, les raisons qui ont conduit
au choix de cette province sont les suivantes:
- la production cotonnière est à ses
débuts, mais on note qu'il y'a tous les profils de producteurs anciens
et nouveaux; ce qui offre des perspectives pour la prise en compte des effets
dommageables sur l'environnement ;
- de nombreux acteurs de terrains s'interrogent sur les risques
environnementaux de cette culture en rapport avec l'équilibre
écologique de la région;
- cette Province fait partie de la Région de l'Est qui
regorge d'énormes potentialités fauniques du pays d'où la
nécessité de contribuer à une meilleure
compréhension de la dialectique expansion de la culture de coton et
préservation de la biodiversité pour l'adoption des mesures
adéquates pour leur gestion rationnelle.
CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE 2.1. Contacts
et identification des sites
La mise en oeuvre de cette étude a
nécessité des concertations avec les services provinciaux qui
participent à la gestion intégrée des ressources
naturelles et à la protection de l'environnement. Des entretiens
informels ont donc été organisés avec les directeurs de la
DPECV, DPRA, DPAHRH, et les chefs de services et projets tels que l'UPC, le
PNGT et le PAIE en vue d'identifier les sites et les organisations de
producteurs. Puis, avec les techniciens de la SOCOMA et l'UPPC-Kompienga nous
avons obtenu des informations sur les GPC de chaque département. Cette
étape de contacts et d'identification a facilité le
repérage des producteurs et facilité les travaux de collecte de
données.
2.2. Les hypothèses de
recherches
Hypothèse générale est que l'introduction de
la culture du coton dans la région de l'Est occasionnerait des
préjudices au niveau environnemental.
De façon spécifique :
y' Les pratiques agricoles actuelles présenteraient des
risques pour les ressources naturelles.
y' Les retombées socio-économiques constitueraient
le facteur important de l'attrait pour la culture de coton.
y' La perception des risques environnementaux chez les
producteurs pourrait contribuer à l'atténuation des effets
dommageables.
2.3. Méthodologie de collecte des
données : les enquêtes
La méthodologie mise en oeuvre dans la collecte des
données de cette étude est basée sur une approche
holistique impliquant tous les acteurs de la préservation de la
biodiversité et la production de coton (Tableau 7). Ainsi, les
organisations socioprofessionnelles, les services techniques et les producteurs
de coton qui sont concernés par l'utilisation potentielle et la gestion
des ressources naturelles ont été pris en compte. En effet, la
connaissance des rapports entre les différents utilisateurs des
ressources ainsi que la façon dont elles sont gérées pour
satisfaire les besoins des populations sont fondamentales pour un
développement durable.
Ainsi, une méthodologie spécifique a
été adoptée pour chaque acteur :
i) Un questionnaire a été administré aux
producteurs de coton (chefs d'exploitation).
ii) Une Interview Semi Structurée (ISS) avec un
focus-groupe a été appliquée aux autres
producteurs (éleveurs, pêcheurs maraîchers, apiculteurs et
CVGF). Les axes essentiels de l'entretien ont été
préalablement répertoriés dans un guide d'entretien
(check-list).
iii) Avec les services techniques des entretiens ont eu lieu
autour de la problématique du coton et des risques environnementaux de
cette culture.
iv) Des observations directes sur les pratiques agricoles ont
été faites durant l'enquête.
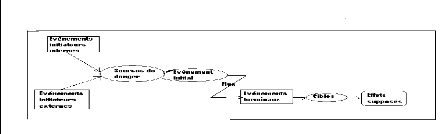
Province Autres producteurs Producteurs de coton
Services techniques
|
Kompienga
|
Eleveurs
Pécheurs
Maraîchers Apiculteurs CVGF
|
Membre de GPC Non membre de GPC
|
Environnement et CV
Agriculture
Ressources halieutiques Ressources animales
PNGT, UPC
Santé, PAIE
|
Source : Données de l'enquête (2006
et 2007)
Tableau N° 7 : OP et service Technique
touchés par l'enquête.
2.4. Outil de diagnostic des sources et facteurs de
risques
De nombreux outils de gestion de risque ont été
développés en cindynique. Les méthodes MOSAR, AMDEC, HAZOP
et HACCP sont utilisées selon les opportunités et surtout la
nature du risque à diagnostiquer.
Pour l'identification des sources et facteurs de risque, la
méthode MOSAR (Méthode Organisée Systémique
d'Analyse du Risque) a été utilisé. C'est une
méthode générique qui permet d'analyser les risques
techniques d'une installation humaine et d'identifier les moyens de
prévention. Selon DASSENS et al (2007) cette méthode est
adaptée à l'étude des milieux et permet d'avoir une vision
globale des risques engendrés par l'installation. En outre, elle permet
de rechercher les dysfonctionnements techniques et opératoires d'une
installation ou d'un procédé dont les enchaînements peuvent
conduire à des événements non souhaités. Le
schéma suivant montre son principe.
Evénement initiateur :
événement à l'origine d'un changement d'état ou de
situation d'une source de danger du système, il peut être
d'origine interne ou externe au système source de danger.
Source de danger : origine du flux de danger,
elle est susceptible d'endommager une cible
Evénement initial :
événement redouté qui caractérise le point de
transition d'une situation normale vers une situation défaillante.
Flux : transaction non désirée du
système source avec son environnement sous, forme d'énergie, de
matière ou d'information.
Evénement terminal :
événement qui résulte de l'aboutissement du flux
initié par l'événement initial vers un état
perturbé du système (fait avéré quantifiable qui
agit sur la cible).
Cible : partie influée par le champ de
danger.
Effets supposés : dégâts
potentiels sur la cible, engendrés par l'événement
terminal.
L'analyse du risque étant une démarche complexe,
il faut se donner le maximum de chance de mettre en évidence la
majorité des risques d'où l'utilité d'une méthode
logique comme MOSAR qui fait appel à la modélisation
systémique car après avoir décomposé l'installation
en sous-systèmes et recherché systématiquement les dangers
présentés par chacun d'entre eux, ces sous-systèmes sont
remis en relation pour faire apparaître des scénarios de risques
majeurs (PERILHON, 1999).
2.5. Plan d'échantillonnage
L'échantillon qui a fait l'objet du suivi provient des
exploitations cotonnières et des autres organisations
socioprofessionnelles paysannes présentes dans le site d'étude
(voir tableau 8).
. Les exploitations cotonnières :
l'échantillon des producteurs a été identifié et
choisi à partir de la liste des GPC présents dans la province et
en fonction de leur répartition géographique. L'objectif
était de couvrir au plus que possible l'ensemble de la province.
Sur environ 145 GPC (dont 70 pour le département de
Pama, 45 pour celui de Kompienga et 30 pour celui de Madjoari) que compte
l'ensemble de la province (Communication de l'UPPK, 2006), une soixantaine (60)
d'exploitations agricoles cotonnières appartenant à trente sept
(37) GPC a été retenue pour l'étude sur la base du
volontariat mais aussi de l'accessibilité des sites de production.
. Les autres organisations de producteurs
paysans : il s'agissait d'organisation d'éleveurs, de
pêcheurs, de groupement de gestion des forêts, d'apiculteurs, de
maraîchers dont 157 de leurs membres ont été
contactés et ont pris part aux discussions de groupe.
Au total, ce sont 19 villages de la province qui ont
été visités lors de l'enquête (Cf. liste jointe en
annexe).
|
Département
Organisation
|
Pama
|
Kompienga
|
Madjoari
|
Total
|
|
Cotonculteur
|
31
|
14
|
15
|
60
|
|
Eleveur
|
59
|
16
|
8
|
83
|
|
Pêcheur
|
8
|
16
|
-
|
24
|
|
CVGF
|
-
|
-
|
23
|
23
|
|
Apiculteur
|
15
|
-
|
-
|
15
|
|
Maraîcher
|
12
|
-
|
-
|
12
|
|
Fréquence
|
57,60%
|
21,20%
|
21,20%
|
100%
|
Source : Données d'enquêtes (2006
et 2007)
Tableau 8 : Répartition géographique
de l'échantillon de producteurs
2.6. Choix des variables
L'objectif principal étant de diagnostiquer les risques
et impacts environnementaux liés à la culture de coton, trois
thématiques ont été considérées : (i) la
caractérisation de l'activité, (ii) l'appréhension des
risques sur l'environnement et (iii) l'opinion qui se dégage et la
formulation des solutions. Les questionnaires et le guide d'entretien ont
été élaborés autour de ces thématiques. Les
paramètres d'intérêt peuvent être
résumés de la façon suivante :
Les incidences socio-économiques : Il
s'agit d'évaluer les retombées financières, les facteurs
de production, les changements intervenus en terme d'abandons ou non par les
producteurs, de produire d'autres spéculations végétales
après avoir introduit la culture de coton. De même, les motifs de
maintien ou d'abandon de la culture de coton, les sources de motivation des
producteurs pour cette culture et l'ancienneté dans le métier ont
été considérés.
Pour l'appréciation de la rentabilité, à
défaut de pouvoir faire une comparaison avec les autres
spéculations, un calcul simple a été fait pour
déterminer la marge brute de la production de coton. Il s'est agi de
déduire les dépenses effectuées pour les intrants
agricoles (pesticides, engrais et semences) du prix d'achat du coton. Enfin,
les acquisitions réalisées par les producteurs grâce au
revenu tiré de la production de coton ont été
évaluées.
Facteurs de dégradation des ressources de
l'écosystème : La dégradation de
l'écosystème étant liée à des facteurs
anthropiques et naturels, il nous a paru indispensable de prendre en compte les
intrants chimiques utilisés (nature, lieu d'approvisionnement), le mode
opératoire pour le dosage, les pratiques agricoles (jachère, la
succession culturale, le mode d'épandage des pesticides et l'usage des
pesticides du cotonnier sur d'autres spéculations.
Risques environnementaux : Pour analyser les
risques environnementaux liés à la production de coton, les
paramètres suivants ont été considérés :
- la distance des points d'alimentation en eau des humains et des
animaux par rapport aux champs de coton ;
- les équipements de protection des producteurs au cours
des traitements du cotonnier ;
- le devenir des emballages des pesticides après
utilisation et estimation de l'importance à partir des quantités
utilisées ;
- les zones de pâture des animaux et
- les intentions d'augmenter les superficies de production.
Perception des problèmes environnementaux :
Il s'est agi là d'une enquête d'opinion qui fournit des
informations sur les perceptions des producteurs par rapport aux
problèmes éventuels qui pourraient survenir suite à
l'exposition aux pesticides des humains. Il en est de même des risques
encourus par les animaux, l'eau et des dangers pour les sols et les autres
composantes de l'écosystème (les abeilles, les animaux sauvages,
les poissons). D'autres aspects tels les faits rapportés dans la zone et
qui sont liés à l'utilisation des pesticides ont
été investigués.
Formulation de proposition : Les interviews
ont également permis de collecter des propositions de solutions sur les
problèmes associés à la production de coton ou
susceptibles de l'être. Chaque acteur concerné par l'utilisation
et la gestion des ressources naturelles a ainsi fait des propositions de
solutions pour prévenir les risques d'intoxication en particulier, et
pour une gestion rationnelle des ressources naturelles en
général.
2.7. Organisation pratique de
l'enquête
Des sorties de reconnaissance dans la zone d'étude ont
été effectuées et ont permis d'identifier et
d'apprécier l'importance des GPC et des autres organisations de
producteur. Puis, l'enquête proprement dite a couvert les périodes
du 18 août au 6 septembre et du 5 au 14 octobre 2006. Le questionnaire a
au préalable fait l'objet de test auprès de neuf (9) chefs
d'exploitation ce qui a permis d'affiner celui-ci. Un deuxième passage
en juillet et août 2007 dans les sites de production a permis la collecte
de donnée et faire des observations complémentaires. Les
questionnaires et guides d'entretien ont été administrés
avec l'aide d'interprète. Les questionnaires ont été
individuellement administrés aux producteurs, tandis que les guides
d'entretien ont concerné des groupes de producteurs.
2.8. Support de collecte des
données
Un questionnaire a été élaboré
(voir annexe 1) et administré aux chefs d'exploitations
cotonnières. Pour les autres organisations de producteur un guide
d'entretien a permis de collecter les informations au cours d'entretien de
groupe.
2.9. Analyse statistique des
données
Les données collectées ont fait l'objet d'un
dépouillement manuel. L'analyse des données à l'aide du
tableur EXCEL 2003 a permis de décrire la pratique de la culture de
coton, les revenus tirés et les perceptions des producteurs sur les
risques environnementaux qui sont associés. Les résultats ont
été résumés par des statistiques descriptives :
moyennes, fréquences et les écart-types.
Pour permettre de mieux appréhender la portée
des résultats de cette étude, il importe de rappeler quelques
concepts en relation avec la problématique environnementale de la
culture de coton. Il s'agit en particulier des concepts d'impact
environnemental.
2.10. Définitions des Concepts en relation
avec les risques environnementaux
·
· L'environnement
L'Agence Française de Normalisation (AFNOR) donne les
définitions suivantes :
· L'environnement est un ensemble à un moment
donné, d'agents physiques, chimiques et biologiques et des facteurs
sociaux susceptibles d'avoir un effet direct et indirect immédiat ou
à terme sur les organismes vivants et les activités humaines ;
· L'environnement est un ensemble de facteurs physiques,
chimiques, biologiques, esthétiques, sociaux et autres constituant le
cadre dans lequel un organisme exerce ses activités.
Selon le code de l'environnement burkinabé,
l'environnement est l'ensemble des éléments physiques, chimiques,
et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques
sociaux, politiques et culturels, qui ont un effet sur le processus du maintien
de la vie, la transformation et le développement du milieu, les
ressources naturelles ou non et les activités humaines.
Toutes ces définitions laissent percevoir que la notion
de l'environnement est complexe et en fonction de différentes
conceptions. Deux principales conceptions peuvent être identifiées
:
· La conception biocentrique
considère l'existence de l'environnement de façon
indépendante de celle de l'homme. Dans cette conception, l'environnement
est considéré comme un ensemble d'objets en inter action. C'est
un écosystème dans lequel l'Homme (y compris son organisation
sociale) et ses activités sont des éléments naturels
constituants parmi d'autres.
· La conception
anthropocentrique perçoit par contre l'environnement comme
un espace de nature physique informationnel défini à travers les
relations de l'Homme sujet et des différents objets qui constituent la
nature. Dans cette conception l'environnement n'existe que par rapport à
l'homme.
·
· Impact environnemental
Dans une approche systémique, l'impact implique
l'action d'un système `source' sur un système `cible'. Le
système `source' peut être une activité humaine et le
système cible est, quant à lui, une composante de l'environnement
(homme, faune, flore, écosystème.).
· L'impact direct peut engendrer
une succession d'impacts secondaires.
· L'impact potentiel est le
risque d'impact qui prend en compte toutes les potentialités toxiques,
éco toxicologiques et écologiques. Il se caractérise par
l'action d'une source (nature, intensité, etc.), l'exposition et
l'accessibilité des cibles, la sensibilité des cibles.
L'impact potentiel est lié à la quantité
et à la concentration du rejet, la mobilité et la
tendance
à la dispersion, la persistance dans le milieu
(dégradabilité, l'accumulation dans les sédiments
des tissus vivants, l'effet nuisible pour l'Homme, les plantes,
les écosystèmes et pour les cibles non vivants).
·
· Notion de risque
C'est un événement possible, redouté et
caractérisé par la probabilité d'occurrence d'une action
et des effets correspondants. Le risque est donc une conséquence
environnementale, potentielle d'un anthropo système en fonctionnement
anormal lié à un dysfonctionnement.
Dans le cadre de cette étude, le diagnostic des
risques et impacts environnementaux de la culture du coton revient à
identifier les systèmes `sources' pour apprécier les changements
ou les modifications susceptibles d'affecter de façon
préjudiciable l'équilibre environnemental dans la région.
Autrement dit, quelles sont les modifications ou les atteintes réelles
et probables que peuvent induire la culture cotonnière sur les
composantes de l'environnement à savoir l'Homme, la flore, la faune et
l'écosystème.
Troisième Partie : RESUTATS ET
DISCUSSION
CHAPITRE I : IDENTIFICATION DES PRODUCTEURS ET DE LA
PRODUCTION
1.1. Caractéristiques générales
des exploitations cotonnières
1.1.1. Structure des exploitations
Les résultats rapportés par le tableau N°
9 montrent les caractéristiques de la structure des exploitations
à travers la taille leurs l'exploitation, les superficies
emblavées pour le coton d'une part et pour les céréales de
l'autre ainsi que des éléments caractéristiques du chef
d'exploitation.
VARIABLES
|
ANNEES
2005 2006
|
Nombre
|
60
|
60
|
Ancienneté de 1-3 ans (%)
|
|
58
|
Ancienneté de 4-6 ans (%)
|
|
22
|
Ancienneté de plus de 6 -10 ans (%)
|
|
20
|
Surface emblavée en coton (ha)
|
3,23 #177; 3,35
|
3,3 1#177;2,60
|
Surface emblavée en céréales (ha)
|
4,08 #177; 3,92
|
4,94#177; 3,63
|
Producteurs Mossi (%)
|
|
48
|
Producteurs Gourmantchés (%)
|
|
38
|
Autres Ethnies* (%)
|
|
14
|
Producteurs à l'âge >20<30 ans (%)
|
|
35
|
Producteurs à l'âge >31<41 ans (%)
|
|
33,33
|
Producteurs à l'âge >42=65 ans (%)
|
|
31,67
|
Producteurs non instruits (%)
|
|
25
|
Producteurs alphabétisés (%)
|
|
30
|
Producteurs de l'école classique (%)
|
|
11
|
Producteurs de l'école coranique (%)
|
|
34
|
Producteurs de profession agriculteur (%)
|
|
88,33
|
Producteurs d'autres professions (%)
|
|
11,67
|
|
Tableau 9 : Caractéristiques structurales
des exploitations productrices de coton dans la province de la
Kompienga
(*) La composition ethnique des autres organisations paysannes
se présente comme suit :
· Les éleveurs sont majoritairement des peulh
· Les apiculteurs composés de Gourmantché
· Les maraîchers composés de Mossi et
Gourmantché
· Les pêcheurs constitués de Mossi, de Dioula
et de Gourounsi
· Les CVGF composés de Gourmantché.
Les exploitations sont en générale de taille
d'environ 6ha où les producteurs pratiquent la culture du coton et
d'autres céréales. Les exploitations sont la
propriété de plus d'allochtones surtout les Mossi. Tous les
exploitants sont actifs avec cependant plus de jeunes entre la vingtaine et la
quarantaine. Ils sont en majorité instruits et exercent quasiment la
profession d'agriculteur. L'examen des résultats (Tableau 8) indique que
la production du coton dans la zone date d'une décennie au plus avec 80%
d'entre eux depuis moins un quinquennat. Au regard des superficies
exploitées nous constatons un accroissement des superficies moyennes
exploitées aussi bien pour le coton que pour les autres
céréales rentre 2005 et 2006 respectivement de 2,48% et de 21%.
Entre les années, les superficies exploitées en coton sont
inférieures à celles destinée aux autres
céréales. Le fait notable est que les superficies moyennes
emblavées en coton sont toujours inférieures à celles en
céréale sur l'ensemble des deux années. Un examen des
figures 9 et 10 portant sur les niveaux de superficies exploitées
indiquent que :
Le niveau de superficie le plus élevé sur la
période d'observation est situé entre 1,5 et 3ha pour : 39,28% et
36,66% en 2005 respectivement pour le coton et les céréales et
45,76% et 28,33% en 2006 respectivement pour le coton et les
céréales.
Par contre, en dessous de 3ha d'exploitation les producteurs de
coton sont majoritaires en année 2005 et en 2006.
En revanche, lorsque les parcelles d'exploitation sont
supérieures à 3ha, ce sont les classes de superficie en
céréales qui sont les plus fréquentes sur les deux
années d'observation.
|
50,00%
40,00%
|
|
|
|
|
|
coton céréale
|
|
|
|
|
[0-1,5 [ [1,5 -3[ [3- 4,5[ [4,5- 6[ = 6
Classe de superficie en ha
Source : Données d'enquête (2006)
Figure N°9 : Niveau de superficies
exploitées par les producteurs en 2005
|
50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00%
10,00% 5,00% 0,00%
|
|
|
|
|
coton céréale
|
|
|
|
[0-1,5 [ [1,5 -3[ [3- 4,5[ [4,5- 6[ = 6
Classe de superficie en ha
Source : Données d'enquête
(2006)
Figure N°10 : Niveau de superficies
exploitées par les producteurs en 2006
En outre, 61,67% des producteurs affirment être
propriétaires des parcelles qu'ils exploitent. Dans ce groupe il y a les
autochtones (gourmantché) mais aussi des migrants. Bien que ces derniers
ne disposent pas de titre foncier, ils estiment cependant qu'ayant accompli les
formalités et ayant eu l'aval des propriétaires terriens ils
pensent pouvoir disposer de ces terres. Les 38,33% restants disposent des
terres en location ou sous forme d'emprunt. Par ailleurs, selon certains
producteurs lorsque les parcelles sont données en location aux
producteurs il leur est interdit de pratiquer l'agroforesterie.
Ces éléments de caractérisation des
exploitations nous laissent penser à l'émergence de la culture du
coton dans la Kompienga, accompagné de l'extension des superficies qui y
sont annuellement consacrées en vue d'accroître la production.
L'extension est source de déforestation et
d'élimination d'espèces végétales parmi lesquelles
les plus vulnérables sont amenées à disparaître. La
destruction de biotopes floristiques (végétales) et fauniques qui
conduit à la disparition d'espèces végétales et aux
migrations ou la disparition d'espèces animales, parmi lesquelles les
insectes pollinisateurs telles que les abeilles ce qui est source de baisse de
rendement de la productivité agricole et forestière etc.
La disparition définitive d'espèces est source de
baisse de la diversité biologique.
Par ailleurs le fait que ce sont les allochtones qui sont
majoritaires dans la production du coton pourrait expliquer la tendance
à l'extension de la terre en défaveur de l'intensification par
l'investissement probablement à cause de l'insécurité
foncière due au statut de la tenure du foncier. De pus la production
agricole est l'apanage de petits producteurs subsistant, ce qui ne laisse pas
entrevoir une proche amélioration des pratiques de production.
Le niveau d'instruction élevé des producteurs
est un facteur favorable à l'introduction d'innovations de technologies
d'intensification des pratiques et d'éduction à l'éco
citoyenneté favorables à la préservation de
l'environnement et du cadre de vie.
1.1.2. Equipements agricoles
L'enquête révèle que les grands
équipements agricoles (motorisés) sont quasiment inexistants. Un
cas de possession de tracteur a été observé dans le
département de la Kompienga. Les équipements moyens sont
cependant présents. Il s'agit essentiellement du matériel
aratoire. Par contre, dans l'aire cotonnière ouest burkinabé,
TERSIGUEL (1992) a mis en exergue un développement de la culture
attelée et de la motorisation. Dans notre zone d'étude, 76,67%
des producteurs détiennent au moins une charrue bovine ou asine. Ces
équipements agricoles sont importants dans les exploitations
cotonnières car ils peuvent conditionner la taille des superficies
exploitées et augmenter la production. SPACK (1997) a déjà
évoqué qu'en pays gourma, lorsqu'un paysan acquière une
charrue cela s'accompagne d'une augmentation de superficie exploitée. De
même, INERA (2000) estime que la culture attelée et dans une
moindre mesure, la motorisation se développe en zone cotonnière
et engendrent une augmentation de la production cotonnière et
vivrière principalement par une augmentation des surfaces
cultivées par exploitation et par personne.
Pour les traitements phytosanitaires du cotonnier, 68,8 8% de
l'échantillon enquêté ont à leur possession au moins
un pulvérisateur manuel ou à pile. Les producteurs qui n'en
possèdent pas (3 1,12%) font recours à un emprunt. Enfin,
d'autres équipements comme les rayonneurs, les semoirs, les charrettes
sont présents chez un certain nombre de producteurs.
1.2. Types de cultures
Dans notre zone d'étude, les spéculations
agricoles exploitées par les producteurs sont les suivantes : Zea
mays (Maïs), Sorghum dura (sorgho), Pennisetum
glaucum (petit mil), riz (Oryza sativa), pour les
céréales ; Vigna unguiculata (niébé),
Vigna subterranea (poids de terre), Phaseolus vulgaris
(haricot) pour les protéagineuses ; Arachis hyppogea (arachide)
pour les oléagineuses et Colocynthis vulgaris L. (melon) et la
pastèque (Citrullus colocynthis) pour les cultures
maraîchères. Il y a par moment une association entre ces cultures.
Les associations les plus courantes concernent le maïs et le
niébé.
1.3. Rotation culturale
La succession culturale est très courante. Elle
concerne la plupart des cultures. L'ordre de rotation vise à permettre
aux cultures de bénéficier des arrières effets des
fertilisants et de lutter contre certaines adventices selon les
enquêtés. Dans l'échantillon concerné par
l'étude, 88,88% des interviewés la pratiquent et 11,12% ne la
pratiquent pas. Parmi ceux qui la pratique, 66,67% des chefs sont à
mesure de donner l'ordre de succession des cultures 33,33% n'en peuvent pas. Le
(Tableau 10) rend compte de la situation. Aussi, il faut noter que ces
rotations sont très diversifiées.
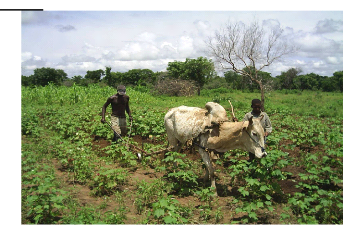
Photo N° 1: Labour de champ avec une charrue
à traction bovine
Ordres de successions Effectif Fréquence
(%)
Coton-maïs-coton 8 20
Maïs-coton-maïs 7 17,5
Coton-maïs-sorgho-coton 5 12,5
Coton-sorgho-coton 3 7,5
Mil-coton-maïs-mil 2 5
Sorgho-coton-sorgho 2 5
Coton-petit mil-coton 2 5
Haricot-coton-maïs-haricot 1 2
Coton-maïs-pastèque-coton 1 2,5
Source : Données d'enquête (2006
et 2007)
Tableau N°10 : Successions culturales
pratiquées dans la zone de l'étude
Il ressort de l'analyse du tableau que l'ordre de succession
« coton-maïs-coton » est le plus fréquent dans
près de 37,5% de cas.
1.4. Activité d'élevage dans la
culture de coton.
L'élevage est pratiqué par la majorité
des producteurs. Le cheptel est constitué de bovins, de petits ruminants
(ovins et caprins) ainsi que de la volaille et d'asin. Sur l'ensemble de
l'échantillon, seul trois (03) producteurs ne possèdent pas de
ruminants. Le taux élevé (95%) de ceux qui possèdent les
ruminants s'explique aisément par leurs multiples apports dans les
activités agronomiques. La traction (bovine ou asine) et le fumier
apparaissent comme les plus fréquents apports des animaux dans la
production végétale. Ils sont cités par 80% des
producteurs qui utilisent les ruminants dans la réalisation des
opérations de labour et de fertilisation. Les autres apports
rapportés par 20% des producteurs concernent la génération
de revenus monétaires pour acquérir de produits
vétérinaires et d'intrants agricoles.
INERA (2000) avait déjà évoqué la
forte intégration entre élevage et culture de coton dans la zone
cotonnière ouest burkinabé.
1.5. Conclusion partielle
La zone d'étude est marquée par une forte
migration. Les ethnies allochtones sont majoritairement les Mossis (48,33%) de
l'échantillon de producteurs qui pratiquent la culture de coton. Cette
situation pourrait expliquer les actions en défaveur de
l'intensification eu égard à l'insécurité
foncière. Aussi, la production végétale s'effectue sur des
superficies relativement petites avec toute fois une part élevée
pour les céréales que le coton. L'ancienneté des
producteurs dans la cotonculture étant récente laisse entrevoir
une lenteur pour l'adoption des paquets technologiques d'où des risques
de dégradation de l'environnement.
CHAPITRE II : RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES 2.1.
Ancienneté et motivation pour la profession
La culture de coton dans la zone d'étude est assez
récente pour la majorité (Tableau 11). La moyenne
d'ancienneté dans la culture cotonnière est de 4,2 #177; 3,09 ans
pour l'effectif interviewé. Sur l'ensemble de l'effectif concerné
par l'enquête, 58,33% n'excède pas 3 ans d'ancienneté. Ceux
qui pratiquent cette culture depuis au moins 10 ans sont au nombre de sept
(07).
Classe d'ancienneté (années)
[1 - 3] [4 - 6] [7 - 9] [10 -12] Total
Effectif (producteurs) 35 13 5 7 60
Fréquence (% des producteurs
enquêtés) 58,33 21,67% 8,33% 11,67%
100%
Source : Données d'enquête (2006)
Tableau 11: Répartition des producteurs
selon leur ancienneté dans la cotonculture
En ce qui concerne la motivation pour la pratique de la culture
de coton, les raisons évoquées sont diverses. Les motivations
courantes les plus évoquées sont les suivantes :
· La génération de revenu monétaire
: La rentabilité et le bénéfice sont rapportés par
61,04% des producteurs enquêtés comme des motifs de
décision d'investir dans la cotonculture ;
· Autres motivations importantes : La facilité
d'écouler, l'assurance d'un marché, la possibilité
d'acquérir les intrants à crédit, les effets probables
d'entraînement positif sur les autres spéculations sont
évoqués par 3 8,96% des producteurs. En rapport avec cette
dernière motivation, des producteurs indiquent qu'une partie des
fertilisants (NPK, Urée) acquis pour la production de coton est
utilisée pour d'autres spéculations végétales.
2.2. Organisation de la production à
l'échelle de l'exploitation
Dans les exploitations, la production cotonnière se
fait en fonction des ressources humaines disponibles mais aussi de
l'intérêt que chacun y accorde. Il n'y a pas un ordre
d'organisation privilégié dans la zone. Il faut constater que
ceux qui disposent d'une famille font participer certains de leurs membres
directement ou indirectement. A défaut, ils font recours à
l'entraide culturale qui est une forme d'organisation de la culture bien
pratiquée dans la zone. La production de coton implique donc toutes les
couches socio-économiques présentes au sein des ménages
agricoles ou à l'extérieur (Tableau 12). Le tableau 12
résume les principales formes d'organisation de la production de coton.
On note que la combinaison de plusieurs types de main d'oeuvre est la
règle dans la zone d'étude.

Photo N°2: Entretien de champ lors d'une entraide
culturale
Type de main d'oeuvre Nombre de cas Fréquence (%
des producteurs
(producteurs) enquêtés)
Femme + enfants + MOS+EC 13 21,31
Femme + enfants + EC 13 21,31
Femme + enfants 8 13,11
EC 7 11,47
Main d'oeuvre salariée 5 8,20
Femme+enfants+MOS 5 8,20
Femme+EC+MOS 2 3,28
Femme 2 3,28
Femme + EC 1 1,64
Femme + MOS 1 1,64
Enfant + MOS 1 1,64
EC+MOS 1 1,64
Femme + EC+MOS 1 1,64
Femme 1 1,64
MOS : Main d'oeuvre salariée ; EC : entraide culturale
Source : Données d'enquêtes (2006 et
2007)
Tableau 12: Participation des catégories
socioéconomiques dans la cotonculture
De façon spécifique, les femmes constituent la
principale force de travail dans la culture de coton. Elles sont mises à
contribution dans 78,69 % des ménages des producteurs
enquêtés. La seconde force de travail concerne les enfants
utilisés dans 65,57% des ménages des producteurs
enquêtés. Si ces catégories socioéconomiques
constituent une main d'oeuvre à faibles coûts pour les producteurs
de coton, leurs bénéfices tirés de la cotonculture ne sont
pas établis. Au contraire, leur contribution étant
considérée dans le cadre de la main d'oeuvre familiale, il est
fort probable que les bénéfices monétaires de la
production de coton leur échappent ou soient marginaux par rapport
à ceux du chef de ménage.
En revanche, l'utilisation de la main d'oeuvre
salariée dans la production de coton est encore relativement rare dans
la zone. Environ 47,5 5% des producteurs enquêtés ont eu recours
à la main d'oeuvre salariée. Ce type de main d'oeuvre est
seulement utilisé en complément de la main d'oeuvre familiale
et/ou de la main d'oeuvre sociale (entraide culturale). L'étude de
WININGA (1995) a montré que dans la Tapoa (village de Napoukoré),
l'emploi de la main d'oeuvre salariée atteignait 43% à 75% chez
les producteurs de coton.
2.3. Revenus monétaires et leur
destination
2.3.1. Les revenus bruts monétaires de la
cotonculture
Les revenus qui ont été obtenus sont ceux de
l'année 2005. Il s'agit des marges brutes obtenues par les producteurs
déduction faite des crédits en intrants agricoles (pesticides,
semences et engrais) octroyés par les compagnies cotonnières.
Ainsi, les 56 enquêtés qui ont cultivé le coton en 2005 ont
obtenu une masse monétaire estimée à 27 592 160 FCFA pour
un total 160,10 ha emblavés soit une marge brute de 172 343 FCFA/ha. La
plus grande marge brute constatée a été de 2,45 millions
(pour 14 ha exploités), soit une marge brute de 612 500 FCFA/ha. La plus
petite marge est 3 000 FCFA pour un ha exploité. Une perte de
près de 60 000 FCFA a été révélée par
un producteur. Les revenus tirés du coton sont donc très
variables d'un producteur à un autre et en fonction de la taille des
superficies emblavées.
2.3.2. Les investissements consentis
Parmi les facteurs de production il y a les intrants
agricoles (pesticides, engrais, semences) le matériel agricole et le
capital humain (main d'oeuvre) et les autres coûts de production tel que
les opérations culturales (préparation du sol et l'entretien des
cultures) et la récolte.
En général les pesticides, les engrais, les
semences et les pulvérisateurs sont donnés aux producteurs par le
biais des GPC sous forme de crédits avant ou pendant la campagne de
production. En effet, sur l'échantillon qui a fait l'objet de
l'étude 100% ont eu recours à ces crédits auprès de
la SOCOMA.
Les crédits de la campagne en cours (2006-2007) sont
évalués à environ 16 744 850 FCFA pour les pesticides, les
semences et l'engrais pour les 59 enquêtés. Ceci correspond
à environ 283 811 FCFA par producteur et 90 269 FCFA par hectare. Le
plus gros crédit octroyé est de 2 millions pour 13 ha et le plus
petit est de 10 700 FCFA pour 0,70 ha.
2.3.3. Destinations des revenus de la culture de
coton
Les revenus tirés de la vente du coton sont
diversement utilisés par les producteurs. Dans la zone, les
dépenses couramment effectuées après la vente se
résument à la résolution des problèmes sociaux.
Mais à côté de ces problèmes sociaux certains
producteurs ont pu acquérir des biens matériels.
Sur les 60 producteurs qui ont pratiqué cette culture
jusqu'en 2005, les revenus ont permis à :
· 31,86% de producteurs d'acheter des animaux (bovins,
petits ruminants et ânes) ;
· 17,70% d'effectuer des dépenses tels celles
liées à la santé, aux frais de scolarité ;
· 15,93% de construire des maisons ou l'achat de
matériaux de construction ;
· 12,39% d'acheter des céréales ;
· 12,39% de se procurer des matériels agricoles
(charrue, pulvérisateur, charrette)
· et 9,73% de payer des moyens de déplacement
(vélo, moto).
Ces données suggèrent l'importance que les
cotonculteurs accordent aux facteurs de production suite à la vente du
coton. En effet, les intrants agricoles (animaux, matériels agricoles)
constituent plus de 44% des dépenses effectuées avec les revenus
tirés de la vente du coton.
2.3.4. Perception paysanne de la rentabilité de
la cotonculture
La rentabilité se définit comme étant
l'aptitude d'une entreprise, d'un capital ou d'un investissement à
dégager un revenu ou un profit. Autrement dit, étudier la
rentabilité d'une exploitation revient donc à examiner si le
système de production fonctionne bien ou mal. Dans le cas de la
présente étude, l'opinion des producteurs a été
recueillie. Il ressort que 86,44% de nos interlocuteurs reconnaissent un
certain niveau de rentabilité de la cotonculture. Mais, ils mentionnent
également la pénibilité des travaux de la culture du coton
pour conclure sur le fait que la marge bénéficiaire obtenue ne
peut pas compenser l'énergie investie et 13,56% estiment ne pas
connaître la rentabilité de cette activité.
L'analyse des facteurs de démotivations dans la culture
de coton fournit d'autres renseignements complémentaires sur la
perception paysanne de la rentabilité (Figure N°11).

38%
13%
7%
9%
33%
Baisse Prix d'achat et acquisition d'intrants
hausse prix d'intrants et paiement tardif
Risque santé et environnement
Débouchés pour autres spéculations
Problème foncier et GPC

Source : Données d'enquête (2006 et
2007)
Figure N° 11 : Quelques facteurs de
démotivations dans la culture de coton
Il ressort que le facteur prix du coton et/ou des facteurs de
production sont les principaux déterminants de la poursuite ou non de la
culture de coton. Environ, 38% des enquêtés accordent une
importance aux niveaux des prix du coton graine et à l'acquisition des
intrants. De même, 33% des producteurs fondent leur décision
d'abandonner le coton sur le niveau des prix des intrants, le délai de
paiement et de l'enlèvement du coton graine. Au total, environ 71% des
producteurs fondent leur décision de produire ou non le coton sur le
facteur prix, et partant sur le marché. Il est important de souligner
que le long délai d'attente des
producteurs pour l'enlèvement et le paiement du coton
est une réalité que vivent les producteurs. Cela est un facteur
d'autant plus important que les producteurs sont guidés à
minimiser certains risques (incendie et battage par la pluie). Aussi, quand le
paiement est fait d'autres problèmes (internes aux GPC) relatifs
à la répartition des charges des crédits agricoles ne
semblent pas convenir à tous les membres.
En revanche, les risques de santé ne semblent pas
importants dans la décision des producteurs de produire ou non le coton.
Environ 13% des producteurs pourraient abandonner le coton si les risques de
santé, environnementaux et la pénibilité de travail
perdurerait. Les problèmes foncier et de gestion des GPC pourraient
constituer des démotivations pour 6,66% des producteurs. Enfin, une
amélioration des débouchés de produits
céréaliers et maraîchers entraînerait un abandon de
la culture de coton par 8,88% des producteurs enquêtés. Ce dernier
critère est similaire au critère lié au marché,
c'est à dire au facteur prix. Ce qui fait passer l'importance des
facteurs prix (produits et intrants) à 80% des producteurs
enquêtés. Une enquête menée par INERA (2000)
révèle que la notion du risque financier est la plus
déterminante dans la prise de décision chez les cotonculteurs.
2.4. Effets d'entraînement de la cotonculture
sur le choix des spéculations agricoles
Les résultats de la question sur le choix des
spéculations agricoles par les producteurs et les changements qui y sont
intervenus jusqu'en 2005 et avant leur implication dans la culture de coton
fournit des informations sur la stabilité des choix de production
agricole dans la zone de l'étude.

27%
38%
35%
Ajout de spéculation Abandon de spéculat ion Aucun
changement

Source : Données d'enquête 2006
Figure N°12 : Choix des spéculations
et changement intervenu chez les producteurs
Il ressort de l'analyse que :
· 27% des personnes enquêtées n'ont pas
opéré de changement. En d'autres termes, l'implication des
producteurs dans la culture cotonnière n'a pas eu d'effet sur les autres
spéculations traditionnellement exploitées. Le coton co-existe de
façon générale avec les autres cultures ;
· Toutefois, 35% des producteurs ont dû abandonner
certaines cultures. Parmi lesquelles figurent l'arachide, le mil, le riz, le
sorgho, l'igname, le haricot et les melons. Seul le maïs n'est pas
concerné ;
· En revanche, 38% des producteurs ont introduit des
spéculations après l'introduction du coton. Dans ce cas, c'est le
maïs qui a été ajouté par 37,04% des producteurs
enquêtés. Cela peut s'expliquer par la possibilité
d'accès aux intrants (NPK, urée) obtenus à crédit
pour le coton et qui sert aussi à la fertilisation du maïs. Cela
suggère également une forte relation entre la culture de coton et
celle du maïs. Cette forte relation a été favorisée
par le dispositif d'encadrement des producteurs de coton dans lequel les
compagnies cotonnières font la promotion de la culture de mais en vue de
valoriser les arrières effets de la fertilisation du cotonnier.
IL reste cependant que des cas de famine ont
été évoqués et les interviewés les lient au
fait que beaucoup de producteurs agricoles s'adonnent de plus en plus à
la culture de coton au détriment des cultures vivrières.
Contrairement aux autres départements, à Madjoari cette
préoccupation est partagée par la majorité des
producteurs. Ils pensent que la baisse de la production
céréalière dans la localité est due au fait que des
producteurs céréaliers s'investissent davantage dans la culture
cotonnière.
Car, d'après les enquêtés (cotonculteurs
et autres producteurs), jadis excédentaire de céréales des
autres départements de la province, Madjoari connaît ces
dernières années de graves pénuries de
céréales.
2.5. Conclusion partielle
La culture de coton génère des revenus
substantiels aux producteurs. Elle contribue à la satisfaction de
certains besoins sociaux donc importante dans les revenus des ménages de
la région. L'organisation sociale de la production est basée sur
la main d'oeuvre familiale avec une grande mise à contribution des
femmes (78,69% des cas) et des enfants (65,57% des cas). Les effets
d'entraînement de la cotonculture sur le choix des autres
spéculations agricoles ont été mis en évidence chez
près 73% de l'échantillon étudié.
Cependant, si la même dynamique est maintenue, la
dégradation des ressources naturelles serait le corollaire de
l'expansion de cette spéculation.
CHAPITRE III : LES FACTEURS DE DEGRADATION DES
RESSOURCES NATURELLES
3.1. L'extension des champs
La création de nouveaux champs correspond à des
soucis de satisfaction de certains besoins. L'exploitation agricole repose
essentiellement sur le capital foncier. Donc, il va de soi que les producteurs
soient guidés dans la mesure du possible par l'accroissement des
superficies. Les principales raisons évoquées par les producteurs
pour l'extension des superficies agricoles sont :
· L'accroissement des revenus monétaires pour
74,24% des producteurs enquêtés. L'augmentation des superficies
entraîne un accroissement de la production alimentaire et partant un
surplus plus important à commercialiser. En outre, l'accroissement des
superficies permet de produire non seulement des produits alimentaires, mais
également des produits agricoles de rente (coton, et autres)
destinés à la commercialisation ;
· La gestion de la fertilité des sols pour 18,18%
des producteurs. L'expansion des superficies agricoles permet de limiter les
effets de la baisse de la fertilité et de la présence des
adventices. Cette stratégie permet de mettre les superficies à
faible fertilité en jachère, même si cette technique est de
plus en plus rare ;
· La pression démographique au sein des
ménages pour 7,5 8% des producteurs. En particulier, l'augmentation de
la taille du ménage entraîne la création de nouveaux champs
pour répondre aux besoins plus importants des membres.
Photo N° 3: Champ de coton

3.2. Pratique de la jachère
La jachère est une technique qui consiste à
laisser un champ au repos pendant quelques années afin qu'il puisse
retrouver sa fertilité. Dans le site concerné par l'étude,
cette technique n'est plus courante. Sur l'échantillon
considéré :
· 70% d'enquêtés ne la pratiquent plus et
dans ce sous-groupe, 73, 81% pensent que cela est imputable au manque d'espace
tant disque 26,19% estiment que leurs parcelles sont toujours fertiles. En
effet, la pression démographique est une réalité dans la
zone, ce qui a pour corollaire une pression sur la ressource foncière.
Cette situation est valable non seulement chez les migrants mais aussi chez les
autochtones.
· Par contre 30% des cotonculteurs affirment la
pratiquer et ceci dans le souci d'accroître la fertilité du sol
(61,11%) alors que les 3 8,89% des producteurs la lie à
l'appauvrissement des sols quoique l'une ou l'autre de ces raisons
évoquées poursuivent le même objectif.
3.3. L'apport de la fumure
organique
La présence de fosses fumières ou de
compostières fonctionnelles permet de se faire une idée sur
l'utilisation des engrais organiques. 45% des producteurs ne disposent pas de
fosses fumières ou de compostières fonctionnelles. Cela ne
signifie pas nécessairement qu'ils n'utilisent pas la fumure organique.
Les 55% des producteurs qui en possèdent ont des âges variables.
Le tableau 13 résume l'expérience des producteurs
enquêtés dans la pratique du compostage à travers
l'ancienneté des ouvrages.
Classe d'ancienneté (années) [1-
2] [3- 4] [5- 6] [7-8] Total
Effectif (Producteurs) 20 8 2 3 33
Fréquence (% des producteurs enquêtés)
60,61 24,24 6,06 9,09 100
Source : Données d'enquête
(2006)
Tableau 13: Répartition par classe
d'expérience de producteurs possédant des fosses de
compostage.
Il ressort que dans le groupe des producteurs qui
possèdent des fosses fumières et de compostières
fonctionnelles, les plus nombreuses ont entre 1 et 2 ans d'existence. Elles
atteignent 60,61%. Le pourcentage restant (39,39%) se compose de fosses
fumières et compostières de 3 et 4 ans (24,24%), de 5 et 6 ans
(6,06%) et 7 et 8 ans (9,09%). Ces données suggèrent d'une part
que cette technique n'est pas répandue et que d'autre part ces
édifices ne résistent pas dans le temps et leurs entretiens sont
contraignantes d'où un découragement de la part des producteurs.
En définitive, les producteurs enquêtés sont faiblement
expérimentés dans le compostage comme technique de fertilisation
organique des parcelles agricoles.
3.4. Les produits phytosanitaires dans la culture
de coton 3.4.1. Les différents types de produits
phytosanitaires
L'usage des intrants chimiques et de fertilisants
minéraux est une pratique très répandue dans la zone. Les
fertilisants minéraux à savoir l'urée et le NPK ont un
taux de 100% d'utilisation chez les producteurs de coton. Pour la campagne
cotonnière en cours (2006-2007), plusieurs types de pesticides et
d'herbicides ont été utilisés (Tableau 14).
Lieux
|
Insecticides
|
Matières actives
|
Herbicides
|
Matières actives
|
Fertilisant
|
|
-Fanga 500 EC
|
Profenofos
|
Gramazol
|
-
|
-NPK
|
|
-Rocky C356 EC
|
Endosulfan et
|
Glyphalm 80 wg
|
-
|
-Urée
|
Producteur
|
|
cypermethrine)
|
Glyphalm 50 wg
|
-
|
-Compost
|
de coton
|
-Capt
|
-
|
Kallach extra
|
-
|
-Fumure
|
|
-Cathio 10 E
|
endosulfan et thirame
|
Agrazine
|
glyphosate
|
organique
|
|
Calriz
|
Propanil
|
Glycel 41%
|
Glyphosate
|
|
|
Titan 25 EC
|
Acétomipride
|
Lambda super 2,5
|
Cyhalatrine
|
-NPK
|
|
Callidim 200 EC
|
Diméthoate
|
Thionex 35 C
|
Endosulfan
|
-Urée
|
|
|
|
Kallach 360
|
Glyphosate acide
|
|
|
|
|
Adwu Na Wuru
|
Isopropylamine salt
|
|
Marchés
|
|
|
Calliherbe 2.4
|
Amin salt
|
|
Locaux
|
|
|
Atrazine 800g
|
Atrazine
|
|
|
|
|
Atrazila 80 wp
|
-
|
|
|
|
|
Herb extra 720
|
-
|
|
|
|
|
Clothodim EC
|
-
|
|
|
|
|
Calloxone super
|
Paraquat dichloride
|
|
|
|
|
Callitraz 90wg
|
Atrazine
|
|
|
Source : Données d'enquêtes (2006 et
2007)
Tableau 14: Types de produits chimiques
rencontrés dans la zone
Trois (03) des insecticides utilisés en cotonculture
ont fait l'objet d'un suivi chez les enquêtés (cotonculteurs)
durant la campagne 2006-2007. La situation sur la quantité
utilisée par les producteurs est la suivante : 3 304 litres de Fanga
500EC, 750 litres de Rocky C386 EC et 171,5 litres de Capt.
3.4.2. Circuits d'approvisionnement et lieux de
stockage
En principe ce sont les sociétés
cotonnières exploitant dans les zones de leur intervention qui mettent
à la disposition des producteurs les intrants chimiques et
minéraux à travers les GPC. En effet, tous les producteurs
enquêtés déclarent se procurer habituellement les intrants
chimiques à la SOCOMA.
Cependant, il n'est pas rare que des producteurs fassent
recours à d'autres sources pour s'en
procurer en cas de
pénurie. Cela est une pratique chez 96,67% des producteurs. Dans ce
sous-
groupe, un lot de 79,32 % s'approvisionnent dans les marchés
locaux (Pama, Kompienga,
Nadiagou, Kompienbiga) tandis que 10,34% les achètent
dans les pays voisins (Togo, Bénin) et 10,34% disent ne pas
connaître de lieu d'approvisionnement autre que le circuit des GPC. Nos
visites dans les marchés locaux (Pama, Kompienga et Kompienbiga) nous
ont confirmé cet état de fait. En effet, dans ces marchés,
nous avons observé des pesticides avec des formulations diverses en
provenance de multiples horizons. La majorité de ces pesticides sont
constitués d'herbicides et d'insecticides destinés à la
culture du maïs, riz, sorgho et de coton selon les étiquettes.

Photo N° 4: Point de vente de pesticide dans un
marché
Sur les emballages sont inscrits comme sources de provenance
Burkina Faso (SAPHYTO), le Ghana, le Bénin et la Chine. Des entretiens
avec les vendeurs, il ressort que les producteurs font recourt à leurs
produits parce qu'ils sont moins chers.
Une fois les produits achetés, ils peuvent être
stockés dans plusieurs endroits. La majorité des producteurs
enquêtés (66,67%) ont rapporté que le stockage des produits
se fait au niveau des champs, en fait dans leurs cases d'habitation
localisées dans les champs de brousse. Pour le reste (33,35%), les
produits chimiques sont stockés dans leurs maisons au niveau des
villages de résidence. En définitive, il n'existe pas de lieux de
stockage spécifique pour les produits chimiques.
3.4.3. Mode d'utilisation
+ Dosage et dilution
Les intrants chimiques sont utilisés pour lutter
contre les prédateurs (insecticides et fongicides), améliorer la
fertilité des sols (urée, NPK) et contre les adventices
(herbicides). Dans cette étude, l'urée et le NPK n'ont pas fait
l'objet d'estimation des doses utilisées. Mais lors des entretiens,
nombreux sont les producteurs qui disent qu'ils prennent 1 sac d'urée et
3 sacs de NPK pour 1 ha de champs de cotonnier. Ce qui correspond à 50
kg/ha pour l'urée et 150 kg/ha pour le NPK. Mais dans la pratique, ce
dosage n'est pas respecté dans la majorité des cas car une partie
de ces engrais est utilisée dans la fertilisation du maïs. Par
ailleurs,
certains enquêtés ne prennent pas la
quantité requise pour limiter la charge du crédit campagne.
Au niveau des pesticides le taux d'utilisation et de 100%
pour le FANGA, 97,77% pour ROCKY et 93,33% pour CAPT. Le dosage des pesticides
est fonction du type d'appareil d'épandage que les producteurs
utilisent. Au delà des pulvérisateurs, il y a une
imprécision manifeste de dosage quand bien même il s'agit du
même appareil. Le tableau 16 renseigne sur les quantités
utilisées et les superficies traitées avec un appareil en UBV
(Ultra bas volume).
|
|
Fanga/Rocky
|
|
|
|
|
|
|
Capt
|
|
|
|
|
QP
|
500
|
1000
|
500
|
500
|
300
|
250
|
250
|
500
|
500
|
250
|
250
|
200
|
250
|
125
|
125
|
QE
|
4.5
|
4
|
4,5
|
4,5
|
4,7
|
4,75
|
4,75
|
4,5
|
4,5
|
4,75
|
4,5
|
4,8
|
4,75
|
5
|
4,5
|
Sup
|
0,5
|
1
|
-
|
0,75
|
-
|
0,25
|
0,5
|
0,5
|
1
|
-
|
0,25
|
0,5
|
-
|
0,25
|
0,5
|
N
|
21
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
3
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
11
|
4
|
|
QP : quantité de produit en ml ; QE : quantité
d'eau en litre ; Sup : superficie en ha ; N : nombre de cas observé
Source : Données d'enquête (2006)
Tableau 15 : Dosage et dilution des pesticides et
superficies traitées en appareil UBV
Le tableau 15 montre que les producteurs n'appliquent aucune
norme de dosage des insecticides. En effet, 500 ml de FANGA et/ou ROCKY peuvent
être dilués dans 4,5 à 5 litres d'eau et appliqués
sur 0,5 à 0,75 ha. Il en est de même pour le CAPT ou par exemple
250 ml peuvent être dilué dans 4,5 à 5 litres d'eau pour
être appliqués sur 0,25 à 0,5 ha de cultures. Les
mêmes observations ont été notées dans le tableau 16
avec le pulvérisateur à TBV.
Produits
|
QP
|
500
|
500
|
500
|
300
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
200
|
200
|
200
|
10 C
|
Fanga/
|
QE
|
14,5
|
15
|
16
|
32
|
20
|
15
|
16
|
15
|
20
|
20
|
23
|
20
|
201
|
Rocky
|
Sup
|
0,75
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,25
|
0,5
|
1
|
1
|
0,5
|
0,25
|
-
|
-
|
-
|
|
N
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
8
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
|
QP
|
500
|
500
|
500
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
166
|
10
|
Capt
|
QE
|
14,5
|
16
|
20
|
15
|
15
|
16
|
16
|
20
|
20
|
23
|
30
|
15
|
20
|
|
Sup
|
0,75
|
0,5
|
0,5
|
0,25
|
0,5
|
0,5
|
1
|
0,25
|
0,5
|
-
|
0,5
|
0,5
|
-
|
|
N
|
1
|
1
|
1
|
7
|
2
|
2
|
11
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
QP : quantité de produit en ml ; QE : quantité
d'eau en litre ; C : capsule de l'emballage ; Sup : superficie en ha ; N :
nombre de cas observé
Source : Données d'enquête (2006)
Tableau 16 : Dosage et dilution des insecticides
avec le pulvérisateur manuel (TBV)
En définitive, le dosage des pesticides dépend
du producteur et certainement de l'état des attaques parasitaires des
parcelles de coton. Mais, il faut noter que quelque soit le type de
pulvérisateur, chaque producteur prit individuellement applique la
même dilution pour Fanga et Rocky. Mais, la quantité d'eau
utilisée dans la dilution est plus élevée avec un
pulvérisateur manuel qu'avec un pulvérisateur à pile. Il
en est de même dans le dosage du Capt.
Nos résultats convergent avec ceux obtenus par BELEM
(1985) dans la zone cotonnière ouest burkinabé qui avait
noté que les quantités d'insecticides utilisées dans deux
des trois villages- échantillons étaient insuffisantes mais il
existait des dosages différents entre les producteurs. Un risque
lié à ce sous dosage est le développement du
phénomène de résistance d'où une utilisation de
dosage de plus en plus croissante et des traitements plus fréquents pour
tuer les
mêmes parasites. Ceci entraîne non seulement une
perturbation de l'écosystème GEORGHIOU et TAYLOR (1997).
+ Nombre d'épandage
Les producteurs de coton de la zone font les traitements
phytosanitaires dans l'optique de prévenir les attaques des
prédateurs et d'augmenter la productivité et la qualité
des récoltes. Dans la zone, il existe une forte variation du nombre de
traitements appliqués aux parcelles de coton (Tableau 17). La moyenne du
nombre d'épandage enregistré est 9,30#177;3,19. D'après
les interviewés, les extrêmes sont 5 pour la borne
inférieure et 20 pour la borne supérieure.
Classe de nombre d'épandage
[5-7] [8-10] [11-13] > 14 Total Moy. Ecart-type
Nombre de producteurs 18 28 8 6 60 9,30 3,19
Fréquence (% des producteurs) 30 46,67 13,33 10 100
Source : Données d'enquête 2006)
Tableau 17: Répartition des producteurs
par classe de nombre d'épandages effectués
La majorité des producteurs de coton
enquêtés (46,67%) ont appliqué entre 8 et 10 fois les
pesticides sur le cotonnier. Il existe des producteurs (23,33%) qui ont
traité plus de 10 fois leurs champs de coton. Enfin, environ 30% des
producteurs ont utilisé entre 5 et 7 fois les insecticides dans leurs
champs.
Ce même constant a été fait par
(SCHWARTZ, 1 997b et LENDRES, 1992) qui concluaient qu'en matière de
lutte contre les parasites du cotonnier , l'adéquation est loin
d'être réalisée dans l'aire cotonnière
burkinabé entre les pratiques paysannes et les recommandations de
l'encadrement technique.
3.5. La prise de précaution dans
l'épandage des produits chimiques
Avant d'effectuer les épandages tous les producteurs
enquêtés déclarent tenir compte de la pluie et de la
direction du vent dominant. Dans la quasi-totalité des cas, ils sont
soucieux de leur protection mais aussi de la nécessité que
l'opération se déroule bien. De même, la pluie est un
facteur important à considérer avant l'épandage. Il s'agit
d'éviter le lavage du produit et la reprise des traitements
phytosanitaires.
3.6. Conclusion partielle
Un état des lieux a permis de mettre à nu les
facteurs de dégradation des ressources naturelles de la région.
L'extension des champs, la quasi absence de la jachère (70% des
enquêtés) et le faible niveau d'apport des fertilisants organiques
sont autant de facteurs à risques.
D'autres facteurs comme les circuits frauduleux
d'approvisionnement en pesticide le non respect et/ou la méconnaissance
des itinéraires techniques d'utilisation des pesticides sont à
redouter dans une optique de la conservation de l'écosystème de
la zone.
CHAPITRE IV : DIAGNOSTIC DES SOURCES DE RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX
4.1. Utilisation des pesticides du coton sur
d'autres cultures
L'utilisation des produits chimiques du cotonnier pour le
traitement d'autres spéculations est un fait réel chez certains
producteurs. Environ 61,66% des producteurs ont affirmé avoir
appliqué les insecticides du cotonnier sur d'autres cultures. Les
cultures concernées sont le niébé, la pastèque le
melon et le maïs (Tableau 18).
Spéculations
|
Profenofes
|
Endosulfan cypermethrine
|
Capt
|
Nombre
|
Fréquence (% de l'échantillon
valide)
|
niébé
|
18
|
5
|
3
|
26
|
60,50
|
pastèque
|
9
|
3
|
-
|
12
|
27,90
|
Melon
|
2
|
1
|
1
|
4
|
9,30
|
Maïs
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2,32
|
Total des cas valides
|
30
|
9
|
4
|
43
|
100
|
|
Source : Données d'enquête (2006)
Tableau 18 : Producteurs appliquant les
insecticides du coton sur d'autres cultures
La culture la plus concernée par l'application des
pesticides du cotonnier est le niébé dans 60,50% des cas
d'utilisation détournée. La pastèque est la seconde
culture (27,90% des cas) qui reçoivent des pesticides du cotonnier,
suivi du melon (9,30%) et enfin le maïs (2,32%). L'insecticide le plus
fréquemment utilisé est le Fanga (profenofes) avec 70% des cas
d'utilisation détournée. Il est suivi par le Rocky (endosulfan et
cypermethrine) dans 21% des cas et du Capt dans 9% des cas. Les
conséquences de cette pratique sont un risque de contamination de ces
spéculations et affecteraient la santé des humains et des animaux
en cas de consommation.
4.2. Distance des points d'eau par rapport aux
champs de Coton
+ Points d'eau de boisson humaine
Les sources d'alimentation en eau de boisson de la population
sont constituées des eaux souterraines (puits, forage) et des eaux de
surface (bas-fond, rivière, marigot). Le tableau 19 résume les
distances entre les champs de cotonniers et les points d'alimentation en eau
potable.
Classe de distance (m)
|
[0-500]
|
[50 1-1 500]
|
> 1 500
|
Total
|
Forage
|
Nbre
|
3
|
11
|
17
|
31
|
|
F
|
9,68
|
35,48
|
54,84
|
100
|
Puits
|
Nbre
|
12
|
11
|
3
|
26
|
|
F
|
46,15
|
42,31
|
11,54
|
100
|
Cours
|
Nbre
|
10
|
7
|
4
|
21
|
d'eau
|
F
|
47,62
|
33,33
|
19,05
|
100
|
|
Nbre = nombre de forages ; F= fréquence en %
Source : Données d'enquête (2006)
Tableau 19 : Points d'eau potable et leur
distance par rapport aux champs de coton
Les résultats indiquent que:
· Sur les 31 forages où la population de la zone
d'étude obtient l'eau de boisson, les 3 forages les plus proches se
trouvent à une distance qui ne dépasse pas 500m. Ces 3 forages
sont localisés dans les villages de Namatoulaye I, Koalou II et de
Pognoan Tikonti. Le reste des forages (23) sont à une distance
supérieure à 500m.
· Sur les 21 puits observés huit 46,15% sont
à une distance inférieure ou égale à 500m.
· Les bas-fonds, rivières et marigots où
la population s'alimente en eau de boisson sont au nombre de 21 et 47,62% de
ces retenues d'eau de surface sont à une distance qui n'excède
pas plus 500m.
+ Points d'eau d'abreuvement des animaux
Les sources d'alimentation en eau de boisson servent
également à l'abreuvement des animaux. A ces sources il faut
ajouter les barrages. L'état de la distance de ces sources par rapport
aux champs de coton figure dans le tableau 20.
Classe de distance (m)
|
[0-500]
|
[501-1 500]
|
> 1 500
|
Total
|
Forage
|
Nbre
|
2
|
3
|
4
|
9
|
|
F
|
22,22
|
33,34
|
44,44
|
100
|
Puits
|
Nbre
|
9
|
5
|
3
|
17
|
|
F
|
52,94
|
29,41
|
17,65
|
100
|
Cours
|
Nbre
|
19
|
12
|
11
|
38
|
d'eau
|
F
|
23,68
|
31,59
|
28,93
|
100
|
Barrage
|
Nbre
|
-
|
1
|
2
|
3
|
|
F
|
-
|
33,33
|
66,67
|
100
|
|
Nbre = nombre F= fréquence en %. Source :
Données d'enquête (2006)
Tableau 20 : Points d'eau d'abreuvement de
bétail et leur distance par rapport aux champs de coton
Les résultats montrent que :
· Les eaux de surface (bas-fond, rivière,
marigot) constituent les points d'abreuvement des animaux les plus
fréquemment rencontrés dans la zone. Elles constituent 56,7 1%
des points d'abreuvement.
· Ensuite viennent, les puits (25,37%), les forages
(13,43%) et les barrages (4,48%).
· Tous les barrages sont situés au moins
à une distance supérieure à 500m des champs de coton.
La proximité des points d'eaux des champs de coton
constitue un facteur de risque de contamination de ceux-ci. En effet, lors de
l'épandage des pesticides, les particules d'aérosols peuvent se
déporter dans ces milieux par les mouvements atmosphériques et
les eaux de ruissellement ou par infiltration. ILLA (2004) dans son
étude en zone cotonnière du Mouhoun attribuait la contamination
des eaux et sols par les pesticides aux facteurs infiltration et
ruissellement.
4.3. Les mesures de protection
+ Equipements de protection
Pendant l'épandage, le port de matériel de
protection est indispensable pour la préservation de la santé
humaine. Dans les sites d'étude, l'interview a permis d'apprécier
le taux d'équipement des producteurs (Figure N° 13).

35%
22%
12%
31%
gants+Bottes Masques+cache-nez
Mouchoirs+foulards+cha peau
Aucun équipement

Source : Données d'enquête (2006)
Figure N°13 : Niveau
d'utilisation de matériel de protection
Ainsi, pendant l'épandage des pesticides 33,7 1% des
producteurs se protègent avec un gant ou un masque. D'autres (53,93%)
affirment ne disposer que d'un masque, d'un cache-nez, d'un, mouchoir, d'un
foulard et d'un chapeau pendant les traitements phytosanitaires. 12,3 6% ont
déclaré qu'ils ne portent aucun équipement particulier
pendant les opérations de pulvérisation dans les champs.
+ Lieux de nettoyage du matériel de
pulvérisation
A la fin de l'épandage des pesticides, les
matériels (pulvérisateur et autres instruments) sont
nettoyés. Il en est de même pour les personnes qui ont
effectué l'opération.

Photo N° 5 : Boîtes vides de
pesticides utilisées pour conditionner l'eau de boisson
Dans ce sens, il n'est pas rare que les matériels
soient lavés dans des lieux qui ne sont pas recommandés. Les
lieux de lavage couramment cités sont les champs, la maison et les
points d'eau (Tableau 21).
Points de nettoyage
|
|
Corporel
|
Matériel et équipement
|
|
Fréquence (% des
enquêtés)
|
Nombre
|
Fréquence (% des
enquêtés)
|
Champs 42
Maison 14
Point d'eau 2
|
72,42 39
24,14 13
3,44 4
|
69,64
23,22
7,14
|
|
Source : Données d'enquête (2006)
Tableau 21 : Fréquence des points de
nettoyage après la pulvérisation
Ainsi, les producteurs qui se lavent eux-mêmes les
mains et les matériels aux champs après l'épandage des
pesticides aux champs sont les plus nombreux ; ils atteignent respectivement
72,42% et 69,64%. Mais, environ 24% et 23% des producteurs respectivement se
lavent et nettoient les équipements à la maison. Certains points
d'eau sont utilisés pour le nettoyage corporel (3%) et du
matériel (environ 7% des cas).
4.4. Les emballages des pesticides
Après les traitements phytosanitaires, les
boîtes vides sont diversement utilisées. En effet, 18,92% disent
qu'elles sont réemployées ; 28,33% déclarent qu'ils les
jettent dans la nature pendant que 52,75% des enquêtés disent en
faire autrement que les deux types précédemment cités. En
fait, ils les brûlent avec les ordures ou ils les enfouissent dans le
sol. Lorsque les boîtes sont réutilisées, elles sont
nettoyées et servent souvent à l'achat de pétrole,
à la conservation des semences et à l'achat du dolo.
Elles servent quelquefois aussi à conditionner l'eau de boisson.
4.5. Les zones de pâture des
animaux
Aux abords des champs de coton se trouvent les zones de
pâture des animaux. Il arrive des moments où les animaux
recherchent des fourrages verts à proximité des champs
pulvérisés. En effet, la pression foncière amène
des animaux à fréquenter les zones non mises en culture qui sont
en réalité confinées entre des champs de coton.

Photo N°6 : Animaux dans les couloirs de
champs
4.6. Les intentions d'accroissement des
superficies
L'accroissement des superficies d'exploitation répond
à des besoins socio-économiques. Il faut produire suffisamment
pour l`alimentation et faire face aux problèmes sociaux qui se
présentent. Dans la zone d'étude, les résultats des
enquêtes ont permis de cerner les intentions d'accroissement des
superficies agricoles. Il apparaît que 96,66% ont l'intention
d'accroître leurs superficies alors que 3,37% sont indécis sur la
question. Pour ceux qui veulent augmenter leurs parcelles, il ressort de
l'analyse que :
· 41,67% des producteurs pensent accroître leurs
superficies exploitées en coton et autres spéculations.
· 28,83% ont l'intention dans les années à
venir de n'accroître que les autres spéculations sauf le coton.
Dans ce sous-groupe, 75% et 62,50% des cotonculteurs concernés ont des
superficies en coton inférieures à 3 ha respectivement en 2005 et
2006.
· 26,67% estiment qu'ils vont augmenter rien que les
superficies emblavées en coton. Dans ce sous-groupe, 87,75% et 75% des
producteurs ont des parcelles en exploitation inférieure à 3 ha
respectivement en 2005 et 2006 avec des niveaux de superficies moyennes
exploitées qui sont 2,95ha et 4,01ha respectivement en 2005 et 2006.
Les conséquences sur le plan environnemental de
l'accroissement des superficies sont : L'extension est source de
déforestation et d'élimination d'espèces
végétales parmi lesquelles les plus vulnérables sont
amenées à disparaître.
La destruction de biotopes floristiques
(végétales) et fauniques qui conduit à la disparition
d'espèces végétales et aux migrations ou la disparition
d'espèces animales, parmi lesquelles les insectes pollinisateurs telles
que les abeilles ce qui est source de baisse de rendement de la
productivité agricole et forestière etc.
4.7. La population animale et
humaine
L'enquête révèle que les producteurs
savent que l'utilisation des pesticides peut affecter négativement les
populations écologiques animales. Environ 97% sont conscients de
quelques effets sur la population apicole. De même, 73% ont
rapporté connaître les effets des pesticides sur la faune sauvage
et 97,67% sur les animaux domestiques. Les effets sur les ressources
halieutiques (poissons) ont été évoqués par 86,67%
des cotonculteurs interviewés.
Des cas d'animaux (bovins) qui sont morts après avoir
brouté du fourrage suite à la pulvérisation d'insecticides
ont été évoqués par les éleveurs.
Par ailleurs, 73,33% des producteurs déclarent avoir
déjà fait des remarques sur leur santé (maux de tête
et des yeux, grattage de la peau etc.) et les lient sans doute à
l'utilisation des pesticides. Sur ce cas particulier, de nombreux faits ont
été rapportés par les cotonculteurs en rapport avec
l'usage des pesticides.
4.8. Les ressources
végétales
Les dangers que courent les espèces
végétales sont liés aux défriches pour non
seulement créer de nouveau champs, mais aussi pour s'en servir comme
bois de chauffe et comme charbon. Si les producteurs procédaient
à moins de défriches, un fort potentiel d'espèces serait
conservé. Même si quelques uns d'entre eux estiment qu'il y a
nécessité d'imposer un quota d'arbres à conserver dans les
champs il se posera un problème pour le suivi.

Photo N°7 : Parcelle d'exploitation
défrichée
4.9. L'eau et le sol
Près de 90% de producteurs estiment que l'utilisation
des pesticides peut avoir des dangers pour l'eau. En général, la
relation est vite établie entre l'eau et les poissons et les êtres
humains pour les risques éventuels. Par contre, pour le sol, les
réponses sont mitigées. Seuls 48,3 3% pensent que les pesticides
peuvent jouer négativement sur les sols ; 10% de
l'échantillon disent ne pas pouvoir se prononcer sur
cette question et 41,67% des enquêtés estiment que les pesticides
n'ont pas d'effets négatifs sur les sols. Selon eux, l'utilisation des
pesticides contribuerait bien au contraire à renforcer et à
maintenir sa fertilité.
|
100% 90% 80% 70% 60%
|
|
|
|
|
50%
|
|
Série1
|
|
40% 30% 20% 10% 0%
|
|
|
DPE SDE DPS SDPS IND,
DPE: Danger pour l'eau, SDE: sans danger pour
l'eau,
DPS: Danger pour sol, SDPS: sans danger
pour le sol, IND:
indécis
Source : Données d'enquête (2006)
Figure N° 14: Niveau de perception de l'effet
des pesticides sur le sol et l'eau
4.10. Conclusion partielle
Le diagnostic a permis d'identifier les sources de risques
environnementaux suivants : l'utilisation des pesticides du coton sur d'autres
cultures, une proximité des champs de coton avec les points d'eau, un
faible niveau d'équipement des producteurs en matériel de
protection, un nettoyage du matériel de pulvérisation aux abords
des points d'eau, un réemploi des emballages des pesticides pour
conditionner l'eau de boisson et des zones de pâture des animaux a
proximité des champs de coton. Toutes ces sources citées
constituent des risques majeurs.
CHAPITRE V : DISCUSSION DES RISQUES ET IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
5.1. Les risques et impacts
potentiels
5.1.1. Risques sanitaires
Les problèmes sanitaires auxquels est exposée la
population de la zone sont liés aux différents sources et
facteurs de dégradation des ressources naturelles qui ont
déjà fait l'objet d'analyse. Il s'agit du mode d'usage des
pesticides. En effet, il faut noter que le niveau d'équipement en
matériel de protection pendant l'épandage est faible. Ceux qui
déclarent disposer de matériel ne l'utilisent pas souvent. Il est
bien évident que pendant les pulvérisations l'air est
pollué et est chargé de particules d'aérosol qui seraient
inhalés par les habitants aux voisinages des champs de cotonnier. Cette
situation a été révélée durant nos sorties
où des habitants d'un village disaient ceci « lorsqu'ils
épandent les pesticides nous passons toute la journée dans de
l'air qui n'est pas bien à respirer ».
Aussi, le nombre élevé d'épandage des
insecticides (pouvant atteindre 20 fois) expose davantage les producteurs
à une intoxication chronique.
L'utilisation des pesticides du cotonnier pour d'autres
spéculations, l'association de certaines cultures (haricot) et les
abords des champs de coton parsemés par des cultures (maïs, sorgho,
oseille, gombo) constituent des risques sanitaires pour la population humaine.
Les pesticides peuvent s'accumuler dans les végétaux. Les travaux
de NEBIE et al. (2002) rapportés par ILLA (2004) concluaient
à la présence de fortes concentrations de cypermethrine (1
à 100mg/Kg et de delthaméthrine (12 à 146mg /kg) à
l'issue de l'analyse de divers échantillons de fruits, légume et
de céréales.
De même l'utilisation des boîtes vides de pesticides
pour conditionner les eaux de boisson sans un lavage sécuritaire est une
source de risque sanitaire pour les producteurs.
Les maladies répertoriées qui affectent les
producteurs de la zone sont les irritations cutanées, le rhume, les maux
de tête et de ventre. Des malaises comme des vomissements et des vertiges
sont cités par les producteurs comme des cas qui surviennent souvent
après l'épandage des produits chimiques. LINCER et al.
(1981) ont mis en exergue que de faibles concentrations de résidus
peuvent avoir des conséquences biologiques significatives et causer des
cancers ou provoquer des transformations génétiques. Des cas
d'intoxication ont été rapportés par les producteurs de
coton et d'autres organisations (éleveurs, agriculteurs,
maraîchers) lors de nos échanges. L'entretien avec les services de
santé (CMA de Pama) ont confirmé certains faits. Il s'agit du cas
de cette famille qui a été amenée en urgence à
l'hôpital après avoir mangé du tô dont la farine
avait reçu accidentellement des pesticides. D'après ce service,
des cas souvent graves ont été reçus et un mois avant
notre passage deux personnes qui s'étaient versés
accidentellement des pesticides dilués ont été admises
dans les services de
santé. Ces situations seraient fréquentes chaque
année. Cette situation a été déjà mise en
exergue par GUISSOU et al. (1996) en zone cotonnière que
l'intoxication aux organochlorés a plusieurs degrés de
sévérité allant des simples vertiges avec des
céphalées aux convulsions voire la mort. FAURIE et al.(
1980) ont fait remarqué une augmentation inquiétante du nombre de
leucémies chez les agriculteurs utilisant sans précautions
particulières certains pesticides.
5.1.2. Dangers relatifs à l'altération du
milieu naturel
> L'empiètement des limites de réserves
forestières
Le développement des activités anthropiques
notamment la cotonculture le long des réserves partielles et totales que
la province partage avec le reste de la région et les pays frontaliers
est une réalité. Durant nos sorties et par le biais des
investigations des inquiétudes subsistent. Nonobstant la mise en place
des CVGF et la surveillance des services techniques (environnement) les limites
extérieures à certains endroits sont empiétées. Les
zones tampons qui ont été matérialisées risquent de
devenir un vieux souvenir. Le cas du village de Samboili illustre bien cet
état de fait. Dans le département de Madjoari, certains
producteurs quittent les abords des réserves d'eux-mêmes pour se
mettre à l'abri des dommages (destruction des champs de coton que les
éléphants leurs causent. Il y a donc une nécessité
de réactualiser les limites de ces réserves.
> Risques liés aux circuits parallèles
d'approvisionnement en pesticides
Le risque majeur lié aux circuits parallèles
d'approvisionnement en pesticides est l'utilisation des formulations de
pesticides non homologués par la réglementation nationale donc
pouvant se révéler très dangereux pour la santé
humaine et pour l'environnement.
> Risques liés à la non maîtrise
de dosage d'insecticides
Les niveaux de dosage différents constatés chez
les producteurs est un facteur qui n'est pas sans risque. Le surdosage ou le
sous dosage des pesticides induit des effets particuliers. En cas de surdosage,
les fortes concentrations de la matière active détruiraient les
parasites ciblés et ceux non ciblés. Aussi, compte tenu du fait
que les producteurs sont sous équipés en matériels de
protections ils inhaleraient des fortes doses ce qui affecteraient
négativement leur santé. De même, les émulsions
concentrées qui tomberont dans le sol agiraient négativement sur
la micro faune.
Par contre, en cas de faible dosage, d'autres
phénomènes pourraient se produire. En effet, les parasites
pourraient développer des résistances.
> Risque de contamination des eaux, des sols et des
plantes
· Les ressources de
l'hydrosphère
La contamination des eaux qu'elle soit de surface ou
souterraine est à redouter. Les facteurs
majeurs sont la
proximité des points d'eau par rapport aux champs de coton ainsi que
la
situation topographique des sites. Les pluies et le ruissellement
entraînent d'importantes
quantités de produits phytosanitaires vers les milieux
aquatiques environnants. L'étude de CISSE et al. (2004) a
permis la détection de 16 pesticides organochlorés dans les puits
avec une concentration supérieure à 0,1jtg/litre dans la zone de
Niayes au Sénégal. De même, les travaux de ILLA (2004) dans
la zone cotonnière burkinabé (boucle du Mouhoun) ont permis de
détecter le métidathion à des concentrations dans des puit
(2,684ug/l) et l'eau de forage (2,465ug/l) et la lie au transport des
pesticides en surface ou en profondeur.
Aussi, il faut noter que la dispersion des pesticides se fait
au delà des agro systèmes. En effet, par les mouvements
atmosphériques (transport par le vent) les pesticides utilisés
peuvent être entraînés vers les ressources lointaines
entraînant ainsi un déséquilibre de ces biotopes. Le
nettoyage du matériel de pulvérisation dans certains points d'eau
est un facteur de risque pour cette ressource et peut affecter la santé
humaine et animale.
· La pédosphère
L'utilisation des pesticides et des fertilisants
minéraux constitue un fait qui peut affecter la qualité des sols.
Aussi, certaines pratiques agricoles telle que l'absence quasi-totale de la
jachère constituent des risques potentiels qui pourraient abaisser la
fertilité et contaminer les sols surtout par l'accumulation des
métaux lourds que contiennent les molécules d'aérosol
utilisées. Dans ce registre, HOSCOET en 1968 a pu mettre en
évidence, une sérieuse contamination des sols cultivés
français par les insecticides organochlorés d'après
(RAMADE, 1978). Des travaux similaires montrant la contamination par les
pesticides en zone cotonnière existent. Les résultats de SAVADOGO
et al. (2006) ont montré une contamination des sols par
l'endosulfan et l'aldrine avec des concentrations variant respectivement de 1
à 22ug/kg et 20ug/kg aussi bien en milieu rural qu'en station
expérimentale.
L'impact environnemental évident est la modification de
la composition physico-chimique des sols. D'autres aspects tel que le
brûlage des sous produits agricoles (tiges du cotonnier) et les feux de
brousse pourraient contribuer à la destruction de la flore et de la
faune pédosphérique.
> La destruction du couvert
végétal
L'impact environnemental qui est perceptible dans la zone
d'étude est sans conteste la déforestation consécutive
à l'extension des superficies cultivées. Elle constitue une
menace pour certaines essences ligneuses et non ligneuses. En effet, dans les
champs cotonniers, les défriches (sélectives ou non) sont
effectuées et en général il ne reste que quelques
espèces ligneuses ; ces dernières sont aussi en nombre
réduit. Il faut également noter que d'autres producteurs font
recours aux feux pour dégager les parcelles d'exploitation.
Les 60 producteurs concernés par l'étude ont
emblavé 395,1 ha qui (dont 160,1 pour le coton) pour toutes les
spéculations confondues en 2005 et 453 ha emblavés (dont 185,5 ha
pour le coton) en 2006. Le fait notable est que la part de superficie
allouée à la culture de coton est en nette augmentation.
Cependant, les superficies de coton ne dépassent guère 40% des
superficies totales emblavées en 2005 et en 2006. Une
estimation des pertes de ligneux à l'hectare pourrait nous situer
davantage sur les dommages subis. OUATTARA et al. (2006) sur la base
d'images satellitaires relate que dans la province de la Kompienga, le fait
majeur qui ressort de l'état de dégradation des formations
végétales est incontestable tant sur le plan distribution
spatiale que sur le plan qualitatif. La même étude
révèle que les superficies occupées par les savanes
boisée et arborée ont respectivement régressé de
76,5% et 60% alors que la mosaïque des champs et jachères a
augmenté de 23,1%.
Cette destruction végétale accentuera la
dénudation des sols d'où des risques liés à
l'érosion aussi bien hydrique qu'éolienne des sols.
Photo N°8 : Parcelle
déboisée

> L'eutrophisation
Le transport des matières fertilisantes
utilisées pour l'amendement des cultures de coton par les eaux de
ruissellement vers les lacs et étangs est inévitable. La
conséquence est un transfert et un dépôt de ces produits
dans les milieux humides d'où un déséquilibre
écologique dû à une colonisation des
végétaux.
> La pollution visuelle et
esthétique
L'abondance des emballages des insecticides et des herbicides
qui sont libérés après les traitements phytosanitaires
constitue une inquiétude. En effet, l'échantillon
étudié (60 producteurs de coton) a libéré 4.397
boîtes vides de pesticides de capacité de 0,5 à 1 litre et
1.044 sachets d'herbicide pour la campagne 2006. Ces emballages qui sont
généralement en matière plastique ont été
rencontrés dans la nature au cours des enquêtes. Ceux qui les
brûlent sans aucune autre forme de précaution ne font qu'augmenter
une émanation gazeuse dont les effets écologiques ne sont pas
bien connus.
5.1.3. Impacts sur la biodiversité
Les perturbations écologiques inhérentes au
système et à la pratique de la production de coton peuvent
affecter toute la chaîne trophique. KUMAR( 1991) mettait en exergue que
les insecticides affectent les processus biologiques. En effet, la faune, et la
flore en passant par la population humaine sont concernées par les
effets dommageables. Ces conséquences négatives pouvant
être directes ou indirectes. CHAPUT et al. (1971) sont parvenus
au fait que l'usage des pesticides en agriculture entraînait les
pollutions des nappes souterraines et rivières, des sols
(dysfonctionnement de la microflore et faune), l'accroissement des maladies
chez les animaux d'élevage exposés.
> L'écologie animale
Pour une meilleure appréhension de ces effets
négatifs, il faut distinguer deux composantes : il s'agit des victimes
cibles (les ravageurs du cotonnier) et les victimes collatérales (non
ciblées). Les ravageurs du cotonnier concernent essentiellement
Hélicoverpa armigera mais aussi d'autres parasites.
Quant aux populations animales collatérales victimes suite à
l'épandage des pesticides, on a les abeilles et autres insectes, la
faune sauvage et les animaux domestiques.
> La population entomophile
L'écologie apicole serait la plus affectée. En
effet, pendant les pulvérisations, les abeilles qui sont sur les
cotonniers meurent si elles sont atteintes par les produits. D'après le
Centre de Recherche en Ecologie, une étude faite au Cameroun, en
Côte-d'Ivoire et au Kenya en 1999 a révélé que ces
dernières années, les insectes nuisibles devenaient de plus en
plus résistants aux produits phytopharmaceutiques et que par ailleurs,
le taux d'extinction des espèces vivantes est passé de mille
à dix milles fois le taux biologique normal.
Les essaims d'abeilles qui sont à proximité
s'éloignent davantage. Les apiculteurs rencontrés affirment que
la baisse de leur récolte de miel est le fait de la rareté des
abeilles dans leur site de production et cela est imputable au «
Didici » (dénomination locale des pesticides)
utilisés en culture cotonnière. Ceux du village de Kpodjari
(situé à 18 km de Pama) disent que : « nos ruches sont
vides. Ces dernières années nous sommes à mesure de
compter le nombre d'abeilles dans chaque ruche alors qu'auparavant ce
n'était pas le cas ».
Aussi, les apiculteurs déclarent que la production
(quantité de miel) obtenue dans les ruches placées à
proximité des champs de coton est faible par rapport aux autres. La
baisse ou la quasi absence des abeilles est inquiétante eu égard
au rôle important que ces insectes jouent dans la pollinisation des
végétaux et toutes les vertus des produits de la ruche (mil, cire
et propolis). C'est aussi une activité socioprofessionnelle qui est mise
en péril.
> La faune sauvage
Le fort potentiel faunique qui vit dans les réserves
totale ou partielle serait affecté. Les particules d'aérosol qui
sont transportées par le vent, l'air et les eaux de ruissellement des
champs traités vers les niches écologiques constitueraient une
sérieuse menace pour cette faune. Le transfert possible d'aérosol
vers les hydrosystèmes et leur inhalation par ces
animaux est susceptible d'affecter négativement leur
santé. Il est très courant comme c'est le cas dans certains
hameaux de culture de Pama et de Tibadi que les pachydermes viennent brouter
dans les champs de cotonnier comme nous l'avons constaté lors de nos
enquêtes.
> Les animaux domestiques
Les animaux qui mangent le fourrage vert aux abords des champs
traités sont véritablement exposés. En effet, lors des
échanges (surtout avec les éleveurs), la culture du coton entrave
leurs activités. Les cas d'animaux morts (bovins et petits ruminants)
sont fréquents. A Tibadi lors d'une séance d'entretien avec des
éleveurs de cette localité on a annoncé à une
personne de l'assistance qu'elle venait de perdre 4 bovins après que ces
derniers eurent mangé les feuilles des cotonniers traités par les
pesticides. Des éleveurs affirment que certains producteurs de coton
pulvérisent jusqu'aux abords (le fourrage) pour protéger leurs
récoltes. Ces faits ont été cités par des
éleveurs de Kompienbiga, Nadiagou, Tibadi et dans la zone de pastorale
de Kaboanga (située à environ 35km de Pama).
> La flore
La caractéristique de la défriche pour la
culture du coton est qu'elle est sélective ou totale. Dans les champs de
coton en général, les espèces ligneuses qui sont
préservées le doivent aux intérêts qu'ont les
producteurs pour celles-ci. Les principales espèces concernées
sont le karité, le raisinier, le tamarin. Les autres espèces sont
systématiquement abattues. Un inventaire floristique et un suivi
écologique pourraient permettre de mieux apprécier la dynamique
de ce problème environnemental en vue d'intégrer les techniques
de régénération et de conservation du milieu.
> La microfaune
La contribution de la microfaune à l'équilibre
des milieux a été mise en évidence. Elle joue un
rôle dans le cycle des échanges entre les sols et les plantes.
Pourtant, l'utilisation des pesticides menace sérieusement les
microorganismes du sol. L'usage des pesticides affecte leur cycle. Aussi,
l'épandage des herbicides non sélectifs tant
apprécié par les producteurs pour son efficacité à
détruire le couvert végétal suscite des interrogations sur
la fertilité du sol mais aussi le devenir des micro organismes de cet
écosystème.
Le tableau 22 met en exergue les groupes d'impacts directs et
indirects en relation avec la culture du coton dans la région.
|
Activités
|
Impacts environnementaux
|
|
Directs
|
Indirects
|
|
Usage des produits phytosanitaire (pesticides)
|
.Pollution des sols
.Pollution esthétique par les emballages
|
Contamination des êtres vivants
|
|
.Pollution des eaux de surface
|
-Pertes de ressources halieutiques -Contamination de la flore
-Contamination des êtres vivants
animaux
-Accumulation de pesticides dans la chaîne trophique
-Eutrophisations
|
|
.Pollution des eaux souterraines .Pollution de l'air
|
- Contamination humaine et animale
- Baisse de la qualité d'eau de boisson
|
|
.Bioaccumulation des pesticides dans la
chaîne trophique
|
- Contamination humaine
- Contamination de la faune
|
|
.Elimination d'insectes nuisibles et utiles pour la pollution
|
- Problème de pollution
- Perturbation de la productivité
végétale
- Perte de biodiversité et déséquilibre
écologique
|
|
.Contamination du fourrage vert
|
- Menace sur la santé animale
- Bioaccumulation des pesticides dans les animaux
|
|
.Elimination des petits mammifères
|
Déséquilibre écologique
|
|
.Intoxication humaine
|
- Apparition des malades
- Baisse de facteur de productions
|
|
.Coûts élevés
|
- Usage de pesticides non homologués -
Développement de contrebande
|
|
Application de fertilisant chimique
|
.Pollution des eaux
|
- Eutrophisation
- Diminution des ressources halieutiques
|
|
.Production de CH4
|
Augmentation de l'effet de serre
|
|
.Coût élevé
|
Réduction des marges bénéficiaires
|
|
Défriche /déforestation
|
-Diminution du potentiel floristique
-Empiètement des limites des réserves
forestières
|
- Déséquilibre écologique - Perte
diversité biologique - Changement climatique
|
Tableau 22 : Grille de quelques impacts
environnementaux
5.2 Mesure d'atténuation des effets
préjudiciables
Les impacts réels ou potentiels de la culture de coton
exigent d'entreprendre des actions pour atténuer les effets pervers. En
effet, l'exploitation des ressources naturelles ne saurait se limiter à
la satisfaction seulement des besoins actuels. Il faut entreprendre des actions
pour une utilisation rationnelle des ressources naturelles support des
activités anthropiques.
L'utilisation des biens environnementaux de la zone
nécessite l'adoption d'attitudes et de pratiques pour la sauvegarde de
la santé écosystémique.
Dans cette optique, pour la préservation de la
santé et des ressources naturelles de la région, il ressort que
:
. 81,97% de nos interlocuteurs estiment qu'il
leur faut du matériel de protection et bénéficier de
formations sur les itinéraires techniques agricoles,
. 9,83% proposent à cet effet l'abandon
de la culture du coton avec une orientation vers les autres
spéculations
. et 8,20% des enquêtés pensent que
l'utilisation des bio pesticides et l'adoption du coton biologique
préserveraient leur santé.
En ce qui concerne le coton biologique, 43,33% disent n'avoir
pas de connaissances à ce sujet et 56,67% affirment en avoir
déjà entendu parler. En outre, 23,33% des cotonculteurs
interviewés disent n'avoir pas reçu de formation alors que 76,67%
affirment en avoir déjà bénéficié en
matière de gestion des ressources naturelles. Selon les
interviewés, ces formations et sensibilisations ont été
assurées par les sociétés cotonnières (67%), par
l'UICN (18%) et les services de l'agriculture et de l'environnement (15%).
.
5.3 CONCLUSION PARTIELLE
La protection et la gestion rationnelle des potentiels
fauniques et floristiques sont un gage pour le succès des projets de
développement de la zone. Il est donc nécessaire de
réfléchir sur des dispositifs en vue d'atténuer les
impacts environnementaux (direct et indirect) identifiés. Des risques
sanitaires et des impacts potentiels sur l'environnement ont été
révélés. Il ressort que la culture cotonnière dans
la zone présente des risques qui n'épargnent aucune matrice
écologique. Les effets probables notamment la contamination de toute la
chaîne alimentaire et l'altération physique du milieu naturel sont
à redouter.
| 

