CHAPITRE I : REVUE D E L A LITTÉRATURE
I .1 . G É N É R A L I T É S SUR L A
D R É P A N O C Y T O S E
I .1 .1 . Définition e t historique d e l a d r
é p a n o c y t o s e
? D é f i n i t i o n
E n général, l a d r é p a n o c y t o s
e est une h é m o g l o b i n o p a t h i e regroupant u n ensemble d e
maladies génétiques transmissibles, caractérisées
par une synthèse a n o r m ale d ' h é m o g l o b i n e ,
protéine sanguine servant a u transport des gaz respiratoires (
oxygène, dioxyde d e carbone) ( C h e t c h a e t a l .,
2 0 1 8 ) . L a d r é p a n o c y t o s e S S o u
anémie f a l c i f o r m e quant à elle est une affection
génétique héréditaire grave à transmission a
u t o s o m ale récessive dans laquelle les globules rouges prennent l a
forme d e faucille a u lieu d e leur forme normale d e disque. C ' e s t une h
é m o g l o b i n o p a t h i e due l a substitution d e l'acide
glutamique hydrophile par l a valine hydrophobe e n position six d e l a
chaîne J d e l'hémoglobine. Cette substitution modifie son a f f i
n i t é p o u r l ' o x y g è n e e t s a solubilité d a n
s l e s c o n d i t i o n s d e f a i b l e p r e s s i o n d ' o x y g
è n e . I l s ' e n suit l a p o l y m é r i s a t i o n e t l a
f a l c i f o r m a t io n des globules ( H u y n h - M o y n o t , 2 0
1 1 ) .
? H i s t o r i q u e
L e p r e m i e r article s c i e n t i f i q u e s u r l a d r
é p a n o c y t o s e est apparu i l y a plus d e 1 0 0 ans.
? E n 1 9 1 0 , Jam e s H e r r i c k ,
cardiologue décrit l e premier cas d e l a d r é p a n o c y t o
s e . Il
rapporta l a présence d e globules rouges e n faucille
a u niveau d u frottis sanguin d'un patient c a r i b é e n . S o n
bilan h é m a t o l o g i q u e m o n t r e une anémie
très prononcée.
? E n 1 9 1 5 , Cook e t M e y e r ont mis e n
évidence l a transmission héréditaire d e cette
m a l a d i e . E n e f f e t , l o r s d ' a n a l y s e s p
l u s p o u s s é e s , i l s o n t r e t r o u v é l e s d r
é p a n o c y t e s dans l e frottis sanguin d u père d'un d r
é p a n o c y t a i r e .
? E n 1 9 2 7 , Hahn e t G i l l e p s i e ont
rem arqué que l a déformation des globules rouges n ' a
lieu qu'en condition d'hypoxie.
? E n 1 9 4 0 , S h e r m a n , é t u d i
a n t e n m é d e c i n e , s u g g è r e même qu'un bas
niveau e n oxygène
altère l a structure d e l ' h é m o g l o b i n e
dans l a cellule.
? E n 1 9 4 9 , N e e l a démontré
que l a transmission d e cette maladie e s t g é n é t i q u e .
L a même
année, Pauling e t I t a n o montrent
qu ' elle est due à une structure a n o r m ale d e l ' h é m o g
l o b i n e , moins s o l u b l e . D ' o ù l a première
découverte d e l 'o r i g i n e m o l é c u l a i r e d ' u n e m
a l a d i e génétique.
? L'année 6 0 , fut l'année d e découverte d
u gène d e l a chaîne 13-globine, situé sur l e
5
c h r o m o s o m e 1 1 .
? E n 1 9 5 7 , I n g r a m m o n t r e q u e l
a d r é p a n o c y t o s e e s t d u e à u n r e m p l a c e m e
n t s u r l e codon
6 d'un acide g l u t a m i q u e par une valine a u niveau d e l
a 13-globine S
? E n 1 9 8 0 , Kan e t a l
ont mis a u point u n test génétique
prénatal d e l a d r é p a n o c y t o s e c e qui perm e t ainsi
aux parents malades o u t r a n s m e t t e u r s d e l a d r é p a n o
c y t o s e d'établir u n diagnostic génotype d e l'enfant
à naître.
? E n 1 9 9 9 , L e d e r b e r g ,
suggère suite à l a r e s s e m b l a n c e m o n t r
é e p a r H a l d a n e comparant
les cartes d e répartition d e l a malaria d ' une part e
t d e l a d r é p a n o c y t o s e d ' a u t r e part que l ' h
é m o g l o b i n e S pouvait apporter u n avantage dans les
régions o ù l a malaria était présente.
I .1 .2 . M a n i f e s t a t i o n s d e l a d r
é p a n o c y t o s e
L a d r é p a n o c y t o s e est une affection
caractérisée par une production d e l ' h é m o g l o b i
n e S ( H b S ) anormale due à une mutation ponctuelle, faux sens e t
non conservative d e l'acide g l u t a m i q u e p a r l a valine e n position
6 d e l a chaîne J d e l a globine ( tableau 1 ) .
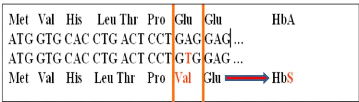
Tableau 1 : Cause moléculaire d e l a d r
é p a n o c y t o s e ( H i e r s o , 2 0 1 5 )
L'hémoglobine S a tendance à s e
polymériser dans s a forme désoxygénée, c e qui est
à l'origine des multiples manifestations des s y n d r o m e s d r
é p a n o c y t a i r e s ( H u y n h - M o y n o t , 2 0 1 1 )
parmi lesquels :
? L'anémie : elle désigne u n
manque d'hémoglobine ( o u d e globules rouges) e t s e traduit par une
fatigue excessive e t une sensation d e f a i b l e s s e . L o r s q u e
l'anémie est assez sévère, l e malade peut avoir des
difficultés à respirer ( e s s o u f f l e m e n t) e t une
accélération des b a t t e m e n ts
d u coeur ( t a c h y c a r d i e ) . L e s signes visibles
sont l a fatigabilité e t une couleur jaune des yeux o u d e l a peau,
appelée jaunisse ( o u i c t è r e ) , e t une coloration
foncée des urines, conséquence d'un taux élevé d e
l a bilirubine produit d e l a dégradation d e l ' h é m o g l o
b i n e des hématies. L a sévérité d e
l'anémie varie a u cours d u tem p s . E l l e peut s'aggraver b r u t a
l e m e n t e n cas d e f o n c t i o n n e m e n t
6
e x c e s s i f d e l a r a t e , o n parle d e
séquestration splénique ( splénique : qui s e rapporte
à l a rate), o u e n cas d'infections à l'origine d e crises
dites aplasiques ( elles sont dues à l ' a r r ê t t e m p o r a i
r e d e fabrication des globules rouges) ( Beaune e t a l , 2
0 0 9 ) .
? Aggravation d e l ' a n é m i e , e l l
e e s t g é n é r a l e m e n t c a u s é e par:
? Séquestration splénique : l e f
o n c t i o n n e m e n t i n t e n s i f d e l a rate est une manifestation
qui s e retrouve s u r t o u t c h e z l ' e n f a n t . L a
rate est u n organe situé e n haut à gauche d e l'abdomen e t
dont l'un des rôles est d e filtrer l e sang e t d ' é l i m i n
er les substances nuisibles ( bactéries, toxines... ) . Les
manifestations d e l a séquestration splénique sont : des
douleurs a b d o m i n ales, une a u g m e n t a t i o n très soudaine d
u v o l u m e d e l a rate ( s p l é n o m é g a l i e ), une
pâleur marquée e t d e manière générale, une
aggravation d e toutes les manifestations d e l'anémie ( o r p h
a n e t , 2 0 1 1 ) .
L a séquestration splénique peut mettre l a vie
e n danger, surtout chez les enfants d e moins d e sept ans. E n cas d e
séquestration splénique, i l est conseillé d e conduire l
e malade e n urgence à l'hôpital d e référence.
? Crises aplasiques : elles s e c a r a c t
é r i s e n t p a r d e s manifestations telles que d e l a
fièvre,
des maux d e tête ( céphalées), des
douleurs abdominales, une perte d'appétit o u des v o m i s s e m e n t
s . Ces manifestations sont transitoires. Ces crises peuvent être
liées à une infection par l e p a r v o v i r u s B 1 9 o u
à u n manque e n vitamine B 9 ( acide folique) qui doit être
prise
r é g u l i è r e m e n t p a r l e s personnes
d r é p a n o c y t a ir e s . L ' i n f e c t io n par le p a r v o v i
r u s B 1 9 s e manifeste par une éruption sur l a peau (
érythème) ; c'est une affection fréquente e t
bénigne qui passe souvent inaperçue chez les enfants non d r
é p a n o c y t a i r e s ( o r p h a n e t , 2 0 1 1 )
.
? Les crises douloureuses o u crises v a s o - o c c l u
s i v e s : ils sont dues à l a « mauvaise »
irrigation e n sang d e certains organes, s e manifestent par
des douleurs vives e t brutales dans c e r t a i n e s p a r t i e s d u corps
e t p e u v e n t , à l a longue, e n t r a î n e r l a
destruction d e certains organes o u parties d'organes : l a nécrose.
Ces douleurs sont les m a n i f e s t a t i o n s l e s p l u s
fréquentes d e l a maladie : elles peuvent être soudaines ( o u
aiguës) e t transitoires ( c'est-à-dire durer quelques heures o u
quelques jours) o u chroniques ( c'est-à-dire durer plusieurs s e m a i
n e s ) . I l arrive aussi que les deux types d e crises coexistent chez u n
même individu ( douleur chronique à laquelle
s ' a j o u t e n t d e s crises b r u t a l e s ) . E l l e s
sont favorisées par l a d é s h y d r a t a t i o n , c ' e s t p
o u r q u o i i l est recommandé d e boire beaucoup d'eau, mais elles
sont aussi favorisées par l e froid, l'altitude, l e stress, les efforts
excessifs, les infections... Toutes les parties d u corps peuvent peut
être c o n c e r n é e s , m ais certains organes s o n t p l u s
sujets que d'autres aux crises v a s o - occlusives : les
7
o s , les pieds e t l e s m a i n s , l e s p o u m o n s , l
e c e r v e a u . L e s crises s e m a n i f e s t e n t d i f f é r e m
m e n t s e lo n l e o u les organe(s) a t t e i n t ( s ) . I l p e u t s ' a
g i r d e douleurs a b d o m i n a l e s , f r é q u e n t e s chez l '
e n f a n t e t plus r a r e m e n t c h e z l'adulte ( Beaune e t
a l , 2 0 0 9 ) .
? Atteinte des o s e t des articulations ( atteinte o s t
é o - a r t i c u l a i r e ) : l'atteinte o s t é o
-
a r t i c u l a i r e est très f r é q u e n t e
, s u r t o u t après l'âge d e cinq ans. Elle s e manifeste par
des douleurs osseuses o u articulaires l e plus s o u v e n t b r u t a l e s e
t qui peuvent changer d e localisation dans l e corps. Elles sont dues à
des gonflements à l'intérieur d'un o s ( oedème i n t r a
- o s s e u x ) . Les douleurs surviennent surtout dans les o s des jambes e t
des bras e t dans l a colonne vertébrale mais peuvent aussi toucher l e
bassin, l a poitrine o u l a tête. Les crises douloureuses, sont d i f f
i c i l e m e n t prévisibles. A terme, des parties d'os peuvent
être détruites ( infarctus osseux o u
o s t é o n é c r o s e ) c e q u i p e u t
conduire à des complications articulaires ( Beaune e t a l ,
2 0 0 9 ) :
? L e s y n d r o m e pied-main o u d a c t y l i t e :
c e syndrome concerne e x c l u s i v e m e n t l ' e n f a n t,
a v a n t l ' â g e d e deux a n s . L e ( s ) p i e d (
s ) et/ou l a o u les m a i n ( s ) d e v i e n n e n t c h a u d s , g o n f l
é s , e t l e s mouvements sont douloureux. Cela peut être l a p r
e m i è r e manifestation d e l a maladie chez les jeunes enfants,
associée o u non à d e l a fièvre.
? L e s y n d r o m e thoracique aigu : i l s e
manifeste par une fièvre, une gêne o u des
difficultés respiratoires ( dyspnée), une
respiration rapide, une toux, e t des douleurs dans l a poitrine. L a
radiographie des poumons montre l a présence anormale d e taches
blanches ( infiltrats pulmonaires). Chez l'enfant i l est souvent d û o u
associé à une infection des
p o u m o n s ( o r p h a n e t , 2 0 1 1 )
? Les accidents vasculaires cérébraux (
A V C ) o u « attaques cérébrales » : les
manifestations sont très variables, e t peuvent être transitoires
( o n parle alors d'accidents i s c h é m i q u e s t r a n s i t o i r
e s o u A I T ) : pertes d e sensibilité o u d e force dans u n b r a s
, u n e j a m b e , l a moitié d u visage, o u tout l e
côté d u corps, paralysie d'un côté d u corps o u
d'un membre ( h é m i p l é g i e ) , maux d e tête (
céphalées), difficultés soudaines à parler (
aphasie), troubles d e l ' é q u i l i b r e , c o n v u l s i o n s ( m
o u v e m e n ts saccadés d e s m e m b r e s a v e c p e r t e d e c o
n s c i e n c e ) , p a r f o is coma. Des maux d e tête violents o u des
difficultés d'apprentissage s o u d a i n e s p e u v e n t être
des signes d'alerte.
? L a susceptibilité accrue aux infections :
Les principaux facteurs expliquant l a grande
sensibilité des d r é p a n o c y t a i r e s
aux infections sont l ' a s p l é n i e fonctionnelle (
non-
fonctionnement de l a rate) e t les troubles d e l a phagocytose. E n
effet i l y a l a suppression d e l'activité m a c r o p h a g i q u e e
t immunologique d e l a rate avec diminution d e l a synthèse d ' I g
M
8
spécifiques ; l a diminution d e l a production d e t u
f t s i n e , qui stimule l a migration des polynucléaires e t favorise
l a phagocytose ; l e défaut d ' o p s o n i s a t i o n qui rend
inopérante l a voie
c o m p l é m e n t a i r e alterne d e défense
contre l'infection ; les débris tissulaires dus à l a
nécrose qui sont des sites d e colonisation b a c t é r i e n n e
. L e s enfants, e t dans une moindre mesure les adultes, sont très
sensibles aux infections bactériennes q u i p e u v e n t s e
développer d e manière fulgurante e t doivent donc être
traitées r a p i d e m e n t . L e s personnes sont plus s p é c
i a l e m e n t sensibles aux p n e u m o n i e s ( infections des p o u m o n
s ) , à l a grippe, mais aussi aux hépatites ( infections d u
foie), aux méningites ( infections d e l'enveloppe d u cerveau), aux
infections urinaires e t aux
septicémies ( infections graves
généralisées). E n outre, les infections provoquent
des
complications propres à l a d r é p a n o c y t o s e :
aggravation brutale d e l ' a n é m i e , a u g m e n t a t i o n d u
risque d e crises v a s o - o c c l u s i v e s , e t a u g m e n t a t i o n d
u risque d'occlusion des vaisseaux e n général... L e risque
d'infection e s t d o n c une conséquence très
sévère d e l a d r é p a n o c y t o s e , c e la reste
une cause d e mortalité dans l'enfance. Cependant, les t r a i t e m e n
t s préventifs perm e t te n t g é n é r a l e m e n t
d'éviter les infections graves. Chez l'enfant, i l est très
important d e prévenir les sources d e bactéries ( foyers
infectieux) chroniques ( a u niveau des d e n t s , d e s a m y g d a l e s , d
e s o s ,
d e l a vésicule biliaire...) e n s'assurant d'une
bonne hygiène, d e maintenir à jour leurs v a c c i n a t i o n s
, e t d e s ' a s s u r e r q u ' i l s p r e n n e n t l ' a n t i b i o t iq
u e q u i l e u r e s t p r e s c r i t ( pénicilline) tous les jours,
sans oubli ( o r p h a n e t , 2 0 1 1 ) .
I .1 .3 . E p i d é m i o l o g i e e t
étiologie d e l a d r é p a n o c y t o s e
L e d r é p a n o c y t o s e est l'affection
génétique l a plus fréquente dans l e monde ( P i
e l e t a l ., 2 0 1 3 ) . Selon l'Organisation M o n d i a l
e d e l a Santé ( O M S ) , environ 5 % d e l a population mondiale
seraient porteuses d'une mutation d r é p a n o c y t a i r e avec une
forte concentration e n
Afrique s u b s a h a r i e n n e ( figure 1 ) . Selon
l'organisation mondiale d e lutte contre l a
d r é p a n o c y t o s
e , o n enregistre 5 0 0 mille enfants naissant chaque année atteints d
e cette pathologie dans l e m o n d e , d o n t 4 0 0 mille e n A f r i q u e .
L a p r é v a l e n c e d u t r a i t d r é p a n o c y t a i r e
est très élevée e n Afrique ( 1 0 à 2 5 % ) e t
atteint 1 0 à 1 5 % e n Afrique c e n t r a l e , 6 à 1 0 % e n
Afrique d e l ' O u e s t ( C eli n e , 2 0 0 9 ) . L ' O M S
enregistre environ 5 % d e décès d'enfants d r é p a n o c
y t a i re s d e moins d e 5 ans sur l e continent africain e t environ 9
à 1 6 % s e trouve e n Afrique d e l'ouest ( A t e c b o s e t
a l ., 1 9 9 7 ) . A u Cam e r o u n , l a p r é v a l
e n c e des porteurs sains d r é p a n o c y t a i r e est
e s t i m é e à 2 5 - 3 0 % ( f o r m e h
é t é r o z y g o t e ) , e t d e 2 % d a n s s a f o r m e h o m
o z y g o t e S S ( I E C D , 2 0 1 6 ) . L a morbidité
e t l a mortalité associées à cette pathologie restent
élevées avec l e seuil d e 1 % des patients a t t e i g n a n t l
' â g e adulte ( O M S , 2 0 1 6 ) .
9
I n i t i a l e m e n t , l a d r é p a n o c y t o s e
était retrouvée dans les régions e n d é m i q u e
s pour l e paludisme : Afrique sub-saharienne, bassin
méditerranéen ( notamment e n Grèce e t e n Italie), Moyen
Orient e t certaines parties d u sous-continent indien e t dans l a
péninsule Arabique ( L a b i e , 2 0 1 0 ; P i e l e t a l
., 2 0 1 0 ) . Suite à d'importants mouvements des
populations, l a
d r é p a n o c y t o s e s'est étendue
indépendamment d u paludisme, p r i n c i p a l e m e n t l e long des
côtes orientales des Amériques, dans les Caraïbes e t e n
Europe d e l'Ouest ( P i e l , 2 0 1 3 ) . Les flux
migratoires récents ont é g a l e m e n t fait d e l a d r
é p a n o c y t o s e l a p r e m i è r e maladie
génétique e n France hexagonale ( Roberts e t M o n t a l
e m b e r t , 2 0 0 7 ) .
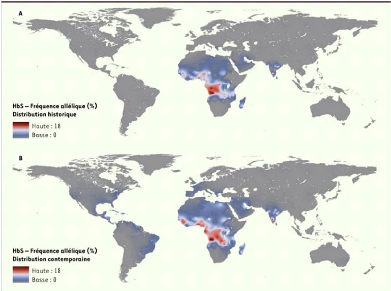
Figure 1 : Distribution historique e t
contemporaine ( 2 0 1 0 ) d e l a d r é p a n o c y t o s e ( P
i e l e t a l ., 2 0 1 0 )
I .1 .4 . Physiopathologies d e l a d r é p a n o
c y t o s e
? Rappel sur l ' h é m o g l o b i n e
L ' h é m o glob ine hum a i n e norm ale e st un p i g m
e n t pro t é i q u e c o m p l e x e coloré rouge, riche
e n fer e t contenu dans les h é m a t i e s . E l l e
représente 9 5 % des protéines i n t r a c e l l u l a i r e s .
S o n rôle physiologique principal est d'assurer l e transport des gaz
respiratoires entre les poumons e t tissus ( E l l e u c h , 2 0 0 4
) e t s u b s i d i a i r e m e n t participer aussi a u maintien d e
l'équilibre a c i d o - basique grâce à u n échange
d e proton avec les groupements aminés e t c a r b o x y l i q u e s d e
certains ses acides constitutifs ( G ir a u d e t e t a l ., 2
0 0 8 ) . Elle est une h é m o p r o t é i n e d e
structure
1 0
t é t r a m é r i q u e d e poids
moléculaire 6 4 4 5 8 d a l t o n s ( Raisonner, 2 0 0 2
) , constituées d e quatre sous-unités polypeptidiques
identiques deux à deux : deux polypeptides o u globines alpha ( á
d e 1 4 1 acides a m i n é s ) d o n t l e u r s gènes d e
structures s o n t p o r t é s par le chromosome 1 6 e t deux g l o b i
n e s n o n - a l p h a ( d e 1 4 6 a c i d e s a m i n é s ; b ê
t a , â p o u r l ' h é m o g l o b i n e a d u l t e A , H b A ;
gamma, ã pour l'hémoglobine foetale, H b F e t delta, ä pour
l'hémoglobine A 2 , H b A 2 ) portés par l e chromosome 1 1 . Ces
c h a i n e s sont unies par des liaisons non covalentes ( figure 2 ) (
Tertian, 2 0 0 8 ) . Chaque c h a i n e d e globine
possède u n groupe prosthétique appelé hème ( donc
s a biosynthèse est catalysée par l ' h è m e
synthétase), constitué d'une p r o t o p o r p h y r i n e I X e
t d'un atome d e fer divalent qui fixe l'oxygène ( B e u l t l e
r e t a l ., 2 0 0 1 ) . Son affinité pour
oxygène
+
d i m i n u e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e l a c o
n c e n t r a t i o n e n p r o t o n s H ( a c i d o s e ) , d i o x y d e d e
carbone ( C O 2 ) , ions C l - , 2 ,3 - d i p h o s p h o - g l y c
é r a t e ( 2 ,3 - D P G ) , tem p é r a t u r e f a v o r i s a
n t l a dissociation d e l'oxyhémoglobine ( H b O 2 ) e t par
conséquence, favorise une meilleure oxygénation tissulaire (
L i a n e t a l ., 1 9 7 1 ) .
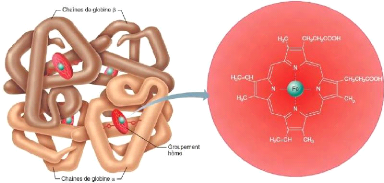
Figure 2 : Ultra structure d e l ' h é m
o g l o b i n e ( C o u q u e , 2 0 1 3 )
Les h é m o g l o b i n o p a t h i e s regroupent
l'ensemble des pathologies liées à une anomalie
génétique d e l ' h é m o g l o b i n e ( C o u p
r i e , 2 0 0 0 ) . L ' a n o m a l i e porte sur les chaînes d
e globine, elle peut être quantitative o u qualitative: dans l e p r e m
i e r cas une chaîne peut être absente o u e n quantité i n
s u f f i s a n t e , c ' e s t l e cas des t h a l a s s é m i e s ;
alors que dans l e second cas i l s'agit d'une mutation ponctuelle d'un
gène codant pour une c h a i n e , c'est l e cas d e l a d r é p
a n o c y t o s e S S ( V i n a t i e r , 2 0 1 0 ) . E n e f
f e t c e s a n o m a l i e s g é n é t i q u e s p o r t a n t
sur les c h a i n e s d e globine peuvent
e n t r a i n e r des modifications structurales d e l ' h
é m o g l o b i n e e t c o m prom e t t r e leurs fonctions
physiologiques: c'est l e cas d e l a d r é p a n o c y t o s e dont l a
p h y s i o p a t h o l o g i e s'explique à plusieurs niveaux.
1 1
? Niveau m o l é c u l a i r e
L o r s q u e l a pression e n oxygène est basse, i l y
a l a p o l y m é r i s a t i o n , l a r i g i d i f i c a t i o n e t
l a diminution d e solubilité d e l ' h é m o g l o b i n e S ( H
b S ) . Ceci Explique les deux signes majeurs d e l a maladie : l ' a n
é m i e hémolytique e t l ' o b s t r u c t i o n d e l a m i c r
o c i r c u l a t io n ( figure 3 ) . Cette polymérisation est
réversible dans les conditions d e r é o x y g é n a t i o
n . A p r è s plusieurs cycles d e
d é s o x y g é n a t i o n e t r é o x y
g é n a t i o n , les cellules perdent leur flexibilité e t
deviennent
d é f i n i t i v e m e n t d é f o r m é e
s e n d r é p a n o c y t e s i r r é v e r s i b l e s . L a p o
l y m é r i s a t i o n d e l ' H b S résulte d e l a form a t i
o n d ' une liaison hydrophobe entre l e groupe isopropyl d e l a valine d e l
a chaîne J d e l a d é s o x y h é m o g l o b i n e e t
une cavité formée par les chaînes d e l a
phénylalanine 8 5 ( noyau benzénique) e t d e l a leucine 8 8 (
groupe isopropyl) d ' une autre molécule d e d é s o x y h
é m o g l o b in e H b S . l a p o l y m é r i s a t i o n peut
être m o d u l é e par différents facteurs parmi lesquels l
a saturation e n oxygène qui est i n d i r e c t e m e n t
corrélée à l a p o l y m é r i s a t i o n , l a
concentration d e l ' H b S qui est i n d i r e c t e m e n t
corrélée a u temps d e p o l y m é r i s a t i o n e n cas
d e d é s o x y g é n a t i o n , l a teneur e n 2 ,3 D P G ( i l
diminue l ' a f f i n i t é d e l ' H b pour 1 ' 0 2 e t
favorise s a conformation d é s o x y e t donc l a p o l y m é r
i s a t i o n d e l ' H b ) , l e p H e t l a tem p é r a t u r e ( l a
p o l y m é r i s a t i o n a u g m ente e n milieu acide e t lorsque l
a tem p é r a t u r e a u g m ente), l e déficit e n g l u c o
se-6-phosphate déshydrogénase ( E .C 1 o x y d o - r é d u
c t a s e , enzyme d e l a voie d e pentose phosphate, impliquée dans
régénération d u coenzyme r é d u i t N A D P H )
( G a l a c t e r o s , 1 9 9 7 ; G i r o t , 2 0 0 3 ) .
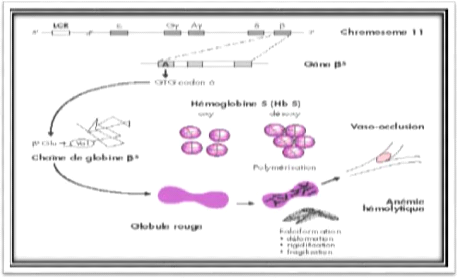
1 2
Figure 3 : Schéma physiopathologique d e
l a d r é p a n o c y t o s e ( E l i o n e t a l ., 1
9 9 6 ) .
? Niveau cellulaire
A u niveau cellulaire, l a p o l y m é r i s a t i o n d e
l ' H b S induit toute une série d e modifications dans l ' h é m
a t i e : l a déshydratation des h é m a t i e s . E n effet l a
p o l y m é r i s a t i o n d e l ' H b S modifie l a
* * 2 * 2 *
p e r m é a b i l i t é d e l a m e m b r a n e d e
s g l o b u l e s r o u g e s a u x c a t i o n s ( N a , K , M g , C a ) .
Elle a u g m ente l a perm é a b i l i t é d e l a membrane d u
globule rouge, favorise l ' e n t r é e d e C a 2 * dans l a cellule. C
e qui active les canaux causant l ' e x t e r n a l i s a t io n d u K * d e l
a cellule pour maintenir
l ' é q u i l i b r e o s m otique e t h y d r i q u e . D
a n s cette circonstance l 'eau e t l e s ions chlorures ( C l -) fuient
|
2 *
d a n s l e m i l i e u e x t r a c e l l u l a i r e . L ' e x
c è s d e C a
|
intracellulaire s ' a c c u m u l e dans des vésicules
|
d ' e n d o c y t o s e c e qui empêche s a
détection par les pompes à ATP, chargées d e son
évacuation.
2 *
D e p l u s , l a d é s h y d r a t é é r y
t h r o c y t a i r e a u g m e n t e l a p e r m é a b i l i t é
a u M g . S a concentration i n t ra
é r y t h r o c y t a i r e dim i n ue f o r t e m e n t ,
e n t r a i n a n t une a u g m e n t a t i o n d e l ' a c t i v a t i o n d u
C o -
*
t r a n s p o r t e u r K e t C l - responsable d ' une fuite
encore plus importante d e K * e t C l .. Cet ensemble
d e perturbation des échanges ioniques m e m b r a n a
i r e s e n t r a i n e non s e u l e m e n t l a déshydratation des h
é m a t i e s mais aussi l a form a t i o n d e grandes fibres d e p o l
y m ères d ' H b S entraînant toute une série
d'altérations m e m b ra n a i re p a r m i l e s q u e l le s l a
libération des h é m i c h r o m e s e t induisant
e n particulier des a g g l o m é r a t s d e
protéine bande 3 sur les membranes é r y t h r o c y t a i r e s
o ù s ' a c c u m u l e n t des immunoglobulines G ( I g G )
anti-bande-3 donnant ainsi des signaux d e leur
1 3
destruction par les macrophages. L a libération d e l ' h
è m e e t d e F e 3 + favorise u n
m i c r o e n v i r o n n e m e n t o x y d a n t d e s p h o s p
h a t i d y l s é r i n e s ( G i r o t , 2 0 0 3 )
.
? Niveau vasculaire
L a d r é p a n o c y t o s e est une pathologie a u
cours d e laquelle i l existe une tendance à l ' h y p e r v i s c o s i
t é . L a libération p r é m a t u r é e des r
é t i c u l o c y t e s dans l a circulation sanguine d u fait d ' une
é r y t h r o p o ï è s e accrue a tendance à
créer dans u n contexte i n f l a m m a t o ir e , une adhérence
des érythrocytes à l ' e n d o t h é l i u m vasculaire. C
' est l e facteur essentiel d u r a l e n t i s s e m e n t d e l a vitesse
sanguin e laissant l e tem p s à l a d é s o x y h é m o
glob i n e d e s e p o l y m é r i s e r, prendre u n e forme
d e faucille e t finir par obstruer c o m p l è t e m e
n t l e vaisseau, avec pour conséquence les crises v a s c o - o c l u s
i v e . E n outre, i l y a activation des plaquettes e t l ' a u g m e n t a t
i o n d u taux d e fibrinogène a u cours des crises v a s o - o c c l u
s i v e s ( G i r o t , 2 0 0 3 ) .
I .1 .5 . Diagnostic biologique d e l a d r é p a
n o c y t o s e
E n Afrique e t e n A m é r i q u e , l a d r é
p a n o c y t o s e est une affection héréditaire relativement
fréquente e t constitue u n r é e l p r o b l è m e d e
santé p u b l i q u e . L e s hématies prennent l a forme e n
faucille ( d r é p a n o c y t e ) quand l a concentration
d'oxygène s'abaisse e t f o r m e n t d e s thromboses suite à
une hémolyse ( C h e t c h a e t a l ., 2 0 1 8
) . I l est donc f o n d a m e n t a l d e pouvoir déceler
cette hémoglobine anormale afin d e développer des bons moyens d
e prise e n charge e t limité son
e x p a n s i o n . I l existe plusieurs techniques d e
diagnostic :
I .1 .5 .1 . Technique d e dépistage d e l a d r
é p a n o c y t o s e
? Test d e f a l c i f o r m a t i o n i n vitro ( test d
' E m m e l )
I l c o n s i s t e à p r i v e r l e s g l o b u l e s
r o u g e s d ' o x y g è n e . O n a l e t e s t d ' E m m e l s i m p
l e e t l e test d ' E m m e l a u m é t a b i s u l f i t e d e sodium
2 % . L e test d ' E m m e l simple est u n test classique, u n examen
microscopique d e cellules spontanément
désoxygénées entre lame e t lamelle. I l consiste à
placer une goutte d e sang entre lame e t lam e l l e , l u t e r à l a
paraffine o u à l a vaseline, l a i s s e r à l a
température d u laboratoire o u mettre à l'étuve e t lire
après 2 4 o u 4 8 heures ( E m m e l, 1 9 1 7 ) . L a
technique a u m é t a b i s u l f i t e d e sodium quant à elle
est plus rapide que l a p r e m i è r e , l a lecture s e fait a u bout
d e 5 à 3 0 minutes. L'intérêt d e ces deux techniques est
qu'elles sont fiables pour révéler l a présence des d r
é p a n o c y t e s . Cependant elles n e perm e t t e n t pas l a
distinction des formes hétérozygotes des formes homozygotes.
D'où i l s'est avéré nécessaire d e faire recours
à d'autres techniques plus spécifiques.
1 4
I .1 .5 .2 . L e s tech niques p h é n o t y p i q
u e s
Les techniques phénotypiques d'étude d e
l'hémoglobine font intervenir les méthodes b i o c h i m i q u e
s d e séparation des p r o t é i n é s . I l s'agit d e
:
? Électrophorèse à p H alcalin ( 8
,4 - 9 ,5 ) : Elle utilise différents supports ( papier, gel
d ' a m i d o n , a c é t a t e d e cellulose).
Principe : i l est basé sur l a
séparation des différentes fractions d e l ' h é m o g l o
b i n e ( contenues dans l ' h é m o l y s â t ) dans u n champ
électrique sur une plaque d'acétate d e cellulose à p H
alcalin e n fonction d e l e u r p o i d s moléculaire e t d e leur
charge électrique.
E n effet, L e sang est prélevé sur
anticoagulant E D T A e t lavé e n l'eau physiologique. Les globules
rouges sont ensuite l y s é s par l'eau distillée pour obtenir l
' h é m o l y s â t . L'étape suivante consiste à
faire deux dépôts d ' h é m o l y s â t ( à 3
c m d u pôle négatif d e l a cuve contenant l e tampon B d e
migration) sur l e support d'acétate d e cellulose p r é a l a b
l e m e n t traité avec l e tampon approprié ( A ) ,
laissé migré 2 h ( à 2 0 0 volts ; à 0 ,5 0 m A ;
à 2 0 ° C ) puis séchée l a plaque e t e n fin l a
colorer avec l e noir amide, l e rouge ponceau S o u l a benzidine. Cette
technique permette d'une part d e poser l e diagnostic e n mettant e n
évidence l a présence d'une fraction d ' h é m o g l o b i
n e d e migration différente des h é m o g l o b i n e s norm
ales e t d'autre part différencier les form e s h o m o z y g o t e s
des form e s h é t é r o z y g o t e s , a i n s i que l a
présence éventuelle d'une autre anomalie d e l ' h é m o g
l o b i n e a s s o c i é e ( B a l é d e n t e t G i r o
t , 2 0 1 6 ) .
? I s o é l e c t r o f o c a l i s a ti o
n
Principe : i l est basé sur l a
séparation des différentes fractions d'hémoglobine e n
fonction d e leur point isoélectrique dans u n gradient d e p H .
Dans c e s y s t è m e d e gradient l a protéine
arrête d e migrer quand elle arrive à son point
isoélectrique ( p H i ) o u s a charge nette est nulle. Cette technique
offre u n m e i l l e u r p o u v o i r d e résolution e t une meilleure
séparation des différentes d ' h é m o g l o b i n e s
( B a l é d e n t e t G i r o t, 2 0 1 6 ) .
I .1 .5 .3 . L e s tech niques g é n o t y p i q u
e s
Principe : i l repose sur l'étude des
gènes e t d e l'ADN par amplification moléculaire suivi d'une
analyse directe ( o l i g o s o n d e s spécifiques-D O T B L O T - P C
R ) o u d e séquençage a u locus d'intérêt.
C e t t e technique consiste p rem i è r e m e n t
à recueillir les cellule s f oe tales puis à l e s cultiver. Les
cellules obtenues sont h o m o g é n é i s é e s dans une
solution l y s a n t e qui sera ensuite traitée par
1 5
l a p r o t é i n a s e p o t a s s i q u e e t l ' A D N
sera e x t r a i t p a r l e m é l a n g e p h é n o l c h l o r
o f o r m e e t p r é c i t é p a r
l ' a l c o o l é t h y l i q u e à basse
température ( - 2 0 ° C ) e t e n fin analysé ( B a
l é d e n t e t G i r o t , 2 0 1 6 ) .
I .1 .6 . Com p l i c a t i o n d e l a d r é p a
n o c y t o s e
Les c o m p l i c a t i o n s d e l a d r é p a n o c y
t o s e sont variables selon les individus mais é g a l e m e n t selon
l a période d e vie ( chez u n même individu). O n les classe
généralement e n deux catégories : les complications a i g
ü e s e t les complications chroniques.
I .1 .6 .1 . C o m p l i c a t i o n s aigü e
s
E l l e s c o m prennent :
+ A n é m i e a i g ü e : l e
syndrome anémique constituait l e principal m o t i f d ' h o s p i t a
l i s a tio n
des patients d r é p a n o c y t a i r e s . E n effet,
i l est l a cause d ' i n t e r n e m e n t d e ces patients dans 2 5 ,4 % des
cas ( C h e t c h a e t a l ., 2 0 1 8 ) ;
+ Crises h y p e r a l g i q u e s : elles c
o n s t i t u e n t l a deuxième cause d e décès l a plus
récurrente
( 2 5 ,1 % des cas) ( C h e t c h a e t a l .,
2 0 1 8 ) ;
+ S y n d r o m e infectieux i n d é t e r m i
n é : l e s cris e s h y p e r h é m o l y t i q u e s e
t l e s p n e u m o p a t h ie s
font également parties des complications a i g ü e
s , comme les trois motifs cités ci-dessus, ils représentent 1 7
,3 % des cas ( C h e t c h a e t a l ., 2 0 1 8 )
.
I .1 .6 .2 . Com p l i c a t i o n s
chroniques
Les complications c h r o n i q u e s p e u v e n t s u r v e
n i r à tout âge mais touchent s u r t o u t l e s adultes. Elles
regroupent :
+ Atteintes o s t é o - a r t i c u l a i r e s
: elles s e traduisent par des douleurs répétées,
différentes
d e celles des crises, lancinantes, aggravées par des
mouvements e t l a marche e t s e calmant généralement a u repos.
L a fragilisation des o s due à leur mauvaise minéralisation est
plus fréquente e t e s t p r é s e n t e dans 1 4 ,6 8 % des cas
( N g o l e t e t a l ., 2 0 1 7 ) .
+ Atteintes p u l m o n a i r e s : ici une
hypertension artérielle p u l m o n a i r e peut a p p a r a i t r e , l
a
m a n i f e s t a t i o n principale e st un a c c r o i s s e
m e n t d e l ' e s s o u f f l e m e n t l o r s des efforts qui aboutissent
à des lésions a u niveau des poumons ( O r p h a n e t ,
2 0 1 1 ) .
+ Atteinte cardiaque : l'anémie
s'accentue souvent e t conduit à une augmentation
compensatrice d u volume cardiaque e t u n souffle a u coeur.
C e n ' e s t p a s i n q u i é t a n t . C e p e n d a n t , c e r t a
i n e s p e r s o n n e s p e u v e n t a v o i r d e s performances cardiaques
qui se d é g r a d e n t a v e c l ' â g e . P a r
1 6
exemple, l e coeur s e fatigue plus vite lors des efforts. L e
suivi régulier perm e t d e détecter c e problème (
O r p h a n e t , 2 0 1 1 )
+ Atteintes rénales : les reins peuvent
également être atteints. Cela s e traduit l e plus
s o u v e n t p a r l a présence d'albumine dans les
urines ( album i n u r i e ) . L e mauvais fonctionnement des reins peut
progresser vers une insuffisance rénale chronique o ù l e rein
n'assure plus s a fonction.
+ Atteinte oculaire : des s a i g n e m e n t s
à l'intérieur des yeux ( h é m o r r a g i e s i n t r a o
c u l a i re s )
p e u v e n t s u r v e n i r c h e z les enfants ( d e plus d e
1 5 ans g é n é r a l e m e n t ) . E l l e s l i m i t e n t p l
u s o u moins
c o m p l è t e m e n t ( c é c i t é ) l e
champ visuel.
+ Troubles d e l'érection : environ 4 0 %
des hommes adultes souffrent d'érections
involontaires prolongées pendant 1 0 à 1 5
minutes e t jusqu'à plusieurs jours, e t devenant r a p i d e m e n t d
o u l o u r e u s e s , i l s ' a g i t d e p r i a p i s m e . C ' e s t u n e
grande urgence car, s i c e l a dure plus d'une heure, i l expose à u n
risque d e lésions définitives des corps érectiles d u
pénis e t donc
d ' i m puissance ( O r p h a n e t , 2 0 1 1 )
.
+ Ulcères des jambes : certains patients
p e u v e n t a v o i r d e s p l a i e s plus o u moins profondes
( u l c è r e s ) s u r l e bas d e s j a m b e s e t l
e dessus des p i e d s . L e s ulcères s u r v i e n n e n t p l u s s o
u v e n t c h e z les h o m m e s q u e les f e m m e s d e plus d e 1 8 a n s
. I l s p e u v e n t m e t t r e l o n g t e m p s à s e r é s o
r b e r , c ' e s t pourquoi i l est important d e faire traiter r a p i d e m
e n t toute plaie à l a jam b e pour éviter l'évolution
vers l'ulcère, o u son aggravation. L'ulcère cutané
représente 2 9 ,5 1 % d e complications chroniques chez les patients d r
é p a n o c y t a i r e s ( N g o l e t e t a l ., 2 0
1 7 )
+ Calculs dans l a vésicule biliaire :
des calculs ( sorte d e cailloux appelés lithiases)
peuvent s e former à l'intérieur d e l a
vésicule biliaire ( lithiase biliaire). L a lithiase biliaire est
courante e t survient r e l a t i v e m e n t tôt dans l a vie. Ils
peuvent b r u t a l e m e n t p r o v o q u e r d e vives
douleurs dans l e ventre, e n haut à droite o u sous
l'épaule droite ( coliques biliaires).
Vomissements, fièvre,
sueurs o u frissons peuvent accompagner ces douleurs e t t é m oignent
d'une c o m p l i c a t i o n . D a n s c e cas, i l e s t nécessaire d
e c o n s u l t e r e n u r g e n c e . 4 0 ,3 1 % des malades
e n sont atteints après l'âge d e 1 8 ans (
N g o l e t e t a l ., 2 0 1 7 ) .
+ Atteinte hépatite : o n peut constater,
parfois dès l'enfance, une augmentation d u
v o l u m e d u foie ( h é p a t o m é g a l i e
) . L ' h é p a t o m é g a l i e est e n général
indolore, mais peut entraîner une gêne a b d o m i n a l e , r e s
s e m b l a n t à u n « poids » dans l e v e n t r e . L e
foie peut durcir e t , à terme, n e peut plus fonctionner normalement (
insuffisance hépatique). L'atteinte d u foie peut être
1 7
favorisée par des hépatites virales o u toxiques
( dues à l a prise d e certains médicaments par exemple) o u par
l'excès d e fer.
? Retard d e croissance : Souvent, dans les pays
o ù l a prise e n charge est bonne, les
enfants ont s e u l e m e n t u n léger retard d e
croissance e t leur puberté peut être retardée e n raison d
e l'anémie. Les adultes sont souvent minces, mais rarement plus petits
que l a moyenne ( O r p h a n e t , 2 0 1 1 ) .
I .1 .7 . Prise e n charge d e l a d r é p a n o c
y t o s e
I .1 .7 .1 . Principes généraux d e l a
prise e n charge
Ils sont basés sur l a mise e n place des centres
spécialisés, des opérations d e d é p i s t a g e ,
d e soins e t d e suivi, l e dépistage néo-natal, des
transfusions ponctuelles, l'éducation des parents, l a bonne pratique
des règles h y g i é n o - d i é t é t i q u e s ,
l a s u p p l é m e n t a t i o n quotidienne e n acide folique o u v i
t a m i n e B 9 , e n antibiotique e t l e t r a i t e m e n t d e s c o m p l
i c a t i o n s l i é e s à l a maladie.
I .1 .7 .2 . T r a i t e m e n t s
spécialisés
Les t r a i t e m e n t s spécialisés d e l a d r
é p a n o c y t o s e regroupent :
? Transfusion sanguine : l a transfusion
sanguine est l e t r a i t e m e n t g é n é r a l e m e n t u t
i l is é
dans l a prise e n charge d u patient d r é p a n o c y
t a i r e . Elle peut être effectuée lorsqu'on a une dim i n u t i
o n importante d u taux d'hémoglobine ( 6 à 7 g / d L ) o u e n
cas d'anémie a i g ü e ;
? Échanges transfusionnels : d e loin
préférés aux transfusions sanguines, ils peuvent s e
faire m a n u e l l e m e n t e n soustrayant l e sang total e
t effectuer une transfusion d e globules rouges. Ils présentent n
é a n m oins u n risque d e surcharge e n fer car i l est difficile
d'ajuster l e v o l u m e d e globules rouges transfusés a u volume s o
u s t r a i t . E l l e s p e u v e n t a u s s i c o n s i s t e r à
une soustraction sélective d e globules rouges des patients,
compensée par des concentrés d e globules rouges sains à
l'aide d'un séparateur d e cellules. Ils minimisent l e risque d ' a c c
u m u l a t i o n d u fer e t p e r m e t d e t r a i t e r l e s v o l u m e s
s a n g u i n s i m p o r t a n t s ( H A S , 2 0 1 0 ) ;
? Prise e n charge des infections : I l est g
é n é r a l e m e n t p r o p o s é pour les
bébés une prise
journalière d e pénicilline ; aux enfants des
vaccins supplémentaires contre les pneumocoques, l e virus d e l a
grippe e t d e l'hépatite B , e t avant tout une bonne hygiène d
e vie des patients ( O r p h a n e t , 2 0 1 1 ) .
? Prise d e l ' H y d r o x y u r é e o u h y d r
o c a r b a m ide : c e médicament agit e n réduisant
les
crises v a s o - o c l u s i v e , les é v è n e
m e n t s p u l m o n a i r e s par s t i m u l a t i o n d u gène d e
synthèse d e l ' H b F ; i l diminue ainsi l a production des radicaux
libres e t empêche l a capture d u N O par
1 8
l'hémoglobine libre libérée a u cours d e l
' h y p e r h é m o l y s e des globules rouges ( Chirico e
t
P i a l o u x , 2 0 1 2 ) .
? prise e n charge d e l a douleur : l a Haute
Autorité d e Santé ( H A S ) e t l ' A g e n c e
française
d e sécurité sanitaire des produits d e
santé ( A F S S A P S ) préconisent dans leurs protocoles d e
prise e n charge d e l a douleur les étapes suivantes ( H A S ,
2 0 1 0 ) : E n première intention, une a d m i n i s t r a t
io n intraveineuse d e K é t o p r o f è n e , Pour les crises
modérées, l a N a l b u p h i n e peut suffire, mais l e
soulagement insuffisant doit conduire à prescrire l a morphine sans
attendre. Pour les crises les plus s é v è r e s , l a morphine
est donnée d ' e m b l é e . P u i s pompe d'analgésie
auto contrôlée ( P C A ) s i l'enfant a plus d e 6 ans
? T r a i t e m e n t des complications : l a
prise e n charge des patients d r é p a n o c y t a i r e s passe
par une mise e n route des mesures préventives
après l e dépistage néonatal. Une surveillance
régulière d e l'état basal permet une prise e n charge
rapide des complications a i g ü e s e t chroniques. D e v a n t toute c o
m p l i c a t i o n , i l est réalisé une h y p e r h y d r a t a
t i o n d e façon systématique avec une prise d'antalgiques e t
d'antibiotiques e n fonction d u type d e
c o m p l i c a t i o n . U n e transfusion sanguine e n cas d
' a n é m i e profonde o u d ' i n f e c t i o n grave peut é g a
l e m e n t être effectuée ( H A S , 2 0 1 0 )
.
? A l l o g r e f f e des cellules souches hém a t
o p o ï é t i q u e s : l a greffe d e cellules souches
h é m a t o p o ï é t i q u e s est l e seul
traitement potentiellement curateur permettant d'espérer une
d i s p a r i t i o n c o m p l è t e e t
définitive des crises douloureuses e t des s y m p t ô m e s
liés à l'an é m i e . E lle vise à remplacer des
hématies S S par des hématies A A o u A S e t nécessite
une compatibilité entre l e donneur e t l e receveur. Toutefois, d e par
s a toxicité potentielle immédiate e t à long term e elle
est réservée aux enfants atteints de form e s
sévères ( A w a , 2 0 0 8 )
? Thérapie génique : L a
thérapie génique constitue u n autre mode d e t r a i t e m e n t
d ' un
trouble génétique par lequel o n insère d
e nouveaux gènes dans les cellules hum a i n e s . D a n s l e cas d e l
a d r é p a n o c y t o s e , l e s cellules souches d e l a moelle
osseuse d u malade sont p r é l e v é e s , u n vecteur porteur d
u gène sain est introduit dans les cellules afin d e les corriger e t
les cellules traitées sont r é i n j e c t é e s a u
malade ( C o t t i e r e t G u e r r y , 2 0 0 0 ) .
I .2 . D R É P A N O C Y T O S E E T
HÉMOLYSE
I .2 .1 . F o n c t i o n des globules rouges e t
rôle d e l a membrane é r y t h r o c y t a i r e
Les globules rouges sont d e petites cellules a n u c l é
é e s , d e form e biconcave contenant
e s s e n t i e l l e m e n t ( 2 / 3 ) l ' h é m o g l o
b i n e . I l s assurent p r i n c i p a l e m e n t grâce à l ' h
é m o g l o b i n e qui est u n p i g m e n t r e s p i r a t o i r e ,
l e transport d e l'oxygène, des poumons aux tissus, e t a u s s i l e
transport
1 9
d u dioxyde d e carbone ( C O 2 ) des tissus aux p
o u m o n s . L ' i n t é g r i t é d e s a membrane cellulaire e
t l e maintien d e s a structure est indispensable à son bon
fonctionnement. L a membrane é r y t h r o c y t a i r e est
constituée d'une b i c o u c h e p h o s p h o l i p i d i q u e dont
les deux couche sont opposées l'une d e l'autre par leur pole
hydrophobe. L e s parties hydrophiles regardent l a périphérie d
e l a b i c o u c h e . L a face externe d e l a b i c o u c h e est
dirigée vers l e cytoplasm e , e s t e n contact avec l e c y t o s q u
e l e t t e protéique globulaire. Des molécules d e c h o l e s t
é r o l v i e n n e n t s e positionner dans les zones hydrophobes.
Cette b i c o u c h e est é g a l e m e n t traversée de part e n
part par des protéines t r a n s m e m b r a n a ir e s , sur ces
protéines s e fixent des sucres d é t e r m i n a n t les groupes
s a n g u i n s . L e s plus i m p o r t a n t e s p r o t é i n e s m e
m b r a n a i r e s d e s érythrocytes sont l a bande
-
3 q u i p r é s e n t e u n a n t i p o r t p o u r l e
passage des ions d u chlore ( C l ) e t les s i a l o g l y c o p r o t
é i n e s qui jouent l e rôle d e transporteurs d e dioxyde d e
carbone ( C O 2 ) ( G i r a s o l e e t a l ., 2 0
1 2 ) .
I .2 .2 . É c h a n g e s m e m b r a n a i r e s
d e s globules rouges
Les transports t r a n s m e m b r a n a i re s peuvent
être regroupés e n deux mécanismes (
Figure
4 ) : les transports passifs selon l e gradient d e
concentration e t les transports actifs contre l e gradient d e concentration.
L a pompe à sodium correspond à une A T P a s e
magnésium-dépendante qui permet l a sortie d e 3 N a * d u
globule rouge e t l'entrée d e 2 K * . L e fonctionnement d e cette
pompe nécessite u n apport énergétique fourni par l ' A T
P issu d e l a glycolyse a n a é r o b i e . I l existe é g a l e
m e n t u n e pompe A T P a s e magnésium-dépendante q u i r e j
e tte
2 *
h o r s d e l ' h é m a t i e u n i o n C a . L e
transport des anions, notamment les ions C l - e t H C O 3 -,
s'effectue a u niveau d e l a protéine bande 3 t r a n
s m e m b r a n a ir e . L a sortie d'acide carbonique est
contrebalancée par une entrée d'ions C l - . L a protéine
3 p e r m e t é g a l e m e n t l e t r a n s p o r t d e l'eau à
travers l a membrane é r y t h r o c y t a i r e . ( L e n o r m
a n d , 2 0 0 1 ; Portier e t a l ., 2 0 0 7 ) .

2 0
Figure 4 : E c h a n g e s d e l a membrane
é r y t h r o c y t a i r e ( P a u r e g u i b e r r y , 2 0 1
5 ) .
Les globules rouges ont g é n é r a l e m e n t
une durée d e vie entre 1 0 0 e t 1 2 0 jours. Ce pendant dans l a d r
é p a n o c y t o s e cette durée d e vie est réduite
entre 1 0 - 1 6 jours à cause d e présence d e
l'hémoglobine anormale S ( Courtois e t a l ., 2 0 0 7
) .
I .2 .3 . Destruction des globules rouges : h é m
o l y s e
L'hémolyse est u n phénomène
physiologique irréversible qui aboutit à l a rupture d e l a
membrane des hématies provoquant l a libération des
éléments i n t r a - é r y t h r o c y t a ir e s dans l e
plasma notamment l'hémoglobine ( M e z z o u e t a l .,
2 0 0 6 ) . E n effet l'accumulation d e modifications sur l a
membrane d u globule rouge a u cours d u v i e i l l i s s e m e n t ( p e r o
x y d a tio n lipidique m e m b r a n a i r e , perte d e résidus
d'acide s i a l i q u e e t formation d e n é o - a n t i g è n e
s d e sénescence) sont autant d e signaux qui perm e t t e n t aux
macrophages d'identifier les globules rouges à é l i m i n e r p
a r phagocytose avec réutilisation des composants ( B e a u m
ont e t H e r g a u x , 2 0 0 5 ) . Chez les d r é p a n o c y
t a i r e i l y a u n d é p a s s e m e n t d u processus physiologique
d e lyse des globules rouges ( G R ) qui devient pathologique. C e
phénomène est d û à une destruction excessive des
hématies o u à u n r a c c o u r c i s s e m e n t d e leur
durée d e vie influencé par plusieurs f a c t e u r s .
2 1
I .2 .3 .1 . M é c a n i s m e s naturels e t
facteurs influençant l ' h é m o l y s e chez les d r é p
a n o c y t a i r e s
L a physiopathologie complexe d e l a d r é p a n o c y
t o s e est basée sur l'instabilité e t l a p o l y m é r
i s a t i o n d e l ' h é m o g l o b i n e a n o r m ale ( H b S ) . C
e qui induit des altérations structurales d e l a membrane d u globule
rouge provoquant une l i p o p e r o x y d a t i o n avec des réactions
radicalaires importantes, dont l a conséquence est
l'accélération d u processus d ' h é m o l y s e . E n
effet, les globules rouges d r é p a n o c y t a i r e s produisaient
plus d e radicaux libres que les globules rouges normaux suite à
l'auto-oxydation d e l'hémoglobine S e n m é t h é m o g l
o b i n e . C e c i explique l e déséquilibre dans les
proportions des radicaux libres générés ( impliqués
dans l ' a c t i v a t i o n d e
l ' a p o p t o s e ) e t l e répertoire a n t i o x y
d a n t i n h é r e n t a u s y s t è m e , o n parle d u stress
o x y d a t i f o u stress oxydant ; d'où l a dim i n u t i o n d e l a
durée d e vie des globules rouges chez les d r é p a n o c y t o
s e ( H e b b a n n i e t a l ., 2 0 1 4 ) . Par
ailleurs i l existe chez les d r é p a n o c y t a i r e s plusieurs
formes d e déficiences d ' e n z y m e s ( e n z y m o p a t h i e s )
pouvant causer l'an é m i e h é m o l y t iq u e , l a plu s
courante est l a déficience e n glucose 6 -phosphate
déshydrogénase ( G 6 P D , E .C 1 o x y d o - r é d u c t
a s e ) . L e déficit d e cet e n z y m e provoque u n déficit e
n N A D P H qui s e répercute sur l a régénération
d u g l u t a t h i o n r é d u i t e t p a r c o n s é q u e n t
s u r l'activité d u g l u t a t h i o n p e r o x y d a s e a u niveau
d u globule r o u g e . C e qui s e t r a d u i t p a r u n d é f a u t
e n peroxydes e t p a r c o n s é q u e n t l ' h y p e r h é m o
l y s e ( B é r a u d , 2 0 1 4 ) . D e plus les
hématies déformées, rigides, présentent des
lésions m e m b r a n a i r e s . L a dim i n u t i o n d e l a
plasticité des h é m a t i e s , leur rétention dans les
très petits vaisseaux, tout cela v a accélérer leur
destruction par les cellules réticulaires macrophages après une i
n f l a m m a t io n . Cette destruction accélérée
s'effectue surtout dans l a rate e t l e foie, avec libération d'un
excès d'hémoglobine dans l e plasma ( H i e r s o , 2 0 1
5 ) . L'hémolyse est manifestée par une augmentation des
taux sériques e n hémoglobine associée à une
augmentation d u lactate déshydrogénase ( L D H , E .C 1 o x y d
o - r é d u c t a s e ) , d e phosphate, d e l a créatine kinase
( C K , E .C 2 transférase) e t aussi par une dim i n u t i o n d u taux
d ' h a p t o g l o b i n e e t d ' h é m o g l o b i n e g l y c o s y
l é e ( A l i e t a l ., 2 0 1 4 ) .
I .2 .3 .2 . Les m é c a n i s m e s d e s
inducteurs d e l ' h é m o l y s e
L ' h é m o l y s e peut être produire par
l'introduction d'agents c h i m i q u e s tel que certains
m é d i c a m e n t s , c a p a b l e s d e modifier
l'intégrité cellulaire e n induisant une réorganisation e
t des c h a n g e m e n t s morphologiques qui résultent d'une cascade
d'effets à partir d e l'altération d e l a membrane lipidique
conduisant f i n a l e m e n t à l a form a t i o n d e s p h é r
o c y t e s e t par conséquent à l a lyse des érythrocytes
( Portier e t a l ., 2 0 0 7 ; M a n a a r g a d o o - C a t i
n e t a l ., 2 0 1 6 ) .
? M é c a n i s m e d e l ' h é m o l y s e
induite par l'aspirine : l'exposition des érythrocytes
hum a i n s à des agents oxydants tel que l'aspirine
à forte concentration favorise l ' h é m o l y s e par p e r o x
y d a t i o n lipidique d e l a membrane é r y t h r o c y t a i r e . E
n effet l'aspirine, précurseur d'acide salicylique d e par son effet
oxydant, peut e n t r a i n e r l a production des radicaux libres, ces
derniers attaquent l a membrane e t par conséquent causer l ' h é
m o l y s e ( H o u c h e r e t a l ., 2 0 0 1 ) .
? M é c a n i s m e d e l ' h é m o l y s e
induite par l a solution hypotonique : lorsqu'un
é r y t h r o c y t e est placé dans u n milieu
h y p o t o n i q u e , i l subit une pression o s m otique
considérable. E n absence d e contre-pression appliquée dans l e
cytoplasme, l'eau ( hypotonique) diffuse dans l a cellule ( hypertonique) via
les a q u a p o r i n e s e t protéines bandes 3 e t crée petit
à petit u n gonflement des hématies, au-delà d'un certain
seuil, l a membrane s'éclate e t l'hémoglobine intracellulaire
passe dans l e milieu extérieur ( h é m o l y s e ) ( A m
r a n e e t A o u a r t i l a n e , 2 0 1 8 ) .
? M é c a n i s m e d e l'hémolyse induite
par l e t r i t o n X - 1 0 0 : L e t r i t o n X - 1 0 0 est u n
d é t e r g e n t n o n ionique qui possède une
partie polaire hydrophile e t une queue hydrophobe. Les molécules d u t
r i t o n X - 1 0 0 s'insèrent dans l a b i c o u c h e lipidique
jusqu'à saturation provoquant ainsi l a perturbation d e l'organisation
des lipides m e m b r a n a i r e s qui sera t o t a l e m e n t
solubilisée sous forme d e micelles o u d e liposomes à des
concentrations très élevée e n détergent (
M u t h u
e t d u rais, 2 0 1 5 ) .
? M é c a n i s m e d e l ' h é m o l y s e
i n d u i t e p a r l e peroxyde d'hydrogène :
L'hémolyse induite
par l e peroxyde d'hydrogène résulte des
dommages o x y d a t i f s destructeurs d e l a membrane cytoplasm i q u e
suite à l a p e r o x y d a t i o n lipidique des acides gras p o l y i
n s a t u r é s ( A G P I ) présents dans celle-ci (Singh
e t R a j i n i , 2 0 0 8 ) . Lorsque l e H 2 O
2 traverse cette m e m b r a n e , i l p e u t causer
2 +
l a d é g r a d a t i o n d e l ' h è m e d e l ' h
é m o g l o b i n e a i n s i q u e l e s i o n s F e , c e qui
génère l e radical
hydroxyle qui est très r é a c t i f p a r l a
réaction d e Fenton. Ces radicaux induisent une c h a i n e d e p e r o
x y d a t i o n lipidique a b o u t i s s a n t à l'hémolyse
( O k o k o e t E r e , 2 0 1 2 ) . L a réaction d e
Fenton est initiée suite à l a formation initiale d e l`anion s u
p e r o x y d e qui e s t à l`origine d u phénomène
radicalaire car e n donnant l e peroxyde d`hydrogène i l peut alors s e
transformer e n radical hydroxyle :
I .2 .4 . L e s a n t i h é m o l y t i q u e
s
2 2
I .2 .4 .1 . Les a n t i h é m o l y t i q u e s
conventionnels
2 3
L e t r a i t e m e n t des a n é m i e s h é m
o l y t i q u e s passe i n e x o r a b l e m e n t par l e t r a i t e m e n t
des causes d e cette anémie. I l y a presque autant d e traitements
qu'il y a d e causes. U n certain nombre d e médicaments
anti-hémolytiques sont disponibles. C e sont les substances qui
présentent l a capacité à retarder o u à inhiber l
a lyse des globules rouges. Par exemple: l'acide folique o u vitam ine B 9 , u
n c o m p l é m e n t d e f e r , d e s s u p p l é m e n t s d e
vitam ine B e t d e s corticoïdes Sous forme des c o m p r i m é s
. ( B a c h h y e t a l ., 2 0 1 5 ) .
I .2 .4 .2 . Les a n t i h é m o l y t i q u e s
naturels
I l existe plu sieurs plantes donc l e s e f f e t s anti-h
é m o l y ti q u e s ont été déjà d é
m o n t r é s . C 'est l e cas par exemple d e l'effet protecteur d u
décocté aqueux des feuilles ( D A F ) e t d u
macéré h y d r o é t h a n o l i q u e des feuilles ( M H
F ) d e Ficus s y c o m o r u s contre l ' h é m o l y s e des
érythrocytes d e patients d r é p a n o c y t a i r e s h o m o z
y g o t e s ( S S ) e t double hétérozygotes ( S C ) . E n
effet Ram dé-Tiendrébéogo e t a l . ( 2 0
1 8 ) ont montré que l e M H F ( 2 m g / m L ) avait une
activité d'inhibition d e 3 1 ,0 2 #177; 0 ,0 0 % tandis que celle d u D
A F ( 3 m g / m l ) é t a i t d e 2 2 ,5 #177; 0 ,0 0 % . T h e
p h i n l a p e t a l .
( 2 0 1 3 ) ont révélé que
3 1 2 5 u g / m l d'extrait d e feuille d e P a n d a n o u s o d o r u s p a n
d a n u s Peut
inhiber 8 3 ,2 5 % d'hémolyse induite par l'ion
ferreux. D e même i l a été démontré
r e s
p e c t i v e m e n t p a r ces auteurs que les extraits s u i v a n t p o u r
r a i e n t i n h i b e r l ' h é m o l y s e induite par l e peroxyde
d'hydrogène : 4 0 .6 % pour 5 mg/ml d'extrait d e feuille d e Fiber
betel ; I C 5 0 = 9 5 1 .4 #177; 3 6 ì g / m l d'extrait d e
feuille d e M e n t h a l o n g ifo l i a ( C h a k r a b o r
t y e t Shah, 2 0 1 1 ; M a g a l h ã e s e t a l ., 2 0 0 9
) .
I .3 G É N É R A L I T É SUR S p
i r u l i n a p l a t e n s i s
I .3 .1 . D é couverte
S p i r u l i n a p l a t e n s i s e s t u n e
microscopique algue bleu-verte découvert i l y a 3 ,6 milliards d ' a n
n é e s . À l a naissance d e l'univers, ces c y a n o b a c t
é r i e s p r o d u i s a i e n t d e l'oxygène à p a r t
i r d u dioxyde d e carbone pour les autres formes d e vie présentes
à c e moment-là. Elles ont ainsi rendu l ' a t m o s p h è
r e respirable perm e t t a n t une possible vie aérobie, e t ont servi
d e nourriture aux poissons, mammifères marins e t à
l'espèce humaine. L a spiruline a survécu aux périodes
glaciaires grâce à s a capacité dite d e c r y p t o b i o
s e , c ' e s t - à - d i r e qu'elle est capable d e s e
rétracter sous form e d'agrégat d e f i l a m e n t s s i les
conditions d e tem p é r a t u r e e t d ' h u m i d i t é lui
sont d é f a v o r a b l e s , c o n s e r v a n t a u centre d e cet
agrégat u n minimum d'humidité pour s a survie, e n attendant que
les conditions redeviennent favorables ( M a n n e t , 2 0 1 6 )
.
2 4
I .3 .2 . H a b i t a t s naturel e t conditions o p t i
m ales d e culture
I .3 .2 .1 . H a b i t a t n a t u r e l
L a spiruline s e développe n a t u r e l l e m e n t
dans des lacs alcalins riches e n sels minéraux des régions
chaudes e t ensoleillées, soit dans une zone t r o p i c o - é q
u a t o r i a l e entre l e 3 5 ° d e latitude nord e t 3 5 ° d e
latitude Sud. Zone qui c o m porte plusieurs pays p r i n c i p a l e m e n t d
a n s trois continents. E n A f r i q u e ces pays sont : T c h a d , K e n y a
, T a n z a n i e ( lac N a t r o n ) , D j i b o u t i , É t h i o p i
e , Congo, Zambie, A l g é r i e , S o u d a n , e t T u n i s i e . E n
Europe les pays concernés sont: F r a n c e , C o r s e , Espagne ; e t
e n A s i e o n liste: I n d e , T h a ï l a n d e , M y a n m a r , Sri
Lanka, Pakistan, Chine e t e n A m é r i q u e : Pérou, M e x i q
u e , Uruguay, Équateur, C a l i f o r n i e , H aïti,
République Dom i n i c a i n e . Son habitat naturel est une eau : n a t
r o n é e ( contenant d u bicarbonate d e sodium naturel dont l e p H
doit être compris entre 8 ,5 e t 1 1 ) ; saumâtre ( d e 2 0
à 7 0 g d e sel par litre d'eau) ; chaude ( entre 3 5 e t 4 0 ° C )
; riche e n n u t r i m e n t s apportés par les affluents des lacs e t
des sols ( f e r , azote, urée, acide phosphorique, sulfate d e
magnésium...) e t riche e n gaz carbonique e t oxygène. S a
croissance varie durant l a journée, e n dessous d e 1 5 ° C e t
au-dessus d e 3 9 ° C , elle s ' a r r ê t e ; o ù l e r a y
o n n e m e n t solaire e s t i m p o r t a n t ( M a n n e t , 2 0 1 6
) .
I .3 .2 .2 . Conditions o p t i m ales d e
culture
E n dehors des conditions naturelles d e culture d e l a s p i
r u l i n e , p e u t faire une culture hors sol. L e bassin d e culture
idéal est e n béton o u e n p o l y c h l o r u r e d e vinyle (
P V C ) . Elle s e cultive sous serres pour protéger des i n t e m
péries: fientes d ' o i s e a u x , p o l l e n s , feuilles, soleil ;
mais aussi pour éviter les pluies diluviennes qui dilueraient l e milieu
d e culture, tout e n l a i s s a n t p a s s e r l a l u m i è r e . L
a taille d u bassin d e culture est d e 1 5 à 1 8 c e n t i m è t
r e s d e profondeur e t d e plusieurs centaines d e mètres d e
longueur, soit 2 5 0 à 3 5 0 m 2 p o u r p e r m e t t r e u
n contrôle des constances p h y s i c o - c h i m i q u e s p l u s i e u
rs f o i s p a r j o u r . S o n p H d o i t ê t r e a u t o u r d e 1 1
, l a t e m p é r a t u r e d e l ' e a u entre 3 0 - 3 5 ° C . Les
intrants c h i m i q u e s utilisés sont tracés e t d e
qualité, ils répondent à u n cahier des charges rigoureux.
U n contrôle d e l a qualité e t d e l a pureté d e l'eau
par des organism e s certifiés e t indépendants est
nécessaire pour assurer une spiruline d e bonne qualité. I l est
nécessaire d e brasser constamment l e bassin d e production à l
' aide d'une grande roue à aube, d e 2 m d e diamètre dont l a
vitesse d e rotation est d e 1 0 tours p a r m i n u t e o u d ' une pompe afin
que tous les f i l a m e n t s d e spiruline soit exposés a u s o l e i
l . L a culture doit utiliser une souche d e spiruline d e q u a l i t é
. A i n s i u n bassin d e 4 m 2 d e 2 0 c m d e p r o f o n d e u r
p r o d u i t 4 0 g d e spiruline sèche par jour ( M a n n e t ,
2 0 1 6 ) . I l existe huit p r i n c i p aux facteurs qui influent
sur l a pro d u c t i v ité d e l a spiruline:
·
2 5
L a luminosité : elle doit être d e 1 6 h par jour (
l ' o m bre perm e t d ' a u g m enter l a photosynthèse e t donc l a
productivité);
· L a température : l a température o p t i m
ale est d e 3 0 ° C e t doit être l a plus constante p o s s i b l e
. l a b i o m a s s e dim i n ue avec l a chute d e l a température l a
nuit ;
· L a vitesse d'agitation ;
· L e p H : i l d o i t ê t r e compris entre 8 ,5 -
1 0 ,5 ;
· L a qualité d e l'eau ;
· L a présence d e macro e t m i c r o n u t r i
m e n t ( C , N , P , K , S , M g , N a , C l , C a , F e , Z n , C u , N i , C
o , S e ) ;
· L a taille d e l'inoculation : une concentration plus
faible a m é l i o r e l a croissance;
· Les solides dissous : dont l a concentration doit etre
comprise entre 1 0 - 6 0 g / l ( D argent,
2 0 0 9 ) .
D ' a u t r e s variables impliquées dans l a
production existent: l a concentration e n oxygène, plus cette
dernière est élevée plus l a croissance est forte; l a
présence d ' urée; d e nitrate d e potassium e t d ' am m o n i a
q u e a u g m ente l a productivité. Rajouter 1 % d e C O 2 , a u g m
ente l a concentration finale e n s p i r u l i n e , à 2 5 ° C l e
taux e n glucides augmente alors qu'à 3 5 ° C c'est l e taux d e
protéines qui a u g m ente. Par ailleurs, l a forte concentration e n
bicarbonate ( 0 ,2 M ) empêche l a contamination p a r d ' a u t r e s
algues. L'addition d'ammoniaque à 2 m M empêche l e d é v e
l o p p e m e n t des a m i b e s . L e meilleur milieu d e culture est
constitué d e : phosphate à 1 ,2 5 g / L , nitrate d e sodium 2
,5 g / L , chlorure d e potassium 0 ,9 8 g / L , chlorure d e sodium à 0
,5 g / L , sulfate d e magnésium à 0 ,1 5 g / L , chlorure d e
calcium à 0 ,0 4 g / L e t bicarbonate d e sodium à 8 g / L . Des
régulateurs d e croissance des végétaux peuvent être
utilisés pour a m é l i o r e r l a croissance d e l a spiruline
comme l e 6 -benzyladénine, l ' a j o u t d ' a z o t e perm e t d e
produire une spiruline plus riche e n protéines, une température
inférieure à 3 5 ° C , une culture sous l u m i è re
rouge e t une concentration élevée e n chlorure d e sodium ( N a
C l ) supérieure à 3 0 g / L perm e t d ' a u g m enter l e taux
e n J-carotène ( H a b i b , 2 0 0 8 ) .

2 6
F i g u r e 5 : Photographie d e l a ferme d e
production d e spiruline d e N o m a y o s - C a m e r o u n .
I .3 .3 . Classification t a x o n o m i q u
e
Tableau 2 : Classification taxonomique d e
S p i r u l i n a p l a t e n s i s ( Benson e t a l .,
2 0 0 0 ; W heeler e t a l ., 2 0 0 0 ) .
Règne
|
Bacteria
|
Sous-règne
|
P r o c a r y o t a
|
Phylum
|
( e m b r a n c h e m e n t )
|
C y a n o b a c t é r i e
|
Classe
|
|
C y a n o p h y c e a e
|
Ordre
|
|
O s c i l l a t o r i a l e s
|
F a m i l l e
|
|
O s c i l l a t o r i a c e a e
|
Genre
|
|
S p i r u l i n a
|
E s p è s e
|
|
P l a t e n s i s
|
|
I .3 .4 . Com position
L a c o m position d e l a spiruline varie selon les
conditions d e c u l t u r e , l a période d e récolte, l ' o r i
g i n e g é o g r a p h i q u e , l e p r o c é d é d e r
é c o l t e , d e s é c h a g e , d e b r o y a g e , d e c o n d
i t i o n n e m e n t , m a is a u s s i p a r l e taux d ' e n s o l e i l l e
m e n t e t p a r l e fait que certains indu s t r i e ls s u p p l é m
e n t e n t l e s milieux d e culture afin que l a spiruline produite soit plus
riche e n fer, e n zinc o u encore e n acides gras. E n général l
a s p i r u l i n e e s t c o m p o s é e d e 7 0 % d e p r o t é
i n e s , 2 0 % d e g l u c i d e s , 5 % d e l i p i d e s , 7 % d e
minéraux e t d e 3 à 6 % d'eau. Cette composition est très
complète e t variée : avec u n excellent apport e n
protéines, une bonne répartition des lipides, des glucides. L a
spiruline
2 7
contient é g a l e m e n t les minéraux, les o l i
g o - é l é m e n t s , les vitam i n es e t les acides a m i n
é s parmi lesquels : phénylalanine, tyrosine, a r g i n i n e , g
l u t a m ate, asparagine. Cependant l a spiruline n e
c o n t i e n t n i v i t a m i n e C , n i i o d e , n i o m
é g a 3 ( M a n n e t , 2 0 1 6 ) . C e l l e
cultivé à Nom a y o s - Y a o u n d e - C a m e r o u n , q u e
nous avons utilisé dans cette étude est aussi riche e n macro- e
t m i c r o n u t r i m e n t
d e même qu'en composés p h y t o c h i m i q u e s
b i o a c t i f s parmi lesquels les p o l y p h é n o l s , les
f l a v o n o ï d e s , l a p h y c o c y a n i n e , l e s
c a r o t é n o ï d e s , l e s a c i d e s p h é n o l i q
u e s comme l'acide c a f é i q u e
e t l e s acide c o u m a r i q u e s o n t e n proportion s i g
n i f i c a ti v e . E l l e a une forte t e n e u r e n f e r e t c o n t i e
n t é g a l e m e n t l e c u i v r e , l e manganèse, z i n c ,
s é l é n i u m ( A m a e t a l ., 2 0 1 6
) .
I .3 .5 . E f f e t s b i o l o g i q u e s d e S p
i r u l i n a p l a t e n s i s
Les études menées par D u p i r e . ( 2
0 1 1 ) montrent que l a richesse d e l a spiruline e n composé
b i o a c t i f s , l a p h y c o c y a n i n e lui confère des
propriétés h y p o c h o l e s t é r o l é m ia n t
e s . P a r ailleurs s a richesse e n vitam i n e , e n fer lui donne des
propriétés anti-anémie f e r r i p r iv e Chamorro
e t a l . ( 2 0 0 2 ) . D e plus à des doses d e 2 0 0
m g / k g / j de la p h y c o c y a n i n e chez l a souris stimule
l'hématopoïèse ( T h a a k u r e t P u s h p a k u m
a r i 2 0 0 7 ) . Nombreuse autres activités biologique sont
allouées à S p i r u l i n a p l a t e n s i s . D e par
s a riche e n différents macro e t m i c r o n u t r i m e n ts d e
même que les composés b i o a c t i f s ( tels que l a p h y c o c
y a n i n e , les p o l y p h é n o l s , l e calcium s p i r u l a n ,
les c a r o t é n o ï d e s , les vitam i n es, ... ) i l a
été d é m o n t r é que S p i r u l i n a p l a
t e n s i s a une activité h é p a t o p r o t e c t r i c
e ( Ism ail e t a l . , 2 0 0 9 ) , h y p o g l y c
é m i a n te ( Deng e t Chow, 2 0 1 0 ) , a n t i h y p
e r t e n s i v e ( I c h i m u r a e t a l ., 2 0 1 3 )
, anticancéreuse ( S a i n i e t S a n y a l , 2 0 1 4
) , a n t i o x y d a n t e , a n t i r a d i c a l a ir e , i m m u n
o m o d u l a t r ic e ( A m a e t a l ., 2 0 1 6 ) ,
antivirale ( M a d e r e t a l ., 2 0 1 6 )
i n vitro e t i n vivo.
? S p i r u l i n a p l a t e n s i s e t d r
é p a n o c y t o s e
L e stress oxydant est une caractéristique importante
d e l a pathologie d r é p a n o c y t a i r e e t joue u n grand
rôle dans l e phénomène d'hémolyse ( Nur e t
a l ., 2 0 1 1 ) . L a spiruline étant riche e n
composés antioxydants ( phénoliques, p h y c o c y a n i n e ,
bêta-carotène...) serait douée d e propriétés
a n t i f a l c é m i a n t e s e t a n t i h é m o l y t i q u e
s . Pour vérifier cette hypothèse, u n certain nombre d e m a t
é r i e l e t d e méthodes a été utilisé.
| 


