4. Valorisation et transformation des ressources
halieutiques
Les ressources halieutiques sont utilisées dans
l'alimentation mais aussi dans l'industrie de transformation. La FAO souligne
que le poisson périt rapidement par rapport à d'autres aliments.
La valorisation et la transformation se font dans les usines industrielles de
la pêche qui se trouvent dans les capitales (Nouakchott et Nouadhibou)
ainsi que la transformation artisanale. Les usines de transformation de la
farine ont commencé en 2005 avec l'usine RIM-
31
Fish et OMAURCI. Par conséquent depuis leurs
installations ont connu de fortes demandes, occasionnant la construction de
nombreuses autres usines dont les capitaux sont détenus par les
étrangers à Nouakchott et à Nouadhibou (Mohamed Lemine et
Braham, 2015).
En effet, l'industrie de la transformation et de la
valorisation a connu une augmentation et la création de nouvelles usines
dans la zone de franche de Nouadhibou. Depuis 2007, le nombre d'usines de
valorisation et de transformation a connu une hausse et 70 % des usines sont
localisées à Nouadhibou.
L'ONISPA est un centre créé en 2007 dont
l'objectif est d'appliquer les bonnes pratiques de qualité, de
l'hygiène et les réglementations nationales et internationales et
les réglementations internationales et nationales. Il fournit
également des avis scientifiques et techniques vis-à-vis des
établissements du secteur de pêche et des ressources halieutiques.
L'ONISPA contribue à la labélisation des produits halieutiques et
fait des inspections de ces produits. En 2014 l'office National d'Inspection
Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture avait
agréé 91 unités dont 68 destinées à la
consommation des humains et le reste pour l'usage des animaux. Dans ces 68, 45
sont localisées à Nouadhibou et les 23 à Nouakchott
(ONISPA, 2015).
Tableau 2 :L'évolution des usines de
transformation et valorisation (Nouakchott- Nouadhibou) (source ONSIPA :
2015)
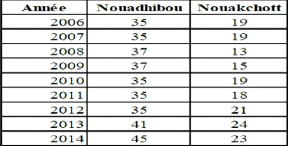
Dans ces usines 97 % de la production transformée est
destinée au marché Européen. La capacité de
traitement de ces usines avoisine les 5000 tonnes/jour. Les usines de la
filière de transformation et valorisation des produits halieutiques
permettent d'obtenir deux produits (farine et huile). Une grande partie de ces
usines utilise la technologie chinoise. Les espèces sardinelles et
éthmalose occupent une place très importante dans la
transformation et la valorisation. Ces espèces ont passé de
20.000 tonnes en 2006 pour passer en 300000 tonnes en 2019 (IMROP, 2019).
L'usine OMAURCI S.A est une usine de transformation à Nouadhibou,
implantée en 2005 et peut traiter plus de 400 tonnes de poissons par
jour. En 2013, L'OMAURCI s'était lancé sur un projet de
transformation en pattes de poissons.

32
Figure 6: L'évolution de la quantité des
espèces transformées (source : IMROP, 2019)
Comme nous l'avons vu précédemment, les
espèces pélagiques sont très abondantes dans la
filière de transformation et de valorisation. Elles sont riches en
acides aminés (histidine), conservées à une
température comprise entre 7 °à 10 °C.
L'approvisionnement des usines commence au débarquement suivi du
transport. Celui-ci qui se fait par des camionnettes, arrivant à
l'usine. Certaines usines ont leurs propres outils pour acheminer les poissons.
Cela se fait à l'aide de pompes modernes aspirant les poissons tandis
que d'autres usines font recours aux services des manoeuvres.
Le déchargement des produits halieutique est fait par
des manoeuvres à l'aide de bacs plastiques afin les acheminer dans les
usines. Dans l'usine, les poissons sont exposés sur le sol sur des
bâches et sont étalés par les pelles mécaniques. Le
processus de préparation se fait en enlevant la tête, la queue,
les écailles et les viscères des poissons.
Nous verrons le schéma de procédés de
transformation et de valorisation des produits halieutiques dans les usines de
transformation. : les produits halieutiques introduits dans le processus
peuvent être diverses formes (aqueuse, huileuse et solide) mais ces
résultats vont être séparés par des
variétés de transformation en utilisant les outils
adéquats.
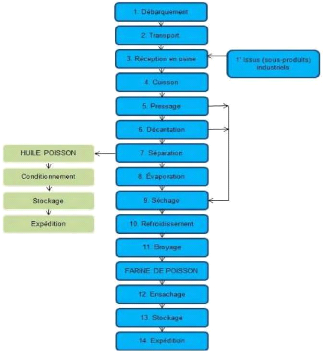
33
Figure 7 : Processus de la transformation et valorisation
filière industrielle
(Source : COLEACP, 2015)
L'huile obtenue de ce processus assure un profil en acide gras
polyinsaturé à longue chaîne (AGLPI), sa présence en
faible quantité peut combler certains rôles dans le corps humain
(Guillaume et al., 1999). En 2014, les usines de transformation des
petits pélagiques ont obtenu 300.000 tonnes de farine. La farine obtenue
est exportée vers le Nigeria et le Ghana où elle est
utilisée dans l'aquaculture pour nourrir en particulier les
poissons-chats (Mohamed Lemine et Braham, 2015).
Lors de l'approvisionnement des usines, les produits peuvent
être contaminés. Ces contaminations peuvent être d'ordre
microbiologiques, chimiques ou physiques. Elles sont causées par
l'altération lors de la capture, de la manutention et de la
transformation. Pour éviter la contamination et ses multiplications, il
est indispensable de respecter les bonnes pratiques. Nous pouvons souligner que
les unités de transformation peuvent rencontrer des problèmes de
productions liées au coût de l'électricité, des
pertes après la capture des poissons et de l'insuffisance des
espèces de stockage.
Toutefois, il faut remarquer que les usines de transformation
mettent en place des nouvelles technologies pour le conditionnement et la
transformation afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson et une
bonne rentabilité. Les procédés de valorisation passent
par la capture suivie de la manutention, la conservation, conditionnement et
par la fin le stockage et le transport. En
34
fait, la conservation et la transformation des produits
halieutiques maintiennent la qualité et l'état de ces produits.
En plus de la chaîne de transformation, un enjeu important se pose pour
assurer la qualité de la sécurité alimentaire
(FAO,2018).
Pour ce qui concerne la transformation artisanale, c'est une
activité pratiquée depuis 1920 en Mauritanie. Elle est
majoritairement exercée par des femmes et des personnes de
nationalité étrangères notamment
sénégalaises et maliennes. Elle est importante car elle
réduit les pertes après les captures. Mais elle n'est
régie par aucune réglementation juridique et le nombre de tonnage
transformé est difficile à estimer (Mohamed Lemine et BRAHAM,
2015).
Les différents types de transformation artisanale sont
:
Le séchage : forme de conservation naturelle des
produits halieutiques, généralement pratiqué sous le
soleil. On enduit de sel le poisson exposé au soleil. L'action du sel
n'est pas seulement de sécher le poisson mais aussi de tuer les
bactéries et de prévenir les contaminations. Deux types de
séchage sont pratiqués en Mauritanie : le premier consiste
à accrocher les poissons sur des lignes pour éviter que le sable
ne les atteigne ; le second type se fait sur du béton propre.
En mettant le sel après avoir procédé
à une source de chaleur. Le sel est efficace pour retirer l'eau des
poissons, pour réduire à néant les bactéries et
aussi pour lutter contre les contaminations. En Mauritanie, les deux types de
séchage cités ci- dessus sont pratiqués. Le séchage
est obtenu grâce à la chaleur, à l'air et du vent (Ward et
Beyens, 2011).
Après le résultat du séchage et du
salage, ils étament le fumage. Celui-ci se fait en utilisant les fours
améliorés « four Chorkor ». Les produits
transformés vont être mis dans le four avec moins de bois pour que
ceux-ci ne brûlent pas trop. Le four a une température minimum de
65° C (Ward et Beyens, 2011).
Les résultats des produits finis peuvent être de
deux sortes : le poisson sec et le poisson fumé « keccax ». Le
poisson sec est plus consommé par les mauritaniens que le poisson
fumé. Le poisson fumé est obtenu de la transformation de
sardinelles et d'éthmaloses, il est consommé en
général par les étrangers tels que les maliens, les
congolais etc.
La transformation et la valorisation artisanale sont vendues
au niveau national. Les imraguens sont spécialisés dans la
transformation du mulet jaune. Quand les imraguens transforment le mulet en
huiles (d'hin), le tichtar et la poutargue, ils procèdent ainsi :
? Le D'hin obtenu à partir de la tête de mulet et
les viscères des poissons, ? Le tichtar composé de la chair du
mulet,
? La poutargue obtenue à partir des ovaires des
poissons

Photo 1: Transformation artisanale Photo 2: poisson sec et
koccax
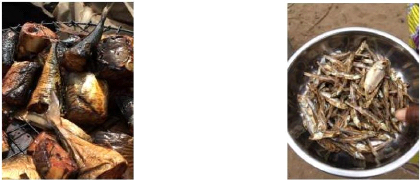
35
Photo 3: Koccax (poisson fumé) Photo 4: Poisson sec
| 


