CHAPITRE V : L'ORGANISATION DES ECHANGES
La dynamique d'un secteur suppose une organisation rigoureuse
des acteurs. Entre la basse vallée de l'Ouémé et Cotonou,
des espaces bien définis servent de support des échanges. Les
circuits sont établis en fonction des acteurs et des moyens de
transport.
5.1. Le support des échanges
5.1.1. Les marchés
De part leurs influences, on distingue trois types de
marchés : les marchés locaux, les marchés régionaux
et un marché international.
5.1.1.1. Les marchés locaux
Dans notre secteur d'étude, chaque agglomération
dispose d'un petit marché qui s'anime surtout dans l'après midi.
Ces marchés sont caractérisés par une prédominance
des produits de première nécessité et en particulier des
produits maraîchers. Les catégories de commerçants
rencontrés sont les demi-grossistes et les détaillantes. C'est
dans ces marchés que les populations s'approvisionnent quotidiennement
pour la consommation familiale.
A Cotonou, ce sont les marchés de moyenne importance
où les commerçantes s'occupent de la vente en détail des
produits alimentaires notamment des condiments et légumes achetés
à l'embarcadère. Au nombre de ces marchés nous avons les
marchés de Gbégamey et de Wologuèdè.
5.1.1.2. Les marchés régionaux
Ce sont les marchés fréquentés par les
populations de plusieurs arrondissements et communes. Les plus importants sont
Azowlissè et Dangbo. C'est dans ces marchés que s'approvisionnent
les commerçants de Cotonou.
55
5.1.1.2.1. Le marché
d'Azowlissè
Il est le plus grand marché de la basse vallée
de l'Ouémé de par son dynamisme. Il rassemble différents
acteurs de diverses provenances. Ainsi, les collecteurs de plusieurs villages
de la basse vallée de l'Ouémé s'y rendent pour
écouler leurs produits.
Par ailleurs, on distingue deux sortes d'animation du
marché : le grand Azowlissè qui s'anime tous les quatre jours et
le petit Azowlissè qui s'anime une fois entre deux grands
Azowlissè. Ce marché comptait 886 vendeurs en 1996. Aujourd'hui,
cet effectif est passé à 1241 ; ce qui témoigne de son
dynamisme. Cet accroissement d'effectif s'assortit de l'augmentation des
quantités de produits exposés dans le marché, ce qui offre
une disponibilité plus large de produits aux commerçants
d'origine variée.
5.1.1.2.1. Le marché de
Dangbo
C'est le deuxième plus influent marché de la
basse vallée de l'Ouémé après celui
d'Azowlissè. Il fut le lieu d'échange privilégié
des populations de la commune de Dangbo et environs et recevait même des
commerçants étrangers. Mais son influence a été
réduite depuis la création du marché de Malomè
situé à cheval entre le marché de Dangbo et
Késsounou et qui s'anime le même jour que Dangbo. De ce fait, ce
marché draine certains commerçants de Dangbo qui
s'approvisionnent en produits maraçichers. Malomè se positionne
donc comme un marché de produits maraîchers alors qu'à
Dangbo, on y trouve un peu de tout.
5.1.1.3. Le marché Dantokpa
Avec une concentration de plus de 20000 commerçants
à chaque foire, Dantokpa est le plus grand marché du Bénin
et l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest (LARES, 2001). Situé au
carrefour des voies lagunaires et routières, il s'identifie à
travers son dynamisme. Ainsi, le nombre de vendeurs est passé de 12000
en 1984 à 18500 en 1992 puis de 24500 en 1998 à plus de 27000
56
aujourd'hui. Cette variation de l'effectif des vendeurs
témoigne du dynamisme de ce marché.
5.1.2. Les embarcadères
Outre les marchés qui constituent des lieux
d'échange originels, les premières négociations qui
concourent à la vente des produits se font au niveau des
embarcadères. Leur nombre est très important dans la basse
vallée. En raison de la densité du réseau hydrographique,
chaque espace aménagé le long d'un cours d'eau ou d'un canal sert
de lieu d'embarquement ou de débarquement. A Cotonou, les
embarcadères se situent le long du lac et du chenal. Le plus important
est celui de Dantokpa. Ils abritent des constructions précaires : apatam
en bois recouvert de nattes ou d'une bâche. Ces espaces servent en
même temps de lieux d'échange et on y retrouve divers produits :
vivriers, condiments, légumes frais, poissons d'eau douce, bidons vides,
fruits, oranges, bananes, ananas. On y trouve également des produits de
l'artisanat (bois, osier servant entre autre à la vente de tomate,
natte, etc.) et les produits agricoles venant du nord du pays tels que : le
mil, le sorgho, les oignons, l'ail, etc. Cet espace ne reçoit pas les
produits pétroliers frelatés du Nigeria à cause de
l'implantation du groupement d'intervention subaquatique des sapeurs pompiers
qui régule le trafic à ce niveau. Les autres embarcadères
sont notamment situés à Mènontin, Zogbohouè,
Yénawa, Agbato. Les produits pétroliers transitent par Hozin
avant d'être convoyés vers les autres communes de la basse
vallée. La partie qui arrive à Cotonou transite souvent par le
débarcadère d'Abomey-Calavi avant d'être convoyée
à l'embarcadère de Mènontin. La conséquence est que
ce produit coûte parfois moins cher à Abomey-Calavi qu'à
Cotonou.
|
6°4s'
6'40'
6°35'--
--
|
2°30' 2°35'
|
+ 6°45'
+ 6°40'
+ 6`35'
|
|
..
bâmé-W.
~~
om -Gbrâ
-a
'A s
c
·
.i.---
|
,DU
(2.. ''
'''''a,
|
-.ZOU ,
|
DU
x
)
in
(n
â
m
è
AGugeUES
|
PLATEAU
N
_iL
7n
|
|
DEPARTEMENT
aBONOU
|
· "
~~~2 '-"^
~"!`
|
-A*
\ Ag~on
0 Atchonsa -
- ; i Adid.
,..,_111. Affama--~
|
|
D
Ponly
X11I
·
dl_\ 0 43angba
,QC~i Only
·
·annq'u
Ghéko ü..-l<0
=
7.o .. Kessaumoua
Houédo '
0 ,'
Vèk}çy
|
Ghana
.'OuezoUmé D
|
Sékodji
*Akpadanot__O_
Awonou
Kodé
*
DJOHOUN__--- l_ _ -
Demè Gbékaidji Azowlissa \
Gbad.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
Kilomètres
Réalisation: Jean LAOUROU Logiciel: Mapinfo 8.0
|
|
+ +
2'30' 2'35' LARD, 2010
|
57
Figure 8: Carte de répartition des
principaux marchés de la basse vallée de l'Ouémé
58
5.2. La commercialisation des produits
5.2.1. Les circuits de commercialisation des produits
agricoles et halieutiques
Le commerce des produits agricoles et halieutiques
obéit à un circuit simple qui met en relation trois principaux
acteurs : les producteurs, les grossistes et les détaillantes ou
revendeuses. Ces acteurs convoient les produits vers les consommateurs selon
quatre voies :
- producteurs- consommateurs
- producteurs- détaillantes- consommateurs
- producteurs- grossistes- détaillantes- consommateurs
- producteurs- grossistes- consommateurs
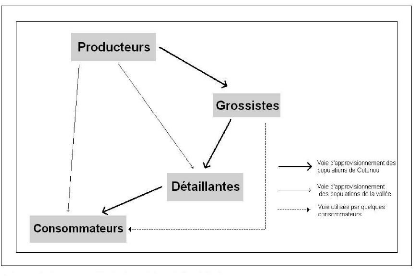
Figure 9 : Circuits de commercialisation des
produits agricoles et halieutiques
Les produits de la basse vallée sont convoyés en
grande quantité vers l'embarcadère de Dantokpa. C'est à ce
point de débarquement que se négocient
les transactions entre les grossistes et les revendeuses de la
ville. Il s'en suit alors une distribution vers les principaux marchés
de la ville.
Les produits vendus dans les marchés et
embarcadères sont de deux sortes. Il y a les produits frais et les
produits transformés. Si les hommes jouent un rôle important
pendant la production, la transformation et la commercialisation sont
réservées aux femmes. Les produits halieutiques se vendent
aussitôt après les prises. Seuls ceux transformés sont
conservés pour animer les marchés.
5.2.2. La commercialisation des produits
d'élevage
Ce commerce est très peu développé entre
la basse vallée de l'Ouémé et cotonou. Les produits de
l'élevage sont pour la plupart destinés à la consommation
interne alimentant ainsi les échanges entre les populations du
département de l'Ouémé comme le montre le tableau suivant
:
Tableau XVII : Mouvements commerciaux des
animaux sur pied (commerce intérieur) dans
l'Ouémé.
|
Bovins
|
Ovins
|
Caprins
|
Porcins
|
Volailles
|
|
207
|
2367
|
4532
|
1097
|
20183
|
Source : Rapport annuel CeRPA, 2007.
Les produits les plus échangés avec Cotonou sont
la volaille et ses oeufs ainsi que les caprins notamment le porc.

59
Photo 3 : Vente d'ovins à Dangbo Photo 4 : Vente de porcs
à Dangbo
Clichés : Jean LAOUROU, mars 2009
60
La photo 3 montre des chèvres apprêtées pour
être vendues alors que la photo 4 montre des femmes assises devant leurs
animaux (porcs) en attenant l'arrivée des clients.
Le marché à bétail est très
animé pendant la grande saison sèche que ce soit dans la basse
vallée ou à Cotonou. Cette période correspond à
celle des grandes fêtes (fin d'année, Ramadan, Tabaski, etc.). De
plus, la grande saison sèche est considérée comme une
période de repos dans la vallée de l'Ouémé et donc
réservée aux cérémonies de toutes sortes ;
d'où des importations d'animaux.
Tableau XVIII : Importation des animaux sur pied
et exportation
|
Ouémé
|
Bovins
|
Ovins
|
Caprins
|
Porcins
|
|
Importation
|
-
|
7303
|
1330
|
-
|
|
Exportation
|
4178
|
327
|
375
|
0
|
Source : Rapport annuel CeRPA, 2007.
Le tableau XVIII montre que 4,48 % des bovins et 28,20 % des
caprins importés sont exportés. Le reste, ajouté aux
productions locales alimentent le marché à bétail dans
l'Ouémé. Les bovins participent très peu aux
échanges intérieurs de l'Ouémé à cause de
leur prix élevé par rapport aux autres catégories
d'animaux.
Tableau XIX: Prix
moyens des animaux sur pied sur les marchés à bétail dans
l'Ouémé/ Plateau
|
Canards
|
Bovins
|
Ovins
|
Caprins
|
Porcins
|
Poulets
|
Pintades
|
Pigeon
|
|
6000
|
170000
|
18000
|
18000
|
28000
|
1300
|
2500
|
1500
|
Source : Rapport annuel, Direction de l'élevage, 2007.
61
Tableau XX: Mercuriales des denrées
d'origine animale (en FCFA/kg).
|
Bovins
|
Ovins
|
Caprins
|
Porcins
|
Volaille (unité)
|
OEufs (unité)
|
|
1800
|
1800
|
1700
|
1700
|
1500
|
65
|
Source : Rapport annuel, Direction de l'élevage, 2007.
Les bovins, les porcins et les caprins sont les plus chers et
la volaille porte le plus bas prix. Lorsqu'on considère le prix du
kilogramme de viande, les espèces les plus chers demeurent les
mêmes et les prix varient entre 1700 et 1800 FCFA ; lequel prix est
supérieur à celui de la volaille (1500F).
5.2.3. Les prix et leurs facteurs de
variation
Les prix sont les données fondamentales stimulant les
échanges. Ils varient en fonction des périodes de l'année
et des marchés considérés.
D'une manière générale, on distingue deux
facteurs majeurs de variation des prix : les facteurs internes et les facteurs
externes.
5.2.3.1. Les facteurs internes de variation des
prix
Il s'agit des facteurs endogènes de variation des prix
dans les localités de production et au niveau des zones
d'échange. Ainsi, nous avons :
5.2.3.1.1. Les facteurs liés à la
période
Les prix des produits agricoles sont élevés au
début de la récolte puisque les produits sont
considérés comme étant rares. Ainsi, ce sont les premiers
à récolter qui bénéficient de cet avantage. Lorsque
la récolte devient abondante, les coûts des produits chutent ; une
nouvelle hausse s'observera pendant la période intermédiaire.
62
Tableau XXI : Prix moyens (FCFA/Kg) de quelques
produits agricoles en fonction des saisons dans la basse vallée de
l'Ouémé
|
Produits
|
Grande saison
sèche
|
Grande saison
des pluies
|
Petite saison
sèche
|
Petite saison
des pluies
|
|
Maïs
|
130
|
115
|
125
|
145
|
|
Riz importé
|
350
|
335
|
400
|
425
|
|
Gari ordinaire
|
170
|
150
|
130
|
115
|
|
Haricot blanc
|
350
|
325
|
325
|
325
|
|
Arachide graine
|
515
|
495
|
475
|
520
|
Source : Calculs de l'auteur à
partir des données de l'ONASA et des enquêtes de terrain 2009
Tableau XXII : Prix moyens (FCFA/Kg) de quelques
produits agricoles en fonction des saisons à Cotonou
|
Produits
|
Grande saison
sèche
|
Grande saison
des pluies
|
Petite saison
sèche
|
Petite saison des pluies
|
|
Maïs
|
135
|
125
|
135
|
155
|
|
Riz importé
|
325
|
345
|
345
|
385
|
|
Gari ordinaire
|
285
|
200
|
210
|
180
|
|
Haricot blanc
|
325
|
310
|
325
|
325
|
|
Arachide graine
|
675
|
705
|
480
|
480
|
Source : Calculs de l'auteur à
partir des données de l'ONASA et des enquêtes de terrain 2009
Pour faire ces calculs, nous avons considéré les
relevés de prix de l'ONASA durant les douze mois de l'année 2008
que nous avions complétés par les données des
enquêtes de terrain. Ensuite, nous avons regroupé les mois de
l'année en fonction des saisons dans chaque région. La somme des
prix mensuels divisée par le nombre de mois de la saison nous a
donné le prix moyen. Ce calcul a été fait au niveau de
chaque produit.
Les prix moyens du maïs, du gari ordinaire, et de
l'arachide graine sont plus faibles dans les marchés de la basse
vallée que sur les lieux d'échange de Cotonou quelque soit la
période de l'année. Par contre, les prix moyens du riz
importé, et de l'haricot blanc sont en hausse par rapport aux prix
enregistrés
63
dans les lieux d'échange de Cotonou. Ainsi, les
denrées alimentaires produites dans la basse vallée de
l'Ouémé sont moins chers qu'à Cotonou dans la mesure
où le commerçant de Cotonou doit comptabiliser les frais de
transport et les autres taxes avant de fixer les prix de vente des produits. Le
phénomène inverse s'observe au niveau des produits
importés de Cotonou et vendus dans les marchés de la basse
valée. Dans l'ensemble, la production de la basse vallée, bien
qu'elle soit faible pour certains produits (riz, haricot etc.) permet la
réduction temporaire des prix sur les marchés.
En ce qui concerne les produits halieutiques, les prix sont
bas en période de crue où on note une forte production. Les
périodes de décrue s'assortissent de la baisse des prises et donc
d'une hausse des prix.
5.2.3.1.2. La qualité du
produit
Elle constitue un facteur de variation des prix. Pour les
céréales par exemple, les éléments
contrôlés sont : la teneur en eau des grains, la propreté
des céréales et la variété (gros grain, petit
grain). Le prix du haricot blanc est différent de celui du haricot
rouge. Au niveau des produits halieutiques et d'élevage, on tient
plutôt compte du type d'espèces.
5.2.3.13. L'état du produit
Certains produits subissent des transformations avant
d'être commercialisés. C'est ainsi qu'on retrouve dans les lieux
d'échange, des tourteaux d'arachide, de la farine de manioc etc. pour ce
qui est de la production agricole. Le prix d'un grand panier de piments rouges
varie entre 7000 FCFA et 9000 FCFA. Le même panier de piments verts a un
prix variant entre 4000 FCFA et 7000 FCFA dans les marchés de la basse
vallée. En ce qui concerne les produits halieutiques, ils peuvent
être à l'état frais, fumé ou fris comme le montre le
tableau ci-après :
64
Tableau XXIII : Prix de quelques espèces
halieutiques en 1997 selon leur état
|
Espèces
|
Etat
|
Prix moyen annuel en FCFA le kilogramme
|
|
Cychlidae
|
Frais
|
953
|
|
Fumé
|
1037
|
|
Chrysichthys
|
Frais
|
1041
|
|
Fumé
|
1078
|
|
Ethmaloses
|
Frais
|
828
|
|
Fumé
|
1108
|
|
Penaeidae
|
Frais
|
1240
|
|
Fumé
|
2082
|
Source : Direction des Pêches
Les prix varient ici en fonction des espèces et de leur
état. Les espèces ont un prix plus élevé à
l'état fumé qu'à l'état frais. Cette variation est
liée au coût de la transformation qui est compris entre 37 FCFA et
842 FCFA.
5.2.3.1.4. Les difficultés de
transport
En période de crue, la navigation devient difficile.
Ainsi, on note une diminution du nombre de pirogues d'où une
augmentation des frais de transport et par ricochet des prix des produits. Dans
la basse vallée, il y a des localités à accès
très difficile en période de crue. L'approvisionnement en
produits étant hypothéqué, les prix montent.
5.2.3.2. Les facteurs externes de fluctuation des prix
Au niveau externe, nous avons :
5.2.3.2.1. L'évolution des prix des
produits pétroliers.
En effet, les échanges sont liés au transport.
Ainsi, lorsque le coût du carburant augmente, les frais de transport
aussi augmentent ; ce qui se répercute sur le prix des produits
échangés. Dans les marchés de Cotonou, les
commerçants qui s'approvisionnent au nord du pays voient les prix de
leurs produits un peu à la hausse par rapport à ceux des
commerçants qui s'approvisionnent dans la basse vallée. Lorsque
le produit devient rare, les
65
commerçants, clients de la basse vallée
ramènent les prix de leurs produits au même niveau que ceux des
autres commerçants ; ce qui leur permet de gagner un peu plus de
gains.
5.2.3.2.2. La fréquentation des
marchés de la basse vallée par des
commerçants
nigérians
En effet, lorsque la production est faible au Nigeria, les
commerçants de ce pays débarquent en grand nombre dans les
marchés de la basse vallée notamment à Azowlissè et
à Dangbo ; ce qui entraîne une hausse des prix des produits.
5.2.4. Les unités de mesure
Elles concernent surtout les produits halieutiques et
agricoles. Les produits de l'élevage étant vendus à
l'unité.
Pour les produits de pêche, l'unité courante est
le panier. Ce sont des paniers de différentes dimensions prêtes
à satisfaire le client en fonction de la culture. Le tableau suivant
présente les unités courantes utilisées par les
commerçants et leurs équivalences en kilogramme.
Tableau XXIV : Unités de mesures et
équivalences en kilogramme
|
Types de produits
|
Unités courantes
|
Equivalence approximative en kilogramme
|
|
Grains
|
Tohoungolo Adjandjan Lèbè
|
01
05
2,5
|
|
Racines et
tubercules
|
Panier Sac
|
Variable
|
|
Légumes
|
Panier
|
Variable
|
Source : Enquête de terrain, 2009
66
Ce tableau présente les principales unités de
mesure utilisées dans la basse vallée de l'Ouémé et
à Cotonou. La manipulation de ces unités de mesure est
maîtrisée par les acteurs qui s'en servent quotidiennement.
5.3. Les infrastructures de stockage et les moyens de
transport
5.3.1. La conservation des produits
Les techniques et moyens de conservation varient d'un produit
à un autre. Pour les produits halieutiques, les commerçants de
Cotonou adoptent une technique toute simple et dans l'immédiat. Elle
consiste à déposer les poissons au milieu de deux couches de
glace concassée et disposée dans une bassine. Cette technique
permet de conserver le produit frais durant quelques heures voire toute une
journée. Dans la basse vallée de l'Ouémé, les
produits sont soit fumés, séchés ou fris ; ce qui permet
de conserver le produit durant quelques jours.
Les produits vivriers sont généralement
conservés dans des sacs. Mais avant, les produits
céréaliers sont biens séchés et parfois
mélangés avec des insecticides dans le cas d'une conservation
à long terme. En cas de mévente, les légumes fruits
(piment, gombo) sont séchés alors que les légumes feuilles
sont exposés à l'air libre afin qu'ils soient maintenus frais.
Les lieux de stockage varient du producteur au
commerçant. En effet, au niveau des producteurs, les produits sont
stockés dans des greniers ou à la maison. Les commerçants
par contre conditionnent leurs marchandises dans des magasins
réservés à cet effet avant de les convoyer à
destination.
Ces infrastructures de stockage sont construites soit par des
structures de gestion des marchés soit par des ONG intervenant dans ce
secteur.
5.3.2. Les moyens de transport
Les moyens de transport varient en fonction du niveau des
échanges.
67
5.3.2.1. Les moyens de transport au niveau
local
Dans la basse vallée de l'Ouémé, le
transport des produits de la zone de production vers les domiciles ou les lieux
d'échange est assuré par les engins à deux roues (moto ;
vélo), les pirogues et les barques. De plus, en raison de la courte
distance qui sépare les zones de production maraîchère des
marchés (cas de Dangbo, Malomè et d'Azowlissè), le
transport par la tête est aussi pratiqué par les femmes.
Les barques (motorisés ou non) sont fortement
utilisées en raison de la densité du réseau hydrographique
et de l'impraticabilité des voies. A la différence de Cotonou
où l'utilisation de véhicules est courante, dans la basse
vallée de l'Ouémé, les véhicules sont
utilisés par des commerçants qui quittent une commune autre que
celle du lieu d'implantation du marché à fréquenter.
5.3.2.2 Les moyens de transport entre la basse
vallée et Cotonou Ce sont des barques et pirogues qui servent
de moyens de transport entre les deux régions d'étude. On en
distingue plusieurs types et leur fréquence varie en fonction de
l'importance des lieux d'échange.
5.3.2.2.1. Les barques et les pirogues en
plastique ou en métallique
Ce sont des embarcations motorisées utilisées
par les responsables administratifs et d'autres agents techniques des
structures de développement. Dans la basse vallée de
l'Ouémé, chaque commune en dispose au moins une. A Cotonou, ce
type de moyen est utilisé par le groupe d'intervention subaquatique des
sapeurs pompiers installé à proximité du plus grand
débarcadère de la ville. On en compte 4 fréquemment
utilisées par ce groupement pour des opérations de contrôle
et de sauvetage des populations.

68
Photo 5 : Pirogue en plastique aux Aguégués
(Cliché : Jean LAOUROU, 2009)
La photo 5 montre une pirogue moderne au bord d'un plan d'eau
aux Aguégués. Le moteur a été enlevé et
conservé dans un bureau.
5.3.2.2.2. Les barques et les pirogues en
bois
Ce sont les barques utilisées par les transporteurs
tant au niveau local qu'entre la basse vallée de l'Ouémé
et Cotonou. Elles sont de différentes capacités et servent au
transport des marchandises et des personnes. Les tableaux suivants
présentent les types d'embarcation et leur fréquence dans les
zones d'enquête.
Tableau XXV : Fréquence des embarcations au
marché d'Azowlissè
|
Types
d'embarcations
|
Nombre
d'embarcations
|
Nombre de passagers
|
|
1996
|
2009
|
1996
|
2009
|
|
Pirogues de 10
places
|
11
|
34
|
110
|
340
|
|
Barques de 20 à 50 places
|
-
|
15
|
-
|
300
|
|
Barques de 70
places
|
-
|
02
|
-
|
95
|
|
Totaux
|
11
|
41
|
110
|
735
|
Source : Enquête de terrain 2009 (données
1996 : TOHOZIN A., 1999)
On compte 11 moyens de transport en 1996 contre 41 en 2009 soit
une augmentation de 30 embarcations en une période de 13 ans.
69
Tableau XXVI : Fréquence des embarcations
au marché de Dangbo
|
Types
d'embarcations
|
Nombre d'embarcations
|
Nombre de passagers
|
|
1996
|
2009
|
1996
|
2009
|
|
Pirogues de 10 places
|
30
|
53
|
300
|
530
|
|
Barques de 20 à 50 places
|
08
|
20
|
160
|
400
|
|
Barques de 70 places
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Totaux
|
38
|
73
|
460
|
930
|
Source : Enquête de terrain 2009 (données
de 1996, TOHOZIN A., 1999)
En 2009 on enregistre 73 pirogues et barques contre 38 en 1996
soit une augmentation de 92,11 %.
Tableau XXVII:
Fréquence des embarcations au marché de Hozin
|
Types de
pirogues
|
Nombre de pirogues
|
Nombre de passagers
|
|
1996
|
2009
|
1996
|
2009
|
|
Pirogues de 10 places
|
44
|
71
|
440
|
710
|
|
Barques de 20 à 50 places
|
02
|
15
|
40
|
800
|
|
Pirogues de 70 places
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Totaux
|
46
|
86
|
480
|
1510
|
Source : Enquête de terrain 2009 (données
1996 : TOHOZIN A., 1999)
On compte 86 pirogues et barques en 2009 contre 46 en 1996 ; soit
une augmentation de 86,96 % en une période de 13 ans.

70
Photo 6 Photo 7
Barques chargées à l'embarcadère de
Tovè, (Clichés : Jean LAOUROU, 2009)
Les photos 6 et 7 montrent des barques en bois chargées
de divers produits. Au niveau de la photo 6 nous avons du bois de chauffage. La
photo 7 montre des produits alimentaires notamment ceux maraîchers.
Dans l'ensemble, on note une nette augmentation du nombre
d'embarcations entre 1996 et 2009 et par ricochet un accroissement du nombre de
passagers. On distingue cependant des barques motorisées et des barques
non motorisées. Les pirogues de 10 places sont
généralement sans moteur. Elles se déplacent donc à
l'aide des pagaies dont la manipulation est maîtrisée par les
transporteurs. Ces pirogues sont généralement utilisées
par les mareyeuses pour les activités de pêche. On compte 21184
pirogues de pêche en 1998 (Direction des pêches). Ces petites
embarcations sont également utilisées pour le transport des biens
et des personnes d'une rive à une autre dans les villages coupés
en deux par un cours d'eau. Les barques de 20 places et plus portent des
moteurs et ce sont elles qui servent de moyens de transport entre Cotonou et la
basse vallée de l'Ouémé. Sur les grandes barques sont
disposées des bâches pour faire écran aux
intempéries de la nature. L'augmentation de la population a
entraîné un accroissement des besoins de transport d'où une
augmentation du nombre de moyens de transport.
71
5.3.2.2.2. La fréquence des barques
à l'embarcadère de Cotonou
L'effectif des embarcations varie d'une période
à une autre dans les embarcadères de Cotonou. En effet, on compte
en moyenne 80 pirogues et barques par jour dont 79 % provenant de la basse
vallée de l'Ouémé et 21 % d'Abomey-Calavi et des environs
de Cotonou. Lorsqu'on aborde la période des récoltes dans la
basse vallée cet effectif passe à 130 embarcations. Dans ces
embarcations, on retrouve des marchandises et des personnes qui peuvent
être des commerçants, des usagers de marché ou des
fonctionnaires comme le montre la photo 8

Photo 8 : Barque assurant le transport entre
Cotonou et la basse vallée de
l'Ouémé (Cliché :
Jean LAOUROU, 2009)
La photo 8 montre une barque chargée en direction de la
basse vallée. Les marchandises sont rangées au fond de la barque
avant l'installation des passagers.
L'organisation est faite de telle sorte qu'un transporteur ne
peut faire qu'un voyage (aller et retour) par jour. Une vague de barques
débarque à Cotonou le matin à partir de 6 heures. Les
barques non motorisées repartent quelques minutes après alors que
les grandes barques motorisées peuvent attendre jusqu'à 14 heures
au plus tard ; c'est à cette même heure que la seconde vague de
barques débarque pour assurer le transport de la soirée.
Cependant, on
72
compte en moyenne 38 barques le matin contre 25 l'après
midi ; ce qui montre que l'affluence est plus grande dans la matinée.
5.4. L'analyse des flux
Les flux s'apprécient à travers la quantité
de marchandises et le nombre de personnes enregistrées au niveau des
lieux d'échange. Ces flux sont résumés dans la figure
9.
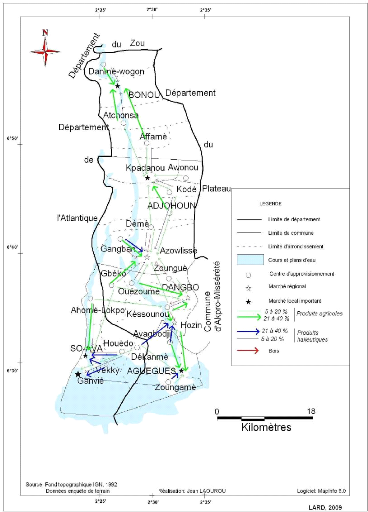
73
Figure 10: Carte des flux des produits dans les
différents marchés de la basse vallée L'analyse de la
figure 9 montre que chaque localité à ses
spécificités. Les produits sont convoyés vers les
marchés locaux puis vers les marchés régionaux
74
(Azowlissè et Dangbo). Ce sont donc ces deux
marchés qui reçoivent les plus grandes affluences dans la basse
vallée de l'Ouémé. Dans ces lieux, s'approvisionnent les
commerçants de Cotonou. Ces marchés reçoivent donc outre
les produits locaux, les produits manufacturés des régions
urbaines. Sur les 1026 usagers du marché d'Azowlissè, 450
proviennent des régions autres que la vallée ; ce qui
témoigne de la fréquentation du marché par des acteurs aux
origines diverses. Par ailleurs, la commune de Sô-Ava envoie beaucoup
plus ces produits vers Cotonou en raison de la courte distance qui
sépare les deux localités. Elle reçoit également
beaucoup de produits en provenance de Cotonou à cause de sa faible
production agricole et de son poids démographique.
D'une façon générale, les produits de
Cotonou sont convoyés vers les plus importants marchés de la
basse vallée avant d'être distribués dans les autres
localités de la région comme le montre la figure suivante :
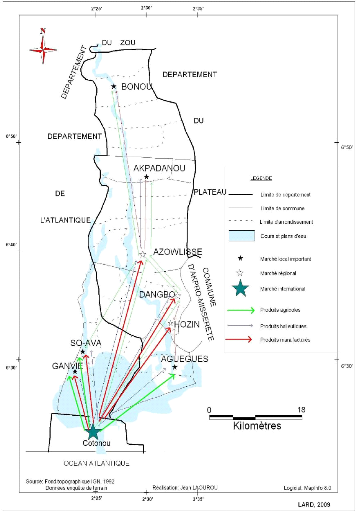
75
Figure 11 : Carte des réseaux de
distribution des produits de Cotonou
Au total, différents facteurs ont participé
à l'évolution des échanges. Ainsi, les variations de la
production influencent l'animation des marchés dans
76
la mesure où c'est la disponibilité du produit
qui permet de déterminer les prix sur les lieux d'échange. Les
offres de la basse vallée sont notamment des produits du secteur
primaire alors que Cotonou fournit outre ses produits alimentaires, les
produits manufacturés importés. Ces biens sont transportés
par des barques et des pirogues dont la capacité varie en fonction du
trajet. On note une augmentation de leur nombre et du nombre de vendeurs dans
les marchés ; ce qui permet de dire que le secteur est en plein
dynamisme. Cette activité a un impact socio-économique non
négligeable qu'il importe de connaître.
77
| 


