Partie I - Le Docteur Bendjelloul, champion
assimilationniste de la cause algérienne
(1930-1938)
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 24
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 25
I - Le réformisme assimilationniste, programme
politique du Docteur Bendjelloul
Né en 1893 à Constantine d'un
père instituteur de formation dans une famille de notables
désargentés1, Mohammed Salah Bendjelloul effectue ses
études de médecine à la faculté d'Alger dans les
années 1910. Selon les documents de surveillance coloniale, Bendjelloul
aurait ensuite été médecin de colonisation dans les
Aurès dans les années 1920 avant d'installer son cabinet dans sa
ville d'origine2. C'est à partir de ce moment que son
activité politique devient publique, en tant que Président de la
Fédération des Elus Musulmans (FEM) du département de
Constantine, de 1932 à la Seconde Guerre Mondiale.
Durant ses études, Bendjelloul est
témoin de l'essor du mouvement Jeune Algérien auquel
appartiennent alors beaucoup de futurs personnages politiques de sa
génération3. Ce mouvement politique, notamment
dirigé par l'Emir Khaled, le petit-fils d'Abdelkader, revendique des
réformes du système politique et l'égalité des
droits pour les Algériens et les colons européens4. Le
courant Jeune Algérien constitue l'émergence d'un discours
politique assimilationniste. Les Jeunes Algériens respectent les formes
et les cadres d'expression du discours politique français. Ils
s'expriment en français, utilisent la presse, revendiquent
l'accès aux droits civiques et à la citoyenneté
française avec maintien du statut personnel musulman. Cette notion
juridique distinguait les Français de statut personnel musulman des
citoyens français de plein droit. Les colonisés souhaitant
exercer leur pleine citoyenneté devaient renoncer à leur statut
personnel musulman, ce qui s'apparente pour eux à une apostasie. L'un
des combats des assimilationnistes est la revendication de la pleine
citoyenneté sans abandon du statut personnel.
1 Entretien avec M'hamed Bendjelloul, fils de
M.S.Bendjelloul, In Julien Fromage, Innovation politique et mobilisation de
masse en « situation coloniale » : un « printemps
algérien » des années 1930 ? L'expérience de la
Fédération des Elus Musulmans du Département de
Constantine, Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2012.
2 Sous-Direction des Services Actifs de Police -
Service Central des Renseignements Généraux, « A/S de M.
BENDJELLOUL Mohamed Salah, ex-député de Constantine »,
Gouvernement Général d'Algérie, 1958. GGA 7G 1403, ANOM,
Aix-En-Provence.
3 J. McDougall, A History of Algeria, op.
cit, p. 181.
4 Voir Charles-Robert Ageron, « Le mouvement
«Jeune-Algérien» de 1900 à 1923 », in
Genèse de l'Algérie algérienne, Saint-Denis,
Éditions Bouchène, 2005, p. 107-130.
Dans ce mémoire, on entend par
assimilationnisme une aspiration à l'égalité
formulée par les colonisés dans les formes du discours politique
du colonisateur. Les adhérents à cet idéal, souvent des
élites éduquées, se distinguent par une francophilie
affirmée et professent leur reconnaissance au colonisateur, se
considérant comme les preuves de la réussite de la mission
civilisatrice. Bendjelloul s'inscrit dans cette dynamique, mais y associe une
stratégie de mobilisation populaire revendicative, qui légitime
le mouvement tout en répandant l'idée assimilationniste
au-delà de l'élite urbaine.
A - La préface de 1935, une profession
d'assimilationnisme
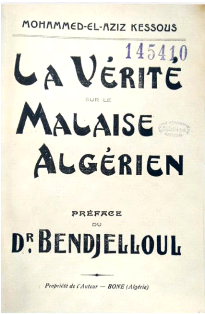
Figure 1 Deuxième couverture de «
La
Vérité sur le Malaise
Algérien » de
Kessous, Bône (Annaba),
Société anonyme de l'imprimerie rapide, 1935.
En 1935, Mohammed-El-Aziz Kessous, alors
rédacteur en chef de l'Entente, publie un essai de 115 pages
intitulé « La Vérité sur le Malaise Algérien
»1. La préface de ce livre est écrite par
Bendjelloul, et est l'une des sources écrites par lui les plus longues
dont nous disposions, et également la seule qui ait été
publiée. « La Vérité sur le Malaise Algérien
» s'inscrit résolument dans l'idée assimilationniste, et ce
dès le verso de la page de titre où l'auteur dédicace son
livre « à [ses] Maîtres de l'Ecole Primaire, de
l'Enseignement Secondaire et des Facultés.
»2.
Une analyse rapide de la couverture est
révélatrice du rôle de Bendjelloul sur la scène
politique algérienne des années 1930 : son nom est imprimé
en plus grand que nom de l'auteur, et semble lui servir de légitimation,
voire d'argument de vente.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 26
1 Mohammed-El-Aziz Kessous, La
Vérité sur le Malaise Algérien - Préface du Dr
Bendjelloul, Bône (Annaba), Société anonyme de
l'imprimerie rapide, 1935.
2 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 27
Dans sa préface, Bendjelloul appelle Kessous
son « cher ami » et « un des membres les plus
représentatifs de la jeunesse intellectuelle indigène
»1. Il loue la qualité du travail de l'auteur pour
« rétablir les faits dans leur exactitude » et « exposer
[les] justes revendications » des Elus Musulmans, dans un contexte de
« calomnies » et de « ragots » dont ils sont
victimes2. En effet, moins d'un an avant la publication de ce livre,
les 3 et 5 août 1934, la ville de Constantine avait été
endeuillée par de violentes émeutes antisémites,
perpétrées par des Algériens musulmans partisans de
Bendjelloul ayant cru, dans un contexte de tensions exacerbées par la
situation coloniale, que leur leader avait été assassiné.
Cette émeute avait été instrumentalisée par les
ennemis de l'assimilation des colonisés comme une preuve de leur
sauvagerie et du danger qu'ils représenteraient s'ils étaient
intégrés au corps des citoyens français3. Afin
de contrer cette campagne de diffamation, Bendjelloul professe « les
sentiments et les intérêts qui lient indéfectiblement
à la France » les représentants des Algériens
musulmans, et espère que, grâce au travail de Kessous, « on
ne mettra plus en doute [leur] patriotisme » :
La France a comblé de bienfaits notre pays,
nous l'avons toujours proclamé et nous le proclamerons toujours. C'est
elle qui a construit ces écoles où des milliers d'enfants
s'adaptent de plus en plus à une vie moderne où l'instruction est
le premier des biens ; c'est elle qui a tracé des routes, établi
des ponts, construit des hôpitaux, défriché des
forêts, fertilisé des marais ce dont nous lui serons
éternellement reconnaissants. Mais n'est-il pas vrai que ces
progrès sont encore loin de suffire à tous les besoins,
qu'ils ont été inégalement répartis et que leur
jouissance est pratiquement refusée à la plus grande partie de la
population laborieuse ? 4
Bendjelloul reprend des thèmes
rhétoriques coloniaux, comme la mission civilisatrice ou plus loin la
référence à l'empire romain, mais il ne se contente pas
d'acclamer la colonisation,
1 Mohammed Salah Bendjelloul, « Préface
», in La Vérité sur le Malaise Algérien -
Préface du Dr Bendjelloul, Bone (Annaba), Société
anonyme de l'imprimerie rapide, 1935, respectivement p. 7 et p. 5.
2 Ibid.
3 Pour une enquête de fond sur cet
évènement et la complexité des facteurs ayant mené
au pogrom, voir Joshua Cole, Lethal provocation, op. cit.
L'auteur y présente également la rhétorique
antisémite employée par Bendjelloul à cette époque
à des fins électoralistes. Si les sources
sélectionnées pour la réalisation de ce mémoire ne
donnent pas suffisamment de matière pour discuter de cet aspect du
discours politique algérien, le recours à l'antisémitisme
de Bendjelloul et d'autres élus algériens musulmans est un fait
avéré.
4 M. S. Bendjelloul, « Préface »,
art. cit., p. 7.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 28
comme l'ont fait les colons quelques années
plus tôt lors des célébrations du centenaire de la
colonisation de l'Algérie. Il commence par louer le travail accompli
factuellement, avant de dénoncer les injustices dans la
répartition des bénéfices en découlant. Il appelle
les colonisateurs français, qui se voient comme les héritiers de
l'Empire Romain en Afrique du Nord, à imiter leurs ancêtres : ne
réduisant pas l'Afrique du Nord à une ressource en biens et en
soldats mais laissant se développer l'élite intellectuelle :
« des poètes, tel Apulée, des empereurs, tel
Septime-Sévère, et des penseurs, tel Saint-Augustin
»1. Plus largement, il affirme que la masse paysanne est
restée dans le même état depuis la conquête
malgré les nombreux bienfaits énumérés dont ne
bénéficie pas la majorité des Algériens. Le
principal apport de la colonisation pour ces masses est la
sécurité, mais elle a été acquise au prix de la
participation des Algériens à toutes les guerres du Second Empire
et de la IIIe République. Cela leur confère « le
droit de réclamer un traitement politique plus équitable et une
vie matérielle meilleure »2. Dans ce texte, Bendjelloul
reste réformiste et peu radical dans ses revendications. Il ne remet pas
en cause la colonisation en soi mais appelle simplement à des
améliorations : il ne dit pas que les Algériens ont droit
à un traitement politique équitable mais « plus
équitable » ; il ne réclame pas vie matérielle digne
mais « une vie matérielle meilleure ».
Deux pôles de demande sont identifiables : la
situation humanitaire, ou soulagement de « l'épouvantable
misère dont souffre le paysan algérien »3, et le
problème politique de la place des musulmans dans la cité
française :
La France est aujourd'hui la deuxième
puissance musulmane de l'Univers, et il se trouve que ses ressortissants
Mahométans sont groupés à sa porte, la prolongent dans
l'espace, et participent activement à sa vie économique et
politique. C'est là une situation unique qui lui impose des devoirs
spéciaux, très différents de ceux qui incombent aux autres
puissances musulmanes, telles l'Angleterre ou la Hollande, dont les sujets
mènent, à des milliers de lieux, une existence tout à fait
particulière4 .
1Ibid., p.
6.
2 Ibid., p.
8.
3 Ibid.
4 Ibid., p.
9.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 29
A ceux qui jugent que l'Islam est incompatible avec la
civilisation européenne, Bendjelloul répond avec une dimension
transimpériale qui se retrouve régulièrement au cours du
parcours politique de Bendjelloul. Il affirme que les
spécificités de l'Algérie dans l'empire colonial donnent
à la France une relation unique et une responsabilité
particulière envers ces populations. La religion musulmane de celles-ci
est une donnée avec laquelle la France doit composer, affirme
Bendjelloul : si l'attachement des Algériens à l'Islam n'est pas
négociable, il n'entre pas plus en contradiction avec le statut de
citoyen français, tout comme l'attachement de certains Français
à la chrétienté1.
Ainsi, l'assimilationnisme de Bendjelloul
formulé dans ce texte se base sur une appropriation des motifs
discursifs des colonisateurs français, pour mettre ces derniers face
à leurs contradictions. Il demande d'eux ce que la propagande de la
mission civilisatrice et de la France pays des Lumières promet : la
liberté et l'égalité pour les colonisés. Ce texte
est un aperçu clair et argumenté du programme porté par
Bendjelloul en tant qu'élu au sein des institutions
coloniales.
| 


