La lutte contre l'habitat insalubre est une
préoccupation ancienne en France et constitue un débat important
sur les conditions de vie des classes laborieuses tout au long du XIXème
siècle. Ces préoccupations sont également partagées
par d'autres pays en Europe qui connaissent les effets de la Révolution
Industrielle.
Le courant hygiéniste
En France, les premiers objectifs de santé publique
furent d'enrayer les épidémies touchant la population. Ce fut le
cas avec les grandes épidémies de choléra de 1832, 1849 et
18651866. Ces épidémies firent des centaines de milliers de mort
en France et plus particulièrement dans les grandes villes à
population nombreuse et regroupée. La propagation de cette
épidémie résidait dans l'absence d'eau potable, propre
à la consommation. A Roubaix, ces épidémies furent
particulièrement meurtrières notamment dans les courées.
Ce type d'habitat, dont nous détaillerons les caractéristiques et
l'évolution par la suite, n'a en effet pas échappé
à ces vagues endémiques. Les maisons, pour la plupart, ne
disposaient en effet pas de l'eau courante. Les habitants se fournissaient
à un point d'eau collectif par l'intermédiaire d'une pompe et
plus tardivement d'un robinet. L'eau non potable y était stockée
dans un puit ou une citerne située en règle
générale à l'entrée de la courée.
C'était bien souvent cette pompe, alimentant des dizaines de personnes,
qui était le lieu de contamination.
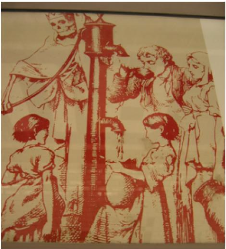
15
Allégorie de la « pompe
meurtrière », fin XIXème siècle
Service Communal
d'Hygiène et de Santé, Ville de Roubaix
Suite à ces épidémies, des
médecins se sont alors interrogés sur les conditions de vie des
ouvriers et ont démontré que c'était en grande partie les
conditions de logement qui étaient responsables de la mauvaise
santé des familles qui y vivaient. Ce fut le cas par exemple en 1838 du
Docteur Pierre Adolphe Piorry qui dans son ouvrage intitulé « Des
habitations et de l'influence de leur disposition sur l'homme en santé
et en maladie » montra l'importance d'établir des ordonnances de
police pour sauver la santé du peuple ainsi que d'accorder des primes de
l'Etat pour la construction de maisons ouvrières saines.
Ce sont les prémisses du « courant
hygiéniste ». Courant ingénieux et novateur pour
l'époque, puisque pour la première fois, la relation entre la
santé et l'habitat est clairement établie. Les premières
actions commencent à apparaître : on voit par exemple qu'entre
1845 et 1849, les frères De Melun, l'un avocat et l'autre
député, fondèrent les « Annales de la Charité
» et créèrent une « Société
d'économie charitable » afin d'allier d'autres membres de la haute
société à la cause ouvrière.
16
Une intervention de l'Etat encore timide
L'intervention de l'Etat, malgré ces actions, demeure
encore timide. Il faudra attendre la première loi de politique sociale
en avril 1850 pour voir ce tabou en partie levé. Cette loi donne une
première définition d'un logement insalubre. Il s'agit : «
de logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter
atteinte à la vie ou à la santé des habitants ». Une
fois encore, la relation entre santé et habitat est mise en avant. Cette
notion a désormais un sens et une action politique. Ce projet de loi est
vivement défendu par Victor Hugo dans un « Discours sur la
misère », discours qu'il prononce contre son propre parti
conservateur.
L'impact de cette loi est tout de même à
nuancer. Ce texte de loi permet une intervention des communes sur les logements
insalubres par le biais d'une décentralisation des pouvoirs au profit
des Conseils Municipaux. Ils ont alors la possibilité de créer
une « Commission des Taudis » afin de rechercher et d'indiquer les
mesures indispensables d'assainissement des logements insalubres mis en
location ou occupés par d'autres que le propriétaire,
l'usufruitier et l'usager. Les travaux qui seront décidés par
cette commission seront alors imposés au propriétaire sous peine
d'amende. Des villes comme Roubaix ou Paris vont s'appuyer sur cette loi pour
commencer à lutter contre l'habitat insalubre gangrenant sur leur
territoire.
Mais on constate que l'application de cette loi est tout de
même variablement suivie et appliquée par les municipalités
puisqu'en effet de nombreux propriétaires ne sont autres que les membres
siégeant dans ces Conseils Municipaux.
Suite à ces actions, d'autres lois vont être
votées. Elles concernent en 1894, l'assainissement du département
de la Seine en rendant obligatoire le tout à l'égout pour toutes
les nouvelles constructions et permet la création des Habitations
à Bon Marché (HBM).
Une autre loi en 1898 détermine un nouvel objectif de
santé publique : l'eau. Chacun doit en effet pouvoir accès
à une eau propre à la consommation et donc sans danger. Elle
impose donc les premières mesures de salubrité et de
sécurité en matière de traitement de l'eau de
consommation.
17
La loi relative à la protection de la santé
publique
Une véritable innovation apparaît avec la
promulgation, le 19 février 1902, de la loi relative à la
protection de la santé publique. C'est la première vraie loi de
santé publique Elle fut adoptée après dix ans de
débat et prévoit:
- L'instauration d'un Conseil d'Hygiène Publique dans
chaque département,
- La création d'un Bureau Municipal d'Hygiène dans
chaque ville de plus de 20 000
habitants.
- La possibilité pour la Commission Sanitaire
Municipale de prononcer l'interdiction
d'habiter pour les immeubles représentant un danger
pour la santé publique et contraindre ainsi les propriétaires
à réaliser des travaux « d'assainissement » de leur
bien.
-La mise en place d'un permis de construire permettant un
contrôle du maire sur l'aspect sanitaire des constructions.
- La création d'un Règlement Sanitaire
Départemental pour la salubrité des maisons et la
prévention des épidémies. Les RSD, plusieurs
modernisés depuis, sont toujours une référence aujourd'hui
dans la lutte contre l'habitat insalubre.
La loi du 9 avril 1903 rendra applicable à la ville de
Paris et au département de la Seine les dispositions de la loi de
1902.
Cependant, l'activité de divers mouvements de
pensée ou encore des congrès internationaux d'hygiène
publique démontrent encore le manque d'efficacité pratique de
cette loi.
18
Les fondements du mouvement PACT
En 1924, la Ligue Nationale Contre les Taudis est
créée afin de lutter notamment contre les quartiers de cabanes de
fortune qui ceinturent Paris. Cette ligue est patronnée par le
gouvernement et les autorités religieuses. Elle organise des
manifestations multiples: conférences, bals de charité, ventes ou
encore tombolas afin de récolter les fonds nécessaires. Elle
crée également une société anonyme d'Habitations
à Bon Marché " Le nouveau logis ". C'est le fondement du
mouvement des PACT (Propagande et Action contre les Taudis) dont le premier
naît à Lyon en 1942.
C'est Jean Pilla, alors étudiant à
l'époque, aidé de quelques amis industriels lyonnais, qui sera
à l'origine de la création du PACT. Cette association fonctionne
au début de la même manière que les groupes de jeunes
bénévoles. Leur philosophie est d'aider les ménages les
plus précaires en luttant contre l'insalubrité dans lesquels ils
vivent et accessoirement de venir en aide aux sans-abri. Ils sont animés
par la conviction que le logement est un élément essentiel de la
qualité de vie des personnes et qu'il permet aussi l'insertion sociale.
Au début, par manque de moyen financier, l'association ne pouvait faire
que des actions de petite envergure. L'idée du PACT de Lyon va
s'exporter rapidement à travers toute la France avec comme premiers
lieux d'ouverture du PACT : " Lille, Roubaix, Dijon, Marseille, Nantes,
Bordeaux et Nancy ". Dès 1951, l'association se regroupe dans une
fédération nationale. Elle va s'imposer comme bailleur social
grâce à des logements dont elle sera propriétaire. Ils vont
ainsi permettre aux personnes les plus fragiles d'être logées dans
des loyers à faibles charges. Des agents sociaux interviendront pas la
suite pour accompagner les familles qui en ont besoin. Le PACT
s'institutionnalise et est reconnu par le gouvernement comme un partenaire
à part entière.
19
De nouvelles orientations face aux conséquences de la
Seconde Guerre Mondiale
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les conditions de
logement sont catastrophiques. Ainsi, de nouvelles orientations politiques sont
prises dès septembre 1948. Ces grandes orientations permettent la
création de l'allocation logement, le droit au maintien dans les lieux
des locataires et la première réglementation des loyers du
secteur privé. Le loyer sera désormais calculé sur la base
de la "surface corrigée " : chaque élément de confort
(lavabo, douche... ) correspond à des m2
supplémentaires servant à déterminer le montant du loyer.
Pour compenser les contraintes financières des propriétaires, se
crée un Fond National pour l'Amélioration de l'Habitat qui
deviendra plus tard, l'Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat.
Le terrible hiver de 1954 est resté, encore
aujourd'hui, dans les mémoires. L'Abbé Pierre lance un appel au
secours en implorant l'Etat de venir en aide aux sans-abri et aux
mal-logés. Un concours national est alors lancé pour
réaliser des Logements Economiques de Première
Nécessité. Ce sont des Cités d'Urgence qui vont être
créées soit 12 000 logements construits sur 220 villes.
Le Code de santé publique sera modernisé en
1957 et la loi " Debré " de 1964 traitera plus particulièrement
des bidonvilles. Les Règlements Sanitaires Départementaux,
prévus depuis 1902, sont renforcés par un décret du 5
octobre 1953 qui institue le Règlement Sanitaire Départemental,
obligatoire cette fois, et assure son application dans tous les
départements avec une adaptation « à la marge » aux
conditions spécifiques à chaque département, palliant
ainsi la carence des règlements communaux.
20
La résorption de l'habitat insalubre
A la suite de l'incendie d'un garni à Aubervilliers en
janvier 1970, le Secrétaire d'Etat au logement, Robert -André
Vivien, présente un projet de loi sur la résorption de l'habitat
insalubre. La loi est adoptée le 10 juillet 1970, en déclaration
d'urgence. La loi Vivien modifie le Code de santé publique, qui
régissait jusque-là, le problème de l'insalubre « en
dur » et intègre le dispositif de la loi Debré concernant
l'expropriation. Ainsi, cette loi comporte des dispositions relatives à
l'insalubrité :
- Elle permet un renforcement de la lutte ponctuelle contre
l'insalubrité - Elle pénalise les marchands de sommeil
- Elle instaure une nouvelle définition de
l'insalubrité en dur : le périmètre insalubre
délimité par le préfet. Il comporte au moins 60%
d'immeubles insalubres, mais englobe des locaux et immeubles salubres.
Après avis du Conseil Départemental d'Hygiène, du maire et
du Conseil municipal, le préfet déclare par un
arrêté global l'insalubrité et l'interdiction d'habiter
pour tout le périmètre.
Elle apporte également des dispositions relatives
à l'expropriation :
- Elle permet de traiter l'urgence de certaines situations
par une déclaration d'utilité publique
accélérée.
- Le loi vise également à une prise de
possession rapide des périmètres insalubres par les
collectivités, qui pourront procéder aux destructions
nécessaires, puis aux reconstructions éventuelles.
Ces actions de Résorption de l'Habitat Insalubre
permettront la démolition d'îlots complets de bâtiments
vétustes et la reconstruction à neuf d'îlots entiers. Ces
opérations seront largement critiquées par la suite puisque non
seulement elles entraînent une déstructuration urbaine mais
également l'éviction des familles les plus pauvres. Leur
relogement se fera pour la plupart dans les zones
périphériques.
En 1976, le "Fond d'Aménagement Urbain " sera
institué sur une logique de redécouverte et de revalorisation des
quartiers anciens. La résorption de l'habitat insalubre sera
également
21
inscrite dans cette démarche. L'accent est cependant
mis, tant pour des raisons architecturales qu'urbanistiques, que pour des
raisons sociales, sur des travaux portant sur les bâtiments existants. La
notion de remédiabilité l'emporte sur celle
d'irrémédiabilité, fondement de la démolition. En
1979, un dispositif financier est mis en place pour faciliter les travaux de
sortie d'insalubrité effectués par les propriétaires
occupants et les propriétaires bailleurs. Une circulaire
interministérielle le 14 janvier 1980 précise la portée de
ces nouveaux outils.
Ces dispositifs juridiques et financiers perdurent jusqu'en
2000. Seules quelques opérations de RHI « pure » : par
démolition de périmètre, seront encore menées dans
certains départements.
Les conséquences de la
Décentralisation
La loi du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, dite loi de «
décentralisation », a été complétée par
la loi du 22 juillet 1983 qui indique que les Bureaux Municipaux
d'Hygiène, datant de la loi de 1902, deviennent des Service Communaux
d'Hygiène et de Santé et que ceux exerçant effectivement
des missions d'hygiène publique peuvent, par dérogation,
continuer à exercer ces missions au nom de l'Etat moyennant une dotation
financière.
Certaines villes seront donc dotées d'un Service
Communal d'Hygiène et de Santé amène de traiter des
dossiers d'insalubrité comme c'est le cas à Roubaix. Sur les
autres territoires, ne disposant pas d'un SCHS, c'est la DDAS qui aura en
charge les problèmes d'insalubrité.
22
Le projet de loi Duflot
Mardi 17 septembre 2013, l'Assemblée Nationale a
adopté en première lecture, par 312 voix contre 197, le projet de
loi Duflot sur le logement. Cette loi instaure la garanti universelle et
l'encadrement des loyers. Mais ce texte de loi comporte aussi de nombreuses
autres dispositions, concernant entre autres les règles régissant
les copropriétés ou la lutte contre l'habitat insalubre.
Le volet permettant de renforcer la lutte contre l'habitat
indigne va être développé ici. Il comprend plusieurs
actions:
- La mise en place d'un acteur unique en vue de simplifier la
mise en Suvre de polices spéciales de l'habitat. Les Etablissement
Publics de Coopération Intercommunal deviendront alors les acteurs
uniques de la lutte contre l'habitat indigne en donnant à leurs
présidents les prérogatives en matière de police
spéciale du logement, détenues d'une part par les maires des
communes membres et d'autre part par le préfet.
- Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil,
grâce, notamment, à l'instauration d'une astreinte administrative.
L'action consistera à faire vérifier par le notaire, lors des
transactions immobilières, que l'acheteur personne physique ou les
dirigeants sociaux ou associés de la société civiles
immobilières se portant acquéreur, ne sont pas déjà
condamnés pour des faits de soumission d'une personne à des
conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (
sauf dans le cas où la personne concernée attestera que le
logement est destiné à son occupation personnelle ).
- Une astreinte de 200 euros par jour de retard dans
l'exécution des travaux permettra également de sanctionner les
propriétaires défaillants aux prescriptions des
arrêtés d'insalubrité. Ces propriétaires auront
désormais à leur charge le coût des travaux mais
également le coût de la maîtrise d'ouvrage. Ce dernier est
en effet aujourd'hui pris en charge par la puissance publique.
- Le texte de loi permet également de modifier la
procédure relative à l'octroi et au versement de l'allocation
logement dans le cas des logements déclarés non décents
afin
23
d'inciter les bailleurs à effectuer les travaux de mise
en conformité, tout en limitant l'impact sur le locataire.
Ainsi, si un logement fait l'objet d'un constat
d'indécence, le droit à l'allocation logement est maintenu durant
un délai d'un an pour le locataire, mais son versement est
différé tant que le propriétaire n'a pas effectué
les travaux de mise en conformité. Durant ce délai, le locataire
ne s'acquitte que du loyer résiduel, sans que cela ne puisse fonder une
action du bailleur à l'égard du locataire pour l'obtention de la
résiliation de bail. Dès que les travaux sont
réalisés, l'aide est reversée au bailleur. Si à
l'issue de ce délai d'un an, les travaux ne sont toujours pas
réalisés alors l'allocation logement est définitivement
perdue.



