2 / Les nécessaires partenariats
Les partenariats « Habitat »
- La "Maison de l'habitat": une aide pour intégrer un
logement social
A Roubaix, la "Maison de l'habitat" permet d'aider une partie
de ces ménages en difficulté dans leurs démarches de
demande de logement social mais également de les informer sur
l'avancée et le suivi de leurs dossiers.
De nombreuses personnes peuvent ressentir un sentiment
d'incompréhension voir d'injustice en constatant que malgré la
gravité de leur situation, les démarches de relogement sont
toujours aussi longues. La « Maison de l'habitat » permet alors
d'informer les ménages sur le traitement de leurs dossiers, de prendre
rendez-vous avec l'élu au logement de la commune pour traiter des
situations d'extrême urgence et enfin de travailler en relation avec tous
les bailleurs disposant de logements sur Roubaix afin de trouver une solution
rapidement tout en respectant au mieux le choix des familles et leurs
critères de sélection. Il arrive que des ménages accordent
une grande importance à la localisation de leurs logements au point de
refuser les propositions faites par les bailleurs malgré l'urgence de
leurs situations. Des quartiers jugés trop difficiles et
insécurisants comme l'Alma ou l'Epeule peuvent être refusés
par des couples avec enfants ou des femmes divorcées ou
séparées.
L'organisation du logement en fonction des coutumes et/ou des
pratiques des familles peut également amener un ménage à
refuser une proposition de logement. Les bailleurs développent
aujourd'hui des cuisines " américaines " (cuisines ouvertes) qui ne
conviennent cependant pas aux modes de vie des familles d'origine d'Afrique du
Nord. La cuisine étant traditionnellement l'espace réservé
aux femmes de la maison et le salon pour recevoir les invités ou pour
les hommes. La séparation entre les pièces doit être claire
et distincte. Pour cette raison, ces familles peuvent donc refuser les
propositions faites par les bailleurs et se reporter sur le parc de logements
indignes.
97
" Chez moi est une réalité
incrustée dans les plus infimes replis d'une mémoire, d'un corps
et ses gestes, ses habitudes. Chez moi est imprimé dans une vie, une
accumulation de jours passés et sédimentés dans un lieu"
(...) Il y avait un espace qui sans moi est à nouveau vide, qu'importe
que le plafond s'effondre, que les murs s'effritent, c'est moi qui l'occupais.
C'est ici que j'ai agi et senti. Habiter, même un taudis, trace une
histoire, une empreinte, occupe définitivement un esprit. Habiter est
irrémédiable et l'on s'en souvient. Alors, parfois, on veut
revenir."Extrait de " l'Inhabitable " de Joy Sorman et Eric
Lapierre
Lorsque ces situations sont durables, les ménages
peuvent tisser des liens étroits avec leur logement.
Ces liens peuvent être affectifs. En effet, les
ménages peuvent être attachés à leur logement parce
qu'ils y ont toujours vécu, y ont vu leurs enfants grandir, ont
tissé des liens avec leurs voisinages... Ils ne souhaitent donc pas
toujours être relogés.
Ces ménages ont également
développé des modes de vie, des pratiques quotidiennes
liés à l'insalubrité qu'ils peuvent chercher à
préserver malgré la situation d'urgence dans laquelle ils se
trouvent.
- De nombreux ménages vont souhaiter être
relogés le plus rapidement mais ils peuvent rencontrer des
difficultés d'appropriation avec les nouveaux équipements mis
à leur disposition dans les logements neufs. C'est leurs modes de vie,
leurs pratiques quotidiennes qui vont être bouleversés. Dans la
région Nord-Pas-de-Calais, des ménages se chauffent encore au
charbon. C'était encore le cas des "Vieux corons" à Douai
Dorignies qui ont fait l'objet d'une réhabilitation PACT récente.
Ces logements sont aujourd'hui tous équipés de chaudière
gaz à condensation. Même si ces installations limitent les risques
sanitaires et écologiques et permettent un meilleur confort des
ménages, ceux-ci n'apprécient pas ce nouvel équipement. Le
charbon permet en effet aux ménages de contrôler leur consommation
en temps réel. Ils peuvent également utiliser du bois lorsqu'ils
ont moins de moyens et certains CCAS (exemple: Bouchain) distribuent
gratuitement du charbon à ces ménages. Une installation au gaz
nécessite donc de nouveaux frais mensuels que les
98
ménages ne souhaitent pas assumer. De plus,les
variations de température peuvent représenter une gêne pour
ces ménages dans leur quotidien.
- D'autres habitants malgré leur situation d'urgence
peuvent refuser d'être relogés car ils se sentent bien chez eux,
à leur place. Cela est encore plus vrai à Roubaix où les
habitants des courées forment de petites communautés,
s'entraident, tissent de véritables liens sociaux. Claude Dujardin,
Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville
l'évoque d'ailleurs dans l'ouvrage " La France invisible": " Une maison,
c'est un chez-soi, quand un appartement n'est qu'un petit bout d'un ensemble:
il n'y a pas la même relation affective aux murs, il n'y a pas cette
impression d'être chez les autres." Les habitants ne souhaitent pas
toujours être relogés car ils ont déjà leur propre
maison.
Ces ménages peuvent mal vivre un relogement dans un
autre logement et surtout dans un autre quartier. Or le principe de
mixité social inclut bien souvent un relogement de ces ménages
précaires dans des quartiers plus embourgeoisés. Les
ménages, en plus de perdre les liens sociaux qu'ils ont mis des
années à tisser, pourront ne pas se sentir à leur aise
avec leur nouveau voisinage comme si le relogement était un
épisode supplémentaire de relégation sociale renvoyant
à sa propre situation de pauvreté. Ce fut le cas d'une locataire
PACT, ancienne résidente de la cité Lys à Fives, elle y
vivait dans une situation de grande précarité. Elle fut
relogée dans une résidence tout confort à proximité
du centre de Lille. Elle a rapidement évoqué des
difficultés d'adaptation mais également d'intégration dans
sa nouvelle résidence. Elle se sentait stigmatisée par son
voisinage.
99
Un partenariat incitatif et de prévention avec la
CAF
La lutte contre l'insalubrité est complexe. Elles
comportent de multiples problématiques qu'il convient de traiter dans
leur ensemble afin d'y remédier. Ces problématiques ne sont pas
uniquement techniques. Elles peuvent être sociales, financières,
juridiques ou encore sanitaires. Elles impliquent donc divers partenaires.
La collaboration et la synergie entre les acteurs est
essentielle dans la lutte contre l'insalubrité. Ces partenaires peuvent
être impliqués dans l'ensemble de la démarche ou
n'être que des interlocuteurs complémentaires lorsque leur
présence est sollicitée. Il existe plusieurs partenaires dans la
lutte contre l'habitat insalubre, ce sont par exemple: des opérateurs,
ou encore l'ANAH par le biais des subventions de sortie d'insalubrité...
Ils ont une approche différente dans le traitement de
l'insalubrité mais complémentaire puisqu'ils ont le même
objectif.
Nous allons dans cette partie, nous intéresser plus
particulièrement au partenariat mis en place avec la CAF.
En 1993, une première convention est passée
entre la Caisse d'Allocations Familiales et la Ville de Roubaix. Celle-ci
permet de contrôler avec plus de sécurité les logements
pour lesquels il y a une demande d'allocation. Jusque-là les logements
antérieurs à 1948 devaient respecter les règles
d'habitabilité suivantes :
- Présence d'un poste d'eau potable,
- De moyens d'évacuation des eaux usées,
- D'un WC particulier pour les habitations individuelles ou d'un
WC par étage pour les
collectifs,
- D'un moyen de chauffage propre.
Ces critères apparaissent insuffisants dans les faits. La
convention a ainsi permis d'être plus
exigeant vis-à-vis des logements mis en location.
Dans le cas d'un logement insalubre, la procédure
administrative est engagée et le bailleur doit réaliser des
travaux de remise aux normes et être contrôlé par le service
d'hygiène pour que le locataire puisse à nouveau prétendre
à l'allocation logement.
100
Le décret du 30 janvier 2002, relatif à la
notion de décence, a permis de lutter plus efficacement contre
l'indécence et l'insalubrité des logements. Cette notion de "
logement décent " se distingue de " logement salubre ".
L'indécence concerne une relation contractuelle entre un
propriétaire bailleur et son locataire. C'est la Loi relative à
la Solidarité et au Renouvellement Urbain 2000/1208 du 13
Décembre 2000, dite Loi SRU qui a introduit la notion de décence
à côté de celle d'insalubrité déjà
existante (l'insalubrité fait référence plus
particulièrement au Code de la Santé Publique et au
Règlement Sanitaire Départemental).
Pour qu'un logement soit décent, il doit remplir un
certain nombre de critères :
- Le logement doit respecter les conditions relatives à
l'insalubrité. Il doit ne pas être frappé d'un
arrêté d'insalubrité ou de péril et ne doit pas
être inhabitable par nature. Le respect des critères du
Règlement Sanitaire Départemental est alors essentiel.
- Le logement doit également répondre aux
conditions relatives à la sécurité et à la
santé des occupants. Dans cette optique, le gros Suvre, la couverture,
les menuiseries, les escaliers et les balcons doivent être en bon
état. Les canalisations et revêtements ne doivent pas
présenter de risque pour la santé. Les branchements au gaz,
à l'électricité, au chauffage, et à l'eau chaude
doivent être aux normes et enfin le logement doit disposer d'un
éclairage naturel et d'une ventilation suffisante.
Si un logement ne présente pas ces
caractéristiques, il est signalé auprès de la CAF,
parallèlement à la procédure administrative
engagée.
Afin de repérer ces situations, un véritable
circuit a été mis en place :
- Le signalement peut venir du locataire lui-même. En
effet, une fiche d'autodiagnostic est envoyé par la CAF au locataire
afin d'évaluer son logement. Il n'y a pas de visite préalable. Le
signalement de l'occupant dans le cas d'un logement indécent sera pris
en compte. Le locataire doit tout de même continuer à payer son
loyer. Une visite à domicile est alors effectuée par un agent du
SCHS. Celui-ci établit un pré-diagnostic afin d'évaluer si
les désordres signalés par le locataire relèvent de
l'insalubrité ou de la non décence.
101
- Depuis 2008, la Ville de Roubaix expérimente
également la Déclaration préalable à la mise en
location (DPML). Cette déclaration permet un contrôle de la
décence du logement avant le versement de l'allocation logement. Cette
information circule bien auprès des locataires comme des
propriétaires. Les visites des logements en location sont donc
régulières. La CAF signale à la ville toutes les nouvelles
allocations versées et le Service Communal d'Hygiène et de
Santé de la ville contrôle systématiquement ces logements
(environ 2 500 contrôles par an).
Dans tous les cas, si le logement est indécent, la CAF
supprime le tiers payant durant 6 mois le temps de la réalisation des
travaux. Si à la fin de ce délai, les travaux ne sont toujours
pas effectués, l'allocation est suspendue pour une durée
indéterminée.
Cette mesure est avant tout incitative pour permettre au
propriétaire de réaliser les travaux. Dans le cas où il ne
les réaliserait pas, les locataires pourraient se retrouver dans
l'obligation de déménager puisqu'il ne
bénéficierait plus d'aide pour payer le loyer. Cette mesure peut
donc être très contraignante pour les locataires et les mettre en
difficulté. Ils peuvent recourir à une procédure en
justice dans le cas de bailleurs indélicats. Or, pour des ménages
fragiles et précaires, ce recours n'est pas toujours aisé. Un
accompagnement de la CAF ou de la SIAVIC peut s'avérer
nécessaire.
102
Des exemples de partenariats pour traiter des risques
sanitaires spécifiques - Réglementation
et partenariats dans la lutte contre le saturnisme
La fabrication en France est interdite depuis 1948 et depuis
1993, la vente et l'importation de peinture contenant du plomb l'est
également. Cette mesure a été complétée par
deux lois. La loi contre les exclusions de 1998 et la loi de Solidarité
et de Renouvellement Urbain en 2000. Ces deux lois permettent de mener une
action préventive à l'encontre du risque saturnin.
En effet, on constate que la loi numéro 98-657 de 1998
relative à la lutte contre les exclusions a introduit la
prévention du saturnisme dans le Code de santé publique et
concède aux préfets des départements une
responsabilité en la matière. En effet l'article 123 de cette loi
les oblige, dans le cas d'une intoxication au plomb ou d'un risque saturnin
avéré par un diagnostic spécialisé, à
prescrire les travaux de prévention requis et à les faire
exécuter d'office si le propriétaire ou le syndicat de
copropriété ne fait pas connaître sous dix jours son
intention de réaliser les travaux dans un délai d'un mois.
La loi SRU du 13 décembre 2000 impose, quant à
elle,un contrôle systématique de l'habitat dès lors qu'il
existe un moindre doute sur la présence de plomb. Cette lutte contre le
risque saturnin s'organise en deux temps: des mesures d'urgence en vue de
supprimer le risque d'intoxication et de nouvelles obligations pour les
propriétaires situés dans une zone à risque. Le dispositif
permet de déterminer les zones à risque. A cet effet, le
préfet peut ordonner le diagnostic des immeubles lorsqu'il est
informé d'un cas de saturnisme chez un mineur ou d'un état
d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble. Ce
contrôle consiste à identifier les murs, cloisons, plafonds et
autres surfaces d'un logement contenant une peinture au plomb et, le cas
échéant, à mesurer sa teneur en plomb. Si le
résultat s'avère positif, le préfet notifie au
propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriété,
les travaux à réaliser. Le propriétaire devra pour sa part
informer les occupants et les personnes réalisant les travaux des
risques qui existent. En cas de carence, le préfet peut se substituer au
propriétaire pour réaliser les travaux de suppression du risque
d'accessibilité au plomb. Lors de la vente, la loi oblige
également les propriétaires de biens immobiliers datant d'avant
1948, d'annexer au contrat de vente, un diagnostic plomb. Ce diagnostic doit
103
également être fourni aux locataires si le bien
est loué. Il concerne les logements occupés mais également
les parties communes.
En cas de présence de plomb dans un logement
habité par des enfants ou une femme enceinte, des plombémies sont
systématiquement proposées. Les Inspecteurs de Salubrité
font parvenir au médecin traitant de la famille une lettre expliquant
les risques accompagnée d'un formulaire de " déclaration
obligatoire " en partie rempli afin que le médecin prescrive la
plombémie. Si une plombémie positive est avérée,
l'Agence Régionale de Santé et/ou le SCHS de la commune mettent
en Suvre une investigation environnementale permettant d'identifier les causes
de l'intoxication et d'aider la famille à prendre les mesures
adaptées pour stopper le processus d'intoxication.
La lutte contre le saturnisme infantile a fait l'objet d'un
partenariat entre le SCHS de la Ville de Roubaix et la DDAS du Nord. Cette
logique partenariale prend effet dès 1995 où une
évaluation permet de mettre en évidence que 17% de la population
du département serait susceptible d'être intoxiquée par le
plomb. Ce taux est beaucoup plus élevé lorsqu'on
s'intéresse à la commune de Roubaix où il atteint 23%.
C'est lors de plombémies expérimentales sur un échantillon
d'enfants de moins de 7 ans et dans des quartiers d'habitat ancien très
ciblés que cette étude a été menée. Cette
évaluation du risque saturnin dans le département, permet de
prendre en considération et en charge l'ampleur du risque, mais
également de mettre en évidence l'absence de moyen
réglementaire et technologique ainsi que d'outils techniques pour le
traiter.
Ceux-ci ont donc évolués par la suite et ont
permis de mieux prendre en charge ce risque grâce notamment à la
loi contre les exclusions de 1993 et à la loi SRU de 2000. Des
évolutions techniques ont permis la mise au point d'appareils qui
mesurent le plomb contenu dans la peinture. A Roubaix, en 2004, un analyseur de
plomb dans les peintures a été acquis pour le Service Communal
d'Hygiène et de Santé. Cet analyseur est utilisé à
chaque diagnostic technique effectué lors des visites d'habitat datant
d'avant 1948 par les Inspecteurs de Salubrité.
Les moyens de prévention, d'information et de
dépistage sont également exploités dans les enquêtes
de salubrité, dans l'implication des partenaires et à travers
l'information du public. La recherche du plomb a été
intégrée dans les procédures de lutte contre
l'insalubrité, qu'elle soit coercitive c'est à dire prise par un
arrêté préfectoral ou qu'elle ait une visée
104
incitative et donc traitée hors arrêté. Le
SCHS réalise de manière systématique un diagnostic plomb
du logement lors de travaux prescrits dans le cadre d'une procédure RSD
pour des désordres moyens et lorsque des enfants sont présents
dans le logement. Un binôme d'Inspecteur a d'ailleurs été
spécialement affecté à cette thématique.
La ville cherche également à informer et
à sensibiliser les médecins généralistes
libéraux au risque saturnin dans l'habitat car ils ont souvent tendance
à le sous-estimer voir et à ne pas le prendre en compte. Des
soirées à thème ont alors été
organisées et des outils d'informations spécifiques ont
été distribués (porto folio...). On constate cependant que
ces évènements n'ont pas eu le succès attendu
auprès des médecins généralistes qui aujourd'hui
encore restent difficiles à mobiliser pour réaliser des
plombémies chez les enfants. Les médecins hospitaliers sont
à contrario plus enclins à se mobiliser et à prescrire des
plombémies. La majorité des parents ne manifeste pas de
réticence pour que des plombémies soient réalisées
sur leurs enfants sauf pour des motifs culturels. Progressivement, les
médecins scolaires ont été également
intégrés à la démarche lors notamment des bilans
obligatoires effectués sur les enfants entrant à l'école
primaire, elles ont permis de dépister un certain nombre d'enfants
intoxiqués. Les partenariats avec les services médicaux de la
CPAM se sont avérés également fructueux et ont permis par
exemple une prise en charge financière du dépistage de la
plombémie.
La lutte contre le saturnisme nécessite des
partenariats solides incluant des acteurs de l'environnement, de la
santé et du social. Les partenariats sociaux jouent un rôle
important de signaleurs et d'agents d'information. Le Conseil
Général et les UTPAS réalisent des journées
d'informations auprès du personnel qui pourra donc par la suite mieux
informer les familles. Un travail a également été
effectué auprès du CCAS de la Ville et des maisons de quartier.
L'information est également distribuée auprès des familles
par le biais d'affiches ou de dépliants mais le travail de
prévention le plus lourd est à destination des enfants.

105
Affiche de prévention contre le risque
saturnin à destination des parents Service Communal d'Hygiène et
de Santé, Ville de Roubaix
106
Un livret de coloriage a été
élaboré et distribué à chaque enfant lors d'une
animation en milieu scolaire, ce livret raconte l'histoire du "monstre
Plombard".
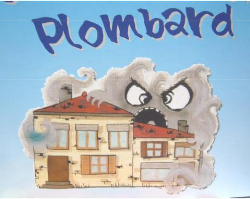
Affiche de prévention contre le risque
saturnin à destination des enfants
Service Communal d'Hygiène
et de Santé, Ville de Roubaix
Ce livret a été décliné sous forme
de contes et d'affiches. Un spectacle théâtral d'une vingtaine de
minutes a également été monté, mettant en
scène "le monstre Plombard". Les parents furent invités au
spectacle et des échanges ont suivi la représentation. L'ensemble
des documents est distribué dans une mallette. Une serpillière
est également présente dans la mallette pour inciter au nettoyage
humide qui retient les poussières éventuellement
contaminées. Mes visites de terrain m'ont permis d'appréhender un
peu plus cet accompagnement des ménages. Peu à peu, les
ménages sont davantage sensibilisés au risque saturnin et les
enfants n'hésitent pas à appliquer les pratiques d'hygiène
préconisées pour lutter contre le "monstre Plombard".
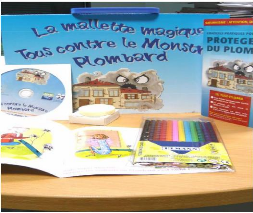
107
La mallette " Monstre Plombard "
Service Communal d'Hygiène et de Santé,
Ville de Roubaix
108
Le réseau « asthme et allergies »
Le réseau asthme/allergies consiste en un partenariat
entre le CHR de Roubaix (service pneumologie), le Centre de Prévention
Santé et le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la
Ville de Roubaix. D'autres villes de la métropole lilloise comme
Wattrelos sont également intégrées au réseau. Ce
réseau permet de mettre en lien des patients souffrant de maladies
respiratoires d'origine allergiques avec un partenariat d'acteurs
pluridisciplinaires qui s'inscrit dans le Plan Régional de Santé
Publique. Ce PRSP issu de la loi dite de "santé publique" du 9
août 2004 a pour objectif de soutenir des projets dont l'objectif est
d'améliorer l'état de santé de la population en
préservant, voire en améliorant son environnement et
particulièrement tous les lieux de vie, d'identifier les risques
constitués par les différentes expositions en éliminant ou
en limitant les expositions et/ou leurs effets.
Le réseau asthme/allergies existe depuis 2005 et a
permis de mettre en place une consultation médicotechnique
avancée. Ce réseau comprend plusieurs acteurs: des
médecins du CHR orientant et suivant les patients, une infirmière
du Centre de Prévention Santé qui assure les visites à
domicile pour la prévention, l'information et le suivi de l'état
de santé du patient, une assistante sociale qui intervient afin de
promouvoir l'accès aux droits et aux soins des patients et enfin les
inspecteurs de salubrité de la Ville de Roubaix , pour certains
également Conseillers Médicaux en Environnement
Intérieur.
Ces inspecteurs de salubrité s'assurent de
l'état du logement, relèvent les désordres et prescrivent
des travaux aux propriétaires. Ces professionnels informent les
personnes que leurs états de santé sont aggravés par leurs
conditions de logement et/ou par la mauvaise appropriation de leurs
logements.
Le propriétaire bailleur du logement est responsable de
la décence du logement et donc de son état sanitaire. Il doit
effectuer les travaux nécessaires à sa mise en
sécurité sanitaire et en décence. Mais les locataires par
leurs appropriations du logement influent également sur leurs
états de santé ou sur celui de leurs enfants. Certaines pratiques
quotidiennes sont en effet néfastes à leur santé: manque
d'aération du logement, défaut d'entretien courant, usage d'un
poêle à pétrole lorsqu'un chauffage existe
déjà, tabac, présence d'animaux.... Il
109
est donc important d'informer le propriétaire bailleur
des travaux à effectuer et le locataire s'il est différent, des
pratiques quotidiennes à adopter. On peut remarquer qu'il est toutefois
plus difficile de traiter avec un propriétaire occupant sur son
logement. Celui-ci sera en effet moins enclin à remettre en cause ses
pratiques.
Chaque acteur dans ce réseau a un rôle important.
Le Service Habitat et Hygiène de la Ville de Roubaix par ses visites du
logement est directement en lien avec le problème de salubrité du
logement et l'appropriation qu'en font ses occupants. Les visites à
domicile sont donc importantes, elles peuvent également mettre en
évidence d'autres problématiques liées au logement et
nuisant à la santé de ses occupants (saturnisme, intoxication au
monoxyde de carbone chronique...).
Le personnel de santé est essentiel pour diagnostiquer
la pathologie, prescrire un traitement et suivre le patient mais il n'a en
effet pas toujours connaissance de l'état du logement. Les assistantes
sociales et les infirmières du Service de Prévention Santé
interviennent, soit au centre, soit au domicile des patients, et
repèrent également les difficultés d'ordre médical
ou social en proposant un accompagnement personnalisé.
Ces visites au domicile des patients sont essentielles car la
pratique médicale montre que de nombreux patients n'appliquent pas les
conseils d'éviction proposés lors de la consultation à
l'hôpital. En effet, aux difficultés de compréhension
s'ajoutent les problématiques techniques, sociales et
financières. Dans d'autres cas, certains minimisent ou exagèrent,
l'état de leur logement lors de leur prise en charge médical par
souhait notamment de relogement dans le parc social ou à l'inverse par
méfiance (crainte de perdre la garde leurs enfants...).
Le réseau peut fournir également divers
équipements aux ménages pour améliorer leurs prises en
charge:
- Une housse anti-acarien, or on constate que bien souvent,
les matelas et oreillers sont extrêmement dégradés. Un
prêt de la Caf est donc possible et permet aux familles de pouvoir en
acheter de nouveaux.
- Un Peak Flow, ou débitmètre de pointe, qui est
un instrument de mesure médical permettant de déterminer la
quantité d'air rejeté par les poumons en soufflant dans un tuyau
gradué. Le Peak Flow est principalement utilisé pour surveiller
l'état des fonctions
110
respiratoires chez les personnes souffrant d'insuffisance
respiratoire et d'asthme sévère. Peu encombrant et très
facile d'utilisation, le patient l'utilise seul à son domicile,
consignant les mesures obtenues afin qu'elles soient examinées par son
médecin traitant. Il permet notamment d'évaluer l'importance
d'une crise d'asthme et d'opter pour la meilleure conduite.
On en conclut donc que le réseau "asthme - allergies"
multidisciplinaire, permet de gérer les pathologies, à la fois du
patient et du bâtiment, dans une démarche de prise en charge
globale.
111
Exemple de cas concret:
Théo, 5 ans
Famille locataire chez propriétaire
privé
|
Diagnostic médical
|
Diagnostic technique
|
Diagnostic comportemental
|
|
Enfant asthmatique et allergique
|
Dans le salon: trace d'une fuite en
|
Les parents fument et ont de
|
|
aux blattes
|
toiture et donc présence
d'humidité sur le mur, au niveau de la façade.
|
nombreux animaux (3 chats...)
|
|
|
Les chats permettent notamment d'éviter la présence
de souris
|
|
Dans le couloir: trace d'une fuite en toiture et donc
humidité sur les murs
|
|
|
Chambre des parents:
|
|
|
développement de moisissures sur le mur de façade
arrière, nouveau-né dort dans la chambre.
|
|
|
Dans le bâtiment: présence
importante de blattes chez tous les locataires
|
|
|
Prise en charge:
|
|
Suite aux visites des inspecteurs de salubrité du SCHS de
la ville de Roubaix, il a été demandé aux
propriétaires
|
|
de régler les pathologies du logement en réalisant
des travaux dans un délai de trois mois. Pour prescrire la
|
|
suppression des désordres, il est fait application du
Règlement Sanitaire Départemental émanant du Code de la
|
|
Santé Publique, et plus précisément des
articles 32 et 33 relatifs à l'entretien général du
bâtiment et la
|
|
suppression des fuites et infiltrations qui sont de la
responsabilité du propriétaire. La lutte contre les insectes
|
|
est une charge locative, cependant, s'agissant d'un immeuble
collectif, il a été demandé au propriétaire de
traiter l'ensemble du bâtiment.
|
|
A l'heure actuelle, les travaux ont été fait par le
propriétaire, il reste cependant encore quelques blattes. Les
|
|
parents fument toujours dans le logement. La famille ne
possède plus qu'un chat pour éviter les souris.Le
|
|
dossier est toujours suivi par le personnel de santé. La
mission est terminée pour le SHCS de la ville de Roubaix.
|
112
Tiffeli, 3 ans
Famille locataire chez un bailleur
social
|
Diagnostic médical
|
Diagnostic technique
|
Diagnostic comportemental
|
|
Enfant asthmatique
|
Chambre des parents et de Tiffeli:
|
Aérations sont bouchées par les
|
|
présence importante de moisissures sur le mur
|
locataires.
|
|
Salon: présence de dalles dégradées au sol
(suspicion d'amiante)
|
|
|
Cuisine: absence d'aération basse.
|
|
Prise en charge:
Les inspecteurs de salubrité ont visité le logement
et relevé les désordres puis ont prescrit la suppression des
désordres sous deux mois au bailleur social conformément aux
articles 32-33-40/1-165 du RSD.
L'aération basse dans la cuisine a été
demandée mais ce n'est pas une obligation pour le bailleur de
l'installer car le logement n'était pas prévu à l'origine
pour la cuisine au gaz.
Les dalles au sol de la cuisine doivent être
changées et le propriétaire doit remédier aux
problèmes d'humidité provoquant des moisissures dans le
logement.
Ce dossier montre la difficulté que l'on peut rencontrer
en traitant avec les bailleurs sociaux pour réaliser des travaux et
restructurer le logement. C'est un patrimoine des années 1970
partiellement rénové : l'air ne circule pas dans le logement
(double vitrage des fenêtres, pas d'aération sur PVC, grilles des
VMC que les locataires bouchent généralement lorsqu'il fait
froid).
Réponse du bailleur: "En ce qui concerne la
présence importante de moisissures sur le mur de la chambre, il s'agit
de moisissures provoquées par la condensation en raison d'un manque
d'aération, fait du locataire.
Concernant l'absence d'aération basse en cuisine, le
logement n'est pas équipé d'une installation au gaz,
l'installation d'une aération n'est donc pas prévue.
La présence de dalles dégradées au sol dans
le salon sera réglée, un bon de commande a été
adressé à leur prestataire pour modifier celui-ci".
113
L'explication du bailleur social n'est pas satisfaisante ou
complète. En effet, la condensation ne peut pas s'expliquer par le seul
manque d'aération: si le mur était complètement
isolé, la vapeur d'eau ne pourrait pas s'y condenser. Il conviendrait de
persister dans la demande de suppression de l'humidité par isolation du
mur. Le bailleur social ne peut cependant isoler le mur d'un seul logement, il
doit réaliser un ensemble de travaux qui relèvent d'une
rénovation complète du bâtiment qui ne peut s'exiger dans
un délai contraint pour des raisons financières.
Le dossier sera toujours suivi par le personnel de santé.
La Direction Habitat et Hygiène interviendra en cas de nouvelles
difficultés avec le logement ou en cas d'autres difficultés
d'humidité dans d'autres logements du même bâtiment.
114
La lutte contre l'intoxication au CO
Survenant de façon sporadique avant 1750, la
fréquence des intoxications au CO s'est accrue considérablement
durant la Révolution Industrielle du XIXème siècle du fait
de l'urbanisation rapide et de l'emploi du charbon pour la production de vapeur
et l'utilisation de chauffage. L'abandon du gaz de houille au profit du gaz
naturel dans les années 19601970, n'a pas entraîné la
disparition de cette intoxication mais a sûrement diminué la
méfiance de la population et la connaissance des médecins
vis-à-vis de ce gaz toxique. Ce risque fut pendant bien longtemps
ignoré des politiques publiques. La région Nord-Pas-de-Calais fut
l'une des premières régions touchée par ce risque avec un
taux particulièrement élevé d'intoxication au CO. Un
réseau de surveillance des intoxications fut donc mis en place
dès 1986, coordonné par le Centre Antipoison Régional et
associant le Centre d'Oxygénothérapie Hyperbare du CHRU de Lille,
les Services d'Urgences des Hôpitaux de la région, les SAMU et
SMUR, les Médecins Généralistes, les Sapeurs-Pompiers en
collaboration avec la DRASS, les DDASS et les bureaux municipaux
d'hygiène et de santé. Depuis 2004, un réseau de
surveillance reprenant les principes de ce réseau régional a
été mis en place sur l'ensemble du territoire français.
C'est l'Institut National de Veille Sanitaire qui en est le coordinateur.
Les pouvoirs publics affichent une volonté
récente de lutter contre ce risque. En juillet 2003, la loi Urbanisme et
Habitat prévoit l'installation de détecteurs de monoxyde de
carbone dans les locaux jugés à risque afin d'éviter les
accidents ainsi que dans les constructions neuves. Un décret y
"détermine les exigences à respecter et les dispositifs à
installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les
intoxications par monoxyde de carbone dans les locaux existants et les
constructions neuves...". Successivement, en août 2003, la loi
d'Orientation et de Programmation pour la Ville et la Rénovation Urbaine
modifie le code de la construction et de l'habitation, et fonde les maires,
à prendre, par arrêté des mesures de sécurité
en cas de risques existants dans les immeubles collectifs: remise en
état ou remplacement des matériels.
Le loi du 9 juillet 2004, relative à la politique de
santé publique, renforce cette action et est destinée à
favoriser une véritable culture de santé publique et de
prévention. Cette loi fixe
115
les règles générales d'hygiène
publique et toutes autres mesures propres à la santé de l'homme
notamment en matière de lutte contre la pollution atmosphérique
d'origine domestique. Cette démarche sera consolidée par la
circulaire du 12 octobre 2004 relative à la campagne de
prévention et d'information du risque CO. Une ordonnance en juin
relative au logement et à la construction s'applique en cas de vente
d'un bien immobilier et implique la réalisation d'un état des
installations intérieures de gaz naturel. Et enfin, le décret du
27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le
monoxyde de carbone, met en place un dispositif de prévention et
instaure une sanction pénale en cas de non-respect de ce dispositif.
A Roubaix, des campagnes de prévention sont, depuis de
longues années, mises en place avant chaque période hivernale et
pendant les périodes de froid par le SCHS et le CCAS de la Ville. Des
guides de prévention sont ainsi distribués aux ménages
lors des visites à domicile et disponibles à l'accueil de la
Maison de l'Habitat.

Guide d'information à destination des
ménages
www.mairie-roubaix.fr
On en conclut donc que de nombreux dispositifs sont mis en
place afin de lutter contre ce risque. Des efforts sont en effet
réalisés en matière de surveillance, de prévention
et d'information afin de limiter les risques encourus pour les occupants
des logements.
116
Le guide « habitat et santé mentale
»
Le droit et l'accès au logement, qu'il
nécessite ou non un accompagnement, sont des conditions essentielles
pour la santé de chacun. Elles demeurent essentielles pour les personnes
qui souffrent ou qui ont souffert de troubles psychiques : le logement leur
procurant un cadre de vie favorisant une certaine stabilité et un
bien-être. On constate cependant qu'à l'heure actuelle les
personnes qui souffrent de problèmes mentaux sont
régulièrement rejetées et se retrouvent dans les logements
les plus dégradés. En effet, les organismes gestionnaires de
logements ou d'hébergement, les propriétaires ou encore
l'entourage familiale peuvent être confrontés aux attitudes
particulières d'une personne en difficulté psychique, dont le
comportement peut nuire à sa vie ou celle de l'entourage, ou
entraîner des dégradations dans son logement. Ils peuvent donc
également être victimes d'isolement et d'exclusion parce qu'ils
n'ont pas été pris en charge assez rapidement et que l'entourage
n'a pas su faire face aux difficultés. Il est donc nécessaire de
leur venir en aide rapidement et de les accompagner dans leurs
démarches. Dans cette optique, les acteurs de l'habitat et de la
santé mentale de la Métropole Lilloise se sont engagés
à travailler ensemble pour le logement des personnes en situation de
handicap psychique. Ils ont notamment mis en place un guide pratique
partenarial « Habitat et Santé mentale ». Ce guide a
été produit par Lille Métropole Communauté Urbaine
(au titre de sa compétence « Habitat » depuis 2005 et dans le
cadre des orientations de son Programme Local pour l'Habitat), l'Agence
Régionale de Santé et les secteurs psychiatriques
rattachés (le département du Nord étant organisé en
41 secteurs de psychiatrie dont 18 sur l'ensemble de la Communauté
Urbaine Lilloise).
Imprimé en 7000 exemplaires, il doit permettre
aux professionnels ou bénévoles d'aider au mieux les actions en
faveur du logement des personnes présentant des troubles mentaux. Ce
guide pratique, complété par un annuaire, permet en effet de
présenter les dispositifs d'accueil, d'hébergement et
d'accompagnement à l'accès au logement mais également
l'ensemble du dispositif de soin ou encore social à destination de ces
personnes.
De nombreux ateliers « Habitat et Santé
Mentale » sont également régulièrement
organisés. Ils regroupent divers acteurs ayant participé à
la réalisation du guide :
117
- Les établissements publics de santé mentale de
Lille métropole et de l'agglomération lilloise
- L'Association Régionale pour l'Habitat
- La FNARS avec la coopération de plusieurs de ses
membres, associations compétentes en matière d'hébergement
et d'accompagnement à l'accès au logement
- Le PACT Métropole Nord et les bailleurs sociaux...
Ces ateliers permettent d'améliorer la
coopération entre les acteurs et de développer de nouvelles
orientations et actions afin de favoriser une meilleure prise en charge des
personnes souffrant de troubles mentaux face à l'activation d'un
réseau.
118
| 


