4. Les compétences interculturelles
Il est humainement impossible, même pour un anthropologue
averti, de cerner l'ensemble des cultures humaines existantes. Etablir une
relation de qualité avec un patient étranger, et ainsi gagner son
adhésion, nécessite des compétences interculturelles
efficaces. Je vais donc décrire, au cours de cette dernière
partie, ces compétences interculturelles.
Pour rappel, j'avais donné, dans la première partie
de ce travail, une définition du concept « interculturel ».
De façon très générale, on pourrait
définir les compétences comme étant l'ensemble des
connaissances (théoriques et pratiques), des attitudes et des
capacités à mobiliser pour effectuer une tâche
déterminée. Dans le domaine des soins infirmiers, une bonne
définition de « compétences » serait celle de Boterf G.
: « être compétent c'est mettre en oeuvre une pratique
professionnelle pertinente tout en mobilisant une combinatoire
appropriée de ressources (savoir, savoir faire, comportement, mode de
raisonnement, ...) »21.
En présence d'un patient étranger, un soignant
devra donc faire appel à des savoirs spécifiques, à des
« savoir - faire » particuliers mais aussi et surtout à un
« savoir - être » approprié (ouverture d'esprit, respect
de la différence, etc.).
« Les compétences transculturelle (voir
ci-dessous pour la définition du terme
« transculturel ») sont un outil composé
d'attitudes, de connaissances et de savoir - faire qui permet de prodiguer des
soins de qualité à des patients divers
»22.
De notre revue critique de la littérature, il ressort
quatre compétences essentielles que le soignant se devrait
d'acquérir dans ce type de relation : la communication interculturelle,
l'empathie, des connaissances spécifiques et l'adaptation du processus
des soins infirmiers.
4.1. La communication interculturelle
La communication humaine est une chose hautement complexe. La
communication entre soignant et soigné est avant tout un échange
entre deux personnes. Cependant, de part le contexte du soin, cet
échange est généralement déséquilibré
au départ de la relation. Le soignant étant parfois en «
position de force » par rapport au soigné. À ce
déséquilibre s'ajoute le problème plus
général de l'ethnocentrisme (voir première partie du
travail). La communication interculturelle se veut, au contraire, une relation
équilibrée entre les deux sujets. Elle vise à favoriser
une compréhension réciproque. Selon Singleton M., la
communication interculturelle implique deux choses : « une
méconnaissance mutuelle qu'il s'agit de rectifier » et «
une reconnaissance réciproque à renforcer
»23.
Malheureusement, il n'existe pas de valeurs purement universelles
qui engendreraient, dès le départ, une compréhension en
parfaite harmonie. Les représentations culturelles sont fortement
liées à la culture de chacun des sujets. Leurs
représentations sont culturellement inscrites et ne sont donc pas
forcément les mêmes. Il s'agit donc de créer une sorte
d'espace de l'entre-deux où soignant et soigné pourraient se
retrouver pour dialoguer. Cet espace ne serait pas le lieu des
vérités universelles (elles n'existent tout simplement pas !)
mais un lieu de respect réciproque des différences. Cet espace
permet de rendre plus compréhensible, tant
21 BOTERF G., Repenser la compétence pour
dépasser les idées reçues - 15 propositions,
cité par BEGHENNOU A., Op. Cit., p. 14.
22 COLLECTIF, Care et compétences
transculturelles, Bruxelles, 2011, p. 17.
23 SINGELTON M., Amateurs de chiens à Dakar
: Plaidoyer pour un interprétariat anthropologique, Louvain-la-Neuve,
Bruylant-Academia, 1998, p. 119.
21
pour le soignant que pour le soigné, les
représentations de l'autre. C'est un lieu où soignant
(occidental) et patient (étranger) se verront respectés dans leur
identité respective.
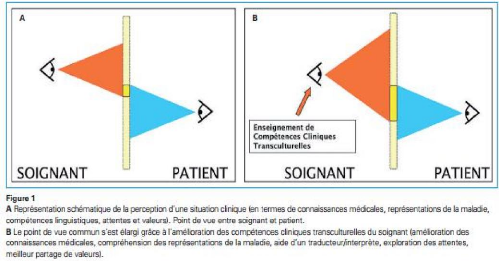
Source : Forum Med. Suisse, 2010 ; 10 (5).
Ce lieu peut être source d'avantages mais également
d'inconvénients (voir l'analyse de notre premier cas). Cet espace, c'est
aussi un peu le lieu où se retrouverait un migrant (africain, par
exemple) qui se serait installé, depuis quelques temps en Belgique. Il
possèderait à la fois des représentations émanant
de sa culture d'origine et d'autres de sa culture d'accueil. Cet espace est
aussi celui du médiateur interculturel, de l'anthropologue.
La relation « soignant - soigné » repose sur des
implicites culturellement partagés. Or, dans une relation avec un
patient d'origine culturelle différente, les présupposés
ne sont pas nécessairement partagés. Lorsque un soignant
accueille un patient de culture différente, il a souvent tendance
à attendre de ce dernier qu'il laisse de côté sa culture
d'origine et ses valeurs pour s'intégrer au milieu du soin occidental.
La conséquence, au lieu d'aller vers un partage et une meilleure
compréhension réciproque, sera souvent une résistance de
la part du patient étranger.
La communication interculturelle entre le soignant et le patient
étranger permet d'éviter les incompréhensions qui
pourraient d'écouler de leurs différences culturelles. Elle
favorise l'adhésion aux soins du patient étranger. Elle implique
un « décentrage » (= utiliser un détour afin de mieux
comprendre le discours du patient étranger) de l'infirmier par rapport
à sa propre culture.
Interculturel versus transculturel
Dans la littérature consultée, il est souvent
mentionné « transculturel » au lieu de
« interculturel ». Le terme « transculturel »
provient du concept de « transculturation » développé
par l'anthropologue cubain Fernando Ortiz Fernandez24. Le terme
« transculturel »
24 ORTIZ F., Controverse cubaine entre le tabac et le
sucre, Ed. Mémoire d'Encrier, 2011, 710 p.
22
concerne des identités culturelles plurielles. L'approche
transculturelle se situe donc au-delà des cultures. Elle permet
d'accéder à une sorte de « méta - niveau » et
offrirait de ce fait une plus-value interculturelle. Pour L.
Ferrant25, il ne s'agit pas seulement de développer des
compétences interculturelles mais « il est indispensable
d'avoir une attitude d'ouverture, une sensibilité à la culture
d'autrui ; c'est là que se situe le transculturel. L'interculturel,
c'est quand la culture de l'aidant est confrontée à la culture de
l'aidé ; le transculturel, c'est la culture qui est présente dans
les relations (...) Pour y parvenir, il faut une combinaison de connaissances,
de compétences et de comportement professionnel. ».
Développement vers des compétences
culturelles (Kripalani, 2006)26
|
D'une approche MULTICULTURELLE
|
CONNAISSANCE
|
|
Via une approche INTERCULTURELLE
|
COMPETENCES
|
|
Jusqu'à une attention et à une
sensibilité
TRANSCULTURELLE
|
COMPORTEMENT
PROFESSIONNEL
|
Interculturel, multiculturel, transculturel, pluriculturel,
interculturalité, multiculturalité, transculturalité ; il
est assez difficile de s'y retrouver parmi ces différents concepts.
D'autant plus qu'il n'y a pas toujours un consensus des chercheurs sur les
définitions.
Le Conseil de l'Europe, qui impulse depuis plusieurs
années des politiques et des actions pour favoriser le dialogue entre
les cultures privilégie le concept d'interculturalité comme
objectif de société. « Pour qu'une société
deviennent réellement interculturelle, chaque groupe social doit pouvoir
vivre dans des conditions d'égalité, quels que soient sa culture,
son mode de vie ou son origine. Cela implique non seulement de
reconsidérer notre façon d'interagir avec les cultures qui nous
paraissent étranges par rapport à la nôtre, mais aussi
notre façon d'interagir avec des minorités comme les homosexuels
ou les handicapés qui se heurtent à diverses formes
d'intolérance et de discrimination. » (Conseil de l'Europe,
1995).
| 


