3.2.3. Les aspects de la précarité
énergétique à Niamey
Dans cette partie nous essayerons d'analyser les
différents aspects de la précarité de l'énergie
électrique ainsi que les stratégies adaptées par les
populations pour tenter de réduire l'impact de ce
phénomène sur le développement socioéconomique des
populations.
3.2.3.1. Les caractéristiques de la
précarité énergétiques
Toute définition de la précarité
énergétique fait partie d'un processus de construction sociale.
C'est pourquoi la réponse à la question « Qu'est-ce que
la précarité énergétique ? » n'est pas
univoque. Ce constat ressort d'une large étude bibliographique. Il n'y a
pas d'unanimité sur les critères à l'aide desquelles on
peut définir et mesurer la précarité
énergétique soulignent FREDERIC H. et al (2011) ; MURIEL B.
(2011) ; EDF et col (2011). Pour ces auteurs, le Royaume-Uni est le premier
pays de l'Union Européenne à adopter une définition
officielle de la précarité. Ainsi, il s'agit pour ce pays d'une
situation dans laquelle se trouve un foyer lorsqu'il doit dépenser 10%
de ses revenus pour couvrir ses dépenses d'énergie pour son
logement afin de chauffer correctement sa résidence. Alors que pour
ISOLDE D. (2007), c'est l'imbrication d'une situation sociale et
économique fragile, d'un logement insalubre et d'un accès
à l'énergie problématique dans un contexte de crise de
logement. Cette définition d'ISOLDE se rapproche de celle du Belge,
FREDERIC H. (2011), pour qui la précarité
58
énergétique traduit l'insuffisance des revenus,
un logement inadapté et des prix croissant de l'énergie.
En France, la définition de la précarité
a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
(dite loi Grenelle 2), portant engagement national pour l'environnement. Ainsi,
la précarité énergétique se définit comme
suit : « est en situation de précarité
énergétique au titre de la présente loi, une personne qui
éprouve dans son logement des difficultés particulières
à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à
la satisfaction de ses besoins élémentaire en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses condition d'habitat ».
Selon l'ONEP (2015), cette définition française
est restrictive à la seule relation entre le ménage et son
habitat et laisse à l'appréciation d'un tiers les sources de
l'inconfort thermique qu'elles soient d'ordre économiques, technique ou
performance énergétique globale. Elle évite aussi la
question des usages ou des pratiques domestiques qui peuvent ne pas être
conforme ou vertueuses, en référence aux économies
possibles. Elle ajoute également qu'elle met de côté la
notion de vulnérabilité liée à la mobilité
et à son coût.
Pour les chercheurs d'IDDRI comme TIMOTHEE, LUCAS C., MATHIEU
et MARION C. (2014), la précarité énergétique se
caractérise par une situation de faible revenu disponible,
combinée à des dépenses énergies et transport
élevés, dues à un certain nombre de contraintes
techniques, territoriales ou infrastructurelles. Pour eux, le
phénomène de la précarité résulte non
seulement du cumul de la mauvaise qualité thermique de l'habitat mais
aussi de l'éloignement des espaces, des services publics, commerciaux,
accroissant le coût de la mobilité résidentielle. Alors que
pour d'autres comme BRUNO et MARECAS (2013), la précarité
énergétique pose la question du coût du logement pour la
simple raison que les logements du centre-ville sont beaucoup plus solliciter
que ceux de la périphérie du fait qu'ils sont bien desservis par
les réseaux d'énergie.
Cependant, nous constatons que tous ces auteurs ont
traité de la question de l'énergie d'une manière
générale sans pour autant l'aborder sous ses différents
sous-secteurs comme la présente étude. Nous constatons
également qu'il existe plusieurs critères dans la
définition de la précarité énergétique selon
les pays et parfois même les auteurs. C'est ainsi que certains pays
utilisent une définition stricte et assez claire, comme le Royaume uni,
tandis que d'autres ne disposent d'aucune définition ou restent assez
vague, sans critères objectives. En effet, pour ces auteurs, la
précarité énergétique se caractérise par un
accès problématique à l'énergie, la mauvaise
qualité thermique de l'habitat et le coût élevé de
la facture énergétique poussant les populations à investir
une part croissante de leurs revenus pour l'énergie afin de lutter
contre l'inconfort au niveau des bâtiments. Partant de ce constat, il est
important de se
59
demander comment se manifeste ce phénomène dans
les grandes cités africaines et plus particulièrement à
Niamey ?
L'une des principales caractéristiques de la
précarité énergétique des pays d'Afrique de l'Ouest
est du prix élevé de la facture d'électricité par
rapport aux pays développés affirment ANTOIN et al (2006) ; AFD
(2009) ; BAD (2015). Or la quasi-totalité des populations issues de nos
villes ont des faibles revenus (moins de 2 dollars par jours) qui ne les
permettent pas de répondre suffisamment au coût de la facture
d'électricité. Ainsi, ALEXANDRE B. et al (2011), ajoutent que le
faible niveau de revenu des ménages, rendant difficile le paiement des
factures, et empêchant tout investissement permettant de diminuer la
facture pour atteindre un niveau de confort supérieur. Ce qui se
manifeste bien souvent par le désabonnement des populations au
réseau par les sociétés de distribution électrique.
Ainsi, le coût élevé du prix de l'électricité
est selon ces auteurs, le résultat de deux facteurs : d'une part la
dépendance énergétique de certains pays d'Afrique de
l'Ouest comme le Niger, et de l'autre, l'utilisation des groupes
électrogènes par les sociétés en charge de
l'électricité, qui demandent des gros investissements. Ce
coût élevé de l'électricité est
illustré par le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Comparaison du prix du KWh du Niger à
d'autres unités géographiques
|
Pays
|
Prix du KWh en Franc CFA pour l'année 2009
|
|
|
|
Afrique Subsaharienne
|
56 franc CFA
|
|
Amérique Latine
|
30 franc CFA
|
|
Asie du Sud
|
17 franc CFA
|
|
|
79 franc CFA
|
|
Niger
|
|
|
|
Source : Groupe de la Banque Africaine du Développement,
2015
Selon les études de ANTOIN E. et al (2006); CHRISTINE
et al (2011), cette situation de précarité se manifeste aussi par
la faiblesse du taux d'accès à l'énergie électrique
dû principalement à l'insuffisance de capacités de
production électrique installées au niveau des pays ouest
africains, la faiblesse du réseau d'interconnexion reliant les grandes
villes de la région et la dépendance énergétique
des certains pays comme souligné si-haut. C'est ainsi qu'en 2012, la
capacité installée reliée aux réseaux
électrique de l'Afrique de l'Ouest était de 20 GW contre 128,9 GW
en France en 2014. En plus la moitié de cette capacité
électrique provient des centrales à gaz, essentiellement
situées au Nigeria. Dans cette région, plus de 250 million de
personnes comptent sur la biomasse pour cuire leurs aliments car elles n'ont
pas accès à l'électricité. La région dispose
en effet un taux d'électrification de 40 % d'après les
études de CHRISTINE et al (2011). Cela montre la faiblesse de la
couverture en énergie
60
électrique. Ce taux varie d'un pays à un autre
ou d'une ville à une autre. C'est ainsi que, le Niger présentait
en 2012, un taux d'électricité d'environ 25 % (INS, 2015). La
consommation électrique par habitant était inférieure
à 50 kilowattheures (kWh) par an durant cette même période
par rapport à une moyenne régionale de 200 kWh et une moyenne
mondiale de 3 104 kWh souligne le Groupe de Banque Africaine de
Développement (2015).
Tableau 4 : Consommation moyenne annuelle
d'électricité par pays ou groupe de pays
|
Pays
|
Consommation du KWh/habitant en 2013
|
|
Afrique du Nord
|
2 880
|
|
Afrique Subsaharienne
|
488
|
|
Monde
|
3104
|
|
Niger
|
49
|
|
France
|
7 292
|
|
Etats-Unis
|
13 246
|
Source : Groupe de la Banque Africaine de développement,
2015
De ce fait, le citoyen moyen nigérien fait partie des
plus faibles consommateurs d'électricité au monde. Ce qui est
paradoxal quand on sait que 3 ampoules sur 5 en France sont alimentées
grâce à l'uranium du Niger. Pourquoi donc le Français doit
consommer plus de l'électricité que le Nigérien qui
dispose de la matière première ? En plus, environ 76 % de la
population n'ont pas accès à l'électricité,
majoritairement limitée en zone urbaine. Cela indique une importante
demande latente dans le secteur de l'électricité et le besoin de
combler l'écart entre la demande et la disponibilité soulignent
GAURI S. et al (2014). Ainsi la ville de Niamey présente un taux
d'électrification de 63 % pour plus de 114 129 abonnés (NIGELEC,
2014). Ce taux peut être considéré comme bon dans
l'ensemble mais présente des déséquilibres d'une part
entre centre-ville comme affirme MAINA B. (2011).
Pour GAURI S. (opp cit), le profil énergétique
4nigérien est celui d'une économie à faible
revenu dans laquelle le secteur des ménages demeure le principal
utilisateur d'énergie. Cela implique une utilisation limitée de
l'énergie dans le secteur productif. Nombreux sont les ménages
qui, dépendent lourdement de la biomasse traditionnelle pour
répondre à leurs besoins énergétiques.
Mais un des handicape majeurs est l'alimentation haute tension
provenant du Nigeria. Cette alimentation reste discontinue selon des
périodes de l'année, surtout pendant l'étiage du fleuve
par manque d'eau pouvant alimenter les barrages qui produisent de
l'électricité (AFP,
4 Profil énergétique : c'est une vue
d'ensemble de la consommation de l'énergie par secteur
d'activité.
61
13/06/2016 à 09heure 18). Ce qui plonge le plus souvent
la ville dans des coupures intempestives. Ces coupures
répétées pouvant durer des heures, voir toute la
journée, sont observées de jours comme de nuits à Niamey,
a constaté un journaliste de l'AFP (Agence France-Presse).
Durant l'année 2014, d'après le rapport
intérimaire de la NIGELEC en 2016, la situation du réseau de
distribution de la ville de Niamey est la suivante :
? La longueur du réseau HTA (Moyenne Tension) est de
542 km contre 4 472 km pour le pays entier, soit 12 % ;
? La longueur du réseau BT (Basse Tension) est de 509
km contre 2 418 km pour l'ensemble du pays, soit 21 %.
Ces nombres de kilomètre comparés aux nombre
d'hectares sur lesquels la ville s'étale demeurent insuffisants pour
desservir l'ensemble des quartiers surtout ceux de la périphérie.
Ainsi, la ville s'étale sur environ 12 000 hectares. Alors si on tient
compte du rapport kilomètre BT au nombre d'hectares, on aura 42 m/ 10
000 m2. Partant de cette analyse, plusieurs quartiers seront
totalement dépourvus d'électricité. Cela témoigne
de la disparité qui existe dans l'accès à
l'électricité dans la ville. C'est ainsi que des populations sont
raccordées aux réseaux électrique et d'autres restent
toujours à la périphérie de celui-ci comme le montre la
carte ci-dessous.
62
Figure 6 : Réseau de distribution
électrique de Niamey
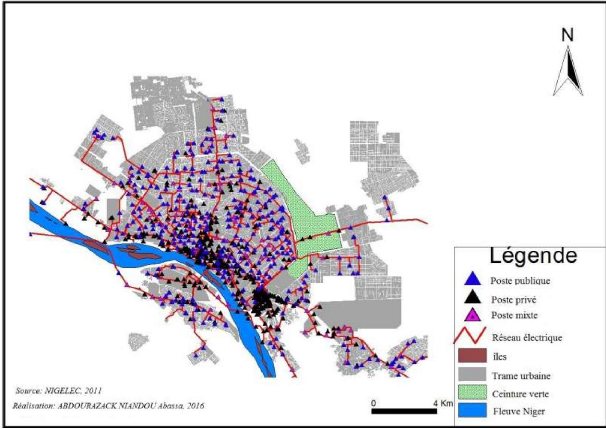
63
A travers la figure n° 6, nous avons d'abord la
concentration du réseau électrique dans le centre-ville et la
péricentrale. Cette concentration est le résultat de la
redynamisation du centre-ville à travers le développement du
commerce et de l'entreprenariat. Ce qui explique le développement des
postes privées au centre plus qu'ailleurs, due nécessairement
à l'insuffisance de la prestation du service électrique. Ce qui
amène certains usagers à la mise en place de ces postes afin de
pouvoir s'approvisionner librement sans qu'il ait des moindres baisses de
tension car l'énergie émis par ses postes n'est que la demande
maximale des usagers mais ces derniers ont la charge de leurs emplacements et
entretiens. Puis la faiblesse du réseau dans les quartiers
périphériques due à l'étalement anarchique de la
ville. Cet étalement se fait à travers des promoteurs immobiliers
qui ne respectent pas les textes de viabilisation des terrains. Ensuite, la
présence des postes publiques et mixtes sur l'ensemble de la ville dont
les premiers sont placés pour le besoin du publique et les seconds, pour
le privé tout en permettant à d'autres usagers de s'alimenter.
Enfin, le caractère archaïque du réseau malgré sa
densification dans le centre-ville et péricentral. Cela est dû
à la dynamique actuelle de ses quartiers.
Selon PATRICE C. (2014), cette précarité se
manifeste aussi par un déséquilibre entre l'offre et la demande
en énergie électrique. Pour lui, ce déséquilibre se
produit à travers une demande nettement supérieure à
l'offre. Ce déséquilibre est surtout perceptible pendant la
période de chaleur où la demande est particulièrement
élevée. Durant cette période de forte demande, la
population fait face à des délestages dans la distribution du
service électrique.
Pour la NIGELEC (2016), la situation du sous-secteur de
l'électricité se caractérise par l'insuffisance et le
vieillissement du parc de production, de transport et de distribution et par la
mauvaise qualité du service. En effet, des difficultés
d'exploitation et de maintenance des matériels sont observées au
niveau de différents départs alimentant la ville de Niamey. Ces
difficultés sont entre autres :
? La présence des tronçons
5vétustes ;
? Déclenchement dû au claquage des câbles
vétustes ;
? Dépassement de la charge admissible6 aux
heures de points; ce dépassement de la charge s'observe par un surcharge
des départs pouvant aller jusqu'à 100 %; c'est la raison pour
laquelle certains onduleurs se claquent;
5 Tronçon : c'est le réseau
électrique qui existe entre deux postes.
6 La charge normale qui est admise par les
câbles.
64
? Départ ayant très longue dérivation en
périphérie, d'où son instabilité. c'est le cas ici
du départ de Goudel;
? Départ en antenne n'ayant aucune possibilité
de bouclage avec un autre départ (sans possibilité de secours),
c'est le cas du départ Rive droite issue du poste de Goudel alimentant
88 transformateurs ;
? Départ neuf saturé car alimentant des zones en
pleine développement ;
? Rupture des conducteurs et anomalie sur les isolateurs dus
à la surcharge.
? Etc.
Ces difficultés vont se traduire par la
défaillance du réseau et du coup, interrompre la prestation du
service continu de l'électricité.
Cette précarité se manifeste également
par la faiblesse de l'éclairage public de la ville affirme SALEY M.
(2008). En effet, avec théoriquement environ 86 km de voiries
éclairées pour 310 km de voiries primaires soit 27,75 % le taux
d'éclairage public. Selon cet auteur, L'éclairage public est
essentiellement concentré dans les secteurs centraux et au long des
voies principales. Il est en général absent au niveau des voies
de dessertes à l'intérieur des quartiers. Ainsi les quartiers des
ménages à faible revenu sont généralement
plongés dans l'obscurité.
Il y a aussi la présence d'autres sources
d'énergies comme les groupes électrogènes et les panneaux
solaires dans certains services et ménages qui montrent bien
l'insuffisance de la Société à satisfaire les besoins des
populations.
Cette analyse de la bibliographie sur les
caractéristiques de la précarité de l'énergie
électrique dans les grandes villes, reste marquée par la
prédominance des auteurs occidentaux sur ceux d'Afrique. Elle laisse
apparaitre le fait que l'énergie n'est pas un phénomène
isolé de l'espace géographique. La perception de la
précarité énergétique par les auteurs est
divergente. C'est ainsi que certains la qualifie d'une situation dans laquelle
un ménage ou un individu rencontre des difficultés
particulières à satisfaire ses besoins énergétiques
tandis que d'autres lui donnent des caractéristiques plus complexes. En
effet, pour ces derniers, la précarité énergétique
se caractérise par le coût élevé de
l'énergie, le faible taux d'accès, la faible consommation
énergétique des populations, les coupures
d'électricité, la faiblesse du réseau électrique,
le déséquilibre entre l'offre et la demande et la
vétusté des équipements électriques. Il est donc
intéressant de se questionner sur les facteurs qui expliquent cette
précarité au niveau de la ville de Niamey.
65
| 


