II. L'efficacité et l'efficience, deux objectifs
injustement au second
plan dans l'établissement des politiques d'achat
public
Plan. La prise en compte de la performance
passe par une responsabilisation des acheteurs publics, puisque cette
responsabilité publique est la source de l'obligation de performance.
Ainsi au moment de fixer les contours d'une politique d'achat public
performante Ð qui consiste à déterminer les objectifs
à suivre pour l'acheteur public Ð la question de l'objet de cette
responsabilisation se pose. Or d'après le Professeur Desmazes, la
responsabilité publique a plusieurs dimensions : « dimension
politique, dimension éthique et morale, dimension économique et
managériale, dimension juridique. » 497 Seules les dimensions
managériale et juridique sont utiles à la mise en place d'une
politique d'achat performante. Actuellement c'est davantage la dimension
politique de la responsabilité des personnes publiques qui est
exploitée pour parvenir à un achat performant. Celle-ci est
cependant largement insuffisante.
Ainsi l'objectif de la fonction achat doit être de
concilier les dimensions juridiques et managériales de la
responsabilité publique (A). L'objectif
d'efficacité occupe cependant une place moins importante
(B).
494 V. Supra.
495 S. BRACONNIER, « Performance et procédures
d'attribution des contrats publics », in Performance et droit
administratif, N. ALBERT (dir.), LexisNexis, Coll. Colloques &
débats, 2010.
496 F. LINDITCH, « Le contrat et la performance, une
rencontre impossible ? », art préc.
497 J. DESMAZES, « Achats publics : la
problématique conciliation des dimensions managériale et
juridique de la responsabilité publique », in Politiques et
management public, vol. 19, n° 1, 2001.
126
A. L'objectif juridico-managérial de la fonction
achat, au service de la performance
L'aspect managérial de l'achat public : la
recherche d'économies sur les coûts de transaction.
Oliver Williamson qui remporta le Prix Nobel d'économie en 2009
a théorisé le concept de coûts de
transaction498. Cette théorie s'intéresse aux
coûts préalables à toutes transactions. On parle
d'économies transactionnelles. Cette théorie des coûts de
transaction (dite TCT) « indique que les caractéristiques des
transactions (leur incertitude, leur fréquence, le degré d'actifs
ou d'investissements spécifiques qui leur sont nécessaires) ainsi
que le contexte dans lequel celles-ci se déroulent (le nombre d'acteurs,
leur opportunisme ou leur degré de rationalité) entraînent
des coûts de transaction qui diminuent la performance. »499
Williamson a comme postulat de départ que les acheteurs
sont dotés seulement d'une rationalité limitée lorsqu'ils
achètent500, ce qui ne les empêchent pas d'être
opportunistes dans leur choix. Aussi toute opération commerciale sur un
marché entraîne des coûts en amont de la transaction.
On peut lister un certain nombre de ces coûts, qui
existent autant dans le secteur public que privé, même si certains
de ces coûts diffèrent, à titre indicatif les entreprises
privées sont soumises aux coûts suivants :
3) « Les coûts de recherche et de
négociation initiale d'un contrat avec un partenaire économique
(É) ;
4) les coûts de contrôle du bon
déroulement du contrat ;
5) les pertes possibles en raison d'un contrat initial
inadapté à la situation réelle ;
6) les coûts de sa renégociation
éventuelle ;
7) les coûts d'opportunité dus à
l'immobilisation du capital destiné à garantir
éventuellement le respect des clauses du contrat (couverture,
caution...). » 501 Williamson cherche donc ensuite à limiter
ces coûts. Les acheteurs doivent choisir la forme institutionnelle la
plus adaptée, soit le marché (contrats classiques), la forme
hybride
498 O.E. WILLIAMSON, Markets and Hierarchies: Analysis and
Antitrust Implications, Free Press, 1975.
499 G. NOGATCHEWSKY, C. DONADA, « Vingt ans de recherches
empiriques en marketing sur la performance des relations client-fournisseur
», Recherche et Application en Marketing, 2005, p. 7.
500 Thèse développée dans : H. SIMON,
Models of Man: Social and Rational. Mathematical Essays on Rational Behavior in
a Social Setting, Wiley, 1957.
501 Liste tirée de : J.-M. LEHU,
L'encyclopédie du marketing commentée et
illustrée, coll. Références, Eyrolles, 2012, pp.
210-211.
127
(contrats néo-classiques tels que la sous-traitance,
concession, réseau, etc.) ou la hiérarchie (intégration
développée par Ronald Coase en
1937502)503.
Modélisation de la « fonction objectif
» de l'acheteur public. Jean Desmazes tente d'appliquer
cette théorie des coûts de transaction aux marchés publics
et entreprend de modéliser quasiment mathématiquement ce qu'il
appel la « fonction objectif de l'acheteur public » afin
d'en tirer une politique d'achat performante504.
Pour cela il considère que cette fonction-objectif doit
être décomposée en trois sous-objectifs qui sont les
suivants :
- « un sous-objectif d'efficience visant la
maximisation du rapport qualité / prix de la fourniture à acheter
,
·
- un sous-objectif de maximisation de la
sécurité juridique de l'achat (de minimisation du risque de
sanction due à un achat non conforme aux règles prescrites par le
Code des Marchés Publics) ,
·
- un sous-objectif de maximisation de la marge de
liberté de choix de la fourniture et du fournisseur
»505.
On l'a vu auparavant, la «
sévérité et la complexité »506
du droit des marchés publics nécessites encore aujourd'hui de
laisser une place à la protection juridique au sein des objectifs de
l'acheteur. De même les acheteurs publics sont au service de
l'intérêt général et ont des préoccupations
non-économiques qui peuvent intervenir lors de l'achat, en favorisant
une entreprise locale plutôt qu'une autre par exemple. Cette
liberté de choix sera prise en détournant autant que possible les
règles afin de ne pas se mettre pour autant dans
l'illégalité.
Chacun de ces sous-objectifs est pondéré, c'est
à dire que leur importance au sein de la politique d'achat à
mettre en place varie selon différents facteurs. Ces trois
sous-objectifs sont objectivement déterminés, tandis que les
facteurs en question sont déterminés subjectivement afin de
prendre en contre les préférences subjectives de chaque acheteur
public.
Finalement cela donne la fonction mathématique suivante
:
502 R. H. COASE, The Nature of the Firm, Economica,
1937.
503 G. NOGATCHEWSKY, C. DONADA, « Vingt ans de recherches
empiriques en marketing sur la performance des relations client-fournisseur
», op. cit., p. 8.
504 J. DESMAZES, « Achats publics : la
problématique conciliation des dimensions managériale et
juridique de la responsabilité publique », op. cit.
505 Ibid.
506 Ibid.
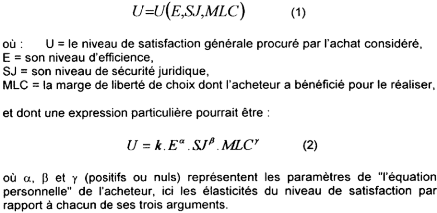
128
Source : J. Desmazes, « Achats publics : la
problématique conciliation des dimensions managériale et
juridique de la responsabilité publique », Op.
cit..
Dès lors, le niveau de performance - se confond avec ce
que le professeur Desmazes nomme « le niveau de satisfaction de
l'achat » - dépend de l'importance donnée à
chaque « coefficient subjectif ».
Il faut insister sur l'importance de l'efficience,
restée depuis trop longtemps au second plan dans la pratique des
acheteurs publics. Certains d'entre eux considèrent les pratiques
pouvant améliorer la performance économique de leurs achats comme
trop « génératrices d'une dégradation de la
sécurité juridique. »507 Il vient que
l'efficacité et l'efficience, en tant que composantes de la performance,
doivent désormais être revalorisées afin de mettre en
oeuvre une politique d'achat efficiente (B).
| 


