3.3.2. Les agences de développement
En vue d'une gestion adaptée et adéquate des
compétences qui leur sont attribuées notamment dans le domaine de
l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, les
collectivités territoriales s'appuient sur un certain nombre de
structures diverses. Ces dernières sont principalement
représentées par les Agences régionales de
développement (ARD) pour appuyer
67 Selon l'article 304 de la loi n°2013-10 du 28
décembre 2013 portant Code général des
Collectivités locales.
68 Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013
portant Code général des Collectivités locales, document
publié par OIT
69 Selon l'article 305 de la loi n°2013-10 du 28
décembre 2013 portant Code général des
Collectivités locales.
58
les collectivités à coordonner et à
harmoniser leurs interventions et initiatives ; l'Agence de
développement municipal (ADM) pour contribuer à renforcer la
décentralisation et le développement local ; l'Agence de
développement local (ADL) pour promouvoir et coordonner les actions de
développement à l'echelle locale.
Toutefois, en dépit de la volonté politique de
l'Etat sénégalais de renforcer l'aspect participatif de la
gestion de l'environnement et des ressources naturelles par législation
adéquate et une réglementation adaptée, force est de
constater que l'implication des collectivités territoriales pourtant
essentielle dans la réussite de la mise en oeuvre de politique de
gestion rationnelle des ressources naturelles notamment forestières
(Retiere, 2015)70 demeure faible. D'ailleurs, certains agents des
Services ayant trait à la gestion des ressources forestières ont
du mal à reconnaitre pleinement les prérogatives des
collectivités territoriales et encore moins des populations locales sous
prétexte qu'elles ne disposent pas de capacités techniques
souvent complexes, requises pour la gestion convenable des forêts (Diop
2019).
II. Evolutions de la gouvernance des ressources
forestières au Sénégal 1. Approches et bref historique de
la gouvernance forestière
L'évolution de la gouvernance forestière au
Sénégal et celle relative aux politiques de décentration
et aux approches dans le secteur forestier notamment en termes de gestion des
ressources naturelles sont étroitement liées. Le secteur
forestier sénégalais a fait l'objet depuis l'ère
coloniale, d'une multitude de changements et constitue l'un des secteurs les
plus dynamiques en matière d'évolutions des approches. A
l'époque d'après la colonisation, l'administration
forestière insistait principalement sur une politique de nature
conservatiste à l'égard des ressources forestières. Bien
avant l'accession du pays à son indépendance en
196071, la gouvernance forestière au Sénégal a
connu de nombreuses évolution manifestes, de l'adoption d'approches
répressives jusqu'à celles de cogestion voir même
relativement autonome en ce qui concerne les collectivités territoriales
(Ribot, 1995 ; IPAR, 2015).
La gestion des ressources naturelles est passée de
centralisé (début 1960) à décentralisée
(dans les années 90) puis concertée (début année
2000) (Touré, 2011 ; Sène, 2014). Ces évolutions sont
marquées par la création de nombreuses cadres de concertation
pour une gestion en commun des ressources. En outre, elle sont
caractérisées notamment par une prise en
70 République du Sénégal - Land
degradation neutrality, Rapport national, septembre 2015.
71 Ce, depuis l'adoption du décret du 04
juillet 1935 portant Nouveau Code forestier pour l'AOF.
considération de la multiplicité des fonctions
écosystémiques des forêts et des divers usages et
intérêts des différentes catégories de parties
prenantes concernées par la gestion forestière durable (Diop,
2019). Dans cette optique, l'implication et la participation actives de
l'ensemble des divers acteurs sont indispensables pour une bonne gouvernance
forestière. Cette dernière se distingue selon une
définition d'Organisations internationales par « un processus
d'élaboration des politiques prévisible, ouvert et
renseigné, fondé sur la transparence ; une bureaucratie
imprégnée d'éthique professionnelle ; un exécutif
responsable de ses actions ; une société civile forte qui
participe aux décisions intéressant ce secteur et aux affaires
publiques en général » (FAO et OIBT, 2010).
Faisant référence à la façon de
faire et d'appliquer les décisions relatives à la gestion,
l'utilisation et la conservation des forêts par différentes
entités publiques (Etat, collectivités, entreprises publiques) et
privées (entreprises, ONG, Association, etc...), une gouvernance
forestière efficace implique l'ensemble des parties prenantes ainsi que
les secteurs les mieux appropriés et étudie les problèmes
majeurs relatifs aux forêts (FAO, 2020). C'est un fondement essentiel
pour une gestion forestière concertée et durable. Dès
lors, le pays s'est engagé à promouvoir la participation publique
en vue de favoriser l'implication des différents acteurs dans la
gouvernance forestière.
59
Période essentiellement
caractérisée par la protection, la conservation et le classement
de la plupart des forêts.
1930 : début du processus de
classement des forêts et des premières actions de reboisement
(plantation en régies).
Les forêts étaient
principalement placées sous le contrôle direct de l'Etat
colonial.
1941 : licence d'exploitation
autorisant les populations à se livrer à l'activité
d'exploitation commerciale (jusque-là réservée uniquement
aux citoyens français).
Multitude d'Actions de restauration
engagées à la suite de dégradation accentuée
liée à la longue sécheresse des années
1970.
Consolidation du dispositif de
conservation des ressources face à une menace sur les
écosystèmes forestiers et les milieux naturels.
Ère des initiatives
d'opérations de reboisement en régie de grande envergure (Projets
de fixation de dunes, de plantation, d'aménagement et
reboisement).
Approches dirigistes du service
forestier, mobilisation d'acteurs locaux, faible participation des
populations.
Consolidation des approches
participatives dans un contexte politico-institutionnel favorable,
marqué par la Décentralisation et le transfert de
compétences relatives à la gestion forestière
(Promulgation loi 96-07 du 22 mars 1996).
Communautés rurales
responsables de la gestion des forêts (non classées et non
privées) de leurs terroirs respectifs.
Nouvelle forme de participation
locale dans la foresterie communautaire à l'origine de l'adoption d'un
nouveau code forestier en 1998.
Nouvelle foresterie permettant aux
populations d'être responsabilisées de l'aménagement et la
gestion des ressources tout en y tirant profits.
Secteurs connexes (agriculture,
élevage) associés, intégration des programmes forestiers,
agricoles et pastoraux. Disciplines (économie, sociologie...)
intégrées dans les politiques forestières.
60
Période
Coloniale
|
|
Période des
années 1970
|
|
Période post
1990
|

Période
post-
coloniale

Premier code forestier (loi 65-23
du 9 février 1965) et
réforme foncière (loi sur le
Domaine national). Volonté
de l'Etat de règlementer
l'exploitation des ressources.
Politique insistant sur la
conservation des ressources forestières et fauniques et centrée
sur la protection forestière, le reboisement et les opérations
sylvicoles.
Mainmise absolue de
l'administration sur les ressources forestière.
Période notamment marquée par la création
de parcs, réserves.
Permis d'exploitation souvent
attribués à des urbains au détriment des populations
rurales riveraines limitées au droit d'usufruits pour leurs besoins (de
subsistance) en produits forestiers.
Période des
années 1980
Changement de politique
forestière : les forêts communautaires (plantées par les
villageois) à la place des initiatives de reboisement de grande
envergure (du service forestier).
Ère des projets
communautaires et de la foresterie rurale avec l'adoption du PDDF.
Emergence des approches participatives.
Définition de
méthodologies d'intervention
forestière en milieu rural avec insistance
particulière sur la participation des populations
locales.
1985 : Création de la
Direction Reboisement et Conservation des sols. Populations
considérées comme main-d'oeuvre bénévole
préoccupée par la restauration du couvert
végétal.
Figure 13 : Frise chronologique de l'évolution des
approches dans le secteur forestier au
Sénégal
61
2. Différents acteurs de la gouvernance
forestière
La gouvernance des ressources forestières fait
intervenir un très grand nombre d'acteurs composant l'environnement
institutionnel. Ces différents acteurs peuvent être
répartis essentiellement en deux (2) catégories : la
catégorie constituée par les acteurs relatifs à l'Etat et
la catégorie des acteurs non étatiques et en particulier les
organisations de base et les ONG locales qui jouent un rôle relativement
faible essentiellement axé sur la formation et la sensibilisation des
communautés locales.
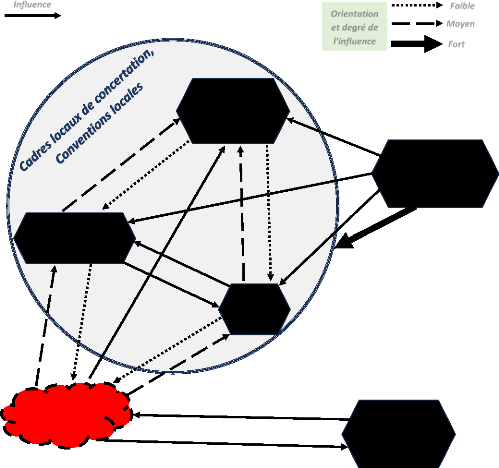
Influence
ACTEURS NON
ETATIQUES
(OCB, ONG)
PARTENAIRES
TECHNIQUES ET
FINANCIERS
COLLECTIVITES LOCALES
ETAT
Rébellion casamançaise
PRIVES PAYS
FRONTALIERS
(GAMBIE)
Orientation
et degré
de
l'influence
Faible Moyen
Fort
Figure 14 : Graphe des acteurs de la gouvernance
forestière et relations entre acteurs
62
La gouvernance des ressources forestières dans la
région de la région naturelle de la Casamance présente une
spécificité relative au longue conflit persistant, mettant en
évidence deux (2) acteurs majeurs : les rebelles qui participent au
pillage des ressources et embarrassent les efforts de surveillance et de
protection, et les acteurs du secteur privé originaires de la
République de Gambie travaillant de connivence avec les pilleurs
sénégalais en leur fournissant les équipements
nécessaires (matériels pour les coupes et véhicules de
transport) et en assurant le commercialisation des produits forestiers
frauduleusement exploités. Au sein des cadres locaux de concertation ou
des conventions locales, les populations conjointement avec d'autres acteurs
mènent des efforts louables à travers les associations à
but non lucratif appuyées par les partenaires techniques et financiers
qui conduisent des actions de protection de l'environnement en partenariat avec
les collectivités locales et les services techniques étatiques.
Ces initiatives en faveur des dynamiques multi-acteurs sont accompagnées
par divers bailleurs de fonds internationaux dont Livelihoods, la Fondation
ACRA...
| 


