1.2 Développement théoriques
récents
Au début des années cinquante, la
littérature économique considérait que la croissance
n'était favorable qu'aux riches Kakwani et al. (2000). En effet, ne
disposant pas de capital humain ni
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 23
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
financier, les pauvres ne pouvaient recevoir qu'une faible
partie des bénéfices de la croissance (grâce à la
redistribution) : c'est la théorie du « Trickle down
».
En dépit des taux de croissance économique
élevés sans précédent, la pauvreté et les
inégalités sont restées néanmoins fortes dans la
plupart des pays sous-développés. Le Bureau international du
travail (BIT), « il était devenu de plus en plus évident,
particulièrement à partir de l'expérience des pays en voie
de développement, que la croissance rapide au niveau national ne
réduit pas automatiquement la pauvreté ou
l'inégalité ou n'assure pas un emploi productif suffisant »
(BIT, 1976).
Egalement, l'approche de la Banque mondiale en matière
de lutte contre la pauvreté a connu des changements radicaux qui
reflétaient, d'une part, les progrès croissants, accomplis par le
milieu académique dans l'analyse très complexe des interactions
entre la croissance économique, l'inégalité des revenus et
des richesses et la pauvreté et, d'autre part, le niveau
d'intérêt, manifesté par le monde politique à
l'égard du thème de la réduction de la pauvreté.
Pour mieux appréhender cette nouvelle vision, les
économistes de développement mettent en évidence des
stratégies visant à réduire la pauvreté. Selon
Bourguignon (2004), dès lors qu'elle vise à réduire la
pauvreté absolue sous toutes ses formes (monétaires et non
monétaires), une stratégie de développement est
entièrement déterminée par ses considérations en
matière de croissance et de répartition. Par conséquent,
le véritable défi à relever consiste à identifier
la nature des liens entre croissance et répartition, le poids variable
alloué respectivement aux objectifs de croissance et de
redistribution.
D'autre part, selon Bourguignon (2004),
l'«inégalité» (ou la «distribution») fait
référence aux écarts de revenu relatif dans l'ensemble de
la population, c'est-à-dire aux différences de revenu obtenues
après normalisation des données observées par rapport
à la moyenne de la population de façon à les rendre
indépendantes de l'échelle des revenus. Et la
«croissance» comme le changement exprimé en pourcentage, du
niveau de bien-être moyen (par exemple, le revenu) qui apparaît
dans l'enquête auprès des ménages.
Cette dernière passe par des stratégies de
croissance4 et des politiques distributives dont la combinaison
pourrait être propre à chaque pays. Par exemple, une croissance
moyenne de 1% du revenu par habitant peut entraîner une réduction
de la proportion des gens vivant dans une
4 Volontairement orientées vers les
pauvres
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 24
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
pauvreté extrême allant jusqu' à 4%, mais
pouvant aussi être inférieure à 1%, selon le pays et la
période (Ravallion, 2004).
Ainsi, ces différentes stratégies de
réduction de la pauvreté ont mis l'accent, à des
degrés divers, sur les mesures destinées à stimuler la
croissance d'une part, et sur les politiques de redistribution d'autre part.
Figure 2: Décomposition des variables
affectant la distribution et la pauvreté en effet distributif et de
croissance
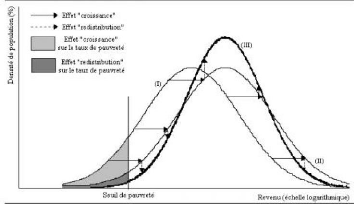
Partant dans ce sens, une variation de la pauvreté est
donc une fonction de la croissance, de la distribution et de la variation de la
distribution. Ce principe est illustré par la figure (1), où
l'indice numérique de pauvreté correspond à la zone
située sous la courbe de densité à gauche du seuil de
pauvreté (fixé ici à 1 USD par jour).
Cette figure fait apparaître la densité de la
distribution du revenu, à savoir le nombre d'individus à chaque
niveau de revenu (représenté sur l'échelle logarithmique
en abscisse). Le passage de la distribution initiale à la nouvelle
distribution s'effectue via une étape intermédiaire qui est la
translation horizontale de la courbe de densité initiale vers la courbe
(I).
L'échelle logarithmique figurant en abscisse, cette
variation correspond à la même augmentation proportionnelle de
tous les revenus de la population et tient lieu d'«effet de
croissance» pur, sans que la distribution des revenus relatifs ne soit
modifiée. Ensuite, le déplacement de la courbe (I) vers la
nouvelle courbe de distribution se produit à revenu moyen
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 25
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 26
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
constant et correspond à la variation du revenu
«relatif» dans la distribution ou à l'«effet
distributif».
De ce fait, il est possible de décomposer la
réduction de la pauvreté en un effet dû à la
croissance et un effet dû à la réduction des
inégalités. Des travaux récents (Bourguignon 2004, Cling
et al 2004, Lopez (2004) montrent que l'élasticité de la
réduction de la pauvreté à la croissance dépend
à la fois de l'inégalité de départ des revenus et
de l'écart entre revenu moyen et ligne de pauvreté. Ainsi, pour
les pays les plus pauvres, la réduction de la pauvreté est
bridée par une distribution inégalitaire des revenus5
et des défaillances de marché qui handicapent la situation des
plus pauvres (Dercon, 2004).
Cependant, au cours des années 90, la lutte contre la
pauvreté a fait l'objet d'évolutions profondes, sensibles
à travers les mesures adoptées par les institutions de Bretton
Woods. Ce n'est qu'en 1999 que l'élaboration d'un document
stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) est devenue
obligatoire pour les pays qui bénéficient des mesures
d'annulation de leur dette (initiative "pays pauvres très
endettés") ou de prêts du FMI. Les DSRP ont cherché
à promouvoir une approche de plus en plus globale de la réduction
de la pauvreté. La thématique de la croissance pro-pauvre
s'inscrit dans cette perspective.
En outre, la croissance pro-pauvre est apparue comme une
alternative aux modèles de redistribution qui conduisent à une
très faible réduction de la pauvreté. L'idée ici,
contrairement à la théorie du « Trickle down
», est de faire émerger la croissance à partir de la base
(les pauvres), c'est-à-dire de mettre les pauvres au coeur du processus
de création de richesse. En effet, comme le souligne Dollar et Kraay
(2002), la croissance à elle seule est insuffisante pour engendrer une
réduction significative de la pauvreté.
Ceci nous amène à soulever la question selon
laquelle, pourquoi la croissance ne profite toujours pas aux plus pauvres ? Par
conséquent, la prise en compte du lien entre la distribution des revenus
et la croissance est cruciale pour toute politique tendant à assurer une
croissance pro-pauvre. Toutefois, comme le souligne Lopez (2004), la question
la plus importante et sans nul doute la plus difficile est celle de savoir de
combien les pauvres doivent bénéficier de la croissance pour
qu'elle soit qualifiée de pro-pauvre.
5 D'après les enquêtes, l'inégalité
mesurée par le coefficient de Gini serait presque aussi forte en Afrique
de l'Ouest que dans les pays les plus inégalitaires d'Amérique
latine - ce qui est loin d'être intuitif.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 27
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Cette question s'intéresse donc à la mesure de
la croissance pro-pauvre. Heureusement, les chercheurs ont proposé une
multitude de mesures pour déterminer empiriquement l'impact de la
croissance sur les plus démunis : la courbe d'incidence de la croissance
(CIC) de Ravallion et Chen (2003) ; le taux de croissance pro-pauvre de
Ravallion et Chen (2003) ; la courbe de croissance de la pauvreté de
(Son, 2004) ; le biais de pauvreté de croissance de McCulloch et Baulch
(1999) ; l'indice de la croissance pro-pauvre de Kakwani et al. (2000) ;
etc.
Selon l'OCDE, la croissance est qualifiée de pro-pauvre
lorsqu'elle s'accompagne d'une réduction significative de la
pauvreté. Cette définition est vaste et nous fournit peu
d'informations.
Certains proposent une approche relative pour définir
la croissance pro-pauvre, en considérant que la croissance est
pro-pauvre lorsqu'elle s'accompagne d'une réduction des
inégalités de revenu (White et al., 2001; Klasen, 2004). D'autres
préfèrent l'approche absolue qui définit la croissance
pro-pauvre comme étant une croissance qui réduit le taux de
pauvreté (Kakwani et al., 2000, 2002).
A l'évidence, l'efficacité de la croissance
comme vecteur de réduction de la pauvreté dépend en partie
des inégalités de revenu. Selon l'approche relative la croissance
est dite pro-pauvre lorsque le taux de croissance du revenu des individus
pauvres est plus important que celui des individus non pauvres (White and
Anderson, 2001; Klasen, 2004). Ainsi, dans le cadre d'une politique
économique pro-pauvre, la réduction de la pauvreté sera
plus forte comparée à une politique de croissance pour laquelle
les inégalités de revenu restent inchangées pour tous,
(McCulloch and Baulch, 1999; Kakwani and Son, 2002).
Autrement dit, elle s'intéresse à la
réduction des inégalités de revenu en faveur des pauvres
suite à une période de croissance économique. C'est
principalement pour cette raison qu'on parle de définition relative de
la croissance pro-pauvre. Ces deux approches posent problème.
La première approche conduit à un paradoxe :
préférer une plus faible croissance (au motif de la
priorité accordée à la réduction des
inégalités) à une croissance plus forte, certes plus
inégalitaire, mais où le revenu des pauvres augmenterait plus
rapidement.
La seconde approche amène quant à elle à
considérer une croissance très inégalitaire comme
pro-pauvres : La plupart des pays, hormis la Roumanie, voient croissance et
réduction de l'incidence de la pauvreté aller de pair. Une telle
définition de la croissance pro-pauvre tend
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
donc à annuler toute spécificité par
rapport à la croissance. De plus, l'utilisation de l'incidence de la
pauvreté tend à focaliser l'attention sur les personnes se
situant juste en dessous du seuil de pauvreté. Un indicateur comme le
taux de croissance du revenu des pauvres (Ravallion & Chen, 2003) peut
paraître préférable.
Cette approche permet de se concentrer essentiellement sur le
lien entre pauvreté et croissance et non sur la distribution du revenu.
Cette approche est cohérente avec le premier des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en 2000
(objectif 1, cible 1 : réduire de moitié en 2015 la proportion de
la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour).
Cette seconde approche est beaucoup moins contraignante que celle de l'approche
relative la croissance dans la mesure où elle se focalise sur les
variations de l'indice de mesure de la pauvreté suite à un
épisode de croissance.
Osmani et al. (2005) proposent une version particulière
en agrégeant les deux approches précédentes. Ainsi, selon
lui, la croissance sera pro-pauvre lorsqu'elle réduit à la fois
la pauvreté et les inégalités. Cette approche a le
mérite d'insister sur les interactions possibles entre croissance,
inégalité et pauvreté.
Le véritable enjeu de l'élaboration d'une
stratégie de développement visant à réduire la
pauvreté réside davantage dans les interactions entre
distribution et croissance que dans les relations entre, d'une part,
pauvreté et croissance et, d'autre part, pauvreté et
inégalités, qui restent essentiellement arithmétiques.
Les économistes conviennent en général
que la croissance est essentielle pour réduire la pauvreté
(-revenu), à condition que la répartition du revenu reste plus ou
moins constante. La réalité tend d'ailleurs à le confirmer
(Deininger et Squire, 1996 ; Dollar et Kraay, 2001 ; Ravallion, 2001 et 2003).
Cependant, le vrai problème de l'élaboration d'une
stratégie de développement est de savoir si la croissance et la
distribution sont indépendantes ou si, au contraire, elles sont
étroitement liées (Bourguignon, 2004).
Au-delà de la question de la distribution des revenus,
on remarque aussi que les niveaux de développement humain sont
très variables entre pays à revenus pourtant comparables
(l'Afrique étant généralement en retard par rapport
à l'Asie). Les liens entre croissance économique et
réduction de la pauvreté sont affectés par les choix
politiques et des facteurs structurels propres à chaque pays. D'autre
part la pauvreté est un phénomène global, les contraintes
imposées par
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 28
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 29
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
le manque de revenus sur les individus s'accompagnant de leur
incapacité à prendre en main leur destin, que l'augmentation du
PIB par tête ne suffit pas à éradiquer (Delleur, 2005)
La croissance est donc indispensable pour réduction de
la pauvreté mais il est aussi nécessaire que cette croissance
s'accompagne d'une politique économique axée
spécifiquement sur les plus pauvres et d'une maitrise des
inégalités des revenus.
| 


