VI. Parentalité
1. Définition
Le Comité national de soutien à la
parentalité synthétise ainsi les idées majeures de ce
concept :
« La parentalité qualifie le lien entre un
adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il
s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et
l'éducation de l'enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un
ensemble de fonctions, de droits et d'obligations (morales, matérielles,
juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans
l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de
l'autorité parentale. Elle s'inscrit dans l'environnement social et
éducatif où vivent la famille et l'enfant. » (37)
Didier Houzel, pédopsychiatre et psychanalyste
français, détaille quant à lui la parentalité en
trois axes :
L'exercice de la parentalité faisant écho aux
droits et devoirs des parents à l'égard de leur enfant.
L'expérience de la parentalité comme une
expérience subjective de devenir parent, de
remplir les rôles parentaux. Elle est relative aux
émotions, au vécu de chacun.
La pratique de la parentalité quant à elle,
correspond aux soins quotidiens, psychiques ou physiques, que les parents ont
à accomplir auprès de l'enfant. (37)
La parentalité est un processus qui évolue en
permanence, il va en-deçà du noyau père-mère
biologiques/enfant, et permet ainsi l'inclusion des multiples formes
parentales. Au-delà des enjeux mobilisés par ces nouveaux
schémas familiaux, la parentalité reste difficile à
caractériser puisqu'elle dépend aussi de l'histoire personnelle,
de la culture et des représentations de chacun.
Comment la puéricultrice peut-elle accompagner chaque
parent dans ce cheminement ?
2. Accompagnement et soutien à la parentalité
Le ministère des solidarités et de la
santé conçoit le soutien à la parentalité comme
suivant : « Soutenir la parentalité, c'est reconnaître
les parents comme premiers éducateurs de leurs enfants et les
accompagner dans la construction de leurs propres choix éducatifs et de
soin, dans le meilleur intérêt de l'enfant et le respect de ses
droits. » (38)
Mais qu'est-ce que véritablement l'accompagnement ?

Dans le dictionnaire des concepts en sciences
infirmières, le mot accompagner correspond à « se
joindre à quelqu'un pour aller où il va, en même temps que
lui. »
Maela Paul, docteur en sciences de l'éducation,
précise : « L'accompagnement nécessite donc, de la part
du professionnel une capacité à combiner des savoirs issus de
pratiques diverses, lui permettant de s'adapter aux situations nouvelles. Il
évoque la proximité et le respect de l'autre, la bienveillance et
le non-jugement. » (39)
De nos jours, les normes sociétales ont beaucoup
évolué. Les femmes mènent souvent de front leur
carrière professionnelle et leur vie personnelle et l'éloignement
possible parents/grands parents compliquent l'échange
intergénérationnel de conseils.
Les séparations au sein des couples sont
régulières, provoquant parfois une rupture de communication, ou
une vision différente de l'éducation de l'enfant. Mais le
changement le plus significatif, encore largement controversé, est celui
de la composition d'une famille.
16
Face à des besoins croissants, une
nécessité d'action se fait ressentir.
Pour cela, le gouvernement a récemment
développé une stratégie nationale de soutien à la
parentalité (2018-2019). Elle a eu pour but de répondre à
l'évolution des structures familiales, à l'émergence de
nouvelles questions des parents, et a indirectement proposé de nouveaux
axes à investir pour les institutions.
Dans ces circonstances, l'accompagnement des familles et le
soutien à la parentalité par les puéricultrices prennent
tout leur sens.
Un document du Centre Ressource Enfance Famille École
(CREFE) propose d'ailleurs des pistes afin d'améliorer le positionnement
professionnel dans le soutien à la parentalité, notamment en
valorisant les compétences parentales. (40)
3. Compétences parentales
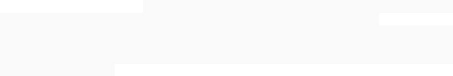
L'idée de compétences parentales est née
lors de la conférence de la famille de 1998 s'intéressant
notamment à « la construction des repères, au maintien
de la cohésion sociale et à l'enjeu de conforter les parents dans
l'exercice de leurs responsabilités. »
Les professionnels du secteur de la petite enfance ne doivent
non plus faire à la place des parents, mais bel et bien les accompagner
dans leur rôle. En collaborant avec eux, l'idée est de lutter
contre leur méfiance, de « passer d'une clinique des
défaillances à une valorisation des potentialités. »
(41)
Le sentiment de compétence parentale c'est «
la perception qu'a un parent de ses habiletés à s'occuper de son
enfant. » Un sentiment positif de compétence est le reflet de
la confiance du parent en ses propres capacités lorsqu'il parvient
à atteindre l'idée qu'il se fait du bon parent.
Le soutien du conjoint et de l'entourage favorise l'atteinte
de ce sentiment de réussite et de satisfaction. Mais, la pression de la
société est telle que nombreux sont les parents cherchant
à se former, pour mieux répondre aux besoins de leur enfant et
ainsi se rassurer. Les puéricultrices peuvent de ce fait,
s'avérer être de véritables personnes ressources, et
confirmer à nouveau leur importance dans le rôle de soutien
à la parentalité. (42)
Cependant, accompagner un parent dans l'évolution de
ses compétences, revient à l'évaluer et implique
inconsciemment un jugement de valeur à l'égard du parent
concerné. Quels sont ses caractéristiques, ses attitudes ou
encore ses traits de personnalité ? Le professionnel évalue selon
des critères d'acceptabilité établis par la
société et selon ses propres affects. Même en
s'efforçant de rester bienveillant, il semble difficile d'être
parfaitement objectif. Le professionnel doit alors lui-même travailler
sur ses préjugés et ses représentations inconscientes.
(41)
Mais, l'incessante recherche de compétences
parentales, ne mène-t-elle pas à un surcroît de
responsabilisation des parents et à une culpabilité d'autant plus
grande pour eux ?
4. Responsabilité
Étymologiquement, le mot responsabilité vient du
latin « responsum » et signifie « se porter garant,
répondre de ». La responsabilité se définit
comme :
«L'obligation faite à une personne de
répondre de ses actes, du fait du rôle et des charges qu'elle doit
assumer, et d'en supporter toutes les conséquences. La notion de
responsabilité est associée dans notre culture occidentale
à celle de faute. Elle résulte pourtant d'une liberté
d'action et intègre la notion de temporalité [...J, dans
l'éducation des enfants par exemple. » (39)
L'enfant n'est de nos jours plus considéré comme
un adulte en miniature, il est reconnu comme un sujet de droits et jouit donc
des droits spécifiques de l'enfant. Vulnérable et en devenir, son
éducation et sa protection sont indispensables pour lui apprendre
à développer une capacité de discernement et ainsi devenir
autonome. De ce fait, l'enfant ne peut être pleinement tenu responsable
de ses actes.
17
Ainsi, les parents, détenteurs de l'autorité
parentale, sont solidairement responsables en cas de problème, et ce,
même si l'enfant était à ce moment-là
surveillé par un autre adulte.
Principalement dans le cadre d'accidents
sévères, la recherche de la cause et du responsable est
systématique.
La culpabilité du responsable est d'autant plus
importante que sa responsabilité est directement impliquée. C'est
un constat fréquent suite à l'accident d'un enfant sous la
surveillance de ses parents. Et pourtant, « la méconnaissance
du développement de l'enfant, et la sous-estimation de ses
capacités, est plus souvent à l'origine des accidents que la
négligence des adultes à l'égard de l'enfant. »
(7)
5. Culpabilité

D'un aspect psychologique, la culpabilité est un
« sentiment douloureux et normal qu'éprouve un sujet à
la suite d'une faute, dont il se sent coupable et responsable parce qu'elle
représente la transgression d'une valeur qu'il a
intériorisée et reconnue valable. » (43)
La culpabilité est un sentiment récurrent dans
la relation parent-enfant et survient selon différents contextes : la
séparation des parents, la maladie ou l'accident d'un enfant...
Ce sentiment apparaît car entre aussi en jeu la notion
de responsabilité. Être parent c'est se sentir responsable du
développement de son enfant, de son avenir, jusqu'à ce qu'il soit
en mesure de gérer lui-même sa propre responsabilité.
Dans un texte de Jean-Claude Quentel, psychologue clinicien,
la culpabilité parentale touchant des parents d'enfants en situation de
handicap, est illustrée ainsi : « ces parents en viennent
à croire que si ça leur est arrivé, c'est sans doute
qu'ils l'ont mérité, parce qu'ils sont coupables. N'ayant pas
fait ce qu'il fallait, ils n'ont en définitive que ce qu'ils
méritent. » (44)
La culpabilité parentale est un élément
fondamental à prendre en compte avant toute rencontre parent-soignant.
Mais, il faut surtout se demander si la culpabilité ressentie est
seulement un sentiment personnel, ou si les parents sont culpabilisés
par le monde extérieur et les attentes
sociétales.(45)
Dans le cadre des accidents domestiques de l'enfant, la
culpabilité inhérente à la fonction de parent est
majorée par cet événement.
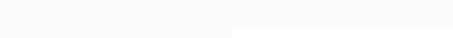
Pourtant, « même lorsque les parents assurent
de leur mieux leurs obligations de surveillance et d'éducation, la part
de liberté laissée à l'enfant dans son apprentissage
comporte des risques que doivent assumer les parents. » (46)
Dans une société toujours plus exigeante, les
puéricultrices, dans le cadre du soutien à la parentalité,
doivent aussi apprendre aux parents à ne pas tomber dans l'hyper
culpabilité.
| 


