1.3.3. L'attractivité illusoire du modèle
urbain :
La diffusion des l'habitat post-ksourien
41 sous forme de quartiers extra-muros,
conséquence de l'éclatement des Ksour et de la
dépréciation généralisée de l'habitat
traditionnel, oppose banalisation à authenticité. Cette forme
d'urbanisation trop banale, car elle procède par mimétisme, et ne
fait jamais appel au passé, où les lotissements se ressemblent
est synonyme d'uniformisation et de falsification de l'identité
territoriale des palmeraies de la réserve. Faits de matériaux de
construction non adaptés aux conditions climatiques
sévères, (béton armé, brique de ciment, verre,
acier), sans espaces verts, sans infrastructures ni services de base. Les
constructions contemporaines font preuve d'une pauvreté d'imagination.
La rupture qu'elle marque par rapport au contexte urbanistique et paysager
immédiat et le maque d'identité qu'elles manifestent en sont les
caractéristiques les plus frappantes. Cette urbanisation est une forme
d'acculturation territoriale qui développe des comportements
individualistes. Parce que le paysage est fonction de pouvoir ou d'absence de
pouvoir, si dans les conditions du développement urbain de la
réserve le paysage de la palmeraie est dégradé, c'est
par défaut d'autorité et des règlements peu ou pas
appliqués. La loi sur le patrimoine culturel (loi
22-80) et le code d'urbanisme (la loi 12-90) et
surtout le permis de construire sont dérégulés en
permanence et n'ont pas d'effets à cause de l'absence d'autorité
pour l'appliquer. Dans la zone d'étude, la banalisation des paysages
ruraux et urbains a des répercussions qui vont au-delà de la
simple altération visuelle ou picturale. Elle a aussi des
retombées économiques considérables dans ce sens où
la dégradation de la qualité paysagère entraîne la
perte d'un potentiel fondamental à l'économie de tourisme
culturel et écologique, pilier important du développement des
oasis. Il est essentiel donc de contenir les changements du mode d'habitat en
vue de les orienter et les organiser afin de réduire la
dégradation urbaine et les déviations paysagères qui s'en
suivent. Il convient de tracer une politique de sauvegarde et de
réhabilitation,
40 Les nouvelles constructions qui
remplacent l'habitat historique ne manquent pas seulement de
l'esthétique mais aussi des infrastructures et des services sociaux de
base. Les eaux usées sont rejetées dans des fosses sceptiques
creusées dans le jardin de l'habitation et des inquiétudes
commencent déjà à s'installer par rapport à la
qualité des eaux de la nappe.
41 Dans l'évolution
générale de l'habitat des oasis, le terme habitat «
post-ksourien » désigne les zones résidentielles
qui se sont développées autour
des Ksour et en de leurs murailles comme forme d'habitat
postérieure au mode traditionnel. L'apparition de ce mode d'habitat
faisant usage de béton armé et de la brique du ciment et d'un
tracé où les habitations ont passé de la forme
agglomérée à la forme en parcellaire illustre le malaise
de l'urbanisation contemporaine des oasis et ses effets sur la
déstructuration économique de la société oasienne
et la disparition des ses valeurs socioculturelles.
voire de modernisation, des principaux Ksour
d'intérêt historique, paysager et écologique. On pourrait
envisager l'implication des opérateurs privés pour leur
reconversion en équipements touristiques (les auberges, les maisons
d'hôtes...) ou en équipements de loisirs et de culture (les
écomusées, les maisons d'arts et des métiers
traditionnels, les centres culturels, les maisons de jeunes, les centres
cinématographiques, etc.). Les nouvelles constructions qui remplacent
l'habitat historique ne manquent pas seulement de l'esthétique mais
aussi des infrastructures et des services sociaux de base. Les eaux
usées sont rejetées dans des fosses sceptiques
creusées dans le jardin de l'habitation et des inquiétudes
commencent déjà à s'installer par rapport à la
qualité des eaux de la nappe. Dans l'évolution
générale de l'habitat des oasis, le terme habitat « post-
ksourien » désigne les zones résidentielles qui se sont
développées autour des Ksour et en de leurs murailles comme forme
d'habitat postérieure au mode traditionnel. L'apparition de ce mode
d'habitat faisant usage de béton armé et de la brique du ciment
et d'un tracé où les habitations ont passé de la forme
agglomérée à la forme en parcellaire illustre le malaise
de l'urbanisation contemporaine des oasis et ses effets sur la
déstructuration économique de la société oasienne
et la disparition des ses valeurs socioculturelles.
1.4. L'impact environnemental de l'urbanisation
:
Il est vrai que la transformation des palmeraies d'une
société agraire à une société urbaine offre
des opportunités considérables du développement local.
Pourtant, les manifestations de ce phénomène dans le territoire
de la réserve posent d'énormes problèmes de maîtrise
et d'encadrement.
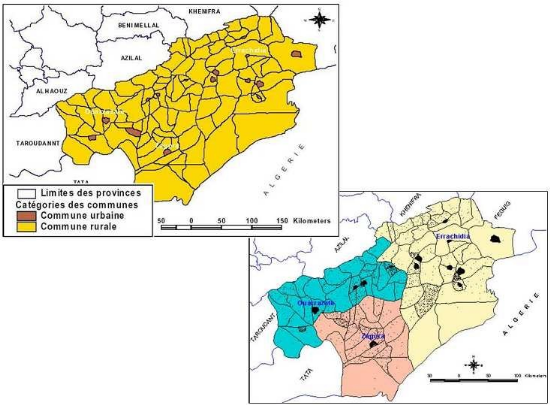
Figure 24 : Catégories des communes et
densité démographique dans les provinces de la RBOSM en
2004
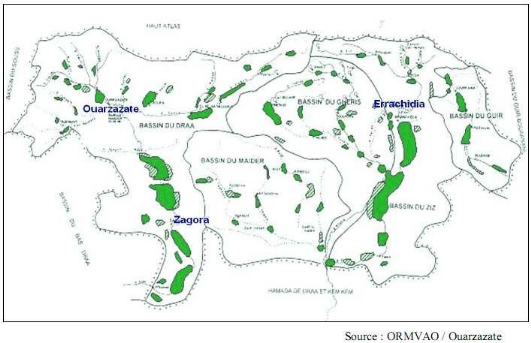
Figure 25 : Carte des palmeraies traditionnelles (zones
tampon de la RBOSM)
La concentration des avantages socioéconomiques de
l'urbanisation (l'emploi, l'éducation, la santé et les conditions
d'habitat) dans les centres urbains et les municipalités, au lieu de
favoriser le développement local entraine le basculement des populations
rurales vers les communes urbaines
favorisées par les politiques d'aménagement et
du développement. L'accroissement de la population urbaine suite
à cette dynamique d'immigration interne entraine la concentration des
activités économiques et des populations sur les zones tampon de
la réserve constituées des palmeraies traditionnelles qui sont
les seuls espaces vivriers de la réserve. La superposition des deux
cartes précédentes (figure 24) avec celle des palmeraies
traditionnelles (figure 25) illustre parfaitement le phénomène de
la pression anthropique sur les palmeraies ce qui signifie un
empiétement progressif sur les terrains agricoles. Il y a lieu de
s'interroger sur les mesures nécessaires pour maîtriser cette
dynamique spatiale pour préserver la qualité du milieu urbain et
des paysages naturels avoisinants. L'orientation majeure à ce niveau est
d'ouvrir les terres incultes à l'urbanisation et de mettre en oeuvre,
dans les zones tampon, des documents d'urbanisme en harmonie avec les objectifs
du statut de la réserve de biosphère dans le sens de
réconcilier la croissance urbaine et la sauvegarde de l'environnement et
de la diversité écologique et paysagère. Dans les zones
tampon de la réserve, constituées d'écosystèmes
extrêmement fragiles et qui repose sur des équilibres
précaires, la
sensibilité écologique et paysagère est
accentuée par la pression démographique et par l'augmentation
continue des besoins en terrains urbanisables.42 De
plus, l'urbanisation des zones tampon amplifie tous les
phénomènes de dégradation de l'environnement et du paysage
mentionnés auparavant tels que la désertification, la
dégradation du couvert végétal, l'érosion des
terres agricoles, la génération des déchets urbains et des
eaux usées. Les populations s'organisent et des associations de
protection de l'environnement se mettent en place. Même si leurs actions
demeurent
répétitives et de portée locale, il
faudrait les encadrer et les renforcer pour faire face au désengagement
de plus en plus prononcé de l'État de la gestion de
l'environnement. Les problèmes locaux relatifs à l'environnement
doivent être hiérarchisés pour fixer les actions à
mener en priorité. Cela permettra d'harmoniser les interventions des
associations et les lancer par la suite sur des programmes de travail
cohérents et concrets.
42 Certaines localités
enfermées vers la frontière sont sérieusement en voie de
disparition : Bleïda, M'Hamid, Taouz, N'kob, Tazarine.
| 


