CHAPITRE III : UN PROJET PAYSAGER POUR LE DEVENIR DU
TERRITOIRE OASIEN
Pour maitriser un paysage il est indispensable de veiller
à son développement harmonieux et intelligent. Il faut
réparer les erreurs de l'occupation de l'espace et redresser les impacts
non désirables des activités humaines sur le milieu. Le projet
paysager apporte à une stratégie d'aménagement une
signification écologique que culturelle et une dimension de
développement humain très forte. Cette seconde étape dans
l'élaboration de projet de territoire a pour objectif :
- de déterminer les principes d'intervention visant
l'amélioration de la qualité paysagère et l'insertion des
aménagements futurs;
- de réfléchir aux usages des espaces naturels
et aux sites remarquables du territoire intercommunal à
privilégier en fonction de leur valeur paysagère et de fixer des
règles d'occupation de l'espace.
C'est une étape de propositions et de choix
d'orientations de la part des acteurs. Le rôle de paysagistes et des
gestionnaires de l'environnement est très important pour aider à
bâtir des propositions intégrées, et le rôle des
élus est déterminant comme décideurs des orientations
stratégiques.
Les échelles d'intervention :
Les propositions pour la requalification des paysages doivent
être réfléchies à deux échelles
différentes :
· À l'échelle de l'ensemble du
territoire, échelle des enjeux communs, les interventions sont
de nature thématique : la maitrise de mutations paysagères
urbaines, la protection des qualités du milieu naturel, la
préservation et la réhabilitation des entrées des communes
et des villages.
· À l'échelle de chaque
entité paysagère, il faut rechercher des
préconisations paysagères et environnementales en lien avec les
vocations économiques dominantes des différentes parties du
territoire : zones à usage réservé à certains types
de fréquentation, prescriptions architecturales en matière de
construction, pérennité de l'usage agricole des terrains,
meilleures intégration des travaux d'aménagement à
l'environnement.
Cette double approche permet d'intervenir de manière
cohérente sur tout le territoire, tout en affirmant les
spécificités de chaque entité paysagère. Les choix
d'aménagement et de développement doivent, quant à eux,
être réfléchis sur la base des usages de l'espace qui
seraient
les plus compatibles avec la qualité souhaitée
au territoire. Il s'agit de désigner les vocations dominantes de chaque
partie du territoire, c'est-à-dire ce à quoi on souhaite destiner
ces différentes parties selon leur aptitude à développer
des fonctions et des usages particuliers et, à partir de là, de
fixer des principes d'utilisation de l'espace.
Programme d'action et principes d'intervention
:
Pour chacune des situations paysagères
rencontrées, le projet de territoire consiste :
- à proposer des principes d'intervention sur les projets
d'aménagement;
- à préciser les actions à conduire pour
améliorer la qualité paysagère du territoire : contenu
des actions, localisation...
Ces principes d'intervention sont des lignes directrices et de
points de référence communs sur lesquels les élus, les
aménageurs, les maitres d'ouvre s'appuieront lors de la
réalisation des aménagements. À ce stade, on ne vise pas
à aboutir au plan d'aménagement d'un village ou d'un site
paysager ou naturel. L'objectif est de se mettre d'accord sur des principes
d'intervention et de traitement adaptés aux spécificités
du territoire. Dans ce stade, chaque nouveau projet, chaque action de
réhabilitation ou de protection valoriseront les atouts paysagers du
territoire, et permettront de renforcer son identité de façon
cohérente. La définition du programme d'action se fait à
l'échelle de tout le groupement de communes; elle permet un traitement
global du territoire et contribue à favoriser la cohérence des
actions. Le projet paysager défini à ce stade doit être
fortement corrélé à l'objectif dominant poursuivi au
travers de projet global de développement intercommunal et de sa
politique d'aménagement : préservation face à la pression
urbaine, objectif de valorisation touristique, d'amélioration du cadre
de vie des habitants, etc. Dans cet esprit, la réserve de
biosphère peut par exemple définir des thèmes
d'intervention prioritaires qui feront l'objet de fiches techniques
simples regroupées dans un guide à l'usage des communes.
Usages du territoire et occupation de l'espace
:
La qualité environnementale et paysagère d'un
territoire dépend intimement du type de développement
économique qui y est pratiqué, des choix d'aménagement
qui y sont faits : nature et localisation des activités,
équipements et infrastructures, aménagement foncier, gestion
forestière, etc. Sa revalorisation passe donc non seulement par des
actions de requalification ou de réhabilitation paysagère,
environnementale ou patrimoniale, mais par une réflexion sur les choix
d'aménagement et de développement. Dans notre territoire
d'étude, certaines zones sont menacées par la présence
d'activités trop agressives et par des usages de l'espace qui ne sont
pas toujours adaptés aux caractéristiques paysagères et
écologiques des lieux. Dans la région des palmeraies,
l'enjeu du projet de territoire est donc de
réfléchir au mode d'utilisation de l'espace au regard de la
qualité et de la sensibilité paysagère et environnementale
qui le caractérisent. Quelle est la vocation dominante de chaque
entité paysagère de notre territoire ? Quelles
conséquences en tirer de point de vue de l'occupation de l'espace et des
choix d'aménagement ? Il est clair que la capacité
d'infléchir les grandes mutations du territoire qui affecte
l'évolution des paysages est limitée et qu'il faut relativiser la
part des choix que peut formuler un groupement de communes. Tant
d'évolutions paraissent inéluctables ou dépendantes des
décisions nationales voire même internationales. Pourtant, en
détenant une bonne part des pouvoirs de planification de l'espace, et en
étant décideurs d'aménagement publics, les communes ont
des moyens, si ce n'est de choisir, tout au moins d'infléchir des
évolutions des évolutions indésirables : comment mieux
faire ce qui relève directement de leur marge de compétence
(outils de planification urbaine adaptés, travaux d'aménagement
judicieux et de qualité, choix de développement
intégrés à la réalité locale) ? Comment
créer les conditions pour que les actions des particuliers, des
entrepreneurs, des aménageurs contribuent à améliorer la
qualité du milieu de vie au lieu de le dégrader ?
Déterminer les vocations dominantes des
entités du territoire :
Quelle est la vocation dominante de chacune des entités
du territoire, en fonction de ses atouts et ses contraintes environnementales
et paysagères ? Au développement de quel type d'activité
est- elle le mieux adaptée ? Que peut-on faire sur telle partie du
territoire mieux qu'ailleurs ? Faut-il continuer à développer les
zones urbaines sur cette partie du territoire alors que sa qualité
paysagère et naturelle constitue un potentiel touristique ? Des espaces
apparaitront plus propices que d'autres aux activités agricoles,
d'autres présenteront de réels atouts pour une valorisation
touristique, d'autre encore pour un développement résidentiel. Il
s'agira alors pour les communes de prendre les décisions qui s'imposent
pour permettre un aménagement en cohérence avec la vocation de
chaque lieu. Ainsi, dans l'avenir, les vocations économiques de l'espace
ne constituent pas une menace pour la qualité paysagère du lieu
et à son intégrité environnementale mais contribuent
à son maintien et à sa valorisation. Le projet de territoire est
de cette façon un nouveau regard sur le territoire qui amènera
à remettre en cause des projets d'aménagement dans leur
conception ou dans leur réalisation et à prévoir des
conditions particulières pour l'occupation de certains espaces.
Définir son projet d'aménagement et de développement en
partant d'une réflexion sur le potentiel paysager et naturel est une
démarche nouvelle. Nous proposons donc des modes de questionnement et
des lignes de conduite permettant d'aborder les usages futurs des espaces du
territoire de la réserve de biosphère des oasis.
Définir les règles de jeu pour
l'occupation de l'espace :
Il s'agit de définir, au sein de chaque entité
paysagère des règles de jeu de l'occupation de l'espace. En
fonction de sa ou ses vocations dominantes, on déterminera la nature des
activités à favoriser, à développer, à
réglementer et les zones correspondantes :
- maintenir les activités agricoles, préserver
la qualité naturelle, favoriser le caractère paysager de
l'espace;
- développer des activités touristiques et
certains types d'accueil;
- orienter la gestion et la restructuration de la
palmeraie;
- interdire certains types d'activités dans des lieux
de grande sensibilité environnementale ou paysagère, tel que les
décharges, les rejets d'assainissement, la construction en béton
armé...
On orientera aussi la localisation des activités :
- localiser les futures zones d'urbanisation;
- choisir des espaces à valoriser pour le tourisme;
- définir des zones naturelles;
- définir des zones agricoles.
La charte paysagère : un contrat intercommunal
sur des objectifs et des moyens.
Lorsque la structure intercommunale a arrêté les
orientations pour son projet territorial, il lui reste à en
définir les modalités concrètes de réalisation ce
qui suppose des engagements formels. C'est l'objet de cette dernière
étape, celle de la validation du projet de territoire et de
l'élaboration de la charte intercommunale, document sur lequel
s'engageront librement les signataires. À ce stade, il importe de :
- définir les moyens nécessaires à la
mise en oeuvre et le rôle de chaque acteur dans celle-ci;
- établir le document de charte;
- amener chaque partenaire à s'engager sur cette
charte;
- assurer la pérennité de la charte et donc la
bonne continuité du projet.
Les moyens de la mise en oeuvre :
L'enjeu est de réunir toutes les conditions qui
favorisent la mise en oeuvre d'un programme d'actions dans le respect de la
charte et la pérennité des choix d'aménagement. Pour
chacune des actions définies, il s'agit de définir les moyens et
les acteurs qui seront chargés de les mettre en oeuvre.
a. Les moyens d'action :
Il s'agit de traduire chaque orientation du projet paysager
en action concrète assortie des moyens de sa réalisation. Les
moyens seront de nature technique et humaine, financier, réglementaire,
de formation et de communication tel que cela est illustré dans le
tableau suivant :
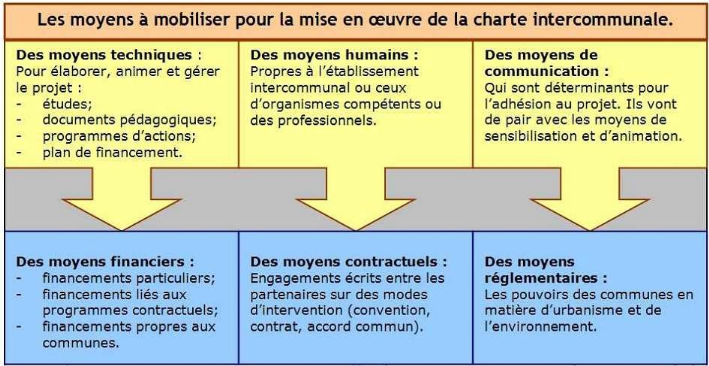
Tableau n° 9: Les moyens de la mise en
oeuvre de la charte intercommunale
b. Les moyens humains :
Dans la mesure où le groupement de communes dispose
d'une équipe technique, elle peut être mise à la
disposition des communes pour les aider et les assister dans la mise en oeuvre
du projet paysager. Les moyens humains, ce sont aussi les personnels
compétents des services administratifs, les cadres associatifs, les
professionnels des ONG internationales impliqués dans des projets de
développement local avec lesquels des conventions de partenariats
peuvent être signés.
c. Les moyens techniques :
L'apport technique se traduit par l'élaboration
d'études spécifiques, par la mise en place de programmes
d'actions précis et par la réalisation d'outils d'aide
technique.
d. Les moyens financiers :
Le projet pour le paysage ne sera viable que si les communes
ont la capacité de dégager des moyens pour le financer. Le
groupement peut disposer d'un financement propre (taxes, lignes
budgétaires...) qui lui permettra d'initier son projet de paysage et de
mobiliser facilement d'autres partenaires, notamment le fonds de
l'équipement communal, pour apporter des financements
complémentaires. Le succès d'une politique paysagère ou
environnementale ne requiert en aucun cas des financements spéciaux.
Tout dépend de la capacité des communes à concevoir de
meilleurs projets dans le cadre de financement communs : par exemple
réaliser des aménagements de villages de qualité dans
la cadre des subvenions publiques ordinaires.
e. Les moyens réglementaires :
Certains aspects du projet paysager gagneront en
efficacité s'ils trouvent une parfaite traduction dans les documents
d'urbanisme. Ceux-ci devront être adaptés afin de prendre en
compte les orientations définies dans le projet paysager commun. Ces
moyens réglementaires qui relèvent soit de groupement soit de
chaque commune peuvent concerner par exemple :
- l'élaboration d'un Schéma directeur
d'aménagement intercommunal afin de mieux prendre en compte
l'environnement et le paysage;
- la prise en compte par les communes du projet de paysage
à l'occasion des révisions d'un Plan d'Aménagement;
- la définition des prescriptions communes de permis de
construire qui seront reprises dans les documents d'occupation de l'espace;
- la mise en place d'une politique d'acquisition foncière
orientée vers la préservation des qualités des milieux
naturels sensibles et du paysage;
- la sollicitation de l'État pour la mise à
l'étude de procédures de protection paysagère, au titre du
plan national de le restructuration de la palmeraie (qualité des
prescriptives internes et externes de la palmeraie, prise en compte des
sensibilités paysagères dans les travaux de restructuration,), la
loi sur la conservation du patrimoine culturel, le code de l'urbanisme, le
règlement sur le classement des sites d'intérêt biologique
et écologique (sites inscrits pour les paysages ruraux remarquables,
sites naturels de valeurs paysagère;
En matière d'affichage, bien qu'il n'existe pas encore
d'assises juridiques spécifiques, la loi sur la conservation du
patrimoine réclame le respect de la visibilité des monuments
historiques. Sur cette base, on peut veiller à la mise en place dans
chaque agglomération de zones d'affichage autorisé,
définissant la localisation, les modes d'implantation et les normes de
taille des supports d'affichage.
f. Les moyens contractuels :
La charte signée par les communes du groupement porteur
de projet rassemble les dispositions acceptées par chaque commune pour
la maitrise du devenir du paysage sur son territoire. Au travers de cette
charte, le groupement s'engage sur un programme d'actions qui seront
menés en partenariat avec des organismes compétents. Les
services publics et les organismes socioprofessionnels intervenant sur le
territoire peuvent être liés par des conventions d'application de
la charte pour la mise en oeuvre d'actions spécifiques.
g. Les moyens de communication :
La prise en compte de paysage et de l'environnement dans les
programmes de développement et d'aménagement implique d'engager
des actions d'information et de sensibilisation à l'égard de tous
ceux qui interviennent sur le territoire et ceux qui y vivent. À chaque
public peuvent être adaptés des outils de sensibilisation
spécifiques :
- l'édition des guides sur le paysage et
l'environnement;
- l'édition des fiches de présentation du
projet;
- la préparation des dossiers de presse pour la presse
locale et nationale;
- des activités pédagogiques dans le milieu
scolaire;
- des manifestations : expositions, conférences, des
journées thématiques sur le paysage, l'environnement, le
patrimoine;
- des chantiers bénévoles d'entretien du paysage
ou du cadre de vie;
- des ateliers de formation pour les professionnels de
l'aménagement et les associations locale.
Pour l'organisation d'actions de formation/sensibilisation, il
est important de disposer de personnel qualifié. Compte tenu de contexte
des oasis, étant une aire protégée de valeur universelle,
l'aménagement des itinéraires des panoramas du territoire est un
outil de sensibilisation et de conscientisation très approprié.
Cette action peut avoir une double vocation : sensibiliser la population
à la diversité paysagère et écologique de leur
territoire et faciliter aux touristes la découverte des richesses
territoriales locales. Ce type d'action nécessite la mise en place d'un
plan de signalisation des sentiers et des sites remarquables pour faciliter la
découverte des paysages et des richesses naturelles et patrimoniales.
Sur ces sentiers, des sorties guidées peuvent être
organisées à vocation diverses : paysagère,
écologique, botanique, archéologique...
Le document de la charte :
Il s'agit maintenant de traduire l'ensemble de ces
dispositions dans un document qui engage ses signataires et assurera la
pérennité de cette approche. La charte paysagère,
instrument d'aménagement intercommunal, est le document de
référence commun qui donne la ligne de conduite que chacun doit
respecter sur le territoire. La charte paysagère se concrétise
par plusieurs documents :
a. Le document cartographique :
Une carte de référence où figurent les
vocations et les mesures de protection et d'aménagement par type
d'espace. Ce document présente une illustration visuelle du et
traduisant les orientations retenues quant à l'usage du territoire et
aux règles d'occupation de l'espace. Ce document cartographique est
complété par des cartes thématiques ou par
entité paysagère. À cette étape, les cartes ne
sont plus des cartes de présentation de l'état du territoire. Ce
sont des cartes prospectives, c'est-à-dire des outils de
référence qui montrent les choix opérés, et
présentent les
orientations principales par type d'espace et la nature
des interventions.63
b. Le document écrit :
C'est un complément de la carte qui présente
l'ensemble du projet par entité paysagère et par thèmes.
Il doit contenir les vocations arrêtées pour chaque type d'espace
du territoire intercommunal, les orientations prises pour la requalification
des paysages et la protection de l'environnement, les principes pour les
aménagements futurs des différents espaces du territoire, un
63 Le dossier cartographique du
projet doit aussi faire objet d'une exploitation pédagogique :
utilisation pour des expositions, pour la réalisation de brochure et des
guides de sensibilisation.
programme d'action avec une hiérarchisation des
priorités, les règles de conduites à respecter par chaque
catégorie d'acteur, les moyens à mobiliser et les programmes
d'action à mettre en oeuvre.
c. Des documents par commune :
La charte peut comprendre des documents à
l'échelle communale qui traduisent les orientations du projet
paysager pour chaque commune et en précise l'impact sur son territoire.
Ce peut être une carte particulière ou un guide de
recommandations. Chaque commune peut ainsi s'approprier le projet au regard de
ses compétences et des priorités. Il faut que chaque commune de
groupement porteur de projet dispose du document cartographique et écrit
complet de l'ensemble du territoire. En somme, la charte paysagère,
engage ses signataires sur un projet de développement territorial
commun. Tout l'enjeu réside dans sa capacité à
mobiliser, à associer et à convaincre l'ensemble des partenaires
pour mettre en oeuvre la politique choisie pour l'aménagement et le
développement de leur territoire. Elle traduit les intensions du
groupement quant au devenir du paysage intercommunal, fixe les grands principes
de projet de territoire et ses orientations majeures et précise les
moyens à engager pour leur réalisation. Elle doit
également prévoir les conditions de sa mise en oeuvre, un
délai de validité et les conditions de son évaluation et
de sa révision. La charte paysagère n'a pas de valeur
réglementaire particulière en tant que tel, et elle n'est pas
opposable aux tiers. Cependant, le recours aux outils réglementaires,
notamment au travers des documents d'urbanisme, permet de mesurer le
degré d'intégration intercommunal au projet de paysage et
à la répartition des responsabilités entre les communes de
groupement. Elle doit être objet d'une présentation publique,
bénéficier d'une publication et être et facilement
consultable. Pour un groupement de communes, bâtir une politique
paysagère c'est s'interroger sur l'avenir de son territoire et prendre
conscience du rôle de l'environnement et du paysage comme leviers de
développement.
Le projet de territoire qui intègre ces
considérations est une démarche en émergence au Maroc.
Elle offre aux groupements de communes un cadre méthodologique leur
permettant :
- d'analyser ensemble les caractéristiques de leur
paysage et lui attribuer une valeur de développement
économique;
- de réfléchir aux vocations des différents
espaces du territoire et à ce que l'on souhaite qu'ils deviennent;
- de prendre de façon volontaire des mesures
destinées à mieux maitriser le devenir du paysage;
- d'élaborer un programme d'action qui soit plus qu'une
série de mesures réglementaires;
Cette approche s'avère très
fédératrice pour l'action intercommunale. Elle permet d'envisager
l'aménagement et le développement du territoire en dehors de
débats relatifs à la mise en oeuvre d'un projet précis.
À ce titre, les chartes paysagères constituent une nouvelle
opportunité pour les communes de renforcer leurs liens ou de les
créer lorsque l'intercommunalité est expérience nouvelle.
Elles sont également une opportunité de structurer un dialogue
avec leurs partenaires économiques, administratifs et associatifs.
Engagement à un meilleur aménagement du territoire,
«les chartes paysagères permettent aux
communes d'appliquer à leur niveau un des principes essentiels de la
conférence de Rio : le droit des générations futures
à un environnement préservé, facteur d'un
développement durable ».
| 


