INTRODUCTION GENERALE
«Le soleil ne doit pas se lever ou se coucher deux
fois sur une femme en train d'accoucher». Proverbe
africain
Depuis les années 1950 et 1960, les pays en
développement ont accompli des progrès sur le plan du
développement humain, progrès que mettent en évidence les
rapports annuels publiés par les agences internationales telles que le
Programme des nations Unies pour le Développement (PNUD) ou la Banque
mondiale. Néanmoins, le dénuement des populations de certains
pays reste immense et les progrès humains des trente dernières
années n'ont été ni uniformes ni harmonieux. La
santé des populations, composante essentielle du développement
humain, est souvent précaire et les indicateurs sanitaires
inquiétants. Ainsi, selon les estimations du PNUD de 2003,
l'espérance de vie est encore inférieure à 50 ans dans une
20e de pays en développement et 14 millions d'enfants de
moins de 5 ans meurent encore chaque année et la sous-alimentation
frappe plus de 150 millions d'enfants. Enfin, plus de 4,5 milliards de
personnes n'auraient pas accès aux services de santé.
Dans des contextes où l'offre de services de santé
modernes est peu importante et les ressources sanitaires plus ou moins
accessibles, l'émergence de questionnements relatifs à
l'utilisation de ces services peut a priori sembler paradoxale. En effet d'une
part, les besoins sont immenses et les services trop rares pour y
répondre convenablement, et d'autre part, l'on constate, lorsqu'on
implante des services censés répondre à ces besoins par
les populations et aux mécanismes susceptibles de l'influencer.
Malgré le développement de tout un champ de
recherche autour de ce thème, il est impossible de dégager une
vision d'ensemble de l'utilisation des services de santé,
phénomène complexe et toujours difficile à comprendre.
Ainsi, différentes lectures de l'utilisation sont possibles selon, par
exemple, que le regard se porte sur le marché des services de
santé ou sur les comportements de santé des individus ou bien
selon que l'observation est centrée sur les expressions spatiales (quels
services sont ou ne sont pas
utilisés ?) ou temporelles (quand ces services sont-ils ou
ne sont-ils pas utilisés ?) de l'utilisation.
A la fin des années 1970, on commence à revoir les
stratégies de développement des services de santé. Les
économies et les termes de l'échange se dégradent, le
poids de la dette publique atteint souvent des niveaux critiques, les
ressources consacrées au secteur de la santé stagnent ou plus
souvent régressent et les grandes ambitions des années
précédentes apparaissent de plus en plus difficiles à
satisfaire.
Les problèmes de la santé maternelle et
infantile, malgré les efforts considérables qui ont
été déployés depuis plusieurs années,
continuent de focaliser l'attention de la communauté internationale et
des pouvoirs publics. En moyenne, 400 mères décèdent pour
100 000 naissances vivantes (Tchad et Culture n° 251, 2006). Un ratio
beaucoup plus élevé dans les pays à faible revenu allant
jusqu'à 1600 voire 2000 dans certains endroits. Chaque minute, 5 290 000
femmes meurent en donnant naissance à travers le monde chaque
année (ONU, 2000)1. Pour une femme qui meurt, 30 sont
handicapées, 47% de ces décès et 60% de ces handicaps se
passent en Afrique alors que la population du continent ne représente
que 12% de la population mondiale. En Afrique, presque la totalité de
ces décès concernent l'Afrique subsaharienne. A la
Conférence Internationale sur la Population et le Développement
(CIPD) tenue au Caire en 1994, la plupart des pays africains se sont
fixés comme objectif de réduire significativement le niveau de
mortalité maternelle. Ce dernier est la cible deux des huit Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). On remarque cependant,
dix ans plus tard, que le niveau de mortalité maternelle reste
élevé et presque stable dans ces pays. Etant donné que la
plupart des causes médicales des décès maternels peuvent
être prévenues (WHO, 2002), ce phénomène se justifie
par le faible taux de recours aux soins maternels. D'après l'OMS, la
fréquence du recours aux soins prénatals parmi les femmes
enceintes est de 63% en Afrique contre 97% en Europe, 95% en Amérique du
Nord, 73% en Amérique Latine et Caraïbes et 65% en Asie. La
fréquence du recours à l'assistance médicale pendant
l'accouchement est davantage plus faible : 42% en Afrique contre 98% en Europe,
99% en Amérique du Nord, 75% en Amérique Latine et Caraïbes
et 53% en Asie (WHO, 2002). Selon la même source, moins de 30% des femmes
reçoivent les soins postnatals en Afrique subsaharienne contre 90% dans
les pays développés. Du fait de la faiblesse des services de
1 Il s'agit d'une estimation des Nations Unies
soins ou de l'absence de la sécurité sociale, de
la pauvreté, de l'ignorance, des contraintes culturelles ou du statut de
la femme dans la société, nombre d'Africaines perdent la vie en
voulant la donner. Elles sont des milliers à perdre leur vie parce
qu'elles n'ont pas eu accès aux soins appropriés, parce qu'elles
n'ont pas pu se rendre dans une structure sanitaire du fait de
l'éloignement des structures sanitaires, parce qu'ignorantes elles se
sont vu interdire la fréquentation d'un centre de santé, parce
qu'elles n'ont pas les moyens financiers pour se procurer des soins.
La mortalité maternelle n'est pas seulement un
problème sanitaire mais une injustice sociale car mourir en voulant
donner la vie est une question de violation des droits humains. Attendre un
enfant et le mettre au monde est un événement majeur pour chaque
femme, chaque couple, chaque famille car il constitue une prolongation de la
vie, voire une victoire sur la mort. Pourquoi alors ce drame silencieux qui ne
dit pas son nom : Voir une femme mourir au moment où cette
dernière donne la vie. Un pays qui envoie ses soldats en guerre pour la
défense de la patrie s'assure toujours qu'ils reviendront en bonne
santé. Pourquoi alors la femme qui est appelée à partir
à la guerre qui est la perpétuation de la race humaine ne doit
pas être sûre de revenir ?
Un proverbe Tanzanien illustre à merveille cette
situation. Une mère qui va accoucher son enfant dit ceci : « Je
vais à l'Océan chercher un nouveau bébé mais le
chemin est long, dangereux et il se peut que je ne revienne pas ».
C'est dire que plus qu'un drame, la mortalité maternelle est un
défi continental.
La revue de la littérature sur le sujet met en
évidence deux types de facteurs explicatifs du faible recours aux soins
modernes par les femmes dans les pays en développement pendant la
grossesse et l'accouchement : les facteurs relatifs à la demande de
soins et ceux relatifs à l'offre.
Dans le premier ensemble, on retrouve les facteurs culturels et
économiques.
Selon l'approche culturelle, la fréquentation des
services de santé dépend des institutions sociales telles que les
coutumes, les réseaux de solidarité, les perceptions ou
représentations symboliques de la grossesse et de l'accouchement, et du
degré d'ouverture à la modernité (Rwenge Mburano, 2007).
L'approche économique, quant à elle, met la fréquentation
des services de santé en relation avec les conditions économiques
dans lesquelles vivent les femmes (Rwenge Mburano, 2007). Dans le second
ensemble, on retrouve les facteurs suivants : accessibilité des soins
(en termes de disponibilité, de temps ou de coût),
qualification du personnel sanitaire, moyens techniques
disponibles, continuité des services, accueil des consultants, temps
d'attente, etc. (Tollegbé A., 2004).
Le niveau élevé de mortalité maternelle
observé dans les pays en développement en général
et africains en particulier, se justifie aussi par le fait que certains
facteurs relatifs à l'offre cidessus mentionnés, notamment
l'accessibilité à des soins obstétricaux d'urgence, la
qualification du personnel sanitaire et les moyens techniques disponibles,
déterminent directement le risque qu'une mère
décède pendant l'accouchement ou quelques jours après, en
cas de complications (RWENGE Mburano, 2007).
Les indicateurs démographiques et de santé au
Tchad restent extrêmement médiocres, reflétant le haut
niveau de pauvreté de la population. L'espérance de vie à
la naissance, de 50 ans (47 ans pour les hommes et de 54,5 ans pour les femmes
; EIMT, EDST, UNICEF et PNUD, 2004) est inférieure à la moyenne
des pays en développement.
.
Le Common Country Assessment (CCA, 2004) a identifié
cinq principales manifestations de la pauvreté humaine au Tchad
liées à des facteurs de risques ci-après: la faim et la
malnutrition résultent essentiellement du déficit et de
l'insécurité alimentaire ; la forte mortalité maternelle
et infantile est la conséquence de l'accès limité des
femmes aux services de santé de la reproduction ainsi que de
l'exposition des enfants à des maladies infectieuses et parasitaires ;
la forte incidence du VIH/sida et du paludisme est essentiellement due à
la non utilisation des moyens de prévention et de protection ;
l'accès limité à l'eau potable et aux services
d'assainissement est la résultante de l'insuffisance et du
dysfonctionnement des points d'eau modernes, des latrines et des
systèmes d'évacuation ; la forte déscolarisation au
primaire est causée par l'inaccessibilité économique
(surcoût) ou culturelle (perception) de l'école.
Les conditions de vie et d'hygiène très
défavorable constituent les principaux facteurs de la morbidité
et de la mortalité au sein de la population.
Bien que les mêmes données de l'EDST aient aussi
révélé qu'il y a une proportion importante des femmes
tchadiennes qui ne recourent pas aux soins modernes pendant la grossesse et
l'accouchement. Il a été observé que parmi les
dernières naissances survenues au cours de cinq dernières
années, moins de la moitié (43%) ont
bénéficié de consultations prénatales auprès
de professionnels de la santé (médecins, infirmières,
sages-femmes et accoucheuses traditionnelles formées).Ces consultations
ont été, dans leur grande majorité, effectuées
par
des sages-femmes (27%), dans une moindre proportion par des
infirmières (9%) et dans très peu de cas, elles ont
été dispensées par des médecins (3%) et des
matrones ou accoucheuses traditionnelles formées (4%). Cependant, pour
plus d'une naissance sur deux (56%), les mères n'ont consulté
personne au cours de leur grossesse. Il n'y a pas eu de recherches explicatives
sur les recours aux soins modernes pendant la grossesse et l'accouchement aussi
bien en sciences sociales (démographie, sociologie, anthropologie, etc.)
qu'en épidémiologie ou en santé publique.
La question de recherche ici est celle de savoir dans
quelle mesure la pauvreté constitue un obstacle à l'accès
aux soins obstétricaux au Tchad ?
L'objectif principal de cette recherche est d'établir
la relation qui existe entre la pauvreté et l'accès aux soins
obstétricaux afin de mettre à la disposition de tous les
intervenants en matière de santé de la reproduction des
informations pertinentes pour améliorer l'accès aux soins
obstétricaux au Tchad.
De façon spécifique, il s'agira de :
· Mesurer le niveau d'accès aux soins
obstétricaux au Tchad ;
· Mesurer le niveau de pauvreté au Tchad ;
· Mesurer l'impact de la pauvreté sur l'accès
aux soins obstétricaux au Tchad.
Cette étude présente les intérêts
aussi bien scientifique, politique, économique et social. En effet,
l'identification et la compréhension des facteurs qui sous-tendent le
recours aux soins obstétricaux peuvent permettre d'améliorer les
connaissances sur les déterminants de recours médical pendant la
grossesse et lors de l'accouchement en vue d'élaborer un cadre d'analyse
adapté à la situation observée dans les pays en
développement en intégrant les éléments
contextuels.
Sur le plan politique, la connaissance des
déterminants de la fréquentation des services de santé
moderne permet de donner une orientation appropriée, suivie et
rigoureuse à la politique de population en promouvant le bien-être
social de la population en général, et celui des femmes et des
enfants en particulier. Pour atteindre cet objectif, les politiques de
population doivent intégrer l'aspect social et communautaire afin
d'être acceptables et acceptées par les populations pour avoir un
maximum de chance de succès, ASSEMAL Alfred (2003).
A travers cette étude, nous espérons apporter une
contribution à la promotion de la
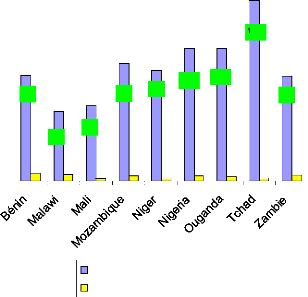
870
500
1100
1100
880
980
580
56
630
24
44
38
60
42
16
47
920
16
Ratio de MM(pour 100 000) Accouchements assistés (%)
« Maternité à moindre risque » en
mettant à la disposition de tous les intervenants en matière de
santé de la reproduction, un ensemble d'informations pouvant leur
permettre de mieux orienter leurs politiques et programmes de santé en
général et en particulier ceux ayant pour but de favoriser
l'accès aux services de santé modernes en général
et les services de soins obstétricaux en particulier.
Ce travail comprend essentiellement cinq chapitres :
Le premier chapitre traite l'accès aux services de
santé modernes et aux soins obstétricaux dans les pays en
développement. Le deuxième chapitre est consacré au
contexte tchadien. Le troisième traite le cadre théorique et
à la méthodologie de cette étude qui sera faite sur la
présentation des données de base de cette recherche et la
procédure de construction des principaux indicateurs d'analyse. Le
quatrième chapitre est consacré à l'analyse descriptive de
l'influence de la pauvreté sur l'accès aux soins
obstétricaux au Tchad. Enfin, le cinquième chapitre examine
l'impact de la pauvreté sur l'accès aux soins obstétricaux
au Tchad.
Graphique 1 : Ratios de mortalité
maternelle et taux d'accouchements assistés dans quelques pays de
l'Afrique subsaharienne (Source : UNFPA 2000- 2005)
| 


