IV.3. Les territoires de transhumance
saisonnière
La transhumance saisonnière se déroule sur des
zones bien éloignées et donc en discontinuité
géographique par rapport au territoire d'attache.
IV.3.1. Territoires complémentaires pour la petite
transhumance de
saison sèche chaude
La petite transhumance peut être
considérée comme le déplacement de courte amplitude ou de
courte durée des éleveurs mbororo avec leurs animaux (Figure
13).
Relations sociales
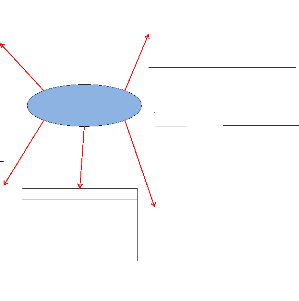
- Accès libre
- Les bergers font pâturer les
TERRITOIRE
COMPLEMENTAIRE POUR LA PETITE TRANSHUMANCE
Fonctionnement
- Manque de coordination collective pour le départ en
transhumance entre les éleveurs - Conflits avec les maraîchers le
long des berges
- Conflits avec les agriculteurs pour les dégâts sur
les cultures lors du retour au territoire d'attache
- Déplacement de courte amplitude (20 km à
partir du territoire d'attache)
- Séjour de courte durée (2 à 3 mois)
- Utilisation des berges de cours d'eau (mars - mai et juillet
- septembre)
- Utilisation des petits hurum (mars - fin juin) -
Départ en transhumance en rang dispersé à intervalle de
deux à trois semaines selon les cas
- Pâturage peu fourni et de qualité médiocre
- Les éleveurs ayant beaucoup d'animaux laissent une partie dans le
territoire d'attache
- Utilisation des parcours naturels et notamment des fourrages
arborés
- Réception des compléments alimentaires comme le
tourteau de coton et le sel - Fin de la transhumance avec la
généralisation des pluies (fin juillet)
Pratiques pastorales
Statut du territoire
|
- Bassins de transhumance non
juridiquement classés comme espaces pastoraux
- Statut pastoral précaire
- Non appropriés par des acteurs
- Exploités par les agriculteurs des villages voisins
(berges pour le maraîchage, la riziculture)
- Exploités par les éleveurs de manière
saisonnière
- Vaine pâture
|
Pratiques agricoles
|
- Cultures maraîchères le long des berges - Mise en
place des culture vers la fin de cette transhumance (début avril)
- Dégâts minimes sur les cultures
- Retour des animaux dans le territoire d'attache pour la fumure
des parcelles
|
animaux en traversant les villages
- Le retour se fait par route à
cause des cultures qui
commencent à être mise en place
136
Figure 13. Fonctionnement des territoires
complémentaires pour la petite transhumance La petite
transhumance concerne d'abord les petits troupeaux et se pratique à
moins de 20 km du territoire d'attache. Deux territoires sont concernés
par cette transhumance pendant des périodes bien distinctes : la berge
de la Bénoué (mars - mai et juillet - septembre) et le hurum
de Gouna (mars - fin juin). Les départs en transhumance pendant
cette période se font en rang dispersé selon les types
d'exploitations à un intervalle de deux à trois semaines. C'est
chaque berger qui décide à quel moment partir, quel site choisir
et quel itinéraire suivre. En effet, les petits éleveurs partent
en transhumance plus tard que les autres. Le nombre réduit de leurs
animaux leur permet de rester quelques jours de plus sur le territoire
d'attache afin de pâturer les petits espaces dans ce territoire et dans
celui des villages voisins. Les éleveurs traversent des villages en
faisant pâturer leurs animaux en chemin avant d'arriver dans les
territoires complémentaires. Par contre, le retour se fait par la route
car les mises en place des cultures commencent à se
généraliser.
Le début du mois de mars, en pleine saison sèche
chaude (ceedu), est un moment très difficile pour
l'alimentation des animaux car le pâturage est peu fourni et de
qualité
137
médiocre. Le manque d'eau et la rareté des
résidus de culture aggravés par le début de la
préparation des champs pour la prochaine campagne agricole avec le
brûlis des restes des pailles de culture sont les principaux facteurs qui
déterminent les déplacements. Ainsi, après
l'épuisement des résidus des cultures pluviales, le cheptel
transhumant (horedji) effectue pendant la saison sèche chaude
(ceedu : février-mars-avril), de petites transhumances dans les
bassins de production céréalière de contre saison (sorgho
muskuwaari cultivé sur les argiles gonflantes et riz en
périmètres irrigués) ou dans les zones inondables pourvues
d'importantes superficies de pâturage naturel situées sur un rayon
de 50 à 75 km. Il peut être accompagné de certains animaux
du cheptel de case (souredji) si les territoires d'attache et de
proximité sont dépourvus de zones inondables accessibles au
bétail. En fin de saison sèche chaude (avril), certains
éleveurs non satisfaits si la saison a été rude pour le
bétail, descendent au sud pour bénéficier des pluies
précoces pendant 1 mois. Dans tous les cas, le bétail doit
retourner sur le territoire d'attache (mai, juin, juillet) pour finaliser la
fertilisation des parcelles à cultiver.
Les éleveurs qui ont beaucoup d'animaux en laissent une
partie dans le territoire d'attache surtout pour la fumure des parcelles, mais
aussi pour des besoins de production d'un peu de lait pour la famille et de
complémentation ou de soin aux animaux mal en point. Ces derniers
s'alimentent à partir des parcours naturels, principalement les
fourrages arborés lorsqu'ils ne sont pas détruits par les feux.
Ils reçoivent également des compléments alimentaires comme
le tourteau de coton et le sel.
Ces bassins de transhumance ne sont pas juridiquement
classés comme espaces pastoraux car cultivés ou inondés en
saison des pluies. Leur rôle fondamental pour l'élevage est
incontournable. Leur statut pastoral reste précaire du fait de la
concurrence à venir entre les éleveurs qui en font un usage
pastoral incontournable en saison sèche et les agriculteurs qui
pourraient être amenés à les défricher pour
implanter des cultures de contre saison (maraîchage, riziculture, etc.).
Leur gestion durable ne peut émaner que d'une concertation entre les
autorités traditionnelles en
charge, les services administratifs concernés et les
fédérations d'éleveurs et d'agriculteurs.
La fin de la transhumance dans cette zone s'achève avec
la généralisation des pluies, fin juillet. Elle peut
également être précipitée par les
dégâts dans les champs à proximité, obligeant les
éleveurs à s'enfuir plus tôt que prévu. Au retour,
toutes les pistes sont fermées par les champs. Les animaux ne peuvent
passer qu'en bordure de la route.
IV.3.2. Territoires délimités pour la
grande transhumance en saison des
pluies
La mise en culture des parcelles et l'exigüité des
parcours sur les territoires d'attache et ses environs amènent les
détenteurs de grands effectifs de bétail (80 têtes et plus)
à effectuer une grande transhumance vers des sites
éloignés (75 à 100 km) reconnus ou délimités
par l'administration ou l'autorité traditionnelle (Figure 14).
Relations sociales
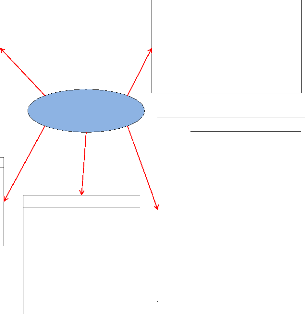
- Accès libre à ces territoires
- Les bergers pâturent les animaux dans la zone
délimitée
- Les autorités traditionnelles contrôlent
l'accès à ces territoires - Paie d'une taxe d'accès par
les éleveurs
- Influence des hommes d'affaires et citadins pour l'accès
à ces territoires
- Tragédie des communs
TERRITOIRE DELIMITE POUR LA GRANDE
TRANSHUMANCE
Fonctionnement
- Manque de coordination collective pour le départ en
transhumance entre les éleveurs - Conflits à l'intérieur
de ces zones à causes des cultures des éleveurs et des
agriculteurs - Échanges entre les éleveurs et les agriculteurs
des villages voisins (lait, céréales) - Vente de lait sur les
marchés voisins - Utilisation du téléphone portable pour
les échanges avec les éleveurs des territoires d'attache et avec
les citadins
- Déplacement de longue amplitude (75 à 100 km
à partir du territoire d'attache) - Séjour de courte durée
(1 à 2 mois) - Utilisation des parcours naturels
- Faible complémentation des animaux - Départ en
transhumance en rang dispersé à intervalle très
rapprochées (2 à 3 jours selon les cas)
- Pâturage fourni et de qualité bonne - Les
éleveurs ayant beaucoup d'animaux laissent une partie dans le territoire
d'attache pour le lait et le labour
- Fin de la transhumance avec le début des
récoltes (fin septembre)
- Utilisation de bergers non peuls par certains
éleveurs
- Risques de prises d'otages contre de fortes
rançons
Pratiques pastorales
Statut du territoire - Zones de
transhumance juridiquement classés comme espaces pastoraux
- Statut pastoral plus ou moins stable selon la
personnalité de l'autorité traditionnelle compétente
- Appropriés par des acteurs (éleveurs et
agriculteurs des villages voisins)
- Exploités par les éleveurs de manière
saisonnière pendant l'hivernage
- Vaine pâture
Pratiques agricoles - Une violation
permanente des agriculteurs pour la culture du maïs et du sorgho pluvial -
Pratique de l'agriculture de case par les éleveurs
- Dégâts minimes sur les cultures
- Utilisation de la fumure organique
- Utilisation importante de la main-d'oeuvre par les
éleveurs pour les activités agricoles
138
Figure 14. Caractérisation des territoires
délimités pour la grande transhumance
139
Il s'agit plus généralement de la transhumance
du cheptel horedji vers ces sites de grands parcours de plaines ou de
collines difficilement cultivables. À la fin de l'hivernage, les animaux
retournent sur le territoire d'attache, pour valoriser les résidus de
cultures pluviales et fertiliser les parcelles des éleveurs.
L'accès aux pâturages éloignés pour la grande
transhumance d'hivernage passe à l'aller comme au retour par la route.
Les pistes de transhumance délimitées traversent les villages et
sont obstruées par les cultures.
Sur ces sites, les agriculteurs migrants cultivent de plus en
plus et pourraient prochainement ne plus respecter les limites de ces grands
parcours indispensables au pastoralisme. De même, certains
éleveurs commencent à y délocaliser une partie de leur
troupeau et pourraient à moyen terme s'y sédentariser et y
développer l'agriculture de la même manière que sur leurs
territoires d'attache originels.
La grande transhumance (ruumirde) (juillet - octobre)
intéresse de plus grands effectifs et des parcours de grande surface
partagés avec un grand nombre d'éleveurs dans le hurum
de Kalgué à l'ouest et la région de Dembo au nord peu
peuplée du fait du relief. Les gros éleveurs vont en transhumance
plus tôt (dès la mi-juillet) et vont plus loin à cause du
nombre assez élevé des animaux dont ils ont la garde. Les
éleveurs n'ayant pas assez d'animaux peuvent rester sur place ou juste
à côté du territoire d'attache, se contentant des espaces
de pâturage dans le territoire et autour des territoires voisins.
Pendant ce temps, les gros éleveurs convoient leurs
animaux en rangs dispersés et en petits groupes vers les espaces de
pâturage. Cette division du troupeau est choisie afin d'éviter les
dégâts des cultures en se frayant un chemin et pour valoriser au
mieux les pâturages et pour dissimuler leur capital aux yeux des preneurs
d'otage qui les rançonnent et des autorités traditionnelles qui
les taxent.
Dans certaines zones de grande transhumance, les
éleveurs très réguliers ou socialement bien
intégrés, délocalisent une partie du troupeau pour
atténuer divers risques et contraintes liés aux longs
déplacements annuels. Le bétail est confié à un
berger, généralement un membre de la famille, qui s'installe de
façon quasi-permanente sur le site, et ne ramène plus le troupeau
sur le territoire d'attache originel.
140
Des échanges d'animaux se font
régulièrement entre les troupeaux délocalisés qui
accueillent les veaux sevrés, et les troupeaux de case qui
s'enrichissent de vaches laitières accompagnées de leurs veaux.
Si le site se révèle intéressant, les bergers
ressortissants d'un même clan ou d'une même grande famille
agrandissent le noyau familial (mariage, rapatriement de femmes et d'enfants)
et parviennent à terme, à développer un nouveau territoire
d'attache sur lequel ils pratiquent également l'agriculture.
Bien plus qu'une simple stratégie d'élevage, la
délocalisation du troupeau participe d'une stratégie d'essaimage
des familles d'éleveurs et de sécurisation et fructification de
leur patrimoine animalier. Certes, intéressante à court terme
pour les familles d'éleveurs, cette délocalisation ne peut
être durable pour l'élevage que si elle échappe au
modèle préexistant de gestion des ressources naturelles sur les
territoires d'attache anciens. Tout développement agricole sur ces zones
d'accueil, doit être encadré et planifié de façon
à préserver ses fonctions pastorales.
Sur les territoires d'attache et de proximité, les
éleveurs accèdent gratuitement aux espaces et aux ressources, en
s'efforçant de respecter et de faire respecter les règles
traditionnelles. Par contre, sur les territoires de transhumance, ils sont
étrangers et doivent payer une redevance forfaitaire. Un montant de 20
000 à 40 000 FCFA par troupeau est payé au sarkin saanou
(ministre traditionnel de l'élevage). Cette redevance devient
symbolique lorsque le transhumant s'intègre socialement dans le terroir
et peut ultérieurement y délocaliser une partie de son troupeau
ou s'y sédentariser.
| 


