III.7.1. Le territoire, espace dont un groupe tire ses
moyens d'existence
Le territoire pastoral est considéré par Bernus
(1982) comme une « aire de nomadisation ». Une telle
définition selon l'auteur, n'empêche pas que d'un groupe à
l'autre, la notion de territoire varie. Elle semble plus floue chez les
certains éleveurs comme les peuls Wodaabe qui ne possèdent pas
d'espace collectif continu, mais des enclaves dispersées. Ils peuvent
ainsi abandonner leurs parcours en cas de difficultés (administratives,
climatiques..), quitte à revenir après la crise. Les Touaregs
semblent plus accrochés à leur territoire pour des raisons qui se
conjuguent : ils ont tissé des liens plus anciens avec leur
région, ils sont imbriqués dans une société plus
hiérarchisée, faisant partie d'un ensemble plus solidaire. Ils ne
quittent leurs parcours habituels que poussés par la
nécessité.
Notre expérience et nos observations dans le Nord du
Cameroun nous amène à considérer que le territoire de
mobilité pastorale un espace utilisé par les éleveurs pour
satisfaire les besoin alimentaires des animaux. C'est un espace
économique, mais aussi un espace écologique et un espace
vécu. Cela montre que le territoire de mobilité pastorale doit
aujourd'hui être abordé de manière globale, tant la
recherche permanente de consensus est nécessaire à toutes les
étapes de sa délimitation, de son accès, de sa gestion, de
son aménagement et de son utilisation. Ainsi, les outils mis en oeuvre
à l'heure actuelle pour l'appréhender doivent intégrer sa
diversification et sa complexification en coordonnant notamment les dimensions
sociales, politiques, économiques et environnementales, en
considérant tous les usages, sur la base d'une participation de plus en
plus active de tous les acteurs concernés de près ou de loin.
111
C'est pour cela qu'il faut prendre en compte les visions, les
imaginaires, les perceptions de tous ces acteurs.
Au-delà du territoire où un groupe satisfait ses
principaux besoins matériels, on pourrait parler du territoire
symbolique, qui unit une communauté dont chaque élément
possède la clef. C'est en somme un territoire géo-culturel
(Bonnemaison : 1982) dont tous les hommes se font une même
représentation. C'est l'espace auquel le voyageur aspire, cela peut
devenir le territoire rêvé qu'on a perdu ; c'est en somme le lieu
où s'incarne la conception collective d'un groupe vis-à-vis du
temps et de l'espace. Cette notion, ainsi définie peut se
matérialiser à différentes échelles (Bernus,
1974).
Cependant, la notion de territoire varie d'une
société à l'autre et même au sein d'une même
société. Chez les Touaregs, Bernus (1974) a montré que les
Imghad (vassaux, tributaires) dressent la carte de leur territoire en dessinant
les vallées et portent les puits où vivent et abreuvent leurs
principaux campements en saison sèche. Le territoire
représenté correspond à leur espace exploité. La
même question posée aux Imajeghen, ancien détenteurs du
pouvoir, reçoit une réponse différente. Ils incorporent
dans leur territoire, l'ensemble des parcours de toutes les tribus dont ils ont
le commandement traditionnel. Cela étend le territoire très loin
autour du campement de l'amanokal, lieu géométrique de
l'ensemble, lui fait de petits mouvements autour de chin Tabaraden. Il
y a ici correspondance entre territoire traditionnel et administratif. Pour les
imajeghen, tous leurs dépendants exploitent un espace collectif dont ils
Sont les seuls répondants. Le même terme, akal,
désigne le territoire des Imajeghen et celui des Imghad. Le premier est
un territoire politique revendiqué, et d'autant plus affirmé
aujourd'hui qu'il représente les pouvoirs d'une chefferie
déclinante. Le second représente un espace exploité
réellement, et manifeste l'indépendance économique d'un
groupe sur ses parcours. Le territoire de la tribu peut aussi se définir
selon la connaissance précise qu'en ont ses utilisateurs. Une
enquête menée par Bernus (1974) a montré que ce savoir,
infiniment précis sur l'espace exploité, est plus flou
au-delà : chaque puits, chaque vallon, chaque site préhistorique,
était connu, situé et décrit avec rigueur dans les
parcours habituels ; au-delà de certaines limites les réponses
étaient plus vagues, et la carte moins remplie. La toponymie
évoquait les événements les plus intimes du
112
groupe dans le territoire qu'il occupe et parcourt chaque
année ; au-delà, la toponymie connue ne désignait plus que
les puits et les sites majeurs.
Le territoire vécu, chez certaines populations
insulaires du Pacifique, correspond à deux besoins essentiels,
l'identité et la sécurité (Bonnemaison 1980). Cet espace
où les habitants sont enracinés, avec une adéquation quasi
parfaite entre les hommes et leur territoire, ne correspond pas à la
vision des nomades. Leur territoire, s'il s'incarne dans une région
donnée, est cependant plus mobile. La précarité des
ressources, la variabilité des pluies, la fréquence des crises,
provoquent des glissements et des déplacements. Le territoire peut se
recréer, sur un autre espace, avec de nouvelles références
et de nouvelles valeurs.
Le territoire est pour le nomade un espace maitrisé,
dont il connait toutes les ressources ; il est jalonné de repères
précis, sites préhistoriques, tombes anciennes, lieux de
batailles célèbres, puits et mares. Ce territoire où il
déplace sa tente et son campement incarne un univers mobile et libre. Le
territoire n'est jamais figé et peut à tout moment être
déplacé et reconstruit : il représente la
possibilité d'une liberté de réajustements toujours
possibles sous la pression d'événements inconnus (Bonnemaison,
1981).
Le territoire est considéré par les Touaregs
comme le résultat d'un travail qui seul permet de rendre viable la
nature à l'état brut (Claudot-Hawad, 1986 et 2008). La terre en
effet ne protège que si elle est parcourue, domestiquée,
modelée par les itinéraires nomades qui régulent les
relations entre les êtres humains et le désert ou, dit autrement,
entre la culture et la nature. Cette image renvoie à l'usage
économique raisonné du sol, géré et ordonné
de manière à rendre optimales l'exploitation et la reproduction
des ressources. Elle correspond également à des usages sociaux et
symboliques du territoire auquel s'identifient les individus et les groupes.
Concrètement, toute unité sociale, de la plus petite (le
campement) à la plus grande (la société tout
entière), est associée à un territoire-parcours extensible
selon les saisons, croisant d'autres parcours qui dessinent les trames
complexes du vaste maillage territorial et politique touareg. Chaque groupe
exerce des droits d'usage prioritaires bien que non exclusifs sur son parcours.
Ces prérogatives se déterminent donc par
rapport aux mouvements dans l'espace définis par des
étapes coutumières, liés à des droits territoriaux
définis, mais aux contours flexibles et négociables suivant les
conditions climatiques ou politiques (Claudot-Hawad, 2012).
La figure 10 présente la définition, les
caractéristiques et les enjeux de pouvoir et les réalités
autour des territoires de mobilité.
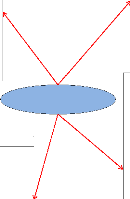
TERRITOIRES DE MOBILITE PASTORALE
Définition et
présentation
|
- Espace approprié ou non, utilisé par les
éleveurs pour la satisfaction des besoins de leurs animaux
- Espace économique, écologique, vécu
- Espace à appréhender de manière globale
(consensus permanent pour sa délimitation, son accès, sa gestion,
son aménagement et son utilisation)
- Coordination des dimensions sociales,
politiques, économiques et
environnementales
- Considération de tous les usages et de la
participation de tous les acteurs (intérêts, visions,
perception)
|
Champ d'application du pouvoir traditionnel
- Domination du rôle du chef traditionnel pour le
contrôle, la gestion, l'exercice d'une autorité, une
compétence
- Zone d'influence des lamidats qui en connaissent
l'étendue, les limites, les utilisateurs
- Défense de la zone d'influence et d'autorité
au-delà des limites administratives et communales - Opposition du
territoire de l'Etat à la pratique féodale d'un pouvoir
hiérarchisé
- Influence des chefs traditionnels sur les choix des
politiques de gestion et d'organisation
- Perception des redevances à chaque installation,
passage
Caractéristiques
- Espace avec des ressources (terres, fourrages, eau...)
- Une localisation (local, proche, lointain) - Une dimension
(restreint, large)
- Une forme (étalée, compacte,
éclatée)
- Des propriétés (fourni, dégradé,
appété, non appété)
- Des aptitudes (disponible, libre d'accès, conflits
limités)
- Des contraintes (menacé, inaccessible, insuffisant,
conflictogène)
Une réalité sociale et
culturelle
|
- Mobilisation des moyens pour le contrôle des territoires
de mobilité (taxes traditionnelles, dons, consensus, réseaux
d'influence...)
- Sentiment d'appartenance et une appropriation
nécessaires à l'épanouissement des fonctions sociales
(rencontres, fêtes, mariages, baptêmes, palabres, renseignements,
nouvelles...)
- Relations avec d'autres communautés et rupture de
l'isolement social (alliances, contrats, échanges,
complémentarités)
- Construction d'une démarche identitaire et
communautariste par la fréquentation des mêmes territoires
- Des relations particulières nouées avec les lieux
de passage, de repos, d'escale, d'abreuvement, d'émondage des arbres
- Une connivence identitaire avec le territoire
fréquenté et les acteurs rencontrés
- Une construction sociale observée à travers les
initiatives de régulation à l'amiable des conflits
|
113
Figure 10. Définition,
caractéristiques, enjeux et réalités autour des
territoires de mobilité Le territoire de mobilité
est une notion concrète qui renvoie à un espace de terre avec des
ressources (terres, fourrages, eau). Le territoire de mobilité a une
localisation (local, proche, lointain), une dimension (restreint, grand), une
forme (étalé, compact, éclaté), des
caractéristiques physiques (fourni, dégradé), des
propriétés (appété, non appété), des
contraintes (menacé, inaccessible, insuffisant, conflictogène) et
des aptitudes (disponible, libre d'accès).
Le territoire de mobilité pastorale peut être
considéré comme la portion de la surface terrestre,
appropriée ou non par les éleveurs pour assurer la reproduction
et la satisfaction des besoins vitaux de leurs animaux (nutrition, abreuvement,
mouvement).
114
Ici l'attention doit être plus accordée à
la manière dont les éleveurs vivent le milieu où ils se
déplacent avec leurs animaux, la façon dont ils se l'approprie au
cours des différentes saisons, le sentiment qu'ils ont ou non de
l'utiliser et de le consommer à leur convenance, de se sentir parmi les
leurs dans leur mouvement, de s'intégrer et de se battre pour se
maintenir sur ce territoire. Les ressources en jeu sont essentiellement les
pâturages, les points d'eau naturels ou aménagés (sources,
mares, puisards, guelta, puits), le gibier, les produits de cueillette
et le bois (Claudot-Hawad, 2012). L'espace nomade est tendu, comme le
précise Retaillé (1989), entre des lieux éloignés
séparés par de vastes vides ; chaque lieu appartient à un
temps organisé, le territoire trouvant son lien dans le calendrier et
non dans la frontière ; en chaque lieu la diversité humaine,
sociale, économique se trouve concentrée, reproduisant presque la
totalité de l'environnement. Dans le lieu, enfin, ne varie que l'ordre
des composants, mais ils sont tous là, contrairement au lieu d'un espace
sédentaire rural qui est marqué par l'exclusivité.
L'espace nomade ressemble, de ce point de vue, à l'espace urbain.
Le territoire de mobilité est plus un espace
socialement construit qu'une terre appropriée par les acteurs majeurs
qui sont ceux qui l'exploitent directement (éleveurs,
agro-éleveurs notamment). Même si ce territoire est une
entité juridique et administrative reconnue, sa gestion échappe
au contrôle de l'entité officielle parce que le pouvoir
traditionnel dans le Nord-Cameroun y trouve un champ d'application de son
pouvoir.
III.7.2. Le territoire de mobilité pastorale,
un champ d'application du
pouvoir traditionnel
Le territoire de mobilité pastorale est dominé
par le rôle des chefferies traditionnelles qui contrôlent,
gèrent et exercent une autorité, une compétence. Ainsi,
les zones de pâturage rentrent dans les zones d'influence des lamidats
qui en connaissent l'étendu, les limites, les utilisateurs. Chaque
lamidat défend étroitement sa zone d'influence et essai de
maintenir son autorité sur ces espaces au-delà des limites
administratives et communales. Les lamibe font prévaloir
l'absolu du pouvoir, sans concurrence et exerce un monopole total sur les
espaces de pâturage : Ils sont alors souverain. L'idée de
territoire de mobilité pastorale se trouve ainsi liée à
celle de contrôle, et le justifie. Au
115
territoire de l'État tel qu'il résulte de la
théorie politique moderne s'oppose dans ce cas ceux qui
reflétaient d'autres structures du pouvoir : la pratique féodale
d'un pouvoir hiérarchisé et dont chaque échelon ne dispose
que d'attributs limités aboutit à une structuration d'espaces qui
s'emboîtent ou qui se chevauchent comme le note Gottmann (1973). Les
territoires de mobilités pastorales discontinus conquis lors des djihads
au début du XIXème siècle sont ainsi
contrôlés de manière féodale par les lamidats.
En tant que dépositaires et gestionnaires du foncier
rural, les autorités traditionnelles influencent les choix des
politiques de gestion et d'organisation des parcours (zones de pâturages,
pistes à bétail) délimités ou non. C'est pour cette
raison qu'il existe une ambigüité dans le comportement des
autorités traditionnelles. Malgré leur accord de principe pour le
bornage des zones de pâturage, les agriculteurs qui cultivent dans
l'espace délimité affirment que ce sont les lamibe qui
leur donnent l'autorisation de continuer à y cultiver. Ce qui remet en
cause évidemment les clauses de la convention signée et place les
éleveurs dans une position de faiblesse. Cette situation est entretenue
expressément par les autorités traditionnelles pour continuer
à bénéficier des « taxes d'arbitrage » que leur
versent les éleveurs chaque année afin de maintenir la zone non
cultivée. Dans un tel contexte, le rôle de l'État devient
alors indispensable afin d'imposer le respect des droits de
propriété ou d'usufruit permanent.
Au Nord-Cameroun, il existe dans les faits une
prééminence du droit traditionnel sur la législation
foncière de l'État. C'est pour cela que les territoires de
mobilités pastorales où les éleveurs vont en transhumance
sont coutumièrement gérés par les chefferies et les
sarkin saanou y sont omniprésents. Ce sont ces derniers qui
accueillent les éleveurs et connaissent leur emplacement au cours de la
saison. Les éleveurs leur remettent pour le laamii'do une
redevance à chaque installation. Selon l'ancienneté des
éleveurs dans les zones de transhumance, les redevances diminuent
jusqu'à devenir symboliques dans bien des cas. Lorsqu'ils ne font que
passer sur le territoire, les éleveurs ne paient rien pour le
pâturage. Et ce, d'autant plus que les éleveurs empruntent de plus
en plus les routes nationales pour atteindre les zones de transhumance. Par
contre, pour l'installation sur le site de transhumance ils s'acquittent d'une
redevance auprès des autorités du lieu, le plus souvent
négociée,
116
même s'il existe un taux officiel35. Les
éleveurs négocient des taux forfaitaires à 20 000 Fcfa par
troupeau. Soit une somme moindre que le taux officiel lorsque le troupeau
atteint 30 bovins.
III.7.3. Le territoire de mobilités pastorales
comme une réalité sociale et
culturelle
Les éleveurs tentent de mettre des moyens en place pour
contrôler les territoires de mobilité pour les animaux (taxes
traditionnelles, dons, consensus, influences). C'est comme si parlant de
mobilité pastorale, on parle des nomades, des Mbororo, des marcheurs
permanents. Les éleveurs ont le sentiment d'appartenance à ces
espaces de mobilité pastorale qui est une construction mentale, une
nécessité biologique pour eux-mêmes et pour leurs animaux.
L'appropriation d'une certaine étendue de territoire de mobilité
est ainsi nécessaire à l'épanouissement de certaines
fonctions sociales ; chaque lieu, selon les saisons, constitue une occasion de
socialisation, de rencontre et d'expression d'un évènement
précis (fêtes, mariages, baptême, soir au village...) et de
relations précises avec d'autres communautés voisines. Ce sera
l'occasion de demander les nouvelles de chacun, de se renseigner. À
travers la mobilité le groupe social n'est pas isolé. Il
entretient des échanges avec l'extérieure, avec les autres
à travers des alliances, des contrats, des échanges, des
complémentarités. Comme le relève Retaillé (1989),
l'affectation des individus à un territoire administratif
d'enregistrement ou à une identité ethnique transcendante n'a pas
beaucoup de sens en dehors de ces liens sociaux qui permettent la survie. Or,
ces liens ne sont pas territorialisés à l'intérieur d'une
surface délimitée portant à la fois une identité,
des richesses, des populations, des genres de vie. Rien n'est ainsi
découpé, tout est plus flou. Le lieu n'assigne pas une
identité qui réside dans autre chose, la tribu par exemple chez
les "nomades" ou la chefferie chez les "sédentaires". Mais alors
nomadisme ou sédentarité n'ont pas de sens puisque les pratiques
spatiales sont croisées et ne renvoient pas à une appartenance
spécifique.
35 200 à 500 Fcfa par tête de
bétail pour la taxe d'inspection sanitaire vétérinaire et
500 Fcfa par tête de bétail pour la taxe de transhumance.
117
Les éleveurs construisent leur démarche
identitaire et communautariste par la fréquentation des mêmes
territoires de mobilité. Ils assimilent leur appartenance à une
même communauté suivant les mêmes itinéraires et en
construisant une relation durable avec le territoire fréquenté.
Des relations particulières sont ainsi nouées avec les lieux de
passage, de repos, d'escale, d'abreuvement et même avec les arbres qu'ils
émondent au passage. Il existe une sorte de connivence identitaire avec
le territoire fréquenté et les autres acteurs rencontré
sur ce territoire, le long de ce parcours. Le territoire nomade comprend un
grand nombre de marqueurs, historiques (tifinagh, ruines
médiévales...), géographiques, mémoriels,
sacrés (tombes des martyrs et des saints, lieux de culte). Dans les
cartes établies par les nomades, le territoire s'organise autour des
points d'eau et des sentiers qui les relient (Bernus 1982 et 1988).
Le construit social à travers le territoire de
mobilité s'observe également par les initiatives de
régulation à l'amiable des conflits entre les éleveurs et
les agriculteurs. Les relations de confiance, de tolérance prennent
ainsi le pas sur les tensions perpétuelles.
|
|



