III.4. Les enjeux et l'importance de la mobilité
pastorale
La pression sur les territoires ruraux s'accentue à
cause d'un fort accroissement démographique qui engendre
l'avancée des terres agricoles au détriment des pâturages.
Différentes études de cas notent que les pâturages se
réduisent comme peau de chagrin au sud du Tchad (Magrin, 2001) ou encore
au nord Cameroun (Moritz et al., 2013 ; Seignobos et Thys, 1998 ;
Kossoumna Liba'a, 2008). Les politiques nationales semblent avoir du mal
à concevoir des schémas d'aménagement des espaces ruraux
qui ménagent un accès pour tous aux ressources. Pourtant, en
même temps que les pâturages diminuent, les cheptels bovins
augmentent (Gonin, 2014). Cependant, depuis la fin des années 90,
différents travaux introduisent un regard renouvelé sur
l'élevage mobile.
El Aich et Waterhouse (1999) montrent comment le
pâturage peut favoriser la biodiversité et maintenir ainsi des
biotopes particuliers. Bourbouze, Lhoste, Marty et Toutain (2002) soulignent
que la mobilité pastorale est aujourd'hui considérée comme
un outil de lutte contre la désertification, même si la
démonstration scientifique du rôle de la mobilité dans la
protection de l'environnement n'est pas aisée comme le montrent les
travaux de Genin (2004), Dood (1994).
97
Contrairement à l'image répandue, ce sont les
troupeaux les plus mobiles qui présentent les meilleurs
paramètres zootechniques (PSSP, 2009) ; ainsi, la mobilité
permettrait d'intensifier la productivité des troupeaux. De nombreuses
études ont démontré à contrario que les pratiques
de nombreux commerçants bétail dans la cadre de l'embouche
bovine, constituent des troupeaux « maigres » à la fin de la
saison sèche pour les engraisser à l'herbe des parcours
grâce à la transhumance effectuée par les bergers peuls
(Colin De Verdière, 1995). Le même auteur montre que les
phénomènes de croissance compensatoire jouant à plein, les
animaux conduits dans une vraie logique pastorale reviennent avec une
conformation supérieure et incomparable avec leur état de
départ. Il montre que la productivité des systèmes
d'élevage sédentaire serait globalement inférieure de 20%
à celle des troupeaux nomades. Ceci donne sens à l'objectif des
éleveurs mobiles qui est en effet de rechercher en permanence les
meilleures conditions possibles pour leur troupeau, en s'adaptant aux
contraintes du milieu en ce qui concerne l'eau et le pâturage. En effet,
la principale raison à l'origine de la mobilité est de maximiser
la productivité du cheptel. Lorsqu'ils se déplacent, les pasteurs
ne cherchent pas seulement à trouver de la nourriture pour leurs
bêtes, ils recherchent aussi les meilleurs pâturages et les
meilleures sources d'eau. Des nutriments de qualité dans les parcours
arides sont éphémères et, comme on peut s'y attendre,
clairsemés. Pour les exploiter de manière performante, les
pasteurs doivent se déplacer souvent et rapidement (Collectif, 2010). Le
même collectif montre que la mobilité est également
importante dans le domaine du commerce. En effet, le bétail a besoin
d'être acheté et vendu. Or, les meilleurs marchés où
les pasteurs tirent le meilleur prix de leurs bêtes sont souvent loin des
meilleures zones de production. Les échanges peuvent être locaux,
nationaux, voire internationaux, en fonction de la saison et de ce qui est
à vendre ou à acheter. Bien souvent, les échanges
impliquent de couvrir de longues distances et le déplacement des
bêtes en toute sécurité joue donc un rôle pivot.
La mobilité pastorale a également une
utilité écologique qui a été démontré
par des études comme celle de Maïdagi et Hierneux (2006). Les
conclusions de ce travail d'analyse des dynamiques de végétation
en relation avec les modes de pâturage font
98
ressortir que les effets du pâturage sont autant moins
marqués que les troupeaux sont appelés à se
déplacer et à développer la mobilité. Par contre,
d'après cette étude, la sédentarisation des troupeaux a
des effets conséquents en matière de dégradation des
écosystèmes. La notion de surpâturage s'applique plus
à une plus à une exploitation continue des ressources pastorales
car les animaux, même peu nombreux, exploitent de manière
sélective les espèces appétées (PSSP, 2009). Ainsi,
la réduction des aires de pâturages, des couloirs de transhumance
et des aires de repos jusque-là exploités par les pasteurs en
zone agro-pastorale et pastorale, en réduisant la mobilité des
troupeaux, augmente les risques environnementaux.
La mobilité pastorale est également un facteur
d'adaptation aux aléas climatiques. En effet, au vu des
réalités sociales, économiques et écologiques,
l'enjeu est de préserver et de renforcer la mobilité pastorale,
de manière à mieux valoriser durablement les ressources primaires
des espaces de mobilité dans les zones soudano-sahéliennes. Ces
espaces se caractérisent par des pénuries des ressources
pastorales liées aux sécheresses plus ou moins fortes et
fréquentes. Les observations faites par Beidou et al., (1990)
montrent que ce sont les troupeaux les plus mobiles qui réussissent
généralement le mieux à surmonter les épisodes
critiques comme la grande sécheresse de 1984. Lorsqu'apparaissent les
limites écologiques de la mise en valeur de terres nouvelles, la
conception nomade multiplie les formules d'adaptation en intégrant des
espaces marginaux qu'elle seule peut rapprocher (Retaillé, 1989).
En plus, la mobilité stratégique de
l'élevage permet l'intégration agriculture-élevage
à grande échelle spatiale et temporelle, et ce sur l'ensemble des
systèmes de production plutôt qu'au niveau de la seule
exploitation agricole. C'est à grande échelle que les
systèmes pastoraux optimisent leur performance et leur résilience
: des ressources clés telles que les nutriments et l'eau ne deviennent
disponibles que dans des concentrations éphémères et
imprévisibles, comme certaines herbacées des zones
septentrionales, qui ne sont exploitables que grâce à la
mobilité. Agriculture et élevage ont pu être
intégrés entre des groupes distincts et spécialisés
d'agriculteurs et d'éleveurs à même d'interagir à
l'échelle transrégionale (voire transnationale) grâce
à la mobilité pastorale. Cet ordre supérieur
d'organisation des deux systèmes de
99
production permet de renforcer la productivité, la
durabilité et la résilience des deux côtés : c'est
une conformation de systèmes qui repose sur la mobilité
pastorale. Là où elle est entravée, cette organisation
s'effondre (Krätli et al., 2013).
L'importance de la mobilité pastorale est
également observée à travers les proverbes et dictons que
le Projet PSSP (2009 : 19) a rassemblé : « Nous les Wodaabe,
nous disons que l'élevage ne nous laisse pas de repos, ne nous donne pas
d'apaisement. Un véritable berger ne peut jamais rester tranquillement
au même endroit. Un bon berger cherche ce qui est le meilleur pour ses
bêtes : la seule chose qui nous tracasse, c'est la santé de nos
bêtes, parce que leur santé signifie notre richesse »
(Angelo By Maliki, 1982) ; « L'animal est le meilleur topographe qui
soit. Les géomètres qui ont tracé les routes dans la
région de Zinder sont venus seulement justifier leurs honoraires, ils
n'ont fait que reprendre les routes pastorales qui existaient notamment le
couloir international de passage » (Issa Loutou, Leader Oudah) ;
« La poussière des pieds est meilleure que celle des fesses
» (Proverbe des pasteurs du Niger - Atelier Addis Abéba, 2008)
; « Si tu construis une maison à un éléphanteau,
tu auras à détruire la maison pour le faire sortir »
(El Jangouma).
L'actualité du nomadisme n'est pas donc
dépassée, au contraire. Le nomadisme historique semblait une
adaptation aux situations écologiques marginales, plaçant les
nomades presque en dehors du monde et de son développement. Mais en
observant les pratiques spatiales et sociales de ces nomades en voie de
disparition, nous rencontrons quelques problèmes contemporains comme les
nouvelles mobilités, les identités défaillantes etc. qui
pourraient être avantageusement traités selon ces métriques
trop ignorées du nomadisme (Retaillé, 1989).
III.5. Quels outils pour appréhender les
territoires ?
L'emboîtement des sous-systèmes acteurs et
espaces géographiques rend difficile l'interprétation et la
compréhension des territoires. C'est pour cela qu'il est indispensable
de proposer de manière précise des outils susceptibles d'aborder
la complexité qui sous-tend à la fois les organisations
spatiales, mais également les systèmes d'acteurs qui les font
évoluer. L'approche systémique est ainsi présentée,
comme un paradigme capable de guider l'approche et la compréhension des
systèmes
100
complexes et comme préalable à des
démarches de modélisation plus avancées (Moine, 2005). Ce
dernier, sans proposer de nouveaux outils, essaie de repositionner des
approches reconnues, les unes par rapport aux autres, dans un ensemble
susceptible de permettre une meilleure compréhension des territoires
(figure 9).
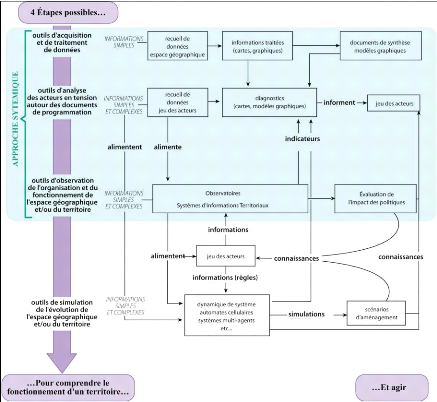
Source : Moine (2005)
Figure 9. Outils et méthodes d'analyse et de
compréhension de l'évolution d'un territoire Trois
sous-systèmes, liés entre eux, sont donc à aborder dans le
cadre d'un diagnostic que Moine (2005) qualifie de territorial :
- Le contexte naturel du territoire abordé, il peut
présenter des contraintes et des atouts qui auront une incidence sur
l'organisation de l'espace géographique, mais aussi sur les relations
entre les acteurs. Dans la région du Nord-Cameroun, il s'agit notamment
des contraintes liées à l'insuffisance des précipitations
entraînant la
101
dégradation des parcours, l'assèchement des
mares, l'insuffisance des résidus de récolte ; les atouts peuvent
être l'abondance des fourrages naturels dans certaines zones mieux
arrosées et la disponibilité des eaux dans les cours d'eau...
;
- L'organisation de l'espace géographique, au travers
de la répartition des objets, de l'interaction entre ces objets, des
forces et faiblesses de cette organisation. Ici, on pourra, comme le
suggère (Elissalde, 2002), analyser les discours souvent
contradictoires, tenus à différents moments sur un territoire
quelconque s'inscrivent dans une archéologie du savoir. L'importance du
temps long, de l'histoire en matière de construction symbolique des
territoires, retient l'attention (Di Méo, 1998). Très
représentatif de ce point de vue, Marié (1982) estime que «
l'espace a besoin de l'épaisseur du temps, de
répétitions silencieuses, de maturations lentes, du travail de
l'imaginaire social et de la norme pour exister comme territoire ».
Cela permet bien entendu de faire « l'état des lieux
», mais contribue tout à la fois à faire exister, et
à façonner une certaine image « géographique
» dudit territoire. Il peut également s'agir d'analyser
l'influence du contexte naturel et de l'évaluation de la mise en oeuvre
des politiques actées dans le cadre des différents documents de
programmation, d'orientation et de prescription ;
- L'organisation des acteurs du territoire
étudié ou diagnostic stratégique (CERTU, 2001), la
superposition de mailles de gestion, l'articulation des documents de
programmation, d'orientation et de prescription, et leur mise en place autour
d'acteurs clés, le décideur devant aujourd'hui intégrer la
notion de « maillagement » (Monnoyer-Longe, 1996).
L'objectif serait également de mettre à jour les logiques de
fonctionnement et d'interaction spatiale dans le cadre des arrangements
sociétés/territoire, y compris les relations
sociétés/environnement (Elissalde, 2002).
Cette approche suppose la mise en oeuvre combinée
d'outils permettant de comprendre le fonctionnement d'un territoire et le cas
échéant, de proposer des simulations de son évolution.
Ainsi, la complexité du territoire nécessite un agencement
d'outils capable d'intégrer et d'analyser les différentes
facettes du territoire. Plusieurs pistes s'offrent actuellement aux chercheurs,
qui reposent sur la combinaison d'outils (Systèmes
102
Multi-Agents, Systèmes d'Information
Géographique, Automates Cellulaires, Systèmes de Gestion de Bases
de Données, Systèmes Experts, Réseaux Neuronaux) en amont
desquels l'approche systémique est toujours requise (François,
1997). Trois orientations émergent :
- Les recherches portant sur la mise en place d'outils
d'observation, notamment les travaux du CERSOT portant sur la mise en place
d'observatoires territoriaux fondés sur la liaison entre Système
de Gestion de Base de Données et Système d'Information
Géographique (De Sède et Moine, 2001) ;
- Les recherches portant sur l'évaluation des
territoires notamment les travaux de Christiane Rolland-May, intégrant
les principes de l'approche systémique et de la logique floue
(Roland-May, 1996 et 2000) ;
- Les recherches portant sur la simulation d'évolutions
de territoires, en témoignent notamment les modèles
développés par le RIKS (Maastricht), couplant une base de
données spatialisées (SIG), un modèle global d'interaction
spatiale et un modèle d'automates cellulaires (Engelen et al.,
1997).
Ces trois types d'approches sont en effet
complémentaires si l'on souhaite disposer d'une vision globale du
fonctionnement d'un territoire (Moine, 2005). En effet, pour cet auteur, les
outils d'observation constituent le socle sur lequel on va pouvoir ancrer une
analyse des différents phénomènes en interrelation sur un
territoire donné, en fonction d'un projet porté par des acteurs.
Fondée en amont sur une réflexion très poussée des
besoins d'observation de la part des acteurs qui produisent, agissent et
guident le fonctionnement d'un territoire, cette première étape,
au travers de la pérennisation des informations qu'elle induit, est
incontournable. L'observation est finalisée par des diagnostics qui
peuvent être pluriels, en fonction des différents acteurs ou
groupes d'acteurs porteurs de projet(s). C'est grâce à cet outil
qu'il est ensuite possible d'évaluer un territoire au travers de la
trajectoire qu'il poursuit en introduisant des dispositifs d'analyse capable de
restituer les différents états occupés par le
système étudié. Ils permettent également
l'évaluation des politiques mises en oeuvre par les acteurs locaux, qui
influencent l'évolution des territoires. Enfin, dans un
103
troisième temps, des outils permettent de simuler le
devenir d'un territoire donné sur la base de règles issues des
observations précédentes.
En conclusion, « l'efficacité des
démarches participatives en aménagement, sera conditionnée
par un réel couplage entre décisions et instrumentation,
notamment instrumentation géomatique, l'espace demeurant au centre de
tous les enjeux » (De Sède, 2002), ceci dans la perspective
d'un système territoire qui intègre simultanément trois
dimensions : temporelle, spatiale, et organisationnelle, qui chacune se
divisent de la manière suivante (Roland-May, 2000) :
- Le temps est composé d'un avant, d'un après et
d'une durée : i) la prise en compte des évènements
passés explique l'état actuel du système et sa dynamique.
Ce passé constitue en quelque sorte le réservoir d'information
par rapport auquel les acteurs vont se référer afin de mener
à bien leurs politiques ; ii) la prise en compte de l'avenir en
projetant ce que les acteurs souhaitent que le territoire devienne, sur la base
de scénarios prospectifs guide les décisions. Cette
démarche est productrice de nouvelles informations ; iii) la prise en
compte de la durée des évènements est importante
puisqu'elle permet finalement d'en nuancer les influences ;
- L'espace est composé d'échelles
emboîtées qui peuvent se retrouver au sein : i) Du local et de
l'ensemble des superpositions spatiales et des acteurs qui s'y
matérialisent. Loin d'être isolés, ces différents
niveaux et acteurs sont très étroitement imbriqués et
liés, ils contribuent à définir les projets et donc
à peser sur le devenir du territoire ; ii) Du global, ou environnement
du système, qui symbolise les influences externes qui peuvent agir sur
la trajectoire du système. Celui-ci ne peut ignorer en effet un certain
nombre d'informations qui, aujourd'hui bien que dépendantes d'un
contexte global, affectent indubitablement le devenir du système local
;
- La dimension organisationnelle est composée de trois
sphères : i) celle des individus, « unité
spécifique au sein des sociétés (...) on ne peut imaginer
de société qui ait été totalement dépourvue
d'autonomie individuelle car c'est grâce à cette autonomie que la
répartition complexe de fonctions que suppose une
société,
104
peut exister » (Lévy, 1994) ; ii) Celle
de la politique ; iii) Celle des relations économiques, culturelles et
sociales.
L'enjeu est de comprendre comment se structurent les
territoires, selon l'acception globale que nous avons proposée ; comment
ils fonctionnent, comment ils évoluent. Nous sommes aujourd'hui
confrontés à des réalités quelquefois difficiles
à mettre en adéquation, avec d'un côté une
complexification croissante des contextes au sein desquels nous
évoluons, de l'autre une exigence de résultat fondée sur
les notions de cohérence et de développement durable qui forcent
à adopter une approche globale capable de saisir et de rendre compte de
cette complexité. En proposant une approche plus globale de la notion de
territoire, nous pensons que sa compréhension en sera
améliorée. Mais il faut faire attention à ne pas tenter de
réduire la complexité à tout prix, il faut lui laisser sa
liberté, c'est-à-dire la représenter en limitant les
mutilations.
| 


