III.2.4. Le territoire comme support d'identité et
aire culturelle
Les géographes se sont intéressés par
ailleurs à la place de l'identité dans la perception du
territoire. En effet, Bonnemaison et Cambrezy (1995) notent que dans les
sociétés dites traditionnelles, le territoire ne se
définit pas par un principe d'appropriation, mais par un principe
d'identification. Le territoire ne peut alors être perçu comme une
entité différente de la société qui l'habite ; le
groupe local appartient à sa « terre » tout autant que la
terre lui appartient. C'est effectivement ce qui fait dire à Le Berre
(1992) que « toute société a des rapports avec son
territoire : on peut appeler pratiques territoriales (de vie, de gestion,
d'aménagement) l'ensemble des actions que le groupe entreprend pour
assurer sa vie et son maintien sur son territoire. Elles ont pour
87
résultat de mettre en relation les lieux qui
constituent son territoire ». Ce ne sont donc plus
nécessairement les centres du territoire qui comptent mais les symboles
qui y sont inscrits et les lieux qui les enracinent. Ce principe
d'identification explique la particularité et l'intensité de la
relation à la terre ; le territoire ne peut être partagé,
vendu, ou même donné ; il est un être et non pas un avoir.
Perdre son territoire, c'est disparaître. Pour Berque (1970), la
mémoire s'investit dans des lieux, des portions de nature où sont
enracinés des potentiels. Dans la même lancée, Martin
(1994) poursuit que la relation tissée entre l'histoire et l'espace
fournit une base apparemment matérielle à l'identité :
elle lui procure un territoire. Pour lui, l'occupation, entraînant le
travail de la sensibilité sur l'enracinement physique, confère
aux 'pays', aux villes, aux quartiers, une dimension symbolique, une
qualité qui secrète l'attachement. On voit donc avec Claval
(1995) pourquoi les problèmes du territoire et la question de
l'identité sont indissolublement liés : la construction des
représentations qui font de certaines portions de l'espace
humanisé des territoires est inséparable de la construction des
identités. L'une et l'autre de ces catégories sont des produits
de la culture, à un certain moment, dans un certain cadre. Par contre,
précise Claval (1995), le support territorial des identités n'a
pas besoin d'être continu et d'un seul bloc lorsque la construction du
moi et du nous est moins fragile et n'est pas menacée de dissolution au
moindre contact : ce qui compte en pareil cas, c'est la dimension symbolique de
certains référents spatiaux, lieux de culte, tombes des
ancêtres. La territorialité s'exprime plus en termes de
polarité que d'étendue. À ce moment, le territoire
symbolique devient mobile. C'est le cas de certains nomades, qui reconstituent
l'espace sacré qui donne un sens à leur vie partout où ils
s'installent.
Cette approche identitaire du territoire pose le
problème de limite supérieure des gabarits territoriaux. En
effet, à partir du consensus autour de l'idée d'espace
conscientisé, il y aurait autant de tailles de territoires que de
possibilités pour des groupes de partager un même rapport aux
lieux, une même territorialité. Autrement dit, les autochtones
peuls sédentaires, les migrants venus de l'Extrême-Nord Cameroun
et les éleveurs mbororo transhumants ont-ils la même perception et
le même rapport avec le territoire sur lequel ils sont installés,
qu'ils exploitent et gèrent ?
88
À partir de ce moment, on peut avec Elissalde (2002) se
poser la question de savoir si l'outillage conceptuel et les
problématiques utilisables par une géographie des territoires
devraient demeurer cloisonnés entre chaque aire culturelle ? Dans ce
cas, un pan de l'analyse géographique demeure pourtant souvent
négligé.
En effet, la plupart des études sur la
territorialisation privilégient avant tout la mise à jour des
logiques de fonctionnement internes d'un territoire, auquel s'adjoignent
parfois des emboîtements multiscalaires. Tout se passe alors comme si
elles reposaient sur un implicite qui est celui du fonctionnement autonome du
lieu étudié, en laissant souvent de côté les
réactivités induites par les interactions avec des ensembles
spatiaux voisins et de même niveau. La conception actuelle du territoire
remet ainsi en cause l'idée de territorium d'autrefois,
ensemble monoscalaire conçu comme une aire délimitée et
étanche, animé par des acteurs inclus dans ses limites. Ce serait
donner à penser qu'une configuration territoriale ne serait que le
résultat de l'action d'un seul groupe poursuivant un seul et unique
projet. Ce serait imaginer qu'une configuration territoriale est le parfait
décalque des idéaux du ou des groupes qui se la seraient
approprié. Ce serait enfin cautionner une vision cynique des rapports
sociaux ; l'organisation de l'espace n'appartiendrait qu'au champ des rapports
de forces, en ignorant toute régulation équitable.
Une autre face du schéma territorial commence à
se dessiner lorsque Di Méo (1998 : 47) énonce les conditions de
l'édification d'un ancrage identitaire en ces termes : « pour
que les échanges sociaux s'y déroulent (dans la région)
sans surprise, selon un ordonnancement bien réglé, plusieurs
conditions territoriales doivent être remplies. Il convient en premier
lieu que l'espace régional possède les caractères d'un
espace social vécu et identitaire, découpé en fonction
d'une logique organisationnelle culturelle ou politique. Il faut en second lieu
qu'il constitue un champ symbolique dans lequel l'individu en
déplacement éprouve un sentiment de connivence identitaire avec
les personnes qu'il rencontre ». Ainsi, les systèmes d'acteurs
permettent-ils de gérer et, à travers leurs actions, de maintenir
une stabilité du système au sein duquel ils agissent. Il en
découle, comme c'est le cas actuellement dans la région du
Nord-Cameroun, une indispensable coordination, une organisation et
finalement
89
l'aménagement avec ce que ce terme peut selon les
définitions admises receler d'équité comme le souligne
Moine (2005). En fait, Brunet (2001) argue que les acteurs doivent être
replacés dans les systèmes qu'ils élaborent afin de leur
permettre de s'approprier, d'habiter, d'échanger et d'exploiter dans les
meilleures conditions qui soient et surtout, de manière
cohérente. C'est pour cela qu'il faut être capable comme le
formule Moine (2005) de comprendre les jeux spatialisés des acteurs et
de leurs multiples choix pour comprendre les processus qui guident
l'évolution de l'espace géographique. Ainsi, la notion de
territoire ne doit pas se réduire à celle d'appropriation. Elle
est en fait beaucoup plus que cela, un système d'acteurs, en tension car
les acteurs sont concrets, repérables. Ils font les territoires au
travers des subtiles relations qu'ils entretiennent et ils constituent autant
de pouvoirs et de contrepouvoirs respectifs qui font équilibre. Le
produit de ces interrelations peut être dénommé
gouvernance, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des
procédures et des pratiques qui sous-tendent l'existence d'un
territoire, autour du jeu complexe des acteurs, par rapport à une
organisation spatiale évolutive.
III.2.5. Finalement, une définition
fondée sur la boucle de rétroaction
qui organise le territoire
Le territoire est donc un système complexe que l'on ne
peut finalement appréhender que sous l'angle d'un système qui
suppose, non une nouvelle définition, mais un repositionnement
conceptuel dans une perspective systémique. Considéré sous
cet angle, on peut avancer la définition suivante empruntée
à Moine (2005 : 77) : « le territoire est un système
complexe dont la dynamique résulte de la boucle de rétroaction
entre un ensemble d'acteurs et l'espace géographique qu'ils utilisent
aménagent et gèrent ». Cette définition selon
l'auteur s'appuie sur la mise en relation de trois sous-systèmes
clairement définis (figure 8) :
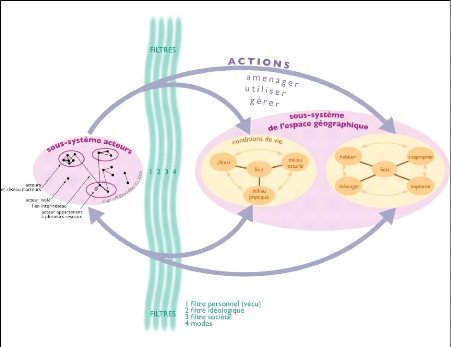
90
Source : Moine (2005)
Figure 8. Fonctionnement du système
territoire
Le fonctionnement du système territoire s'appuie ainsi
sur le sous-système acteurs qui agit sur le sous-système de
l'espace géographique de la manière suivante :
- Les acteurs en interrelation qui vont permettre, soit dans
un espace donné, soit par rapport à une problématique
donnée, de comprendre en partie les raisons des équilibres ou des
déséquilibres en présence qui déterminent une
stabilité dynamique du territoire ;
- L'espace géographique, espace aménagé
par les acteurs, en fonction du géosystème34,
présentant de multiples objets en interaction et que l'on peut
désagréger en trois sous-systèmes : i) le
géosystème ou milieu géographique au
34 Le géosystème est un concept
permettant d'analyser les combinaisons dynamiques de facteurs biotiques,
abiotiques et anthropiques associés à un territoire. S'inscrivant
dans une démarche systémique, il est utilisé en
géographie pour étudier les interactions
nature-sociétés dans une dimension à la fois temporelle et
spatiale (Beroutchachvili et Rougerie, 1991).
91
sein duquel évoluent les acteurs, on parlera des
contraintes ou aménités naturelles qui entrent en interaction
avec les acteurs et influencent l'organisation de l'espace géographique
; ii) l'espace anthropisé constitué par l'ensemble des objets
anthropiques (réseaux, constructions, hommes, etc.) répartis au
sein du géosystème ; iii) l'espace social, celui des rapports
sociaux qui recèle « l'ensemble des interrelations sociales
spatialisées » (Frémont et al., 1984), entre les individus,
les groupes et en étroite relation avec l'espace politique et
institutionnalisé ; iv) l'espace politique et institutionnalisé
au sein duquel sont formalisées les multiples relations entre les
acteurs. Il s'agit d'une portion d'espace régi par la reconnaissance de
règles communes ;
- Les systèmes de représentation, qui se fondent
sur l'interconnexion entre trois types de filtres : individuel, sociétal
(valeur) et idéologique (théorie, modèle), qui forgent
à la fois la connaissance et la conception qu'ont les acteurs du monde
qui les entoure (Callon et Latour, 1990). Aménagé par les
sociétés qui l'ont successivement investi, le territoire
constitue un remarquable champ symbolique. Certains de ses
éléments, instaurés en valeurs patrimoniales, contribuent
à fonder ou à raffermir le sentiment d'identité collective
des hommes qui l'occupent (Di Méo, 1998).
III.3. Les intérêts du territoire pour
l'élevage mobile
Le territoire est au sens des écologues, « la
zone de peuplement et de distribution d'une espèce
végétale ou animale donnée ». Il résulte
de « l'ensemble des relations qu'une société entretient
non seulement avec elle-même, mais encore avec
l'extériorité et l'altérité, à l'aide de
médiateurs, pour satisfaire ses besoins dans la perspective
d'acquérir la plus grande autonomie possible, compte tenu des ressources
du système. » (Raffestin, 1997). Si les débats sur
l'élevage d'herbivores sont largement posés à
l'échelle planétaire (réduction des gaz à effets de
serre, alimentation mondiale, biodiversité...), l'élevage
contribue aussi au développement durable des territoires ruraux : il s'y
présente comme une activité ancrée dans des
sociétés, des filières et un espace local où il
fournit des produits et services multiples (Manoli et al., 2011). Les
travaux de ces derniers ont permis à partir d'une revue bibliographique
de préciser
92
comment les chercheurs abordent les relations entre
élevage et territoire. Ils montrent qu'au niveau du territoire
l'élevage est une activité centrale pour des communautés
d'agriculteurs (Hubert, 1994 ; Gibon et Ickowicz, 2010), il y façonne
les paysages et la biodiversité (Caron et Hubert, 2000) et produit des
services écosystémiques (Burkhard et al., 2009). Il peut
y remplir une diversité de fonctions qui vont bien au-delà de la
fourniture de denrées alimentaires pour les filières longues,
mais qui relèvent de spécificités locales comme la
production de fibres pour l'habillement des personnes, celle de fertilisants
organiques pour l'agriculture familiale comme l'ont montré Steinfeld et
al., (2006) ou Iiyama et al., (2007), la valorisation des
sous-produits agricoles et industriels de proximité (Dedieu et
al., 2011). L'élevage est une source de revenus et d'emplois
pour les éleveurs et l'ensemble de la filière. Il est aussi, dans
certaines sociétés vulnérables, à la fois un
véritable capital sur pied (Bonfiglioli, 1988), le support de dons
resserrant les solidarités familiales et une source directe
d'alimentation (Duteurtre et al., 2009). Enfin, l'élevage peut
être une activité avec des significations symboliques et
culturelles localement très fortes comme par exemple en pays gaucho
du nom du vacher traditionnel des régions de Pampa (Litre et
al., 2008).
C'est ainsi à ce niveau territorial que les politiques
doivent pouvoir expliciter ce que l'on peut attendre de l'élevage, et
que l'ensemble des acteurs, dont la recherche, doit pouvoir décliner les
différentes dimensions des interactions entre l'élevage et les
territoires (Manoli et al., 2011). Ces derniers ont distingué
trois grandes familles d'investigation des interactions entre élevage et
territoire. La première se centre sur les relations entre les
systèmes d'élevage et les modes d'utilisation de ressources
naturelles spatialisées. La seconde est focalisée sur la
diversité des systèmes de production existant sur un territoire
donné. La troisième considère les systèmes
d'élevage comme des systèmes techniques enchâssés
dans des collectifs et des sociétés humaines.
L'élevage extensif utilise une gamme de ressources
naturelles spatialisées. La première famille d'approches a pour
objet l'utilisation de ressources naturelles, caractérisées en
premier lieu par leur localisation dans l'espace et qui impose une
nécessité de reconnecter activités d'élevage et
enjeux autour de l'usage de l'espace.
93
Manoli et al., (2011) montrent que les objectifs des
études faites dans ce sens sont de comprendre le rapport à
l'espace des activités d'élevage dans un contexte où les
ressources naturelles deviennent un facteur limitant, et où il y a donc
compétition entre plusieurs usages possibles du sol. L'élevage
est ici une activité en compétition avec d'autres
activités pour l'utilisation de l'espace ; le territoire, vu à la
fois comme le support d'activités humaines et comme le produit de ces
activités, est considéré ici plus dans sa dimension
spatiale que sociale : c'est l'espace qui est au centre des questions de
recherche. À l'intérieur de ce courant, on peut distinguer deux
types d'approches : d'un côté les études centrées
sur la localisation de l'élevage (analyse statique des facteurs), de
l'autre, l'analyse est plus dynamique et se centre sur les processus de
changements d'utilisation du sol.
Le premier groupe de travaux recensé par Manoli et
al., (2011) se centre sur la représentation de la localisation
des systèmes de production et des densités animales à des
échelles géographiques larges et sur l'identification des
facteurs explicatifs de ces localisations. La classification des
systèmes d'élevage faite par Sere et Steinfeld (1996) a fait date
: elle propose de cartographier les différents types de systèmes
de production à une échelle régionale (un ensemble de pays
d'une même région du monde). Ce sont les facteurs
agro-écologiques qui sont mis en avant pour expliquer cette distribution
spatiale des systèmes de production. D'autres facteurs de localisation
sont présentés dans le zonage de systèmes d'élevage
européens, réalisé par Pflimlin et al., (2005).
Les différentes zones sont délimitées principalement par
des facteurs pédoclimatiques, mais les dynamiques
socioéconomiques et des éléments d'histoires locales sont
également pris en compte. Le rapport « Livestock Long Shadow »
(Steinfeld et al., 2006) a été un autre travail montrant
les liens entre systèmes d'élevages et éléments
géographiques. Les localisations des différents types de
systèmes d'élevage (définis par les espèces
élevées, le système de production, le degré
d'intensification par exemple) sont expliquées aussi par des
caractéristiques humaines de l'espace : espaces urbains, ruraux,
périurbains, existence d'infrastructures. Les contraintes naturelles
sont toujours présentes dans cette description (présence de
certains types de systèmes selon les climats par exemple). Bourn et Wint
(1994) ont
94
travaillé sur ce lien entre géographie et
élevage, mais surtout à travers la spatialisation des
densités animales. Ils ont eux aussi proposé d'autres facteurs
que les facteurs agro-écologiques pour modéliser des
densités animales : densité de la population humaine, maladies
animales, présence d'agriculture, etc. Au final, la plupart de ces
études s'identifient à un courant scientifique qui prend de
l'ampleur, celui de `livestock geography' (Kruska et al., 2003 ; Reid
et al., 2000 ; Sere et Steinfeld, 1996 ; Thornton et al., 2007 ; Wint,
2007), dont la finalité est d'aider à l'élaboration de
politiques nationales et internationales du développement de
l'élevage. C'est pourquoi elles sont faites à une échelle
large. Des cartes de densités animales, de systèmes
d'élevage à des échelles continentales à
nationales, sont le produit commun de toutes ces études. Ces cartes sont
élaborées grâce à des SIG et elles donnent une image
statique des différents facteurs de localisation des activités
d'élevage : les facteurs agro-écologiques sont
prépondérants (climat, reliefs montagneux, maladies animales par
exemple), quelques facteurs de type humain sont pris en compte (marché,
zones urbaines, infrastructures, agriculture).
Manoli et al., (2011) ont recensé un
deuxième groupe de travaux qui a pour objet d'étude des
dynamiques d'utilisation des sols. Dans ce cas, l'accent est mis sur les
processus qui expliquent ces dynamiques. Ces travaux abordent les liens entre
activités agricoles (et utilisatrices d'espace en général)
et dynamiques spatiales. Par exemple, les travaux de Poccard-Chapuis (2005)
analysent l'avancée des fronts pionniers dans la forêt amazonienne
et la place des systèmes d'élevage dans ce processus. Le
rôle joué par les réseaux de commercialisation à la
fois locaux, nationaux et internationaux est mis en avant dans la description
de ces processus. Certains de ces travaux se réclament d'un courant
relatif au « land use and land cover changes » (LULCC) :
Lambin et al., (2000) ; Lambin et al., (2001) ; Stephenne et
Lambin (2001) ; Veldkamp et Lambin (2001). Par exemple, Lambin et al.,
(2000) s'efforcent de mettre en lumière la complexité des
mécanismes qui se cachent derrière les changements d'utilisation
de l'espace, en cherchant à se différentier des approches
simplificatrices qui sont faites pour expliquer les causes d'une dynamique
spatiale particulière (déforestation, dégradation des
pâturages, urbanisation, etc.). Ils déconstruisent ainsi
certains
95
« mythes » simplificateurs comme le concept de
« capacité de charge ». Celui-ci est souvent
avancé pour expliquer un seuil à partir duquel un pâturage
donné sera surexploité. La capacité de charge est,
à leurs yeux, à relativiser fortement lorsqu'elle est
utilisée dans le cadre des écosystèmes arides,
caractérisés par un déséquilibre permanent. Ces
auteurs soulignent ainsi le besoin de mettre en place une compréhension
rigoureuse des contextes locaux, par l'appui sur des études de cas par
exemple, pour mieux appréhender notamment comment les grandes dynamiques
globales se reformulent dans un lieu particulier (Ickowicz et al.,
2010). Il s'agit de réexaminer de grandes hypothèses globales
considérées comme des lois générales, ou au moins
de bien les appliquer aux unités de temps et d'espace pertinentes.
Manoli et al., (2011) mentionnent que ces approches
de `LULCC' sont très complémentaires des approches de
localisation développées dans le premier groupe : elles donnent
une analyse plus dynamique des utilisations de l'espace, elles se centrent sur
la compréhension des processus. Les études de localisation des
activités donnent une image des résultats de tout un processus.
Elles sont une façon de montrer que les activités
d'élevage ont des raisons de se placer là où elles se
placent. Dans une réflexion sur le développement durable, les
activités d`élevage doivent être reconnectées aux
espaces et aux ressources qu'elles utilisent (Naylor et al., 2005) :
elles sont bien une activité d'usage des ressources naturelles
spatialisées (parmi d'autres). Dans cette perspective, donner une
représentation du « maillage » de l'élevage (Wint,
2007) à l'échelle de grandes régions, est une
première étape essentielle.
Pourtant, relèvent Manoli et al., (2011),
quand il s'agit de développement, et de compréhension des
dynamiques d'utilisation de l'espace, ces niveaux ou même les niveaux
nationaux s'avèrent insuffisants (Hubert, 1994 ; Lambin et al.,
2001) et le niveau de l'exploitation comme entité
élémentaire de gestion de l'espace agricole devrait être
mieux pris en compte (Wint, 2007). Ainsi, la compréhension du niveau
local, grâce à l'analyse d'études de cas apparait comme une
nécessité (Manoli et al., 2011). Bommel et al.,
(2010) ont ainsi proposé un modèle générique
d'étude des interactions entre l'élevage et l'espace à ce
niveau local sur la base de la comparaison
96
de modèles multi-agents développés dans
plusieurs territoires de France, Brésil, Uruguay et
Sénégal.
Dans les deux types d'approches, les densités animales,
leur répartition et leur localisation sont, comme l'ont montré
Manoli et al., (2011), reliées majoritairement à des
facteurs agro-écologiques. Par contre, le niveau socio-économique
est peu étudié. Enfin, les spécificités des
activités d'élevage ne sont généralement pas
considérées : la mobilité par exemple qui marque des
différences fortes dans l'utilisation de l'espace entre élevage
et agriculture, n'est pas analysée, car les questions sont
focalisées sur les ressources naturelles en elles-mêmes. Si l'on
se place dans une perspective d'élaboration de politiques de
développement, il est important de considérer le niveau local
comme le niveau où se reformulent des grands facteurs globaux (agro
écologiques, socio-économiques) et où ils se combinent
à des facteurs plus spécifiquement locaux (place de la
mobilité, fonctions particulières de l'élevage...).
|
|



