INTRODUCTION GENERALE
Préambule
Pendant mon immersion au sein de la communauté
d'éleveurs mbororo dans le cadre de ma thèse, j'ai pu constater
la difficulté pour eux de s'approprier un territoire de vie et
d'activité. Malgré leur volonté de se fixer et d'adopter
une partie des modes de vie sédentaires en pratiquant une agriculture de
subsistance, les éleveurs ne sont pas assurés de leur emprise
territoriale permanente. En août 2007, j'ai reçu sur mon terrain
de recherche Emmanuel Torquebiau, mon co-directeur de thèse. Nous avons
visité les deux terroirs de sédentarisation des éleveurs
mbororo dans le bassin de la Bénoué au Nord-Cameroun. Pendant
cette tournée, nous avons trouvé des villages abandonnés
par les éleveurs qui ont fui les attaques des coupeurs de route (photo
1).

Photo 1. Emmanuel Torquebiau visitant le village de
Laïndé Ngobare abandonné par les
éleveurs
Au cours de cette tournée, mon co-directeur a pu se rendre
compte de la réalité de la
situation que je lui expliquais, sans le convaincre, dans son
bureau au CIRAD à Montpellier. Ce phénomène de prise
d'otages vient compliquer davantage la situation des
Mbororo et de leur volonté d'appropriation territoriale
propre à leur mode de vie et d'activité. Alors qu'ils avaient
commencé à organiser leurs petits territoires de fixation
tout en continuant la mobilité avec leurs animaux,
l'insécurité physique les a obligé à se
déplacer dans les gros villages voisins.
2
Après la soutenance de ma thèse en novembre
20081, je suis revenu dans les deux terroirs pour faire une
enquête complémentaire pour un article que j'étais en train
de terminer avec Patrick Dugué sur la diversification des
activités des éleveurs avec leur fixation. J'ai ainsi pu
constater que de nombreux éleveurs qui faisaient partie de mon
échantillon d'enquête étaient repartis au Nigeria, d'autres
avaient recommencé le nomadisme tandis que la majorité
s'était définitivement implantée dans les villages voisins
tout en rentrant cultiver leurs parcelles. Tous ces mouvements permanents et
ces incertitudes autour des lieux de vie et d'activité de ces
éleveurs m'ont amené à m'interroger sur les territoires de
mobilité pastorale dans ce contexte de forte pression sociale et
sécuritaire. En effet, au Nord-Cameroun, les surfaces agricoles sont en
constante augmentation en même temps que les effectifs bovins. Par
contre, les territoires d'élevage sont en réduction. À
côté de cela, nous assistons au maintien des aires
protégées, des zones d'intérêt
cynégétique et des parcs nationaux. La pression sur ces
territoires pastoraux s'est renforcée depuis 2013 avec l'arrivée
massive des éleveurs mbororo venus de la RCA, accusés
d'être des partisans de la Séléka et violentés par
les anti-balaka (meurtres, rackets,...).
Face à cette situation, il est important pour une
gouvernance territoriale, une gestion harmonieuse et durable ainsi qu'une
limitation des situations conflictuelles entre les différents acteurs,
de réfléchir sur la problématique de gestion et
d'organisation des espaces entre multi-acteurs et activités. Ma
contribution va se limiter aux territoires de mobilité pastorale. En
effet, dans le cadre de ma thèse (Kossoumna Liba'a, 2008) et diverses
publications (Kossoumna Liba'a et al., 2010 ; Kossoumna Liba'a et
al., 2011 ; Dugué et al., 2011 ; Kossoumna Liba'a et
al., 2011 ; Kossoumna Liba'a, 2012 ; Dugué et al.,
2013), j'ai abordé la problématique de gestion des territoires et
des ressources naturelles à l'échelle de deux terroirs
d'éleveurs mbororo sédentarisés non loin de la ville de
Garoua dans le Nord du Cameroun (Ndiam Baba et Laïndé Ngobara). Les
résultats ont mis en évidence les différentes formes
d'organisation, d'exploitation et de gestion des territoires de fixation et de
mobilité (petite et grande transhumance). Ils ont permis
également d'identifier les structures de ces territoires, les espaces
d'appartenance et les
1 La thèse s'intitule : « De la
mobilité à la sédentarisation : gestion des ressources
naturelles et des territoires par les éleveurs mbororo au Nord Cameroun
». Elle a été soutenue le 28 novembre 2008 à
l'Université Paul Valéry - Montpellier III (France).
3
principales dynamiques passées et en cours. Ces travaux
ont relevé enfin les interférences entre les différentes
activités rurales dans et au-delà de ces territoires, les
nouvelles pratiques des éleveurs et les nouveaux niveaux d'organisation
individuels et collectifs.
Partant de la complexité de la mobilité
constatée lors des différents déplacements des animaux au
cours des différentes saisons2, il me paraît important
de mener une réflexion plus large afin de mieux appréhender le
problème plus global sur les territoires de mobilité pastorale au
niveau de la région du Nord-Cameroun en prenant en compte les autres
acteurs en présence que sont les agriculteurs et les lobbies
environnementaux ainsi que les autorités traditionnelles et
administratives. Il s'agit également de proposer, à partir de
l'analyse du contexte local, une démarche de coordination entre les
acteurs pour une gestion harmonieuse de ces territoires de mobilité
pastorale.
Problématisation
Dans la zone soudano-sahélienne du Nord-Cameroun, la
cohabitation entre territoires agricoles, territoires pastoraux et territoires
réservés pour la biodiversité est clairement antagoniste
et conflictuelle, bien que les différents acteurs entretiennent
certaines relations d'échanges et de complémentarité.
Les agriculteurs et les éleveurs, anciennement
implantés dans la région, grignotent les aires
protégées et ont le sentiment de payer au prix fort l'effort de
préservation imposé aux pouvoirs publics par les lobbies
environnementaux. L'augmentation de la pression anthropique dans certaines
zones protégées (favorisée par des mouvements migratoires
importants d'agriculteurs et d'éleveurs, camerounais et
étrangers), le refus de certains lamidats3 de recevoir des
troupeaux, les droits de passage très élevés
pratiqués par d'autres lamidats et le regain de braconnage créent
une situation de tension extrême que personne ne veut prendre le risque
de gérer.
De nombreux territoires de mobilité pastorale (espaces
de pâturage et les pistes à bétail) délimités
depuis longtemps ont été classifiés comme aires
protégées au grand dam des
2 Multitude d'acteurs aux intérêts et
stratégies complexes, difficultés d'accès aux grands
espaces de pâturage délimités, intrusion dans les aires
protégées, difficulté de maintien des espaces
délimités pour l'élevage, conflits,
complémentarités, échanges...
3 Dérivé du fulfulde francisé
« lamido », sur le modèle de sultanat, pour
désigner le territoire sur lequel s'étend le pouvoir d'un
laamii'do (Seignobos et Iyébi-Mandjek, 2000).
4
éleveurs qui se trouvent privés d'une partie de
leurs territoires et voient leurs déplacements réglementés
de façon telle qu'ils ne peuvent plus vivre suivant leur
expérience ancestrale de la terre et de l'eau. En plus, ces territoires
de mobilité sont grignotés par les champs des agriculteurs de
plus en plus nombreux. De manière générale, les
superficies disponibles pour les activités d'élevage et
d'agriculture semblent suffisantes mais leur accessibilité et leur
répartition dans l'espace posent problème.
Cependant, les autorités traditionnelles autant
qu'administratives n'assument plus leur rôle d'arbitrage et de
régulation pour une organisation harmonieuses des territoires ruraux qui
sont délaissés ou valorisés de manière anarchique
ou arbitraire sans prise en compte objective des besoins des populations, des
exigences du développement durable et de la paix sociale. De plus, la
crise économique des années 90 s'est traduite par la baisse des
interventions de l'État dans l'aménagement du
territoire4 et le règlement des conflits territoriaux,
même si certains projets de développement5 sont
intervenus dans la zone sans avoir des résultats probants.
La problématique a donc été
recentrée sur le questionnement suivant : dans un contexte de
densification agricole, d'augmentation du cheptel et de présence de
vastes zones protégées, à quelles conditions et sur quels
territoires l'élevage mobile peut-il continuer à se pratiquer
?
La question centrale de la recherche est donc celle de savoir
quelle est la place de la mobilité du troupeau dans un contexte de
pression sur le territoire rural ?
De nombreux questionnements et interrogations
spécifiques méritent des clarifications et réponses :
comment peut-on envisager une gestion harmonieuse et équitable des
territoires de mobilité pastorale en tenant compte des
préoccupations des autres acteurs en présence (agriculteurs et
lobbies environnementaux notamment) ? À quelles conditions peut-on
continuer à préserver les vastes espaces dédiés
à la biodiversité dans un contexte de forte demande d'espace
agricole et de raréfaction de l'espace de pâturage, en plus de
la
4 De façon générale,
l'État ne se donne pas les moyens financiers de ses politiques. Les
fonds mobilisés sont principalement issus de l'aide au
développement. L'État a donc rarement des moyens continus pour
assurer un contrôle effectif des espaces ou des ressources publics et
d'en réguler l'exploitation.
5 Projet de Développement Paysannal et de
Gestion des Terroirs (DPGT), Projet de Gestion Sécurisée des
Espaces Pastoraux (GESEP) Projet de développement de l'Ouest
Bénoué (PDOB)...
5
convoitise permanente des agriculteurs et des éleveurs
? Comment peut-on réhabiliter et préserver les territoires de
mobilité pastorale (espaces de pâturage et pistes à
bétail) délimités mais colonisés par les
agriculteurs ? Comment la mobilité pastorale peut-elle continuer
à se faire dans un contexte de forte pression sur les territoires qui
lui sont dédiés ? Comment les éleveurs adaptent-ils leurs
mobilités ? Quels sont les différents territoires de
mobilité utilisés par les éleveurs et quelles sont leurs
caractéristiques ? Comment faire émerger un consensus entre les
acteurs autour des territoires communs ? Quelles instances de gestion et
d'organisation pour les territoires de mobilité pastorale ? Quelles sont
les conditions de durabilité des modalités de gestion et
d'organisation de ces territoires de mobilité pastorale ? À
quelles conditions peut-on envisager une spécialisation territoriale ou
une mixité ? Telles sont les préoccupations qui guident notre
réflexion dans le cadre de cet essai.
Démarche méthodologique
La démarche méthodologique commence par le
cadrage de la thématique au cours d'un stage postdoctoral au sein de
diverses unités mixtes de recherche. Le concept de territoire de
mobilité qui est au centre de notre positionnement scientifique s'appuie
sur les travaux pionniers qui nous ont permis d'abord de mieux
appréhender le « territoire » de manière
général, puis de manière spécifique de saisir son
sens comme bien commun et enfin de le situer dans le contexte de la
mobilité pastorale. L'analyse de la place du territoire dans la
mobilité pastorale s'appuie également sur diverses
théories autour des biens communs dont celles de Garrett Hardin et
d'Elinor Ostrom dans leurs soucis respectifs de saisir la construction des
relations, d'appréhender les processus de négociation entre
acteurs aux intérêts parfois divergents qui partagent une
ressource commune.
Le thème abordé dans le cadre de cet essai
s'inscrit dans une réflexion partagée qui a débuté
en 2012 à travers diverses rencontres et stages de recherche. En effet,
du 1er novembre 2012 au 30 janvier 2013, j'ai effectué un stage
postdoctoral à l'UMR Innovation du CIRAD de Montpellier (France). Le
stage a été financé par le Service d'Action Culturelle et
de Coopération (SCAC) de l'Ambassade de France au Cameroun et
géré à Montpellier par Campus France. Ce séjour m'a
permis de discuter avec plusieurs
chercheurs notamment à l'UMR PRODIG de
l'Université de Paris X Nanterre et au CIRAD de Montpellier.
Les divers échanges m'ont permis de recadrer ma
thématique autour de l'approche géographique de la
mobilité de l'élevage dans un contexte de pression en insistant
sur le concept de territoire de mobilité pastorale. Nous avons ainsi
centré le contexte autour des incertitudes fortes sur les territoires de
mobilité pastorale sur le plan spatial (accroissement des surfaces
agricoles, maintien voire extension des aires protégées,
occupation des pistes à bétail et des parcours) et
sociétal (genèse de l'installation des éleveurs dans la
région, les processus et mode d'appropriation de l'espace de fixation,
relations entre les éleveurs et les autres acteurs). L'accent a
été porté sur la logique institutionnelle
défavorable à l'élevage alors que les élites
locales capitalisent ou investissent dans le bétail.
Échelle d'observation et d'analyse
La recherche se base sur la géographie des territoires
avec un accent spécifique sur les territoires de mobilité
pastorale. Deux types d'échelles nous intéressent dans le cadre
de cet essai : l'échelle d'étude et l'échelle d'action.
L'échelle d'étude correspond à des
échelles de gestion, d'exploitation et d'organisation des territoires de
mobilité (Figure 1).
|
|
|
|
Territoires illicites de mobilité pastorale
|
|
|
|
|
|
Territoires de transhumance saisonnière
|
|
|
|
|
|
Territoires pastoraux de proximité Territoire de fixation
des éleveurs
|
|
|
|
|
|
|
6
Figure 1. Échelles d'étude des
territoires de mobilité pastorale
Elle est régionale en considérant la
verticalité : petits territoires de fixation des éleveurs (Ndiam
Baba et Laïndé Ngobara) ; territoires pastoraux de proximité
(collines, bas-fonds et territoires d'agriculteurs voisins à savoir
Boklé, Sanguéré Paul, Djefatou, Djola) ; territoires de
transhumance saisonnière (bord des cours d'eau, espaces de
pâturage délimités, villages lointains à savoir
Kalgué, Mayo Bouki, Dembo et Gouna) ; territoires
7
illicites6 de mobilité pastorale (zones
d'intérêt cynégétique et parcs nationaux de Faro,
Bénoué et Bouba Ndjidda).
Sur le terrain, nous avons également cherché
à faire une superposition de différents niveaux de territoires
avec les autres acteurs en présence (élevage/chefferies ;
élevage/communes ; élevage/aires protégées ;
élevage/agriculture,...).
Nous nous sommes appuyés sur l'analyse de la place des
acteurs impliqués dans la gestion et l'organisation de la
mobilité au niveau des différents territoires. Cette
mobilité est d'autant plus singulière qu'elle ne s'intègre
pas dans une dynamique locale institutionnalisée, comme on le constate
au Niger et au Mali où l'on remarque une meilleure gestion de la
transhumance à condition que les éleveurs soient
intégrés ; exemple également au Sénégal avec
les peuls qui s'installent et s'intègrent dans la gestion des communes
et des forages grâce à leur cotisation et les taxes qu'ils
paient.
Nous avons également tenu compte de l'échelle
transnationale de la mobilité des éleveurs dans et autour des
aires protégées (relation de réciprocité entre les
nouveaux arrivants, avec les transhumants des autres pays, ceux qui partent du
Tchad pour le Nigeria en passant par le Nord-Cameroun). En même temps,
nous nous sommes focalisés sur les rapports entre les différents
territoires.
L'échelle d'action renvoie à des échelles
de décision, de négociation et de concertation spatiale. Elles se
répartissent entre le territoire villageois, le territoire communal, le
territoire intercommunal, le territoire coutumier et, dans une moindre mesure,
le territoire administratif.
|
Territoire administratif Territoire coutumier
Territoire intercommunal Territoire communal
Territoire villageois
|
Figure 2. Echelles d'action
6 Les territoires illicites sont constitués
des zones d'intérêt cynégétiques (aires
protégées et parcs naturels). Malgré l'interdiction d'y
pâturer, les éleveurs y « volent » du pâturage
selon leur propre terme, d'où son caractère illicite.
8
L'échelle de l'action dans le cadre de la
mobilité pastorale peut être diverse, mais l'impact de cette
action sur le spatial est toujours local. Une politique régionale aura
des impacts locaux, même si son étendue correspond à la
région. C'est pour cela que tous les niveaux spatiaux de décision
doivent être intégrés dans le processus de
négociation et de concertation.
La recherche se déroule dans le Nord du Cameroun. Cette
région se situe dans le bassin de la Bénoué entre
l'Extrême-Nord et l'Adamaoua (figure 3).
12° 16°
12° 16°
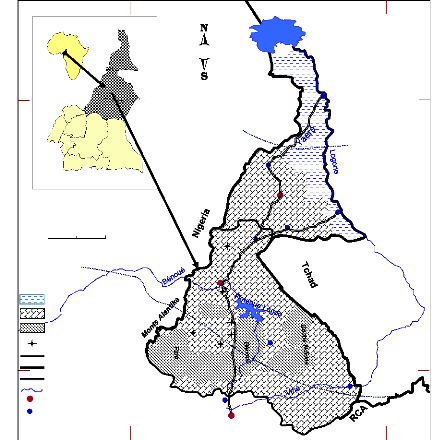
12°
8°
Légende
1200 mm
0 50 100 km
Chef-lieu de région Ville secondaire
Zone cotonnière
Aires protégées (Faro) Territoires
d'étude
Cours d'eau
Yaéré
Limite régionale
Limite nationale
Route nationale n°1
W + E
Ndiam Baba
Laïndé Ngobara
Kalgué Ngong
Mbé
Ngaoundéré
Garoua
Adamaoua
600 mm
Gouna
Mayo Bouki
Dembo
Nord
Adoumri
Extrême-Nord
Kaélé
Guider
Lac Tchad
Maroua
Tcholliré
Mora
Touboro
Kousséri
Yagoua
12°
8°
Figure 3. Présentation du Nord-Cameroun et
des territoires d'étude
9
Dans la plaine de la Bénoué, le climat est
soudanien à une seule saison des pluies au sud et de type
sahélien au nord (Roupsard, 1987). La pluviométrie est comprise
entre 700 et 1 500 mm d'eau par an répartie sur cinq mois. La diminution
globale de la pluviométrie au cours des deux dernières
décennies, liée à l'irrégularité de la
répartition et de la date d'arrêt des pluies, engendre un risque
climatique pour la culture cotonnière qui s'accroît avec la
latitude (M'biandoun, 1990).
La diversité des sols de cette zone provient de la
pluralité des conditions de pédogenèse liées aux
contrastes pluviométriques et aux contrastes des reliefs qui
caractérisent cette région. Cette diversité est croissante
du Sud vers le Nord (Brabant et Gavaud, 1985 ; ORSTOM, 1984 ; USAID fac, 1974).
Sur l'ensemble de la région, les principaux types de sols
rencontrés par ordre d'importance agronomique décroissante sont
d'abord les sols ferrugineux tropicaux (texture à dominante sableuse,
horizon argileux en profondeur) qui couvrent environ 2 000 000 ha et 60% des
terres cultivées, puis les vertisols (à forte teneur en argile 40
à 45% et forte capacité de rétention d'eau). Ensuite
viennent les sols fertialitiques (à teneur en argile moyenne 25%)
souvent caillouteux ; les sols hydromorphes (horizon à gley ou
pseudo-gley, forte activité biologique) fréquents au Sud de
Garoua (Tcholliré, Bocki sur environ 600 000 ha) ; les sols alluviaux
dans les vallées en bordure des rivières.
Les sols du bassin de la Bénoué se sont
formés à partir d'un socle cristallin fortement
arénisé et sur des grès datant du crétacé
(ORSTOM, 1984). Ce bassin contient des sols légers aptes aux cultures
pluviales. Ce sont les sols ferrugineux tropicaux profonds et souvent
lessivés des plaines d'alluvions anciennes et des zones
vallonnées. Ce sont aussi les sols profonds argilo-sableux et
argilo-limoneux formés d'alluvions fluviales récentes, comme ceux
de la vallée de la Bénoué et de la vallée du Faro.
Les vertisols sont assez peu représentés (vallée de la
Bénoué et du Mayo Kébi). Les sols hydromorphes, à
argiles gonflantes des bas-fonds et de plaines, sont très étendus
(Bocki, Tcholliré). Ils sont durs et sensibles à l'érosion
hydrique. Les lithosols peu évolués se situent aux pieds des
pentes (apports colluviaux) et sur les versants des reliefs (sols
d'érosion). Ils sont peu propices à l'agriculture.
10
Sur le plan géologique, cette région est
localisée sur un bassin crétacé, parsemé
d'inselbergs et dominé par des massifs gréseux, granitiques ou
volcaniques. Ils sont dominés par des sols minéraux bruts
lithosoliques et les sols peu évolués d'érosion lithiques
(Brabant et Humel, 1974). Ces massifs montagneux portent le nom fulfulde de
« hossere ». On peut citer hossere
Laïndé-Massa ; hossere Bangoura ; hossere
Wadjéré ; hossere Kokoumi ; hossere
Kalgué ; hossere Siddiri ; hossere Mbapé ;
hossere Harandé ; hossere Ndiam Baba ; hossere
Ngola ; hossere Sorké...
Sur un soubassement de roches cristallines ou
métamorphiques, se sont déposées d'importantes alluvions
le long du réseau hydrographique composé essentiellement de la
Bénoué (13 614 km), le Mayo Kebbi, le Mayo Rey et le Faro (13 493
km) très poissonneux (Segalen, 1967). Il existe cependant dans cette
zone plusieurs autres cours d'eaux intermittents qui tarissent presque tous
pendant la saison sèche. Parmi les cours d'eau les plus importants, on
peut citer : mayo Douka ; mayo Gabago ; mayo
Betnodjé ; mayo Binossi ; mayo Tane ; mayo
Dadi... À côté de ces cours d'eau, il existe des lacs
naturels dont les plus remarquables sont Ndjigoro manga, Ndjigoro
pétel, Ngouen, Babi, Goré...
La végétation varie suivant le climat, la
pluviométrie, le relief et les différents types de sols. D'une
manière générale, il existe dans la zone des savanes
boisées ou arborées ou arbustives voire des forêts claires
du bassin de la Bénoué. Les principales formations
végétales sont (Letouzey, 1985) : la formation grégaire
à Isoberlinia doka et Isoberlinia tomentosa ; la
formation à Boswellia odorata, Sclerocarya birrea,
Prosopis africana ; les formations à Combretum, Terminalia,
Anogeisus leiocarpus. Dans les zones inondables, on distingue les
formations graminéennes à Hyparrhenia rufa, Vetiveria
nigritana et Echinochloa pyramidalis ; sur les montagnes, on
rencontre une forêt claire faite de Ficus, Diospyros, Boswelia,
Vitellaria... Le bas des versants est recouvert de ligneux comme
Crossopteryx erinaceus, Bombax costatum, ainsi que Anigeisus
et Isoberlinia. La strate herbacée est à base de
Pennisetum pedicellatum et Andropogon tectorum. On trouve
également dans ces montagnes diverses espèces d'Acacia
(hockii, dudgeoni, senegal,..).
Sur le plan agricole, au Sud de Garoua, le coton, le maïs
et l'arachide constituent les principales sources de revenus pour les paysans.
Dans la région de Guider et des
11
piémonts, le coton et l'arachide demeurent les
principales cultures de rente tandis que le sorgho pluvial est
réservé à l'autoconsommation et à la fabrication de
la bière (bit bit).
Hypothèse de recherche
La recherche part de l'hypothèse que dans un contexte
de forte incertitude sur le territoire pastoral, la mobilité du troupeau
ne peut continuer à se faire que grâce à un consensus pour
une délimitation territoriale et une forte implication de l'État
et des acteurs locaux (élites, autorités traditionnelles,
agriculteurs, éleveurs, conservateurs). Il s'agit de considérer
l'ensemble des acteurs, individuels ou collectifs, étatiques, coutumiers
ou privés qui, de droit ou de fait, jouent un rôle effectif dans
la régulation de l'accès et de l'usage des terres et des
ressources naturelles, à travers des décisions portant sur la
définition des règles d'accès ou d'usage, l'attribution de
droits, l'arbitrage de conflits, la formalisation de droits ou d'accords, etc.
Il s'agit comme le suggèrent Benkahla et Hochet (2013) de décrire
concrètement la façon dont les choses se passent
réellement, sans présager de leur statut au regard de la loi,
avec leurs relations de complémentarité, de compétition,
de concurrence ou de synergie : pour un type de problème donné,
quelle(s) autorités sont mobilisées par quels acteurs ? Quels
sont les rapports entre pouvoirs coutumiers, administration territoriale,
services techniques dans le traitement de ce type de problème ?
Permettent-ils d'arriver à des solutions ? Ces questions permettent de
s'interroger sur le fait que de nombreux acteurs interviennent potentiellement,
que les acteurs qui jouent un rôle effectif ne sont pas forcément
ceux qui ont des prérogatives légales, que les relations qu'ils
ont entre eux sont variées.
Un travail de l'état de l'art nous a permis de nous
positionner par rapport à des controverses scientifiques ou au sein des
milieux du développement pour mieux problématiser la recherche
par rapport à la zone soudano-sahélienne d'Afrique et montrer ce
qui fait la spécificité du Nord-Cameroun. Nous avons
également fait le point sur les expériences passés et en
cours concernant l'appui à la mobilité du bétail,
l'organisation et la gestion des territoires ruraux dans cette région.
Les éleveurs étant les premiers concernés par la
recherche, nous avons voulu mettre en évidence l'identité des
éleveurs et leur place dans le contexte sociopolitique de la
région. La problématique des inégalités (sociales
et ethniques) des acteurs face aux enjeux territoriaux nous amène
à montrer que
12
les éleveurs sont des acteurs faibles dans le processus
de négociation, d'accès et de gestion des territoires ruraux dans
le Nord du Cameroun.
Clarification du concept de territoire de mobilité
pastorale
Notre vision du territoire s'appuie sur le courant de
pensée amorcé par les géographes « tropicalistes
», notamment africanistes, comme Jean Gallais, Pierre Gourou, André
Lericollais, Paul Pélissier, Gilles Sautter qui ont commencé
à se préoccuper de la diversité des milieux et de leurs
rapports à la société. L'apport des monographies de
terroir fut unanimement reconnu du fait de la rigueur méthodologique qui
les guidait, et même si leur composante était fondamentalement
descriptive, ces monographies tentaient d'avoir une compréhension
globale des processus (Gallais, 1989). Ces travaux se sont attelés
à montrer les faits d'organisation sociale, de structuration des
systèmes fonciers, de la relation à la nature. Cette
géographie tropicale africaine s'est surtout intéressée
aux grandes échelles, aux terroirs (et non à la région),
aux zones rurales et aux sociétés traditionnelles (Claval et
Sanguin, 1996).
Pendant mon séjour à Montpellier dans le cadre
de ma thèse, j'ai pu consulter les travaux d'autres géographes
qui s'intéressent davantage à l'analyse spatiale, l'utilisation
de méthodes statistiques, la valorisation graphique des études,
tout ceci teinté d'innovations dans tous les domaines, que ce soit
technique comme conceptuel. Le structuralisme a eu évidemment une
influence très forte sur ces travaux (Brunet, 1987 ; 1997). Ces derniers
étaient pratiquement tous orientés vers la détermination
de structures spatiales construites sur la base de similitudes des
paramètres des unités spatiales. Beaucoup d'espaces ont ainsi
été passés au peigne fin de la statistique et des
données socio-économiques, pour en dégager des
chorèmes, des modèles d'organisation, des cartes de
synthèse, des atlas. J'ai d'ailleurs pu m'approprier le langage
chorématique que j'ai appliqué à mon terrain de recherche
doctorale pour modéliser les petits territoires de fixation des
éleveurs (Kossoumna Liba'a, 2008).
Le choix de travailler sur la mobilité pastorale m'a
donc amené à manipuler le concept de territoire. Celui-ci est
issu de la longue histoire de la géographie, et en particulier de la
période des années 1950-1980, pour laquelle l'héritage des
géographes ruraux, et surtout tropicalistes, mais aussi les innombrables
débats théoriques qui eurent lieu, ont été
13
fondamentaux dans la construction d'une discipline qui a su
résister, dans une certaine mesure, au courant positiviste. Ce concept
est aujourd'hui bien approprié par la géographie, notamment
économique et sociale, mais aussi par d'autres disciplines comme la
sociologie et l'économie.
Sur le plan conceptuel, nous nous sommes attelé
à clarifier le concept de territoire de manière
générale avant de proposer une définition et une
caractérisation des territoires de mobilité pastorale. Partant de
son sens politico-administratif tel qu'utilisé à partir du
XVIIème siècle, le territoire est en effet
replacé dans la géographie universitaire avec sa
définition dans le Dictionnaire de Géographie dirigé par
Pierre George (1970) et la réorientation de son usage dans la
géographie française avec les travaux de Ferrier (1984) et sa
diffusion dans divers domaines des sciences (géographie,
économie, sociologie). Après le sens donné par les
géographes tel Le Berre, Brunet, Di Méo, Raffestin, le territoire
est placé au centre de débats sur sa place au service du
développement à travers les travaux de Moine (1995), Levy et
Lussault (2003), Le Berre (1992) ou Debarbieux (1999).
Une des questions épistémologique est
également de savoir si le territoire a un sens pour la
société. Au Nord-Cameroun, le territoire est le lieu
d'application du pouvoir traditionnel. Cette acception du territoire que les
géographes lient au contrôle et au pouvoir est attachée aux
problèmes de géographie politique que nous documentons en nous
appuyant sur les travaux de Pinchemel et Pinchemel (1997), de Claval (1995) et
de Gottmann (1973). Dans cette région, le territoire est
également une réalité sociale. Partant de
l'éthologie animale à partir des travaux l'autrichien Konrad
Lorenz (1973) et le Néerlandais Nikolaas Tinbergen (1967) qui font
découvrir le rôle que joue la territorialité dans la vie de
beaucoup d'espèces, nous nous attardons sur les points de vue des
géographes qui se refusent à transposer les leçons de ces
chercheurs à leur domaine. Il en est ainsi des travaux de Malmberg
(1980), Roncayolo (1990), Claval (1995), Le Berre (1992), Badie (1995) ou Di
Méo (1998) qui retirent des exemples fournis par l'éthologie
l'idée qu'il faut s'attacher aux moyens mis en oeuvre pour
contrôler l'espace afin de comprendre le dynamisme des
sociétés. Par ailleurs, que ce soit les éleveurs ou les
autres acteurs qui utilisent, gèrent et contrôlent le territoire,
ils le considèrent comme lieux de
14
symboles et de représentations qui ont fait
également l'objet de nombreux travaux de géographes. Cette
dimension symbolique du territoire est en effet présente dans les
travaux de Gottmann (1952), Dardel (1990), Brunet et al., (1992),
Claval (1995), Di Méo (1998) ou Raffestin (1986), Moine (2005) ou
Debarbieux (1999). En plus, les différents acteurs ont un sentiment
d'appartenance aux territoires qui est une construction mentale. Les
géographes se sont également intéressés à
cette place de l'identité dans la perception du territoire comme le
montrent les travaux de Bonnemaison et Cambrezy (1995), Le Berre (1992), Berque
(1970), Martin (1994), Claval (1995), Di Méo (1998), Moine (2005) ou
Brunet (2001). Le territoire est donc, comme le suggère Mazurek (2012),
du domaine des acteurs, mais surtout des actions et des stratégies qui
peuvent être du domaine du réel, de l'imaginaire ou du virtuel,
mais qui, toujours, reconstruisent des réalités identitaires sur
l'espace. Le territoire est donc multiple, fonction de l'appropriation des
groupes sociaux, et c'est l'interaction entre ces territoires qui forme
l'espace. Finalement, nous convenons avec Moine (2005) que le territoire est un
système complexe dont la définition est fondée sur la
boucle de rétroaction qui l'organise. Son fonctionnement s'appuie ainsi
sur le sous-système acteurs qui agit sur le sous-système de
l'espace géographique que nous allons tenter d'appliquer à la
situation du Nord-Cameroun.
Le territoire a également un intérêt pour
l'élevage. Les travaux sur les relations entre le territoire et
l'élevage montrent que les communautés d'agriculteurs y accordent
une place centrale comme l'attestent Hubert (1994), Gibon et Ickowicz (2010).
Ces relations façonnent les paysages et la biodiversité (Caron et
Hubert, 2000) et produisent des services écosystémiques (Burkhard
et al., 2009). Les différentes dimensions des interactions
entre l'élevage et le territoire ont fait l'objet de définitions
par des auteurs comme Manoli et al. (2010). Après avoir
cherché à comprendre le rapport à l'espace des
activités d'élevage, dans un contexte où les ressources
naturelles deviennent un facteur limitant et où il y a une
compétition avec d'autres activités pour l'utilisation de
l'espace, ces auteurs se centrent sur la représentation de la
localisation des systèmes de production et des densités animales.
Nous nous appuyons également sur les points de vue d'autres auteurs
comme Sere et Steinfeld (1996), Bourn et Wint (1994), Kruska et al.,
(2003), Reid et al., (2000), Thornton et al., (2007) qui ont
proposé de cartographier les différents types de systèmes
de production à une échelle régionale en les mettant en
relation avec divers
15
facteurs (agro-écologiques, localisation, contraintes).
Au regard de l'évolution de la situation des territoires
d'élevage au Nord-Cameroun, nous nous sommes intéressés
par ailleurs à d'autres groupes de travaux qui ont pour objectifs
d'étude les dynamiques d'utilisation des sols (Poccard-Chapuis, 2005 ;
Lambin et al., 2001 ; Ickowicz et al., 2010; Naylor et
al., 2005 ; Bommel et al., 2010).
Sur le plan méthodologique, en prenant en compte
l'emboîtement des sous-systèmes acteurs et espaces
géographiques qui rend difficile l'interprétation et la
compréhension des territoires de mobilité pastorale, nous nous
sommes appropriés la démarche systémique qui est
présentée comme un paradigme capable de guider l'approche et la
compréhension des systèmes complexes. Nous nous appuyons ainsi
sur les travaux de Moine (2005) qui, sans proposer de nouveaux outils, essaie
de repositionner des approches reconnues, les unes par rapport aux autres, dans
un ensemble susceptible de permettre une meilleure compréhension des
territoires. Le diagnostic territorial proposé par l'auteur s'appuie sur
trois sous-systèmes, liés entre eux : le contexte naturel du
territoire, l'organisation de l'espace géographique et l'organisation
des acteurs. L'approche suppose la mise en oeuvre combinée d'outils
permettant de comprendre le fonctionnement d'un territoire et, le cas
échéant, de proposer des simulations de son évolution.
Sans mobiliser, comme le suggère François (1997), la combinaison
d'outils (Systèmes Multi-Agents, Systèmes d'Information
Géographique, Automates Cellulaires, Systèmes de Gestion de Bases
de Données, Systèmes Experts, Réseaux Neuronaux) en amont
desquels l'approche systémique est toujours requise, nous proposons une
démarche concertée pour la gestion durable et paisible des
différents territoires en prenant en compte le point de vue des
différents acteurs en présence. Pour cela, s'impose une
nécessité de diagnostic du territoire qui distingue, à
partir des signes visibles dans le paysage, la situation, le fonctionnement et
la dynamique de l'activité agricole et distingue les enjeux relatifs
à son évolution et aux interactions avec les activités non
agricoles présentes dans le territoire, comme le propose Lardon et
al., (2007) et Benoît (1977). Nous avons tenté comme le
suggère Guetat-Bernard (1999) de repérer les dimensions
conjuguées des différents espaces à la fois social,
perçu ou représenté, de vie, produit. Afin d'aboutir
à une analyse du territoire la plus complète possible, nous avons
retenu comme Merenne (2002) le principe de considérer qu'un territoire
comprend de façon
16
pertinente et générique cinq
sous-systèmes territoriaux : i) la résidence, ii)
l'appropriation, iii) l'exploitation, iv) la communication et les
échanges et v) la gestion.
La capitalisation des approches, visions et expériences
des différents auteurs nous a permis de mieux appréhender les
territoires de mobilité pastorale pour lesquels nous avons
proposé une définition et une caractérisation qui prend en
compte sa diversification et sa complexification. En nous appuyant sur le
contexte du Nord-Cameroun, cette clarification conceptuelle coordonne notamment
les dimensions sociales, politiques, économiques et environnementales,
en considérant tous les usages, sur la base d'une participation de plus
en plus active de tous les acteurs concernés de près ou de loin.
Dans cette région, nous considérons le territoire de
mobilité pastorale comme un champ d'application du pouvoir traditionnel,
mais aussi comme une réalité sociale et culturelle qu'il faut
prendre en compte dans tout processus de décision pour son
fonctionnement et sa gestion.
Positionnement théorique
Sur le plan théorique, nous nous appuyons sur le
modèle de Garrett Hardin qui stipule que, lorsqu'une ressource est en
libre accès, chaque utilisateur est conduit spontanément à
y puiser sans limite, poussant à sa disparition. L'exemple donné,
qui correspond à la situation constatée au Nord-Cameroun, est
celui d'un pâturage sur lequel chaque éleveur cherche à
accroître son troupeau puisque, de toute façon, le prix à
payer est quasi nul par rapport au bénéfice immédiat
obtenu. Mais, au terme de ce processus, tous les éleveurs sont perdants.
On relève ici une parenté de cette « tragédie »
avec la thèse de la surpopulation que Malthus avait
énoncée à la fin du XVIIIème
siècle. Selon Hardin (1968), il n'y a que trois solutions à cette
« tragédie » : la limitation de la population pour stopper la
surconsommation, la nationalisation ou la privatisation. Émise à
la veille du grand mouvement de dérégulation et de
déréglementation de l'économie mondiale, on comprend que
la troisième voie fut exploitée à fond pour justifier le
recul de l'intervention publique. Le modèle de Hardin est une
application du dilemme du prisonnier mis en évidence par la
théorie des jeux. Si les suspects, au lieu de se dénoncer
mutuellement, coopèrent, ils subiront des peines moins lourdes. Mais ils
ne sont pas portés spontanément à la coopération
et, dès lors, tous ont tendance à se comporter en «
passagers clandestins ».
17
C'est la pertinence de ce modèle que va attaquer
vigoureusement Elinor Ostrom sur la base d'une approche
néo-institutionnaliste.
L'analyse s'appuie également sur la théorie de
l'intérêt commun d'Elinor Ostrom. Son approche renouvèle la
façon d'aborder les problèmes, occasion de saisir les relations
qui se construisent, les négociations qui s'observent. Ses travaux ont
montré comment l'étude de formes de propriété et de
gestion collective, outre l'intérêt qu'elle présente en
elle-même, permet des avancées majeures dans la
compréhension de nos économies, au-delà des institutions
dominantes sur lesquelles ont porté la plus grande partie des analyses
des économistes, à savoir les marchés, les firmes ou les
institutions publiques. La problématique d'Ostrom se situe dans ce cadre
néo-classique rénové par le courant
néo-institutionnaliste. Pour résoudre le problème des
passagers clandestins, sur lequel insistait Hardin, Ostrom veut «
contribuer au développement d'une théorie valide au plan
empirique des formes d'auto-organisation et d'autogouvernance de l'action
collective » (Ostrom, 2010 : 40), de telle sorte que « les
appropriateurs adoptent des stratégies coordonnées »
(ibid : 54). Autrement dit, et c'est l'originalité du travail d'Ostrom,
elle cesse de se fixer sur la nature des biens qui déterminerait leur
caractère de commun et elle se penche au contraire sur le cadre
institutionnel et réglementaire qui préside à leur
érection en tant que communs, mieux, qui les institue en tant que
communs. Si la problématique des biens communs/collectifs/publics
s'oppose à celle des enclosures, ce n'est pas parce que, soudainement,
la nature des biens aurait changé ; c'est parce qu'il s'est produit un
changement dans les rapports de forces, dont la sanction va être
l'abolition d'anciennes règles et l'adoption de nouvelles. Au lieu de
voir seulement dans les biens communs comme des ressources, Ostrom les
considère comme une forme particulière de propriété
qui ne peut être séparée d'une délibération
collective permanente.
Collecte de données complémentaires
auprès des acteurs
La collecte des données complémentaires s'est
étalée sur deux années (2012 et 2013). L'analyse de la
genèse de l'installation des éleveurs mbororo dans le
Nord-Cameroun a permis de mieux comprendre leur place et leurs rôles dans
la gestion et le fonctionnement des territoires de mobilité. Les
enquêtes et entretiens auprès de vingt chefs
18
d'exploitation7, choisis de manière
aléatoire, ont permis de revenir sur la façon dont ils ont acquis
les espaces de fixation en analysant les rapports/alliances avec les
lamibé et en insistant sur les rentes captées par ces derniers,
les fréquentes remises en cause des droits d'accès. Nous nous
sommes également penchés sur le rôle des liens que les
éleveurs mbororo tissent avec les citadins et les élites
commerçantes de la région pour pouvoir accéder à
certains territoires. Ensuite, les enquêtes et entretiens dans les
villages environnements nous ont permis de mieux saisir les rapports que les
éleveurs mbororo entretiennent avec les autres groupes qui investissent
également dans l'élevage (Massa, Moundang, Toupouri...) pour
savoir si, par-delà tous les conflits, il n'y a pas des alliances, des
échanges et des complémentarités. De manière
générale, l'historique des migrations et des fixations de ces
acteurs allogènes ont permis de s'intéresser à la
politique au niveau local et régional d'accompagnement des mouvements
des populations. Cela a permis de saisir les stratégies d'adaptation de
ces acteurs à la crise et à l'évolution du fonctionnement
de l'État et de la politique d'aménagement des espaces ruraux de
manière générale.
Enfin, nous sommes revenus sur l'histoire de la protection des
espaces pour savoir qui étaient les lobbies environnementaux, pour
comprendre dans quels contextes l'État a accepté de classifier
ces espaces et la place de l'élevage dans ces espaces.
Par rapport à la mobilité, nous avons fait des
investigations sur les déterminants des mouvements et des
mobilités, en ciblant plus particulier les points suivants : les raisons
qui provoquent les départs, les mobilités, l'identité et
les caractéristiques de ceux qui bougent c'est-à-dire ceux qui
ont les moyens de partir8. Il s'agissait de connaitre le profil de
ceux qui restent et ce que font ceux qui n'ont pas la capacité de
s'adapter, leurs marges de manoeuvre, les dynamiques observées, les
transformations, les évolutions de la mobilité avec la pression
et les contraintes ainsi que les adaptations face à la fragmentation de
l'espace. En outre, si les éleveurs « volent » du
pâturage dans les aires
7 C'est une unité de production familiale
qui se résume à l'ensemble regroupant un homme marié (chef
de ménage), son (ses) épouse(s), leurs enfants et
d'éventuels dépendants directs, les parcelles en
propriété, le cheptel animal et l'ensemble des activités
extra-agricoles. Cette définition assez globale correspond au saare
qui, au Nord-Cameroun, est considéré comme
l'exploitation.
8 En Côte-d'Ivoire par exemple, ceux qui partent
ne sont pas n'importe qui.
19
protégées, ce qu'ils vont au-delà des
limites qui sont finalement flexibles et dénote de la capacité
des éleveurs à bouger, à s'engouffrer dans des
brèches.
Nous nous sommes intéressés non seulement
à la mobilité du troupeau mais aussi à la mobilité
des hommes. La mobilité s'inscrit en effet dans les trajectoires
mêmes des éleveurs. C'est un fond culturel et de capacité ;
nous faisons allusion ici à ce qu'on appelle « le capital
mobilité » que l'on analyse en termes de capabilité. Cette
notion s'appuie sur les débats actuels sur les politiques de transition
en rapport à la mobilité des animaux (continuité de
l'élevage extensif basé sur la mobilité ou
évolution vers l'intensification, mais à quelles conditions
?).
Les enquêtes et entretiens avec les éleveurs ont
par ailleurs permis de cerner la place de la gouvernance dans cette
région, notamment en ce qui concerne la corruption, les rackets et
brimades. Nous partons du constat que l'État laisse faire les
autorités traditionnelles dans l'organisation de l'accès et de la
gestion des territoires ruraux. Face à la puissance des lamibés
dans cette région, les marges de manoeuvre semblent faibles, au risque
d'une explosion sociale comme en RCA et au Nigeria. Or, si nous assistons
à la démission de l'État dans la mise en oeuvre des
politiques de développement territorial, un transfert de
compétence dans ce sens doit être opéré. En effet,
dans un contexte de crise économique persistante et de
décentralisation en cours, on assiste à la mobilisation des
acteurs locaux et à l'émergence des politiques de
développement territorial local. Ainsi, le système administratif
local doit être réactif et d'adapter rapidement aux diverses
mutations du territoire. Ce système doit chercher alors à
susciter la mobilisation des acteurs locaux autour du projet de
développement territorial à partir de nouvelles pratiques de
gestion, d'organisation, de fonctionnement, de négociation, de
concertation, de décisions partagées. Cette orientation fait
appel à la notion de gouvernance territoriale qui, au-delà d'un
terme à la mode, est une nécessité face à la
réalité des territoires en mouvement et en mutation dans une zone
rurale sous forte pression. La gouvernance met l'accent sur la crise de la
gouvernabilité des territoires, la multiplicité et la
diversité des acteurs et l'interdépendance des acteurs entre eux.
La superposition des textes étatiques avec les coutumes locales, qui a
un impact direct ou indirect sur la vie du territoire, créée
des
20
incertitudes chez les acteurs, que vient encore aggraver leur
complexité tant sur le plan juridique que social.
Concernant les modes de gouvernance, nous nous appuyons sur
les travaux d'Olivier de Sardan (2004). En prenant le concept de «
gouvernance » dans un sens purement descriptif et analytique, aussi
empirique que possible, nous le définirons avec lui comme une forme
organisée quelconque de délivrance de biens et services publics
ou collectifs selon des normes et logiques spécifiques. Chaque
forme organisée de cette délivrance (chaque arrangement
institutionnel), fonctionnant selon des normes particulières et mettant
en oeuvre des logiques spécifiques, peut alors être
considérée comme un « mode de gouvernance ». Cette
définition que nous avons retenue se focalise par contre sur une
fonction particulière de l'action collective, de l'autorité ou de
la régulation, qui a longtemps été associée
à l'État, et qui aujourd'hui peut être mise en oeuvre par
d'autres types d'institutions et d'acteurs (communes, villages,
chefferies,...). Elle nous semble donc à ce titre plus opératoire
et mieux adaptée à l'analyse de matériaux empiriques
spécifiques dans le cadre de notre position scientifique.
Apports majeurs dans le cadre de l'Habilitation à
Diriger des Recherches
- Le premier apport se situe au niveau de la contextualisation
spatiale et sociétale de la mobilité pastorale dans la
région du Nord-Cameroun ;
- En second lieu, les territoires de mobilité pastorale
ont été définis et caractérisés avec leurs
ressources, les acteurs en présence et leurs relations, les
modalités d'accès, les modes de gestion, les stratégies
d'accaparement et de contrôle, les conflits ;
- À la fin de l'essai, les démarches
participatives pour la gestion harmonieuse des territoires communs sont
proposées ainsi que des scenarii de gestion et d'organisation des
territoires de mobilité pastorale dans la région du
Nord-Cameroun. Ces démarches amorcent une réflexion sur la
nécessité de coordination entre les différents types
d'acteurs concernés par les territoires de mobilité pastorale
à différentes échelles (villageois, communal et
intercommunal, régional) en impliquant plusieurs niveaux d'acteurs :
éleveurs, agriculteurs, autorités
21
traditionnelles, gestionnaires des aires
protégées, élus locaux, représentants de
l'État, organismes d'appui aux développement,...) ;
Le document est organisé en deux grandes parties. La
première comporte deux chapitres qui portent sur la contextualisation
spatiale et sociétale des territoires de mobilité pastorale. Le
premier chapitre analyse les enjeux spatiaux de la mobilité pastorale au
Nord-Cameroun en s'appuyant d'abord sur les enjeux du développement des
territoires ruraux, puis sur les contraintes de l'élevage mobile dans
cette région et, enfin, sur la pression permanente exercée sur
les territoires de mobilité pastorale. Le deuxième chapitre
présente le contexte sociétal autour des territoires de
mobilité. Il commence par revenir sur la genèse de l'installation
des éleveurs mbororo dans la région afin de mieux comprendre la
marginalité spatiale qu'ils subissent. Il analyse ensuite les relations
tant d'échanges, de complémentarités que de conflits entre
les différents acteurs locaux concernés par la gestion et
l'exploitation des territoires de mobilité. Il s'agit des relations
autorités traditionnelles/éleveurs ; autorités
administratives/éleveurs ; citadins et élites
commerçantes/éleveurs ; agriculteurs/éleveurs ;
éleveurs/éleveurs.
La deuxième partie comporte trois chapitres et porte
sur notre contribution à la compréhension des territoires de
mobilité pastorale. Le troisième chapitre revient sur
l'émergence du concept de territoire, un concept récent et
polysémique dans la géographie humaine, sa place au service du
développement, son application dans le champ du pouvoir, sa
réalité sociale, symbolique et de représentation ainsi que
sa perception comme support d'identité et aire culturelle. Il
présente également l'intérêt du territoire pour
l'élevage avant de discuter des outils pour appréhender les
territoires et la nécessité de le diagnostiquer. Il se termine
par la définition et la caractérisation du territoire de
mobilité pastorale au Nord-Cameroun, en tant que champ d'application du
pouvoir traditionnel et réalité sociale et culturelle. Le
quatrième chapitre analyse en profondeur les territoires de
mobilité pastorale au Nord-Cameroun, leur typologie et leur
fonctionnement. Il analyse en détail la zone de sédentarisation
de la famille (le territoire d'attache), le voisinage du territoire d'attache
(les territoires pastoraux de proximité en saison pluvieuse et en saison
sèche froide), les territoires de transhumance saisonnière (les
territoires complémentaires
22
pour la petite transhumance de saison sèche chaude et
les territoires délimités pour la grande transhumance en saison
des pluies) et, enfin, les territoires illicites de mobilité (les aires
protégées). Le cinquième et dernier chapitre propose une
démarche de concertation pour la reconnaissance des territoires de
mobilité pastorale dans un contexte de forte pression. Après
avoir intégré le territoire de mobilité dans un contexte
de bien commun, il présente les nombreuses interventions aux
résultats mitigés en matière de concertation et de
sécurisation foncière avec les objectifs poursuivis, leurs
acquis, succès et insuccès ainsi que les conflits
d'intérêts entre les utilisateurs et conflits de pouvoirs entre
les instances de médiation et de régulation. Tout en capitalisant
les expériences de ces projets, nous proposons une démarche
d'appui à la gestion concertée des territoires de mobilité
pastorale. Cette démarche commence par la phase d'identification et de
formulation, puis celle d'analyse, ensuite celle de négociation et
concertation et enfin la phase de mise en oeuvre. Elle se termine par la
recherche d'un consensus autour des aires protégées.
23
PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION SPATIALE ET
SOCIETALE DES TERRITOIRES DE MOBILITE PASTORALE
24
|
|



