I.3.4. Les aires protégées sous forte
pression des agriculteurs et des éleveurs
L'État camerounais a classifié depuis
l'Indépendance de larges superficies de savanes en zones exclusives de
chasse et de protection de la flore et de la faune sauvage20.
Interdit au pâturage et à l'agriculture, l'aire
protégée a progressé en surface depuis les années
1970 pour se stabiliser depuis les années 1990. En fait, au
Nord-Cameroun, la tradition de la conservation de la biodiversité est
ancienne. Les aires protégées sont non seulement une
réalité physique, mais également un atout
économique important. Créées entre 1932 et 1980, elles se
composent de trois parcs nationaux (Bénoué 180 000 ha, Faro 330
000 ha, Bouba Ndjidda 220 000 ha) et 27 zones cynégétiques (ZIC)
ou réserves de chasse dont 23 sont affermées aux guides
professionnels de chasse essentiellement expatriés21. Tout ce
vaste réseau d'aires protégées représente
près de trois millions d'hectares, soit 44% du territoire de la
région. La principale contrainte environnementale dans cette zone de
savane est la sécheresse et la pression anthropique forte dans les parcs
et zones de chasse (Figure 6).
20 La première aire protégée
date de l'administration coloniale française en 1916. Il s'agissait du
domaine de chasse de Bouba Ndjidda. C'est surtout à partir de 1932 que
le mouvement de transformation des réserves forestières s'est
amplifié pour atteindre son apogée après
l'indépendance, en 1960.
21 Les zones d'intérêt
cynégétique (ZIC) ont été créées par
arrêté (N° 86/SEDR/DEFC du 21/10/1969) pour les 16
premières. Dix autres seront classées ensuite vers 1972.
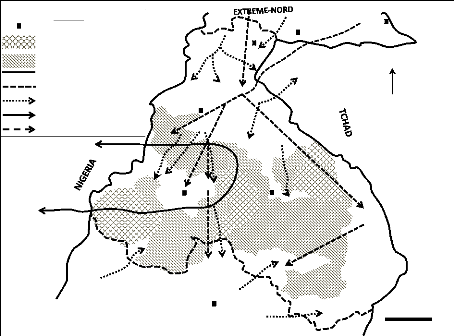
Limite nationale
Limite régionale
Transhumance avec points d'attache Transhumance sans points
d'attache Migrations des populations
Zone d'intérêt cynégétique
Parc naturel
Légende
Ville
ADAMAOUA
Poli Tcholiré
Garoua
Ngaoundéré
Guider
Kaélé
Yagoua
0 100 km
N
44
Source : Adapté de CIRAD et GLG Consultants (2013)
Figure 6. Aires protégées et
mouvements des populations et des animaux au Nord-
Cameroun
I.3.4.1. Des aires protégées
convoitées par les éleveurs transhumants et
sédentaires
Les éleveurs affirment qu'ils « volent
fréquemment le pâturage » dans certaines aires
protégées lors de la transhumance. En effet, des menaces planent
sur leurs activités d'élevage car, à l'origine, les
éleveurs de la région ont toujours considéré qu'il
y avait concurrence entre le bétail et la faune sauvage (Ndamé,
2007). Fréquemment accusés de surpâturage, les
éleveurs sont de plus en plus inquiets et coincés entre les aires
protégées et les champs des agriculteurs. Cette situation est
d'autant plus préoccupante que les pistes à bétail, les
zones de transhumance, même délimitées, et les aires de
repos pour les animaux, sont sous la menace des cultures. C'est tout simplement
la condamnation d'un système d'élevage traditionnel qui a
montré la preuve de son efficacité face aux aléas
climatiques récurrents dans la région. La « redistribution
forcée » de la force de travail et de l'espace proposée aux
différentes activités amène
45
les éleveurs, particulièrement nombreux dans la
région, à réduire de façon draconienne l'amplitude
des transhumances, en abandonnant certains itinéraires et en modifiant
leurs objectifs. Pour de nombreux observateurs, c'est une véritable
crise des systèmes pastoraux sahéliens. On est en train de passer
progressivement des mouvements de troupeaux dictés par des
critères climatiques et écologiques, à des mouvements
justifiés par des choix économiques. On assiste progressivement
à un déplacement du centre de gravité de l'élevage
du Nord-Cameroun vers les zones situées plus au sud de la région.
Cela oblige désormais l'éleveur vivant dans la région et
qui d'ailleurs ne profite d'aucune aide de l'État, à faire des
choix s'il veut continuer son activité, puisqu'il est appelé
à faire face à des charges nouvelles que la suppression du
système traditionnel entraîne. Le cas des éleveurs
transhumants Mbororo semble plus préoccupant. Ces derniers ne pourront
survivre qu'en se sédentarisant et ceux qui ne pourront s'adapter aux
mutations en cours en devenant aussi agriculteurs seront amenés à
disparaître à moyen terme (Ndamé, 2007).
| 


