I.1.2.2. Histoire de la
télédétection
L'histoire de la télédétection peut
être scindée en cinq grandes époques (Midekor et
al., 2013) :
? En 1856, date à laquelle la première
photographie aérienne a été prise par Nadar à
partir d'un ballon, fut le point de départ de la
Télédétection. Cette dernière a tout d'abord
évolué avec le développement de l'aviation, surtout pour
des besoins de reconnaissance militaire.
? De la première guerre mondiale jusqu'à la fin
des années 1950, la photographie aérienne devient un outil
opérationnel pour la cartographie, la recherche
pétrolière, la surveillance
Mémoire Master Siradji, 2021
Page 11
de la végétation. On assiste à un
progrès continu de l'aviation, des appareils photographiques et des
émulsions (couleur, infrarouge noir et blanc, infrarouge fausse
couleur).
? La période qui commence en 1957 et s'achève en
1972 marque le début de l'exploration de l'espace et prépare
l'avènement de la télédétection actuelle. Le
lancement des premiers satellites, puis des vaisseaux spatiaux habités
à bord duquel sont embarqués des caméras,
révèle l'intérêt de la
télédétection depuis l'espace. La première
application opérationnelle de la télédétection
spatiale apparait dans les années 1960 avec les satellites
météorologiques.
? En 1972, un satellite de type ERTS rebaptisé au
Landsat fut le premier satellite lancé en
télédétection pour la gestion des ressources terrestres,
ouvre l'époque de la télédétection moderne. Le
développement constant des capteurs et des méthodes de traitement
des données numériques ouvre de plus en plus les champs
d'applications de la télédétection et en fait un
instrument indispensable de gestion de la planète et de plus en plus un
outil économique.
? Enfin, depuis les années 1970, la
télédétection connait une évolution continue
marquée par : la haute résolution spatiale des capteurs,
diversifications des capteurs utilisés dans des domaines variés,
multiplication des satellites dotés par des capteurs actifs.
I.1.2.3. Processus de la
télédétection
Selon Bul (2008), le processus de la
télédétection comprend généralement sept
étapes (figure 6) à savoir :
Source d'énergie ou d'illumination (A) :
À l'origine de tout processus de
télédétection se trouve nécessairement une source
d'énergie pour illuminer la cible. Le plus souvent, voire dans la
presque totalité des cas, cette source d'énergie est le soleil.
Mais le satellite lui-même peut être source d'énergie :
c'est le cas pour le domaine de la télédétection radar.
Rayonnement et atmosphère (B) : Durant
son parcours « aller » entre la source d'énergie et la cible,
le rayonnement interagit avec l'atmosphère. Une seconde interaction se
produit lors du trajet « retour » entre la cible et le capteur.
Interaction avec la cible (C) : Une fois
parvenue à la cible, l'énergie interagit avec la surface de
celle-ci. La nature de cette interaction dépend des
caractéristiques du rayonnement et des propriétés de la
surface. Chaque objet géographique émet ou réfléchi
un rayonnement dans les
Mémoire Master Siradji, 2021
Page 12
diverses fréquences du spectre
électromagnétique. Cette caractéristique s'appelle le
comportement spectral. En télédétection, on suppose que
tout objet ou classe d'objet sur la surface terrestre possède sa propre
« empreinte digitale » dans le spectre
électromagnétique (la signature spectrale), en fonction de la
longueur d'onde du rayonnement qui est réfléchi ou émis
par lui-même. Ainsi, une parcelle de canne à sucre aura des
signatures différentes en fonction de son stade végétatif
et de son niveau de maturation.
Enregistrement de l'énergie par le capteur (D)
: Une fois l'énergie diffusée ou émise par la
cible, elle doit être captée à distance par un capteur qui
n'est pas en contact avec la cible mais embarqué à bord d'un
satellite ou d'un avion par exemple, pour être enfin enregistrée
sous format numérique.
Transmission, réception et traitement (E) :
Cette information enregistrée par le capteur est transmise,
souvent par des moyens électroniques, à une station de
réception généralement située au sol où
l'information est transformée en images (numériques ou
photographiques).
Interprétation et analyse (F) : Une
interprétation visuelle et/ou numérique de l'image traitée
est ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on
désire obtenir sur la cible.
Application (G) : La dernière
étape du processus consiste à utiliser l'information extraite de
l'image pour mieux comprendre la cible, c'est-à-dire la portion d'espace
étudiée (une ville, une zone inondée, une forêt,
etc.) afin de nous en faire découvrir de nouveaux aspects ou pour aider
à résoudre un problème particulier.
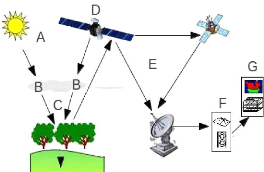
Figure 6 : Les sept étapes du
processus de télédétection selon Bul (2008) : (A) source
d'énergie ; (B) atmosphère ; (C) cible ; (D) capteur ; (E)
transmission, réception et traitement ; (F) interprétation et
analyse ; (G) Application
Mémoire Master Siradji, 2021
Page 13
I.1.3. Technique de Système d'Information
Géographique (SIG)
I.1.3.1. Histoire du SIG
Selon Françoise (2008), l'histoire du SIG peut être
subdivisée en trois grande période à savoir :
? Du début des années 1960 jusqu'en 1975, les
travaux de quatre chercheurs, impliqués dans les différents
projets départ et d'autre dans le monde, sont à l'origine du
concept de « Système d'Information Géographique ». Au
Canada, c'est Roger Tomlinson qui décrit, la méthode la plus
adaptée en termes de coût et de performance à la
cartographie et à l'analyse des informations environnementales
collectées dans le cadre de l'inventaire des espaces canadiens. Au
même moment, en Grande-Bretagne, D.P. Bickmore est chargé de la
réalisation de l'Atlas of Great Britain and Northern Island. Face aux
critiques dont il est l'objet, du fait d'un délai de production trop
long et de la complexité des documents réalisés, il
propose une approche basée sur l'utilisation de technologies
informatiques qui permettrait de stocker et de traiter les données, de
modéliser les situations et de restituer de façons cartographique
les résultats pour un rapport. Ces deux expériences
simultanées vont parvenir à des conclusions similaires quant
à l'intérêt du développement d'une filière
numérique en cartographie. Aux États-Unis, Howard Fisher et Jack
Dangermond développent une nouvelle méthode de cartographie
automatique, fondée sur des réalisations graphiques rapides et
peu coûteuses, qui associent à la carte des données
statistiques. Ces chercheurs, animés par la même motivation de
développer un outil technologique novateur afin d'accroître les
performances et la qualité de la production cartographique et d'en
diminuer les coûts, sont aujourd'hui considérés comme les
précurseurs des SIG.
? À partir de 1973 jusqu'au début des
années 1990, l'intérêt de développer ce type de
système intégré est admis et la prise en charge du
développement est assurée par des institutions nationales,
surtout Nord-Américain. Ces années sont celles de la recherche
universitaire qui débouchera sur les concepts fondamentaux et les
premiers algorithmes d'analyse spatiale. La motivation va de faire avec
l'avènement de l'informatique qui s'accompagne d'une diminution des
coûts d'équipement et avec la fourniture de données
satellitaires sous forme d'images numériques. C'est aux
États-Unis que les premiers systèmes opérationnels ont vu
le jour. On peut citer, à titre d'exemples, le logiciel «
Geographic Resource Analysis Support System » (Grass)
développé à partir de 1982 par les laboratoires de
recherche du
Mémoire Master Siradji, 2021
Page 14
département de la défense américaine ou
encore le logiciel Arc Info de la société ESRI (Environmental
Systems Research Institute) fondée par Jack Dangermond à la fin
des années 1960 et dont l'origine est le « Laboratory for Computer
Graphics » de l'Université de Harvard, créé par
Howard Fisher.
? Dès 1990, l'exploitation commerciale du SIG a
débuté en profitant des progrès technologiques
réalisés en micro-informatique. Les logiciels proposés
sont divers et s'accompagnent de toute une gamme de produits matériels
permettant d'acquérir une chaîne complète de traitement
incluant les modalités d'acquisition et de restitution de l'information.
Grace aux divers logiciels, une explosion de marché concernant à
la fois le matériel, les logiciels et les données entraîne
la multiplication des utilisateurs qui mettent en oeuvre des applications dans
des domaines extrêmement variés. L'implantation des SIG dans
divers secteurs d'activité est facilitée par une concurrence
commerciale et par la standardisation des produits, et une certaine
banalisation de l'utilisation des SIG. Sous la pression d'une demande
croissante, le marché du logiciel, des données et des services
s'ouvre rapidement.
I.1.3.2. Les différents composants d'un
SIG
Le SIG est constitué de cinq composants majeurs (Collet,
1994) à savoir :
Les matériels informatiques
Le SIG fonctionne aujourd'hui sur une très large gamme
d'ordinateurs, des serveurs de données aux ordinateurs de bureaux
connectés en réseau ou utilisés de façon autonome.
Des systèmes client-serveur en intranet, extranet voire via internet
facilitant ensuite et de plus en plus la diffusion des résultats.
Les logiciels
Ils assurent six fonctions suivantes : saisie des informations
géographiques sous forme numérique (Acquisition), gestion de base
de données (Archivage), manipulation des données
géographiques (Analyse), mise en forme et visualisation (Affichage),
représentation du monde réel (Abstraction), la prospective
(Anticipation).
Mémoire Master Siradji, 2021
Page 15
Les données
Les données représentent le contenu même
de SIG. Elles peuvent être des cartes géographiques et/ ou des
informations relatives à ces objets. C'est la composante la plus
importante d'un SIG. Les données géographiques peuvent
être, soit importées à partir de fichiers, soit saisie par
un opérateur. Les utilisateurs
Le SIG étant avant tout un outil, qui s'adresse
à une très grande communauté d'utilisateurs depuis ceux
qui créent et maintiennent les systèmes jusqu'aux personnes
utilisant dans leur travail quotidien la dimension géographique. Avec
l'avènement de SIG sur l'internet, la communauté des utilisateurs
de SIG s'agrandit de façon importante chaque jour, il est raisonnable de
penser qu'à brève échéance, nous serons tous
à des niveaux différents des utilisations de SIG.
Les Méthodes et Savoir-faire
Le SIG fait appel à de divers savoir, donc à des
divers métiers qui peuvent être effectués par une ou
plusieurs personnes. On retiendra notamment la nécessité d'avoir
des compétences en analyse des données et des processus, en
traitement statistique et en traitement graphique.
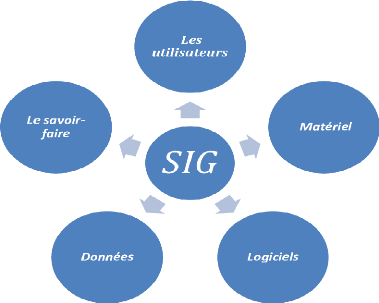
Figure 7 : Différents composants d'un
SIG (Mahdid, 2019)
Mémoire Master Siradji, 2021
Page 16
| 


