103
Conclusion
Les ligneux pérennes de la localité de Houdouvou
sont dégradés par les affres
climatiques et les activités anthropiques. L'analyse
des variabilités pluviométrique, des indices de diversités
(Indice de Shannon H'= 1,518891351, Indice de Simpson D= 0,032777199166,
Equitabilité EQ = 0,16325528) et des densités (195 tiges/ha)
permet de confirmer la dégradation des ligneux pérennes. De plus,
la quantité de ligneux prélevé, les modes de
préparations des champs, les principales cultures pratiquées, le
degré d'occupation de l'espace par l'agriculture et les habitations
corrobore l'hypothèse de la dégradation spatio-temporelle des
ligneux pérennes par les activités humaines. Par ailleurs, les
défaillances de l'administration et les limites de la législation
aggravent et accélèrent le processus de dégradation qui
aura des conséquences environnementaux et socio-économiques dans
ladite localité.
104
Chapitre 3. Effets de la dégradation des ligneux
pérennes
Introduction
La perte de surface forestière dans le monde progresse
d'années en années,
notamment dans les régions tropicales. Le recul de
l'arbre et de la forêt en Afrique tropicale sèche est le plus
symbolique des phénomènes de désertification qui affectent
le Sahel depuis une bonne décennie. Chaque année, ce sont des
centaines de milliers d'hectares qui sont déboisés dans les zones
sahéliennes, La désertification et la déforestation sont
les principales conséquences de la destruction de ces surfaces
végétales. De même, la dégradation des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou à des
conséquences directes sur la nature en générale et sur les
hommes et leurs activités en particulier. Etant un lieu
d'approvisionnement par excellence en bois, les ligneux pérennes de
cette localité son en raréfaction et les conséquences sont
perceptibles à plusieurs niveaux. . La survie biologique du Sahel est en
jeu, survie humaine et animale aussi bien que végétale.
L'objectif de ce chapitre est d'analyser les conséquences
environnementaux d'une part est les conséquences
socio-économiques de la dégradation des ligneux pérennes
d'autres part.
3.1. Les effets environnementaux de la
dégradation des ligneux pérennes
La dégradation des ligneux pérennes à des
conséquences directes sur les
composantes de l'environnement. Ces conséquences
s'observent au niveau de de l'augmentation du taux de mortalité des
ligneux pérennes, au niveau de la raréfaction des espèces
dans la localité. De plus, les zones dégradées se
multiplient de plus en plus et gagnent en superficie.
3.1.1. Diminution du nombre de ligneux dans la
localité
La conséquence directe de la dégradation des
ligneux pérennes est la diminution
du nombre des arbres dans la localité. La forte
pression des phénomènes naturels notamment la rareté des
pluies et l'abondance de la chaleur entrainent des graves conséquences
sur les ligneux pérennes comme la diminution du nombre des
espèces. En effet les espèces ne pouvant pas s'adapter aux
conditions hydriques entent en défoliation (photo 3), sèchent
parfois meurent complètement. Ce phénomène est observable
à travers les indices de mortalités des individus. (Figure 35)
? Indice de mortalité des espèces
pérennes
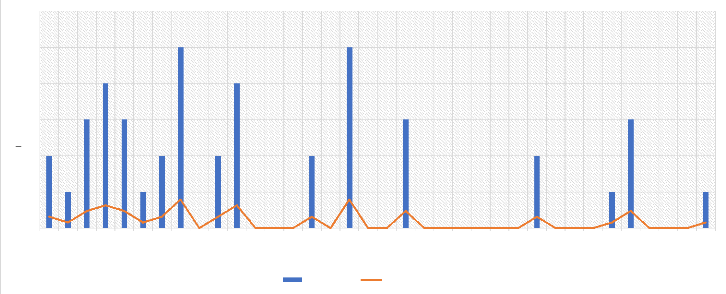
Individus mort
4
6
5
3
0
2
1
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36
Placettes
Arbres mort Taux de mortalité
105
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
Figure 35.Taux de mortalité par placette
106
La figure ci-dessus montre le taux des arbres pérennes
morts dans la localité de Houdouvou. Ainsi, les 11 premières
placettes recensent la majorité des arbres morts dans la
localité. Ces placettes ont été faites dans la zone de
reboisement. Les placettes 19 à 27 ont été faites dans les
zones d'habitations. On ne retrouve pas beaucoup de ligneux morts parce qu'il y
une forte présence des hommes et qu'ils ont la possibilité de
couper les pérennes morts. Ainsi, la courbe du taux de mortalité
montre que la placette 8 et la placette 17 enregistre le plus grand taux de
mortalité. Ce taux est aussi élevé entre la placette 3 et
la placette 5. L'analyse de ce taux de mortalité permet de conclure que
les ligneux pérennes se raréfient grandement dans la
localité. L''analyse de ce taux par zone permet de mieux
appréhender le phénomène.
? Indice de mortalité des espèces
pérennes par zone
L'analyse du taux de mortalité par placette (figure
33) donne un aperçu général de la moralité des
ligneux pérennes. L'analyse du niveau de mortalité par zone donne
une répartition plus explicite de la mortalité des ligneux
pérennes. Tableau 14.
Tableau 14. Taux de mortalité par zone
Zone
|
Arbres
morts
|
Taux de
mortalité
|
Zone de reboisement
|
17
|
269%
|
zone dégradé
|
13
|
206%
|
Champs
|
8
|
127%
|
Zone d'habitation
|
6
|
79%
|
TOTAL
|
44
|
680%
|
|
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
Le tableau ci-dessus montre le taux de mortalité des
ligneux pérennes en fonction des principales zones. Ainsi, la zone
où on rencontre beaucoup de ligneux morts est la zone de reboisement
avec 269%. Le deuxième lieu est la zone dégradée avec 206%
suivi de la zone des champs 127% et la zone d'habitation avec 79%. L'analyse du
taux de mortalité par zone confirme ainsi le fait que les ligneux morts
sont plus nombreux dans la zone de reboisement et moins nombreux dans les zones
d'habitations. La mortalité continue de ces ligneux conduits à la
raréfaction des espèces ligneuses pérennes.
? Indice de raréfaction des ligneux pérennes
La conséquence directement observable de la
dégradation des ligneux pérennes est la raréfaction des
ligneux. Cette raréfaction est observable en fonction des principales
107
espèces qu'on retrouve dans la localité. Le
tableau suivant montre les ligneux qui sont rares dans la localité.
Tableau 15. Indice de raréfaction par espèces
N°
|
Espèces
|
Indice de
raréfaction
|
Nombre
d'individus Non-
rare
|
Nombre
d'individus
rare
|
1
|
Acacia Albida
|
78
|
Non Rare
|
0
|
2
|
Acacia nilotica
|
86
|
0
|
Rare
|
3
|
Acacia seyal
|
72
|
Non Rare
|
0
|
4
|
Anacardium occidentale
|
94
|
0
|
Rare
|
5
|
Azadirachta indica
|
22
|
Non Rare
|
0
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
92
|
0
|
Rare
|
7
|
Cissus quadrangularis
|
86
|
0
|
Rare
|
8
|
Colophospermum mopane
|
86
|
0
|
Rare
|
9
|
Combretum migranthum
|
97
|
0
|
Rare
|
10
|
Cobretum glutinosum
|
89
|
0
|
Rare
|
11
|
Dalbrgia melanoxylon
|
97
|
0
|
Rare
|
12
|
Diospyros mespiliformis
|
97
|
0
|
Rare
|
13
|
Eucalyptucus globulus
|
89
|
0
|
Rare
|
14
|
Erophaca baetica
|
97
|
0
|
Rare
|
15
|
Faidherbia albida
|
72
|
Non Rare
|
0
|
16
|
Feretia apondanthera delile
|
97
|
0
|
Rare
|
17
|
Ficus glumosa
|
97
|
0
|
Rare
|
18
|
Ficus sycomorus
|
97
|
0
|
Rare
|
19
|
Grewia mollis juss
|
92
|
0
|
Rare
|
20
|
Grewia villosa
|
97
|
0
|
Rare
|
21
|
Gymnosporia senegalensis
|
97
|
0
|
Rare
|
22
|
Hyphaene thebaica
|
94
|
0
|
Rare
|
23
|
Mangifera indica
|
83
|
0
|
Rare
|
24
|
Moringa aleifera
|
97
|
0
|
Rare
|
25
|
Ozora insignis
|
97
|
0
|
Rare
|
26
|
Psidium guajava
|
94
|
0
|
Rare
|
27
|
Sclerocarya birrea
|
86
|
0
|
Rare
|
28
|
Tamarindus indica
|
89
|
0
|
Rare
|
29
|
Ziziphus mauritiana
|
86
|
0
|
Rare
|
30
|
Ziziphus spina-christi
|
94
|
0
|
Rare
|
Total
|
2 656
|
4
|
26
|
|
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
Le tableau 15 indique les indices de raréfaction des
espèces présente dans la localité de Houdouvou. Les
espèces ayant des indices supérieures à 80 sont rares et
celles ayant des indices inférieures à 80 ne sont pas rares. Sur
30 individus, 26 sont
108
considérés comme rares et 4 ne sont pas rares.
Ainsi, Azadirachta indica, Acacia Albida, Acacia seyal et Faidherbia albida
sont considéré comme des espèces qui ne sont pas
rares. On constate ainsi que les espèces sont de plus en plus rares dans
la localité. L'indice de raréfaction des ligneux est
également étudiée en fonction des familles
d'espèces. (Tableau 16)
Tableau 16. Indice de raréfaction par familles
N°
|
Familles
|
Indice de
raréfaction
|
Individus
Non Rare
|
Individus Rare
|
1
|
Arecaceae
|
94%
|
0%
|
Rare
|
2
|
Malvacées
|
97%
|
0%
|
Rare
|
3
|
Mimosaceae
|
50%
|
Non Rare
|
0%
|
4
|
Fabaceae
|
53%
|
Non Rare
|
0%
|
5
|
Meliaceae
|
22%
|
Non Rare
|
0%
|
6
|
Balanitaceae
|
92%
|
0%
|
Rare
|
7
|
Moracée
|
94%
|
0%
|
Rare
|
8
|
Myrtaceae
|
83%
|
0%
|
Rare
|
9
|
Tilaceae
|
78%
|
Non Rare
|
0%
|
10
|
Anacardiaceae
|
61%
|
Non Rare
|
0%
|
11
|
Caesalpiniaceae
|
89%
|
0%
|
Rare
|
12
|
Celastraceae
|
97%
|
0%
|
Rare
|
13
|
Combretaceae
|
86%
|
0%
|
Rare
|
14
|
Rubiaceae
|
97%
|
0%
|
Rare
|
15
|
Rhamnaceae
|
81%
|
0%
|
Rare
|
16
|
Vitaceae
|
86%
|
0%
|
Rare
|
Total
|
1261%
|
5
|
11
|
|
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
Le tableau ci-dessus analyse la raréfaction des
ligneux pérennes en fonction des principales familles d'espèces
qui ont été inventoriées. Sur 16 familles
d'espèces, cinq familles sont considérées comme
étant nombreuses car leurs indices de raréfaction sont
inférieurs à 80. Par ailleurs, 11 familles sont
considérées comme rares car leur indice est supérieur
à 80. Ainsi, la famille des Meliaceae (22), Mimosaceae (50),
Fabaceae (53) Anacardiaceae (61) et (Tilaceae) sont
considéré comme nombreuse dans la localité. Par contre, la
famille des Arecaceae, Malvacées,
Balanitaceae, Moracée, Myrtaceae,
Caesalpiniaceae, Celastraceae, Rubiaceae,
Rhamnaceae, Combretaceae, Rubiaceae, Rhamnaceae,
Vitaceae sont considérées comme rare.
109
? Abondance relative des espèces
L'analyse de l'abondance relative permet de déterminer
les espèces les plus abondantes dans la localité et les
espèces en voie de disparition. Le tableau 17 montre l'état
d'abondance des principales pérennes.
Tableau 17. Abondance relative des espèces
N°
|
Espèces
|
Nbre Individus
|
Abondance
relative
|
1
|
Acacia Albida
|
37
|
0,059
|
2
|
Acacia nilotica
|
42
|
0,066
|
3
|
Acacia seyal
|
31
|
0,049
|
4
|
Anacardium occidentale
|
17
|
0,027
|
5
|
Azadirachta indica
|
157
|
0,248
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
6
|
0,009
|
7
|
Cissus quadrangularis
|
16
|
0,025
|
8
|
Colophospermum mopane
|
36
|
0,057
|
9
|
Combretum migranthum
|
7
|
0,011
|
10
|
Cobretum glutinosum
|
20
|
0,032
|
11
|
Dalbrgia melanoxylon
|
1
|
0,002
|
12
|
Diospyros mespiliformis
|
5
|
0,008
|
13
|
Eucalyptucus globulus
|
36
|
0,057
|
14
|
Erophaca baetica
|
5
|
0,008
|
15
|
Faidherbia albida
|
64
|
0,101
|
16
|
Feretia apondanthera delile
|
5
|
0,008
|
17
|
Ficus glumosa
|
1
|
0,002
|
18
|
Ficus sycomorus
|
3
|
0,005
|
19
|
Grewia mollis juss
|
12
|
0,019
|
20
|
Grewia villosa
|
5
|
0,008
|
21
|
Gymnosporia senegalensis
|
3
|
0,005
|
22
|
Hyphaene thebaica
|
10
|
0,016
|
23
|
Mangifera indica
|
33
|
0,052
|
24
|
Moringa aleifera
|
2
|
0,003
|
25
|
Ozora insignis
|
3
|
0,005
|
26
|
Psidium guajava
|
11
|
0,017
|
27
|
Sclerocarya birrea
|
18
|
0,028
|
28
|
Tamarindus indica
|
13
|
0,021
|
29
|
Ziziphus mauritiana
|
23
|
0,036
|
30
|
Ziziphus spina-christi
|
10
|
0,016
|
Total
|
632
|
1
|
|
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
110
Le tableau ci-dessus montre l'abondance en pourcentage des
principales espèces Dans la localité. Ce tableau permet de voir
qu'il y a que deux espèces qui sont abondantes dans la localité
de Houdouvou. Il s'agit d'Azadirachta indica avec 0,248 % et de
Faidherbia albida avec 0,101%. Tous les autres espèces ne sont
pas abondantes et se situe en dessous de 40%. Les espèces en voie de
disparition sont Ficus glumosa (0,002), Dalbrgia melanoxylon (0,002),
Moringa aleifera (0,003), Ozora insignis (0,003), Gymnosporia senegalensis
(0,005), Ficus sycomorus (0,005). Cette indice est aussi analyser en
fonction des principales familles d''espèces et permet de
déterminer les familles les moins abondantes dans la localité.
Figure 36.

Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
Figure 36. Abondance relative par familles
L'analyse de l'abondance relative des familles
d'espèces permet de déceler deux familles dont le niveau
d'abondance est supérieur à 50 %. Il s'agit de Meliaceae
(0,25), Fabaceae (0,16). Deux familles comprises entre 40 et 50%.
Il s'agit Anacardiaceae (0,12) et Mimosaceae (0,11). Deux
familles comprises entre 30 et 40. Il s'agit de Tilaceae (0,08) et de
Myrtaceae (0,08). Dix familles dont l'abondance est inférieure
à 20 %. Ainsi, les familles d'espèces dans la localité de
Houdouvou ne sont pas abondantes, cet état traduit une
raréfaction des ligneux pérennes.
111
? Etat général de la végétation
pérenne
Les enquêtes de terrain menés ont permis d'avoir
une perception du niveau d'érosion des ligneux pérennes dans la
localité. Ils nous ont permis d'évaluer le niveau de la
végétation dans l'optique de voir si elles ont augmenté ou
diminué. La figure suivante montre clairement l'état des
végétaux pérennes à Houdouvou.

60
Nombres d'individus
50
40
30
20
10
0
70
En diminution En augmentation Sans Changement
Touché
Etat de la végétation
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 37. Etat des ligneux pérennes
La figure ci-dessus montre l'état de la
végétation pérenne dans la localité de Houdouvou.
Les enquêtes ont permis de relever que les ligneux pérennes sont
en diminution contrairement aux autres années. Ainsi sur 120 personnes
enquêtés, 66 pensent que les ligneux pérennes sont en
diminution, 21 pensent que c'est sans changement, 21 pensent que c'est
touché et seulement 12 pensent que c'est en augmentation. Les personnes
qui pensent que les ligneux sont en augmentation sont
généralement les jeunes et ceux qui n'ont pas durées dans
la localité. Les personnes âgées et celles ayant
durées dans la localité affirment sans ambages que les ligneux
pérennes sont en diminution.
Pair ailleurs, le degré de leur diminution a
été étudié pour voir la fréquence à
laquelle ces ligneux se dégradent. (Figure 38)
Dégré de diminution
|
Faible
Moyen
Fort
|
|
|
|
|
0 10 20 30 40 50
Nombre de personnes
112
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 38. Degré de dégradation des ligneux
pérennes
La figure 38 illustre la vitesse à laquelle les
ligneux pérennes diminuent. Ainsi, les enquêtes ont permis de voir
que le degré de diminution est fort. En effet, 45 personnes sur 120
pensent que les ligneux pérennes diminuent de manière forte, 39
pensent que le degré de diminution est moyen et 36 pensent que le
degré de diminution est faible. Ainsi, la conséquence directe de
la dégradation des ligneux pérenne est la diminution du nombre
d'espèces dans la localité. Cette raréfaction est à
l'origine de l'augmentation du nombre des espaces dégradées ainsi
des températures.
? Faible fréquences des ligneux
pérennes
L'effet direct de la dégradation des ligneux
pérennes est la faiblesse de la fréquence de ces ligneux. Les
indices de fréquence permettent d'apprécier le niveau
d'apparition des ligneux pérennes dans la localité. La
fréquence des principales espèces pérennes est
représentée dans le tableau 18.
113
Tableau 18.Fréquence des espèces pérennes
N°
|
Espèces
|
Nbre de
relevé
|
Fréquence
|
1
|
Acacia Albida
|
8
|
22,22
|
2
|
Acacia nilotica
|
5
|
13,89
|
3
|
Acacia seyal
|
10
|
27,78
|
4
|
Anacardium occidentale
|
2
|
5,56
|
5
|
Azadirachta indica
|
28
|
77,78
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
3
|
8,33
|
7
|
Cissus quadrangularis
|
5
|
13,89
|
8
|
Colophospermum mopane
|
5
|
13,89
|
9
|
Combretum migranthum
|
1
|
2,78
|
10
|
Cobretum glutinosum
|
4
|
11,11
|
11
|
Dalbrgia melanoxylon
|
1
|
2,78
|
12
|
Diospyros mespiliformis
|
1
|
2,78
|
13
|
Eucalyptucus globulus
|
4
|
11,11
|
14
|
Erophaca baetica
|
1
|
2,78
|
15
|
Faidherbia albida
|
10
|
27,78
|
16
|
Feretia apondanthera delile
|
1
|
2,78
|
17
|
Ficus glumosa
|
1
|
2,78
|
18
|
Ficus sycomorus
|
1
|
2,78
|
19
|
Grewia mollis juss
|
3
|
8,33
|
20
|
Grewia villosa
|
1
|
2,78
|
21
|
Gymnosporia senegalensis
|
1
|
2,78
|
22
|
Hyphaene thebaica
|
2
|
5,56
|
23
|
Mangifera indica
|
6
|
16,67
|
24
|
Moringa aleifera
|
1
|
2,78
|
25
|
Ozora insignis
|
1
|
2,78
|
26
|
Psidium guajava
|
2
|
5,56
|
27
|
Sclerocarya birrea
|
5
|
13,89
|
28
|
Tamarindus indica
|
4
|
11,11
|
29
|
Ziziphus mauritiana
|
5
|
13,89
|
30
|
Ziziphus spina-christi
|
2
|
5,56
|
Total
|
|
124
|
344,44
|
|
Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
Le tableau ci-dessus montre le niveau de fréquence des
principales espèces inventoriées dans les 36 placettes des zones
de reboisements, des zones de cultures, des zones d'habitations et des zones
dégradées. La liste des 36 espèces permet
d'apprécier ainsi les fréquences des ligneux pérennes.
L'espèce ayant la plus grande fréquence dans la localité
est Azadirachta indica avec77.78%. Les espèces ayant les plus
petites
114
fréquences sont Combretum migranthum,
Dalbrgia melanoxylon, Diospyros mespiliformis, Erophaca
baetic, Feretia apondanthera delile, Ficus glumosa, Ficus sycomorus,
Grewia villosa, Gymnosporia senegalensis, Moringa
aleifera, Ozora insignis avec chacune 2,78%. Plusieurs seuils
permettent ainsi de classer la fréquence de ces espèces en
espèces de faibles ou de fortes fréquences. (Tableau 19)
La classification des espèces en groupe est la
résultante des typologies selon les proportions. Dans le cadre de notre
étude, il existe quatre (04) différents groupes d'espèces.
Cette classification explique en générale la typologie des
espèces pérennes en fonction des classes en pourcentage des
totales et dans la localité. Ainsi donc, on retrouve dans cette analyse
:
- Les espèces très rares dont les taux sont
compris entre]0 S 1[% ;
- Les espèces rares dont les taux varient de]1 - ? 5[%
;
- Les espèces moyennement fréquentes dont les taux
sont compris entre]5 - 10[%
- Les espèces très fréquentes dont le
taux sont compris entre]? 10[% ; sont illustrer dans les tableaux de lecture
ci-dessous.
Tableau 19.Fréquence totale des espèces par classe
de pourcentage
Espèces de
fréquence] ? 10 [% de total
|
Espèces de fréquence moyenne] 5 - 10[% de
total
|
Espèces de
fréquence rare
] 1 - ? 5[% de total
|
Espèces de
fréquence très
rare] 0 = 1[% de total
|
Acacia Albida
|
Anacardium occidentale
|
Combretum migranthum
|
|
Acacia nilotica
|
Balanites aegyptiaca
|
Dalbrgia melanoxylon
|
|
Acacia seyal
|
Grewia mollis juss
|
Diospyros mespiliformis
|
|
Azadirachta indica
|
Hyphaene thebaica
|
Erophaca baetica
|
|
|
115
Cissus
quadrangularis
|
Psidium guajava
|
Feretia
apondanthera delile
|
|
Colophospermum mopane
|
Ziziphus spina-christi
|
Ficus glumosa
|
|
Cobretum glutinosum
|
|
Ficus sycomorus
|
|
Eucalyptucus globulus
|
|
Grewia villosa
|
|
Faidherbia albida
|
|
Gymnosporia senegalensis
|
|
Mangifera indica
|
|
Moringa aleifera
|
|
Sclerocarya birrea
|
|
Ozora insignis
|
|
Tamarindus indica
|
|
|
|
Ziziphus mauritiana
|
|
|
|
|
Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
L'analyse de la fréquence des principales
espèces en fonction des classes de pourcentage permet de faire ressortir
la classe des espèces ligneuses afin de de faire ressortir le niveau de
rareté des ligneux pérennes. On retrouve ainsi 13 espèces
de forte fréquence. Il s'agit Acacia Albida, Acacia nilotica, Acacia
seyal, Azadirachta indica, Cissus quadrangularis, Colophospermum mopane,
Cobretum glutinosum, Eucalyptucus globulus, Faidherbia albida, Mangifera
indica, Sclerocarya birrea, Tamarindus indica, Ziziphus mauritiana. En
outre, 6 espèces ont sont considérées ayant une
fréquence moyenne. Il s'agit ainsi Anacardium occidentale, Balanites
aegyptiaca, Grewia mollis juss, Hyphaene thebaica, Psidium guajava, Ziziphus
spina-christi. Par ailleurs, 11 espèces ont une fréquence
rare. Il s'agit de Combretum migranthum, Dalbrgia melanoxylon, Diospyros
mespiliformis, Erophaca baetica, Feretia apondanthera delile, Ficus glumosa,
Ficus sycomorus, Gymnosporia senegalensis, Moringa aleifera, Ozora
insignis.
L'analyse de la fréquence des ligneux pérennes
permet de montrer un état de raréfaction des ligneux dans la
localité de Houdouvou, car sur 30 espèces, seulement 13 sont
considérées comme fréquentes et 11 comme rares.
116
3.1.2. Forte variation du niveau des
températures
La dégradation des ligneux pérennes conduits
à de forte variation de température. Les données de
températures du département du Diamaré nous permettent
d'avoir par extrapolation les variations thermiques de la localité de
Houdouvou. L'analyse de variabilité thermique va se faire de 2001
à 2010 et de 2010 à 2017. La figure 37 montre les tendances des
températures de 2001 à 2010.
? Niveau de température de 2001 à 2010.
La figure 39 illustre les variations de températures
de 2001 à 2010 en fonction des températures annuelle, des
températures minimum et maximum.

Source : station Maroua- Salack, avril 2021
Figure 39. Variation des températures de 2001 à
2010
La comparaison des températures de 2001 à 2010
montre de forte instabilité des maximums et des minimums de
température. On observe ainsi une hausse des températures de 2001
à 2010. L'année 2001 a connu un maximum de 34.9 et celle de 2010,
35.7 tandis que le minimum de 2001 n'est que de 29,3, celui de 2010 est de
29,9. Les années 2001 et 2002 n'ont pas connu de forte variations car il
y pas eu beaucoup d'écart entre les températures minimales,
annuelles et maximales alors que les années de 2003 à 2010 ont
connu de forte variation de froid et de chaud. Les années 2011 et 2017
ont aussi connues de légère variation thermique. (Figure 40)
37,2
35,6 34,7 36,1 35,7 35,3 34,8
29,2 30,6
28,7 28,2 28,2 28,5 28,7
22,9 22,9 23,9
21 21,6 22,7
22
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Années
T° M maxi T°Mmuni T°M
annuelle
température °C
117
Source : station Maroua- Salack, avril 2021
Figure 40. Variation des températures de 2011 à
2017
La figure ci-dessus représente les données
thermiques des années de la période 2011-2017. On remarque dans
l'ensemble que les conditions de température sont moyennement
équitables. Cependant, la température moyenne maximale est
légèrement dépassée les 37,2°c. Il s'agit
notamment de l'année 2013.Tout comme la température moyenne
minimale, on constate la même remarque dans l'ensemble une faible
variation des températures sauf l'année 2016 qui a connu une
légère hausse qui avec 23,9°c. Tandis que la
température moyenne annuelle, les données thermiques de la
période 2011, 2012et 2016, la tendance dépasse 20°c. On
remarque ainsi une petite stabilité des températures à
partir de 2011.
Les activités humaines telles que l'utilisation de
combustibles fossiles, l'exploitation des forêts et l'élevage du
bétail exercent une influence croissante sur le climat et la
température de la terre. Le sol libère beaucoup de carbone ancien
dans les zones où de nombreux arbres ont été abattus. La
déforestation a un double effet négatif sur le changement.
Premièrement, parce que l'arbre qui a converti le CO2 en oxygène
a disparu. Deuxièmement, parce que le sol perd du carbone
séculaire lorsque l'utilisation des sols passe de la forêt
à l'agriculture.
En effet, les arbres pérennes contribuent grandement
à réguler le climat en absorbant le dioxyde de carbone (CO2) de
l'atmosphère. Lorsqu'ils sont abattus, cet effet positif est perdu et le
carbone stocké dans les arbres est libéré dans
l'atmosphère, aggravant l'effet de serre.
118
3.1.3. Extension des zones
dégradées
La deuxième conséquence qui découle de la
dégradation des ligneux pérennes est
l'extension des zones dégradées. En effet, la
forte exploitation des bois cause la multiplication des zones sans ligneux.
Cette absence de ligneux a pour effet direct l'accélération du
phénomène d'érosion dans la localité de
Houdouvou.
? Vaste superficie sans grands ligneux
La dégradation de la ligneuse pérenne laisse de
vastes superficies sans arbres comme le montre la photo suivante.
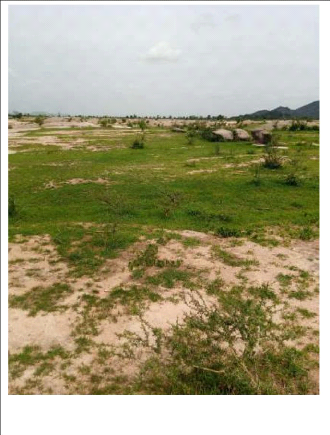
Long: 10°38'24»N Lat: 14°10'12»E Al:
530m
Source : Djafnga, 2021
Photo 6. Vaste espace dégradé
119
La photo ci-dessus montre une vaste étendue d'une
zone dégradée. On remarque sur cette image beaucoup d'hectare
sans une forte végétation ligneuse à part quelque arbuste
de moins de 1 mètre de hauteur. En effet, cette zone était
apurant rempli d'arbres. La forte demande en bois du centre urbain a conduit
à une exploitation anarchique et incontrôlé des ligneux. Le
résultat direct est la disparition des grands arbres et
l'impossibilité des jeunes plants de gagner en hauteur.
La disparition des ligneux dans cette zone à cause la
perte de la couverture pédologique est favorisée l'installation
d'une forte érosion. (Planche photographique 7).
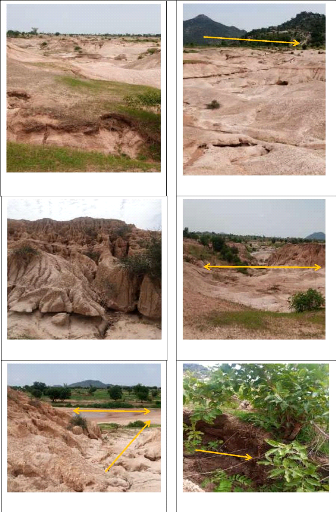
Long: 10°38'52»N Lat: 14°10'52»E Al:
500m
Photo A. Vaste étendue
érodée
Long: 10°38'32»N Lat: 14°10'22»E Al:
501m
Photo C. Modelé de l'érosion
Long: 10°38'22»N Lat: 14°10'63»E Al:
500m
Photo E. Sens d'écoulement des eaux
Long: 10°38'45»N Lat: 14°10'22»E Al:
503m
Photo B. Source de provenance des eaux
Long: 10°38'20»N Lat: 14°10'62»E Al:
511m
Photo D. Elargissement du lit du cours d'eau
Long: 10°38'36»N Lat: 14°10'42»E Al:
508m
Photo F. Processus de destruction d (un
ligneux
120
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 7. Vaste surface érodé
121
La planche ci-dessus montre le système
érosif qui s'est mis en place dans la zone dégradée. La
disparition de la végétation a permis le drainage d'une masse
importante de sol et par ricochet, les sols se voient vidé de leurs
couches arables. Ainsi, la photo A montre le niveau d'étendu de la
végétation, la photo B montre le lieu de provenance des eaux car
les eaux qui érodent ces terres proviennent de la chaine de montage. La
photo C montre ainsi les formes de modelés issues de l'érosion.
La vitesse de destruction du sol a ainsi élargi les champs
d'écoulement de l'eau (Photo D). Le sens d'écoulement de l'eau
est venu rejoindre le mayo (Photo E). Le niveau d'évolution de
l'érosion affecte les petits arbustes de la zone dégradée
(Photo F).
L'érosion hydrique consiste en un enlèvement
des particules du sol, qui sont transportées plus loin en aval. Il
s'agit d'une forme de dégradation des sols, qui varie dans le temps et
dans l'espace. Cet ensemble de processus provient de l'interaction de facteurs
actifs, en particulier l'agressivité climatique passive, notamment la
texture du sol, la couverture végétale, la valeur de pente.
Dans la localité de Houdouvou, les cours d'eau qui
traversent cette zone sont à l'origine des mouvements de masse
observés pendant la saison de pluie. Conséquences, des particules
de terre sont régulièrement arrachées entrainant dans leur
chute des espèces végétales (Planche photographique 7).
3.2. Les effets sur les activités
humaines
La dégradation des ligneux pérennes à
beaucoup des effets sur les hommes et leurs activités. Ces
conséquences vont de la baisse de la production agricole à la
raréfaction des bois de chauffe et des bois d'oeuvre en passant la
raréfaction du pâturage et la raréfaction des surfaces
fertiles. Des enquêtes ont été mené pour avoir
l'avis des populations sur les effets de la dégradation des ligneux
pérennes (figure 41)
100
90
80
Nombre de personnes
70
60
50
40
30
20
10
0
Oui Non
Effes de la dégradation
122
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 41. Effets de la dégradation
Les enquêtes de terrains nous ont permis d'avoir les
avis des populations sur les conséquences de la dégradation des
ligneux pérennes dans la localité de Houdouvou. Ainsi, sur 120
personnes enquêtés, 87 pensent que la dégradation des
ligneux pérennes à des effets sur les activités des
hommes. Ces effets ont été classés en fonction de leur
degré d'importance comme la montre la figure 42.
Sans
importance
|
Peu important Assez important Très important Niveau des
effets
|
|

Nombre de personnes
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 42. Niveau des effets
Les conséquences socio-économiques de la
dégradation des ligneux pérennes dans la localité de
Houdouvou sont très importantes. La figure ci-dessus illustre le
123
niveau de ces effets. On observe ainsi que le niveau des
effets est très importants. Sur 120 personnes enquêtés, 69
pensent que la dégradation des ligneux pérenne à des
effets très important, 36 pensent que ces effets sont peu important, 33
pensent que ces effets sont assez importants et seulement 12 pensent que c'est
sans importance. Les effets de la dégradation de ces ressources
s'observent au niveau de la diminution de la production agricole.
3.2.1. Baisse accru des produits agricoles et extension
des zones de cultures
Les enquêtes avec les riverains ont permis de faire
ressortir les cultures dont la
production a baissé et augmenté dans la
localité. (Figure 43)
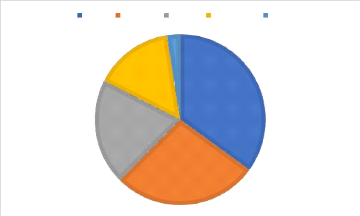
Coton Arachide Sorgho Maraichers Maïs
20%
15%
3%
27%
35%
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 43. Variation de la production agricole
La dégradation des ligneux pérennes a pour
conséquence la dégradation de la qualité du sol et par
ricochet la baisse de la production des cultures. Les enquêtes ont
été menées pour voir les cultures dont la production est
encore bonne. Ainsi, la culture dont la production n'a pas beaucoup
baissé est la culture de coton avec 35%/ Elle est suivie de la culture
des arachides avec 27%, de la culture du sorgho (20%), des cultures
maraichères (15%) et enfin de la culture du maïs (3%).
En effet, la dégradation des ligneux pérennes
à des impacts considérables sur la nature et la qualité du
sol. Les pertes de sol des terres agricoles peuvent avoir de graves
répercussions sur l'environnement en plus de réduire la
productivité des sols. La baisse
124
de productivité d'un sol attribuable à
l'érosion peut être importante. Cela peut découler tout
simplement de l'amincissement de la couche de sol sur la roche, ce qui
réduit le volume disponible pour les racines des végétaux.
Il est plus courant que les rendements culturaux soient réduits par la
perte d'éléments nutritifs des végétaux et que les
propriétés physiques du sol soient dégradées.
(Photo 7)

Long: 10°38'27»N Lat: 14°10'19»E Al:
600m
Source : Djafnga, juillet
2021
Photo 7. Mauvaise production agricole
La photo ci-dessus montre une mauvaise production
d'arachide sur un sol qui a perdu sa fertilité. Les enquêtes
menées auprès du propriétaire du champ font relever que la
production sur cette parcelle à baisser de près de la
moitié par rapport aux années antérieures.
Plusieurs changements ont été observés
dans la localité. Il s'agit notamment de l'extension des zones de
cultures, de la dégradation des ressources ligneuses, de la
raréfaction des surfaces fertiles (photo 7), de la diminution des
ligneux les plus utilisés et la multiplication des espaces
dégradées (Tableau 20).
125
Tableau 20. Changements observés
Changements observés
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Pourcentage valide
|
Pourcentage cumulé
|
Etalement des zones de cultures
|
45
|
37,5
|
37,5
|
37,5
|
Dégradation des ressources ligneuses
|
30
|
25,0
|
25,0
|
62,5
|
Raréfaction des surfaces fertiles
|
21
|
17,5
|
17,5
|
80,0
|
Diminution des ligneux les plus utilisé
|
9
|
7,5
|
7,5
|
87,5
|
Multiplication des espaces dégradés
|
15
|
12,5
|
12,5
|
100,0
|
Total
|
120
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Les principaux changements observés sont
reportés dans le tableau 17. Le changement le plus flagrant est
l'étalement des zones de cultures avec 37,5% et la dégradation
des ressources ligneuses avec 25%. Le troisième changement est la
raréfaction des surfaces fertiles avec 17,5%, la multiplication des
espaces dégradées avec 12,5 % et enfin la diminution des ligneux
les plus utilisés avec 7,5%.
Un ancien de la localité affirme que « pour
trouver du bois pour la cuisson des aliments, il faut s'enfoncé plus en
brousse et allé sur les montagnes car les arbres sont de plus en plus
rares dans le village. Les espaces de cultures ont augmenté avec la
forte croissance de la population »
Les surfaces de cultures augmentent de manière
grandissante du fait de la raréfaction des terres fertiles et la forte
demande de la population en produit agricole. Ces conséquences
proviennent lorsqu'il y a dégradation des ressources pérennes. En
effet, la terre végétale, qui est la couche du sol la plus
fertile, est la plus vulnérable à l'érosion et c'est elle
qui disparaît en premier lorsqu'il y pas des arbres pour les
protéger. Par ailleurs, les mécanismes d'érosion
éliminent de préférence la matière organique du
sol, l'argile et les substances limoneuses fines. L'association de perte de
terre végétale et de fractions plus fines du sol peut avoir de
graves conséquences sur les rendements culturaux. Dans la plupart des
cas, l'épandage supplémentaire d'engrais peut neutraliser les
conséquences de l'érosion sur la fertilité du sol, mais
cela représente une dépense supplémentaire pour
l'agriculteur. La planche photographique suivante montre dans
126
qu'elle mesure les zones de cultures ont augmenté dans la
localité au détriment des ligneux pérennes.

Long : 10°38'16»E Lat :14°10'44»E Al
: 650m
Photo B. Champs à perte de vue
Long: 10°38'32»N Lat: 14°10'22»E Al:
501m
Photo A. Multiplication des zones de
cultures
B
Long : 10°38'18»E Lat :14°10'32»E Al
: 620m
Photo C. Faible densité des ligneux dans la zone
de culture.
A
C
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 8. Extension des surfaces de
cultures
127
La planche ci-dessus montre l'étalement des zones
de cultures dans la localité de Houdouvou au détriment des
ligneux pérennes. En effet, la photo A montre une multiplication des
zones de cultures allant des zones d'habitations jusqu'aux berges de la
rivière. La photo B montre des hectares de champs à perte de vue
et la photo C quant à elle montre des zones de cultures avec peu de
ligneux pérennes. Les baisses de production agricoles dû aux
baisses de la fertilité des sols provoqué par la
raréfaction des ligneux pérennes engendrent l'extension des zones
de cultures pour compenser le manque à gagner en production
agricole.
3.2.2. Raréfaction des bois d'oeuvres, bois de
chauffe et pharmacopées
La surexploitation des produits ligneux pérennes
à comme conséquences directe la raréfaction des
espèces utilisées dans la construction des habitats et dans la
cuisson des aliments. Dans les systèmes énergétiques
ruraux, le bois joue le rôle de combustible dans la satisfaction de
besoins énergétiques aussi essentiels que la cuisson des aliments
et le chauffage. Sa raréfaction se traduit pour des populations
très nombreuses par des difficultés accrues de subsistance et par
la rupture de leur système énergétique. Pour pallier
à ces manquements, les populations utilisent souvent les produits
ligneux non pérennes comme le montre la photo suivante.

Long: 10°38'27»E Lat: 14°10'23»N Al:
610m
Source : Djafnga, juillet
2021
Photo 8. Ressource de combustion alternative
128
La photo ci-dessus illustre des sources de production
alternative aux ligneux pérennes. On observe sur cette photo un fagot de
tige de coton dans le domicile d'un paysan de Houdouvou. La raréfaction
des ligneux pérennes conduits les populations,
généralement les femmes à recueillir les tiges de coton ou
de mil pour faire cuire les aliments. Cette photo montre une conséquence
directe de la dégradation des ligneux pérennes.
Le chef du village fait remarqué que « les
populations sont obligées de collecter les tiges de coton, de mil et
même les épis de maïs égrainé pour faire de la
cuisine parce qu'il y plus d'arbre dans le village ». En effet, la
biomasse dans sa forme solide traditionnelle (bois de feu et déchets
agricoles) représente une portion considérable et souvent
insuffisamment reconnue de l'approvisionnement énergétique total.
Le bois de feu seul couvre la majorité de la consommation
énergétique totale.
Les enquêtes de terrain ont montré que la
principale source de bois de chauffe est le ramassage de bois mort avec 37, 5
%. La coupe de bois vivante vient en second position (Tableau 10). Les
conséquences de la dégradation des ligneux pérennes ne
s'observent pas qu'au niveau de la raréfaction des bois de chauffes et
des bois d'oeuvres, elles s'observent aussi au niveau de la raréfaction
des ligneux utilisés dans le soin des habitants.
La contribution du bois de feu en tant que source
d'énergie ne se limite pas aux systèmes
énergétiques ruraux ou aux secteurs de subsistance. En effet, la
demande urbaine (Maroua) représente une part croissante de la
consommation de bois de feu tant du fait des migrations de ruraux qui
conservent un mode de vie de type rural que de la dépendance des
familles plus pauvres qui continuent à recourir au bois pour leurs
besoins domestiques.
Les entretiens avec les gardiens de la zone de reboisement
ont permis de savoir que plusieurs espèces étaient auparavant
utilisées pour soigner les individus ont disparu et deviennent de plus
en plus rare, ce qui complique lorsque qu'il faut soigner des personnes. Ainsi,
les effets de la dégradation s'observent au plan social avec la
raréfaction des bois d'oeuvre et de chauffe et au plan sanitaire avec la
raréfaction des
129
ligneux utilisés dans la pharmacopée. Ces
conséquences sont aussi observables sur le plan économique avec
la raréfaction du pâturage.
3.2.3. Raréfaction du pâturage
La raréfaction du pâturage est aussi une
conséquence de la dégradation des ligneux
pérennes. En effet, la raréfaction du
pâturage est causée par le surpâturage. Le surpâturage
peut être défini comme une action du cheptel modifiant les
potentialités d'une terre de parcours. La première manifestation
est la modification de la composition floristique. Les espèces
appétées, trop sollicitées, disparaissent au profit
d'espèces non appétées qui ont eu la possibilité de
se multiplier. Cette disparition peut être due à
l'épuisement du système racinaire. Les enquêtes
menées auprès des populations pour déterminer les
activités économiques les plus pratiquées place
l'élevage parmi les derniers des activités. (Figure 44)
80
70
Nombre des individus
60
50
40
30
20
10
0
Agriculture Elevage Commerce Vente de bois
et
charbons
Activités
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 44. Activités les plus pratiquées
La figure ci-dessus montre les activités
économiques les plus pratiquées dans la localité. La
première activité est dont l'agriculture (62,5%), la
deuxième est le commerce (16,6%), la troisième est la vente du
charbon avec 12,5 % et la dernière activité est l'élevage
avec 8,3%. On remarque ainsi que l'élevage vient en dernière
position avec seulement 8,3%. Cette faible proportion s'explique par le fait
que le
130
pâturage est de plus en plus rare dans la
localité, ce qui pousse les populations à se tourner plus vers
l'agriculture et le commerce.
L'autre manifestation du surpâturage est plus connue,
avec l'apparition des phénomènes d'érosion (planche
photographique 7), parfois spectaculaires qu'il entraîne. La
raréfaction du tapis herbacé, voire sa disparition, et le
piétinement favorisent l'érosion hydrique. Cette action est
particulièrement sensible en zone de relief, comme le montre la photo B
qui se trouve dans la zone dégradée et à forte
érosion hydrique. La planche photographique 9 montre de vastes zones
dégradées et des animaux à la recherche du
pâturage.

Photo A. Espèces appétées dans la
zone dégradée
Long: 10°38'20»N Lat: 14°10'62»E Al:
501m
A
Long: 10°38'22»N Lat: 14°10'66»E Al:
611m
Photo B. Troupeaux à la recherche du
pâturage dans la zone dégradée
B
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 9. Animaux à la recherche du
pâturage
La planche photographique ci-dessus illustre le manque
criard du pâturage pour la nutrition du bétail. Ainsi, la photo A
montre une zone dégradée où il ne reste plus que les
espèces appétées et la photo B montre des moutons à
la recherche du pâturage
131
dans la zone dégradée. La dégradation
des ligneux pérennes entraine le phénomène
d'érosion (photo B) et par ricochet la disparition des couches arables
sur laquelle se développent les herbes indispensables à la
nutrition des animaux.
| 

