Conclusion
La désertification, aboutissement final d'un processus
dans lequel interviennent une trop forte pression démographique, la
destruction des zones écologiquement fragiles, la dégradation par
le surpâturage, la surexploitation et le déboisement. La
dégradation des ligneux pérennes a donc des conséquences
environnementales comme la raréfaction du nombre des ligneux,
l'extension des zones dégradées et l'accentuation du
phénomène d'érosion. Au niveau anthropique, les
conséquences s'observent au niveau de la baisse de la
productivité agricole, au niveau de la raréfaction des ligneux
utilisés dans la cuisson des aliments, au niveau du bois disponible pour
la construction des habitats et la pharmacopée. De plus, la
raréfaction du pâturage affecte grandement les éleveurs de
bétail. Cependant, des solutions sont mise en place par les populations
locale, l'Etat et les institutions pour résoudre le problème de
raréfaction des ligneux pérennes.
132
Chapitre 4. Stratégies de gestions, de
pérennisations et perspectives
Introduction
La dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes à des effets considérables sur l'environnement et
les activités humaines. Face à cette situation, la recherche des
moyens de pérennisation est la condition sine qua none pour amortir les
effets de la dégradation de cette ressource indispensable à la
survie des hommes en générale et des habitants de la
localité de Houdouvou en particulier. Pour ce faire, des
stratégies ont été développé localement par
les populations riveraines dans l'optique de freiner la raréfaction des
ligneux pérennes. Aussi, les institutions étatique et
privée interviennent dans la promotion et la protection des ligneux
pérennes. Ce chapitre se propose ainsi de de mettre en relief les
différentes stratégies existantes dans la localité, de les
évaluer et de proposer des moyens pour une meilleure gestion des ligneux
pérennes.
4.1. Gestion locale et paysanne des ligneux
pérennes
Plusieurs moyens sont développés par les
populations locale dans le sens de la protection, de la promotion et de la
préservation des ligneux pérennes. La mise en place de ces moyens
passe par une prise de conscience. Ainsi, le principal moyen est la mise en sol
des plants.
4.1.1. Plantation des arbres
Le principal moyen utilisé par les populations de
localité de Houdouvou pour assurer une utilisation durable des ligneux
pérennes consiste à planter de nouveaux plants. Les
enquêtes de terrain ont été menées pour voir la
proportion des personnes qui ont au moins une fois planté un arbre
depuis qu'elles sont dans la localité. Les résultats de cette
enquête sont représentés dans la figure suivante.

Nombre des individus
40
80
70
60
50
30
20
10
0
Oui Non
Personnes ayant une fois planté un
arbre
133
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 45. Etat des personnes ayant une fois planté un
arbre
La figure ci-dessus montre le nombre des personnes ayant une
fois mis sur terre une plante dans la localité de Houdouvou. Les
enquêtes de terrain ont permis de monter qu'une bonne proportion de
personnes ont déjà planté des arbres. Ainsi, sur 120
personnes enquêtés, 75 ont déjà planté des
arbres et 45 ne l'ont pas encore fait. Ces arbres sont plantés dans les
lieux d'habitations, en bordure de routes, dans les écoles, dans les
champs et dans les zones de reboisements. La photo suivante montre une plante
qui a été mis en sol par les riverains.
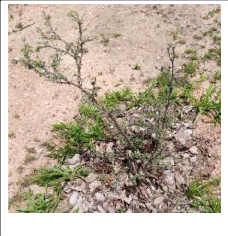
Long: 10°38'21»N Lat: 14°10'13»E Al:
420.2m
Source : Djafnga, 2021
Photo 9. Jeune plant d'Acacia raddiana planté.
134
Cette photo montre une plante d'acacia raddiana
planté dans la localité par les populations riveraines. On
observe ainsi que des moyens sont mis en place pour compenser le déficit
des ligneux pérennes.
En dehors des jeunes plants plantés, d'autres moyens
sont mis en place par les populations pour assurer la protection des ligneux
pérennes.
4.1.2. Mesure de pérennisation
Les enquêtes de terrain ont permis de mettre en relief
quatre principales mesure mise en place par les individus pour assurer la
durabilité des ligneux pérennes. Ces mesures vont de l'entretien
des arbres, de la limitation des zones de cultures à la plantation des
arbres et à la limitation des coupes. La figure 46 représente ces
principales mesures.
Mesure de pérennisation
|
Entretenir les arbres Limiter les zones de cultures Planter les
arbres Limiter les coupes
|
|
|
|
|
0 10 20 30 40 50
Infividus
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 46. Mesures de pérennisation
La principale mesure utilisée par la population
consiste en la limitation de la coupe des arbres pérennes. La
deuxième mesure consiste à planter les arbres, la
troisième à entretenir ces arbres et la quatrième consiste
à limiter les zones de cultures. Ainsi, sur 120 personnes
enquêtés, 45 personnes limitent les coupes d'arbres, 39 optent
pour planter les arbres, 25 personnes pour l'entretient des arbres et seulement
9 personnes pour la limitation des zones de cultures.
135
4.2. Gestion étatique et institutionnelle des
ligneux pérennes.
La gestion des ligneux pérennes dans la
localité de Houdouvou est assurée par l'Etat à travers ses
démembrements et par des institutions.
4.2.1. Gestion étatique des ligneux
pérennes
La gestion étatique des ligneux pérennes dans
la localité de Houdouvou passe par la sensibilisation et le
contrôle des ligneux pérennes, par l'existence des moyens
d'accès aux ligneux, par l'existence et le renforcement des
législations forestière et par l'augmentation des zones de
reboisement.
? Existence des restrictions judiciaires
Au niveau départemental du Ministère des
forêts et de la faune, la stratégie de pérennisation
adoptée est principalement centrée sur le contrôle et la
régulation des ressources ligneuses. Des lois sont mise en place dans ce
sens. Des enquêtes de terrains ont été menées pour
évaluer le niveau de connaissance de ces restrictions par les
populations riveraines. La figure montre la proportion des personnes ayant
conscience de l'existence des mesures pénale.

Non
15%
85%
Oui
Oui Non
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 47. Connaissance de loi sur les ligneux
La figure ci-dessus montre la proportion des riverains qui
savent que des lois existent dans le cadre de la protection des ligneux. Ainsi,
les personnes qui savent que ces lois existent représentent 85% tandis
que les personnes qui ignorent l'existence de
136
ces lois représentent 15%. Ce graphique montre ainsi
qu'une bonne majorité de la population sait qu'elle n'a pas le droit de
couper les arbres comme elles veulent. Les entretiens menés avec les
autorités des eaux et forêts ont permis de faire ressortir les
moyens utilisé dans la préservation des ligneux pérennes.
(Encadré 3)
Encadré 3. Moyens de gestion des eaux et forêts
Les populations n'ont pas le droit de couper abusivement les
ligneux. Elles peuvent élaguer les arbres, mais pas de manière
abusive. Elles doivent être assistées de professionnel pour ne pas
modifier le champ de gravité de l'arbre. Il y a aussi des
périodes bien déterminé pour élaguer les arbres.
C'est en saison sèche qu'on élague. S'ils sont
élagués en saison pluvieuse, ces arbres ont une grande
probabilité de mourir dans quatre ou cinq ans. Il est autorisé de
couper les arbres mais, il faut au préalable se procuré des
documents. Il faut un but précis, soit pour faire un champ ou pour
bâtir une maison. Concernant les champs, sauf les tiges d'avenir sont
autorisés à être coupé.
Agent 1
Pour couper un arbre, il faut se procuré des
documents. Cependant, il faut planter un autre arbre à la place et le
suivre. Il n'est pas question de planter un arbre et de la laisser sans
surveillance. Les agents passent chaque fois pour s'assurer de la suivie et de
l'évolution de l'arbre. Si on trouve une personne en train
d'élagué un arbre frais sans autorisation, on la pénalise
directement. Pour avoir une autorisation, il faut bien spécifier l'usage
qu'on veut faire de cet arbre avant d'avoir une autorisation.
Agent 2
L'encadré ci-dessus montre les différents moyens
utilisés par les agents des eaux et forêts pour la gestion des
ligneux pérennes. Ces agents sont situés dans des points
stratégiques du secteur. L'agent N°1 est situé à la
limite entre la ville de Maroua et le canton de Kalliao. L'agent 2 est
situé à la sortie de Houdouvou. Ces agents interviennent dans les
contrôles à l'entrée (photo 10) et à la sortie des
points stratégiques du canton.

Long: 14° 13'40» Lat: 10°35'50» Al:
4432, 3 m
137
Source : Djafnga, 2021
Photo 10. Agent de contrôle
La ci-dessus montre un agent des eaux et forêts en
exercice de ces fonctions à la sortie du canton de Kalliao. Il
contrôle ainsi les quantités de bois qui sortent de la
localité. Houdouvou étant un lieu par excellence
d'approvisionnement de la ville de Maroua en bois, ces agents sont
chargés de réguler le degré d'exploitation des ligneux
pérennes.
Par ailleurs, des enquêtes ont été
menées auprès des populations pour voir les principaux moyens
d'accès aux ressources ligneuses. Il faut ainsi avoir des autorisations
de la commune ou des autorités des eaux et forêts. La figure 48
représente les principaux moyens d'accès aux ligneux
pérennes.
60
Autorisation de la Autorisation des eaux et Sans
autorisation
commune forêts
138
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 48. Moyen d'accès aux ligneux
Les enquêtes de terrains ont permis de faire ressortir
les principaux moyens d'accès aux ligneux pérennes. Sur 120
personnes enquêtés, 51 personnes accèdent aux ligneux sans
autorisations, 48 personnes se procurent des autorisations des autorités
des eaux et forêts et 21 personnes se dirigent vers la commune. On
remarque ainsi que la majorité des personnes cherchent des autorisations
avant d'avoir accès aux ligneux pérennes.
? Extension des zones de reboisement
Des moyens ont été mis en place pour
créer et étendre les zones de reboisements dans la
localité. Les agents de l'environnement ont mis en place la zone de
reboisement à travers le projet sahel vert depuis 2013. Ainsi, le
premier site de reboisement à vue le jour en 2013, le deuxième
site en 2014. Au total 5 sites de 1250 ha ont vu le jour. La zone est
constituée des espèces naturelles et des espèces
plantées (planche photographique 10). Depuis l'ajout de ces nouvelles
espèces, la zone est considérée comme zone de
reboisement.
D'un point de vue opérationnel, le Gouvernement du
Cameroun a pendant les années 1970/80 initié et mis en oeuvre un
vaste programme de reboisement dénommé « Opération
Sahel vert », le but étant de maitriser l'avancée du
désert, de sensibiliser et d'éduquer les populations à des
gestes citoyens de préservation environnementale. Sa mise en oeuvre a
cependant souffert des conséquences de la crise économique
qu'a
139
connue le pays à partir de 1987. Cette opération
a été relancée dans la région de
l'Extrême-Nord en 2008 par le Ministère de l'Environnement et de
la Protection de la Nature (MINEP) à travers des activités de
reboisement financées par le budget d'investissement public de l'Etat du
Cameroun (BIP). Cette relance s'inscrivait dans la mise en application du
PAN/LCD (2006) dans le cadre du respect de l'engagement du Cameroun
vis-à-vis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification.
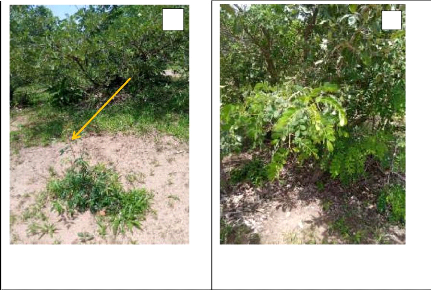
Long: 10°30'11»N Lat: 14°10'10»E
Al: 520.2m Photo A : Espèces pérennes reboisé
A
Long: 10°3031»N Lat: 14°10'23»E Al:
460.6m Photo B : Espèces non plantée dans la zone de
reboisement
B
Source : Djafnga, 2021
Planche photographique 10. Formations végétales
d'alignements
La planche photographique ci-dessus montre les
différents types d'espèces pérennes qui se trouvent dans
la zone de reboisement. On observe sur la photo A une plante (Azadirachta
indica) qui a été planté sous l'initiative du projet
sahel-vert dans la zone de reboisement. La photo B par contre montre une
espèce pérenne qui a poussée de manière naturelle
sans intervention humaine. Cette planche montre ainsi les actions menés
dans l'optique d'assurer une meilleure durée des ligneux
pérennes.
140
En, effet, l'élaboration et la mise en oeuvre des
Projets doivent s'arrimer aux cadres internationaux de validation des
résultats par l'harmonisation des indicateurs pertinents. La
réactualisation du Document de référence du Projet «
Opération Sahel vert » vise donc à prendre en compte les
dynamiques en cours susceptibles d'impacter la mise en oeuvre efficiente des
stratégies opérationnelles de lutte contre la
désertification et la dégradation des sols dans la zone
soudano-sahélienne.
Le rôle croissant de la diversité des acteurs de
la lutte contre la DDTS invite à redéfinir le cadre
réglementaire et juridique de leurs interventions en vue de veiller
à la préservation des intérêts des
communautés bénéficiaires. Le développement de
nouveaux mécanismes et dispositifs internationaux de préservation
environnementale implique à un niveau supérieur, des instances
supra nationales dans les politiques publiques. L'élaboration et la mise
en oeuvre des Projets doivent s'arrimer aux cadres internationaux de validation
des résultats par l'harmonisation des indicateurs pertinents. La
réactualisation du Document de référence du Projet «
Opération Sahel vert » vise donc à prendre en compte les
dynamiques en cours susceptibles d'impacter la mise en oeuvre efficiente des
stratégies opérationnelles de lutte contre la
désertification et la dégradation des sols dans la zone
soudano-sahélienne.
La méthodologie adoptée pour cette
réactualisation s'articule en cinq points:
- une revue documentaire conséquente sur les
différents domaines liés à la dégradation des
terres au Cameroun et aux Projets « Sahel vert » et «
Aménagement du Bassin Versant de la Bénoué » ;
- les entretiens avec les acteurs-clés du processus de
lutte contre la désertification ;
- l'analyse des données
géoréférencées existantes (données SIG,
Cartes, bases de données, etc.) ;
- l'organisation des missions de terrain en vue de confronter
la réalité aux données
géoréférencées existantes pour une orientation
judicieuse des interventions futures de l'Etat et de ses partenaires ;
- l'organisation de deux ateliers de validation du document
réactualisé.
141
A travers le présent document, le Gouvernement de la
République réitère sa ferme volonté d'oeuvrer
durablement à la restauration des terres dans les zones affectées
par la désertification en luttant contre la dégradation des
terres et en contribuant à l'augmentation de la fertilité des
sols. Ce but s'inscrit dans l'objectif global de lutte contre la
pauvreté et dont la vision est définie dans le Document de
Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).
4.2.2. Gestion institutionnelle des ligneux
pérennes
Des institutions interviennent sur la nécessité
de la protection des ligneux pérennes à travers des campagnes de
sensibilisations et des mesures d'accompagnements.
? Sensibilisation et contrôle des ligneux
pérennes
L'action de sensibilisation de la population est avant toute
chose l'appel à la prise de connaissance à la participation du
reboisement mais surtout à la protection des espèces ligneuses
dans la localité. Les riverains pour le besoin de bois d'énergie,
champs agricole et jardin détruisent les arbres. Pour limiter cette
destruction, les agents de l'état et des ONG interviennent dans la
sensibilisation sur la nécessité de préserver les ligneux
pérennes. Des enquêtes ont été mené pour voir
le niveau des personnes qui ont été une fois sensibilisé
sur la préservation des ligneux. Figure 49.
120
100
80
60
40
20
Npmnre de personnes
0
Oui Non
Sensibilisation
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 49. Personnes sensibilisées
142
La figure ci-dessus montre le nombre personnes qui ont
été sensibilisé par un organe sur l'importance de la
préservation des ligneux pérennes. Ainsi, sur 120 personnes
enquêtées, 96 personnes ont été sensibilisées
et 24 n'ont pas été sensibilisées. Ce graphique montre une
proportion assez importante du niveau de gestion. Ces sensibilisations ont
été faites par des ONG, des GIC, des autorités des eaux et
forêts, des autorités traditionnelles et la commune. Figure 50.

23%
33%
17%
17%
10%
Communes ONG
GIC
Autorité tra
Eaux et forêts
ditionnelle
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 50. Agents de sensibilisation et d'accompagnement
La figure ci-dessus montre les différents agents qui
interviennent dans la sensibilisation dans la localité de Houdouvou. Les
autorités traditionnelles viennent en première position avec 33%,
la commune avec 23%, Les agents des eaux et forêts et les GIC avec 17 %
chacun et enfin les ONG avec 10%. On remarque ainsi que des institutions
interviennent aussi dans la protection des ligneux. Ces agents interviennent
avec des moyens d'accompagnement et de suivis. On y retrouve entre autre la
distribution des plants, le contrôle des ressources ligneuses et la
distribution des foyers améliorés. Figure 51.
90
80
70
60
50
40
30
20
Nombre de personnes
10
0
Distribution de plants Agent de contrôle Distribution de
foyers
améliorés
Mesures d'accompagnements
143
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 51. Mesures d'accompagnements
La figure ci-dessus montre les différentes mesures
mise en place pour assurer la préservation des ligneux pérennes.
La première mesure est la distribution des plants avec 65 %, la
deuxième mesure est le contrôle et le suivie avec 22,5 % et la
troisième mesure est la distribution des foyers améliorés
avec 12,5 %. On remarque ainsi que la principale mesure utilisée est la
distribution des plans.
Une grande majorité de la population à
bénéficier de ces mesures comme le montre la figure 52.
|
|
|
|
Bénéficiaires d'un accompagnement
|
Non
Oui
|
|
|
|
|
0 20 40 60 80 100
Nombre des individus
|
|
|
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 52. Bénéficiaires d'une mesure
d'accompagnement
144
Les enquêtes de terrains ont permis de montrer que 75,5
% des personnes enquêtées ont bénéficié des
mesures d'accompagnements et seulement 27,5 % des personnes n'ont pas
bénéficié des mesures d'accompagnements.
4.3. Evaluation des stratégies
utilisées
? Apport considérable dans la protection des
ligneux pérennes
La protection, la gestion et la conservation des ligneux
pérennes est la condition sine qua none pour favoriser une vie à
long terme des arbres dans la localité de Houdouvou. C'est dans cette
optique que des stratégies ont été mise en place au niveau
locale, institutionnel et étatique. Le niveau d'applicabilité de
ces mesures est appréciable tant au niveau local qu'au niveau
institutionnel et étatique.
Au niveau locale, il faut relever de prime abord un niveau
important de prise de conscience des populations en ce qui concerne les valeurs
écologiques et socio-économiques des ligneux pérennes car
sur 120 personnes enquêtés, 72,5% des personnes savent que la
dégradation des ligneux pérennes à des effets
néfastes. De plus, une grande proportion des riverains intervient dans
la plantation des ligneux pérennes dans la localité. De plus, la
majorité d'elles se procurent une autorisation (40%) avant d'avoir
accès aux ressources pérennes.
Au niveau institutionnel, on note une implication au travers
des projets de sensibilisation, de gestion, de suivi et de distribution des
plants. Ainsi, on note la présence des Organisations Non Gouvernementale
(ONG) et des Groupements d'Initiative Commune (GIC) qui oeuvrent de
manière considérable car sur 120 personnes
enquêtées, 80% ont déjà été
sensibilisées dans la protection des ligneux.
Au niveau étatique, la gestion des ligneux est plus
poussée car on relève une réelle implication des agents de
contrôles des eaux et forêts, des gardiens de la zone de
reboisement, des autorités traditionnelles, de la commune et du projet
de reboisement sahel vert. En effets, les agents des eaux et forêts sont
présents dans le village, dans les lieux d'exploitations abusive des
ligneux et dans les principales entrées de la localité
malgré les réticences rencontrées sur le terrain. Les
autorités traditionnelles jouent un rôle considérable dans
la sensibilisation et l'octroi des autorisations pour couper un
145
arbre. Elles sont souvent les auxiliaires entre les
autorités institutionnelles et les riverains. Les gardiens de la
réserve sont quant à eux les boucliers qui permettent aux ligneux
de la zone de reboisement de ne pas sombrer drastiquement dans la
dégradation car malgré les retards de paie, ils continuent de
garder la zone. Avec 1250 hectares de zones reboisées, le projet Sahel
vert à permit de maintenir une bonne diversité et densité
floristique dans la localité.
? Limite des stratégies
utilisées
L'Arbre en tant qu'être vivant à un rôle
écologique indéniable, mais dès lors qu'il se situe au
coeur d'un milieu à forte extension urbaine et démographique,
cela peut également lui conférer de multiples fonctions
socio-économiques. Dans le contexte de paupérisation accrue des
riverains de la localité de Houdouvou, l'adoption de ce principe est
encore incertaine, d'où la vulnérabilité permanente des
essences pérennes face aux multiples conséquences d'une gestion
peu étudiée.
Mis à part la nécessité d'avoir recours
à des méthodes d'intervention mieux conçues et plus
appropriées, on voit aussi que les incitations à planter faites
par les pouvoirs publics présentent un caractère trop ponctuel
sans se projeter dans un contexte de durabilité, ce qui les rend souvent
inefficaces. En effet, il faut relever un délaissement dans la
protection des ligneux pérennes dans la zone de reboisement dans la
mesures ou les gardiens ne reçoivent pratiquement plus ce qui est
fixé dans le cahier de charge du projet. La recherche permanente du
profit individuel prime sur le bien être individuel et la
conséquence directe est la dégradation des ligneux. De
même, l'amour de l'argent pousse les autorités de contrôles
des ligneux à délivrer des permis d'exploitation d'une semaine
pour une maudite somme de 200f et d'un mois pour une somme de 500F. A cette
allure, le phénomène de déforestation risquerait de se
pointer bien tôt.
Malgré l'implication considérable des riverains
dans la gestion des ligneux pérennes, on note une bonne part qui coupe
encore les arbres de manière irrégulière car 42, 7% de la
population accède sans autorisation aux ligneux.
Néanmoins, une véritable durabilité des
arbres pérennes requiert avant tout l'implication de la population
elle-même. Une interrelation doit s'établir entre ces deux
146
entités de telle sorte que les apports issus des
essences soient effectifs pour les habitants qui, parallèlement,
pourront alors être disposés à en devenir les principaux
gestionnaires.
Ainsi, c'est en favorisant le développement d'un
sentiment d'appropriation chez les citadins que les arbres pérennes
pourront vivre plus longtemps dans la localité, et en même temps,
il reste indispensable de promouvoir des actions sur le long terme,
basées sur la mise en relation des trois volets de développement
durable pour faire valoir le statut du patrimoine arboré pérenne.
Des lois doivent ainsi être renforcées, des stratégies
revues, améliorer et préconiser pour une meilleure
pérennisation des ligneux.
4.4. Renforcement de la législation
forestière et perspectives
Les textes de lois en matière des ressources sont un
maillon important dans la protection des ligneux pérennes. D'autres
mesures doivent y être ajoutés afin d'assurer une meilleure
gestion des ligneux pérennes
4.4.1. Renforcement de la législation
forestière
Les politiques de gestion concourent à
l'amélioration des conditions d'utilisations des ressources
forestières ligneuses. Elles s'appuient sur les réalités
socioculturelles, technoscientifiques et économiques. Le recul et la
disparition de même que la dégradation du massif ligneux est due
à l'absence d'une bonne gestion, le non-respect et application
sécuritaire, le faible appui institutionnel, la non budgétisation
(financement) et matériels, les actions anthropiques perpétuent
la dégradation de la ressource pérenne et constituent un obstacle
pour la gestion et conservation durable du couvert ligneux. Pour ce fait, il
nécessite une politique règlementaire juridique et un appui
institutionnel afin que les ligneux pérennes soient
protégée et conservée.
o Au Cameroun, c'est la Loi n°96/12 du 05 août
1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement qui la
réglemente. Dans son article 4, paragraphe d, elle donne une
définition du développement durable comme étant « le
mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre les capacités des générations futures
à répondre aux leurs ».
o La loi forestière de 1994 ne parle, quant à
elle, que de protection des forêts, charge qui incombe à
l'État. C'est d'ailleurs cette gestion centralisée des
147
ressources qui pose problème, car elle n'intègre
pas toutes les parties prenantes. Avec l'avancée remarquable du
processus REDD+ au Cameroun dans les années 2012 et 2013 et le souci
d'engager la société civile et les populations locales dans la
gestion durable des forêts, le Cameroun et bien d'autres pays de la
sous-région se sont engagés dans les processus de réforme
des lois. Cette dernière vise à améliorer le cadre
réglementaire pour une gestion durable des ressources. Le pays a donc
engagé depuis peu le processus de révision de sa loi
forestière datant de 1994, avec pour défis d'assurer la pleine
participation de tous les acteurs et d'intégrer les enjeux
émergents liés à la gestion des ressources
forestières et fauniques (UICN, 2014). Ainsi, la gestion
concertée des ressources impliquant la participation effective des
populations locales est le gage d'une gouvernance environnementale
améliorée.
Les différentes reformes en matières de lois
relatives à la protection de l'environnement ont commencés depuis
1994 et subissent des modifications jusqu'à nos jours. Le tableau
suivant donne le récapitulatif des différentes
réformes.
Tableau 21. Texte de lois sur la protection de la nature au
Cameroun
|
PERIODE
|
TEXTES D'APPLICATION
|
|
1995
|
-Décret N° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les
modalités d'application du régime de la faune
|
|
-2. Décret N° 95 / 531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts
(MINEF)
|
|
1996
|
3. Décret N° 96/642/PM du 17 septembre 1996
Fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des droits de
redevances et taxes relatifs à l'activité forestière
|
1998
|
4. Décret N° 98 /345 de la 21/12/98 portante
organisation du Ministère de l'environnement et des forêts
|
1999
|
5. Décret N° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant
les modalités d'application de l'article 71(1) nouveau de la loi
n°94 /01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la
faune et de la pêche ;
|
|
148
|
2002
|
6. Arrêté N°0222/A/MINEF du 25 mai 2002
portant procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de
contrôle de la mise en oeuvre des Plans d'Aménagement des
Forêts de production du domaine forestier permanent
|
2006
|
7. Instruction N° 1/MINEP/CAB du 19 avril 2006
prescrivant la lutte contre l'exploitation illégale des ressources
naturelles
|
2008
|
8. Arrêté N° 0315/MINEF fixant les
critères de présélection et les procédures de choix
des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière
|
|
9. Arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les
modalités
d'attribution en priorité aux communautés
villageoises
riveraines de toutes forêts susceptibles d'être
érigée en forêts communautaires
|
|
Source : Gilles Herbert FOTSO.
Université de Douala - Master 2 Recherche 2012 adapté par
Djafnga
La multitude de ces réformes administratives montre la
volonté du gouvernement camerounais de protéger son patrimoine
naturel. On remarque ainsi que le premier décret avait pour but de fixer
les modalités d'application du régime de la faune et des
forêts alors que le décret de 2008 entre plus en détail car
il fixe les critères de présélection et les
procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation
forestière et les modalités d'attribution en priorité aux
communautés villageoises riveraines de toute forêts susceptibles
d'être érigée en forêts communautaires. On voit ainsi
la nécessité d'impliquée les populations locales dans la
promotion et la gestion des forêts communautaires.
Les politiques sectorielles relatives à la conservation
de la biodiversité et au développement durable
élaborées au Cameroun incluent principalement le régime
des forêts et de la faune (contenu dans la loi n° 94/01 du 20
janvier 1994) et ses divers décrets d'application, dont les objectifs
comprennent :
- La protection du patrimoine forestier et faunique de la
nation en participant à la conservation de l'environnement et à
la préservation de la biodiversité de façon durable, ainsi
qu'en renouvelant les ressources forestières et fauniques grâce
à une meilleure gestion ;
149
- L'approvisionnement régulier en produits forestiers
et fauniques de façon durable pour les générations
présentes et futures ;
- La participation des populations rurales, des partenaires et
des parties prenantes à la mise en oeuvre, notamment par le biais de la
propriété des forêts communautaires.
La mise en place de ces lois permet de limiter la
dégradation des ligneux pérennes. Toutefois, il faut allier ces
lois avec d'autres mesures plus intégrante afin de mettre sur pied un
système solide et plus innovateur dans le domaine de la protection des
ligneux pérennes. Les perspectives sont ainsi proposées dans
cette optique.
4.4.2. Perspective pour une gestion durable des ligneux
pérennes
Pour assurer une gestion plus efficiente et plus efficace des
ligneux pérennes, des stratégies doivent être revues et
adoptées au niveau de tous les acteurs (populations, institutions,
Etat). Ces stratégies doivent être orientées dans plusieurs
sens. Il faut ainsi :
1' Une gestion intégrée des ligneux
pérennes : Elle consiste à adopter une vision globale et
multifonctionnelle des ligneux pérennes. Elle recherche des voies
possibles qui soient à la fois écologiquement durable,
socialement équitable et économiquement viable. En effet, la
recherche d'une gestion ligneuse écologiquement durable consiste
à toujours mieux comprendre et utiliser les forces de la nature à
l'oeuvre. Ce critère requiert que toutes les décisions concernant
l'aménagement soient fondées sur une compréhension
actualisée et profonde des fonctions écologiques des ligneux.
1' Une gouvernance plus transparente et
équitable : La bonne gouvernance et la transparence sont des
préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et
à une gestion durable des ligneux pérennes dans la
localité de Houdouvou. Les faiblesses et insuffisances du dispositif
institutionnel apparaissent aujourd'hui comme un des principaux écueils
à une bonne gouvernance. En effet, la volonté politique du
gouvernement, la participation effective des populations, la prise de
conscience du secteur privé, comme aussi l'engagement de la
communauté internationale, sont autant nécessaires pour rompre le
cercle vicieux où la pauvreté est à la fois cause et effet
de la dégradation de l'environnement en
150
générale et des ligneux pérennes en
particulier. Une bonne gouvernance dépend des acteurs locaux et des
groupes d'intérêt : il faut qu'ils jouent leur propre rôle
et se respectent les uns les autres.
? Une réduction de la
vulnérabilité des forêts des terres arides aux
événements naturels défavorables : Les
forêts des terres arides sont exposées à plusieurs
difficultés et dangers naturels : les inondations, la sécheresse,
les tempêtes de vent, les précipitations
irrégulières, le stress hydrique, etc. En raison de la pression
démographique sans cesse croissante, la demande est aujourd'hui
supérieure à la production forestière dans les zones
arides. La mise en valeur des forêts dans les zones arides doit donc
envisager l'adoption de mécanismes visant à diminuer la
vulnérabilité des forêts à ces facteurs.
? Une participation des communautés à la
surveillance et à la prévention des menaces pesant sur la
santé des forêts : Les institutions responsables de la
protection des forêts doivent collaborer avec d'autres parties prenantes,
tels que les bûcherons, les producteurs de charbon de bois, les
agriculteurs, les groupes de chasseurs et les éleveurs, pour
prévenir et maîtriser les maladies, les incendies et autres
menaces susceptibles de mettre en danger les forêts des terres arides.
Les populations susceptibles de prêter leur concours doivent être
clairement identifiées et des points focaux fiables doivent être
désignés, encouragés à entretenir un contact avec
le département des forêts et bénéficier de courtes
formations en complément d'autres activités ;
? Une application d'une approche adaptative de gestion
forestière : L'adaptation au changement climatique
nécessite d'adopter une approche de gestion souple, réactive et
préventive. La vigilance et la surveillance sont indispensables pour
déceler les effets du changement climatique sur les
écosystèmes forestiers et pour appliquer une gestion adaptative.
Des systèmes de surveillance fondés sur les conditions locales
doivent être établis dans les zones forestières de vaste
superficie.
? Promouvoir les ressources forestières
d'importance socio-économique : Les forêts ne sont pas
seulement une source de subsistance pour les populations rurales ; elles sont
également de plus en plus souvent une source de produits pour
151
les populations urbaines, qui sont tributaires de la
production des zones rurales à proximité des villes. La gestion
forestière doit faciliter l'accès aux nombreux avantages que
procurent les forêts et contribuer à leur durabilité ;
? Etablir un cadre juridique, politique et
institutionnel favorable à la gestion durable des forêts :
Etablir et appliquer de bonnes pratiques de gestion forestière
représente un grand défi dans la localité de Houdouvou. La
pauvreté tend à encourager les populations à adopter des
stratégies plus simples pour survivre. Les nouvelles règles sont
appliquées durant une certaine période, mais sont ensuite peu
à peu oubliées lorsque l'élan disparaît. La seule
solution consiste à examiner et à réviser en permanence
les lois, les réglementations et les engagements, ce qui est un outil
très important pour assurer le fonctionnement et le suivi des programmes
de gestion. Les obstacles linguistiques doivent être surmontés ;
pour cela, les administrations forestières et les ONG doivent
améliorer la communication avec les communautés locales en les
aidant à comprendre les documents et les procédures de base, en
les expliquant, en les commentant et en les traduisant dans les principales
langues locales.
? Utilisation de la méthode PLASA : La
Méthode PLASA repose sur 5 théories et utilise comme
ingrédients les matériaux disponibles dans la nature (cailloux,
pierres, gravier, sable, fumier, compost, eau). La première phase est le
captage de la frange capillaire. Elle est suivi la mise en place de trou en
forme d'entonnoir inversé et de l'épandage des terres riches et
humide. Les dernières phases concernent le revêtement et la prise
en charge. La méthode PLASA (Planter Sans Arrosage)
détaillée dans la les étapes suivantes :
Etape 1 : Capter la frange capillaire : La
frange capillaire est en géologie la zone de transition une zone
saturée et une zone non saturée. A ce niveau, l'opération
consiste à un trou qui atteint le niveau de cette frange capillaire afin
que le jeune plant puisse bénéficier du système naturel
d'arrosage. Son influence s'observe généralement à partir
de 15 à 20 cm au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la fin
de la saison des pluies (novembre à avril) et selon la nature du sol
(sols latéritiques, argileux, sablonneux...). Ce niveau se reconnait par
une sensation de fraîcheur au toucher de la terre qui sort du fond du
trou.
152
Etape 2 : Faire un trou adéquat : Pour
faire un bon trou, il doit être en forme d'entonnoir renversé afin
de réduire l'action des rayons solaires sur la frange capillaire ; car
un trou à large ouverture accueille plus de rayons solaires qu'un trou
à ouverture modérée.
Etape 3 : améliorer la qualité du
terreau : A ce niveau, l'opération consiste à trouver
une terre bénéfique à la plante car une terre riche en
éléments nutritifs (matière organique, compost, fumier
etc...) constitue une « alimentation riche et équilibrée
» pour une croissance normale et une bonne santé de la plante.
Etape 4 : Poser un revêtement à double
fonction : Le revêtement est posé sur les parois
supérieures du trou et au pied du plant afin de réduire le
processus de dessèchement dû à l'effet des rayons solaires
et au vent. On utilise à ce niveau pierres, cailloux et graviers comme
matériaux de revêtement eu égard aux
caractéristiques protectrices que renferment ces matériaux.
En outre ce revêtement crée un environnement peu
attractif aux termites comparativement au paillage dont l'inconvénient
est de favoriser la prolifération des termites.
Etape 5 : L'arrosage et la protection : Cette
étape est la dernière de la méthode PLASA. La
Méthode PLASA fait de la frange capillaire la source principale
d'alimentation en eau. Cependant, dès l'apparition des signes de
déshydratation du plant (feuilles fanées le matin, craquantes
avec perte d'éclat). L'arrosage se fait, lentement, longuement afin de
réussir l'infiltration de l'eau sous le plant.
La Méthode PLASA enregistre des gains en
économie d'eau et de temps : 1 litre d'eau par semaine par plant, une
fréquence d'arrosage allant de : 1 fois par semaine à 1 fois les
15 jours, 1 fois le mois, et, souvent à 0 arrosage durant la saison
sèche.
La mise en place de cette méthode dans la
localité de Tchéré serait d'une importance remarquable,
car les populations ne vont plus se peiner pour arroser à chaque fois
les plants et les plants auront des meilleures conditions pour se
développer.
La prise en compte de toutes ces stratégies pourrait
endiguer ou freiner la dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou. Une gestion participative
et un développement durable impulsé par la base est une condition
nécessaire à la pérennisation des ligneux
pérennes.
153
| 


