II.2.1 PHASE DE DEVELOPPEMENT
La phase de développement comporte trois étapes
essentielles : le choix du logiciel de programmation, les
fonctionnalités utilisées et l'organisation et la structure du
contenu.
a. Choix du logiciel de programmation
Le logiciel de programmation utilisé est
eXeLearning (eLearning XHTML editor). C'est un logiciel auteur qui est
dédié pour créer des contenus et des modules
d'évaluations dans la perspective d'alimenter les environnements
numériques de travail (ENT) dans une logique de formation, de suivi
et
- 51 -
d'accompagnement des apprenants (Le Clainche, 2010).
Développé à l'Université d'Auckland en
Nouvelle-Zélande, eXeLearning permet de
créer des séquences d'activités d'apprentissage
interactives dans tous les domaines de l'enseignement.
Simple, efficace et multiplateforme (Windows, MacOS, Linux),
ce logiciel permet à l'enseignant de créer des cours attractifs
que l'apprenant qui pourra l'utiliser pour produire des travaux et s'initier
à une utilisation propre des ressources d'Internet.
Devant une grande variété d'outils pouvant
être utilisés pour la conception et la mise en ligne des contenus,
notre choix a porté sur ce logiciel pour les raisons suivantes :
- eXeLearning est un outil
polyvalent qui permet de générer différents types de
contenus adaptés à différents plateformes
pédagogiques telles que Moodle, Claroline, Ganesha,
Dokeos, etc. ;
- eXeLearning est un logiciel open
source (libre et gratuit) ; mais suffisamment performant dans la mesure
où il permet l'intégration de plusieurs types de contenus
(textes, iconographiques, audio ou vidéo) et dans la mesure aussi
où il permet de créer des évaluations interactives avec
une possibilité de suivi des apprenants ;
- des exercices interactifs (textes à trous, QCM, etc.)
peuvent également être proposés ;
- il permet de présenter des contenus sous forme de
documents numériques de qualité professionnelle ;
- eXeLearning propose la
création des outils pédagogiques ou iDevices qui
comprennent une gamme de formes pédagogiques qui décrivent le
contenu (p.ex. objectifs, études de cas, activités de lecture,
texte libre) ;
- 52 -
- Avec eXe, les utilisateurs peuvent
développer des structures d'apprentissage qui leur conviennent et
créer des ressources flexibles et facilement mises à jour ;
- il est conçu pour aider les enseignants et les
concepteurs pédagogiques dans la publication du contenu sur le web, sans
être des experts du HTML ou du XML.
b. Les fonctionnalités utilisées
Nous allons nous attarder uniquement aux
fonctionnalités que nous avons exploitées. Les différents
outils peuvent être classés en deux catégories : les outils
d'édition de textes et les outils d'évaluation.
1. Les outils d'édition de textes
:
Ces outils nous ont permis de rédiger un texte libre,
présenter une activité, proposer une activité de lecture
en donnant des consignes, préciser les objectifs visés à
travers l'activité proposée et présenter un message de
retour suite à l'activité. Les outils d'édition
utilisés sont : activité, activité « lecture »,
objectifs, réflexivité et texte libre.
2. Les outils d'évaluation :
Pour créer les activités d'évaluation,
nous avons exploité les outils pédagogiques suivants :
activité « remplir les blancs », choix multiple, exercice
« vrai ou faux », galaxie d'images et Quiz SCORM.
Chaque activité d'évaluation commence par une
consigne qui sert de base à l'exercice. Il est possible de donner des
indices pour aider l'apprenant à comprendre la question en cas de
besoin. Ensuite, on peut mettre un message de retour approprié
(écho en retour) qui lui permettra de savoir si sa réponse est
exacte.
- 53 -
Hormis le Quiz SCORM qui est un outil d'évaluation
sommative, tous les autres sont des outils d'évaluation formative. En
fait, le quiz SCORM est une variante du QCM, mais qui permet d'enregistrer les
scores de l'apprenant. Mais en amont, le score exigé est fixé
pour que l'exercice soit considéré comme réussi.
Ces différentes ressources qui sont mises à la
disposition de l'élève sont choisies pour susciter la motivation
de celui qui apprend en le renforçant positivement et en lui donnant un
espace dans lequel il puisse apprendre à son propre rythme.
Nous avons mis également l'accent sur le
caractère personnel de l'apprentissage (enseignement
individualisé) et sur les activités à réaliser
(expériences, documentaires et situations-problèmes).
c. Organisation et structure du contenu
La première tâche à réaliser
était d'organiser et de structurer le contenu d'apprentissage dans
l'environnement informatique. A cet effet, nous avons d'abord
créé le plan de la séquence et choisi les activités
pour alimenter ses différentes parties.
Selon la démarche pédagogique centrée sur
l'élève, chaque séquence d'apprentissage porte un titre et
comprend quatre rubriques sous forme d'activités, à avoir :
je m'exerce, j'expérimente, je me documente, je
résous une situation-problème et je découvre les mots
clés. Pour faciliter l'exploration et l'exploitation du
contenu par les apprenants, nous avons remplacé le jargon informatique
par le jargon pédagogique. Ceci dans le but de respecter l'esprit de
notre approche basée sur la responsabilisation et l'intérêt
de l'apprenant qui le pousse à se prendre en charge en faisant le choix
de l'activité qu'il désire réaliser.
A présent, nous allons présenter les
éléments constitutifs de chaque module. Nous décrirons
ci-dessous les six unités pédagogiques de base.
- 54 -
Les figures suivantes dévoilent la présentation
de quelques pages du didacticiel. La figure II.3 montre l'arborescence du plan
et la page d'accueil du didacticiel.

Figure II.3 : Arborescence du plan et page d'accueil
du didacticiel
Après cette étape, nous avons ensuite repris ces
quatre activités de base dans les autres modules formant ainsi un
système informatique plus complexe avec 15 (quinze) module, dont la
granulométrie (taille) a été bien étudiée
(ni trop grande, ni trop petite à la fois). Parmi ces modules, on compte
5 (cinq) qui cadrent avec les synthèses minérales et 10 (dix) qui
portent sur les synthèses organiques.
- 55 -
1. UNITE 1
Cette unité donne le titre du module, les objectifs
poursuivis, les pré-requis et l'activité « lecture ».
Les objectifs sont formulés à la première personne pour
sensibiliser l'apprenant sur les savoirs, les savoir-faire et les
savoir-être qu'il doit acquérir (cfr. Figure II.4)
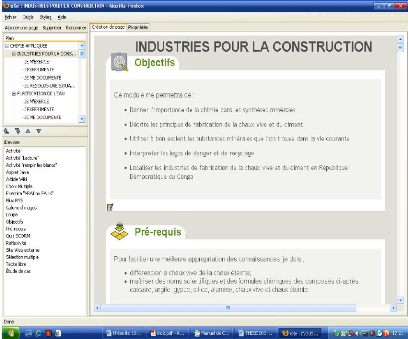
Figure II.4 : Présentation d'un module avec
ses objectifs et pré-requis
Cette unité permet à l'ordinateur de jouer le
rôle de tuteur et de précepteur car elle présente les
informations du module sur l'écran. L'apprenant est invité
à lire et à étudier. Cette activité est du type
cognitif et dans ce cas le didacticiel remplit sa fonction de tutoriel.
- 56 -
2. UNITE 2
L'unité 2 porte sur les exerciseurs. A la fin de la
première activité consacrée sur la « lecture »,
l'élève est invité à s'exercer afin de tester et de
consolider ses connaissances sur les notions apprises dans le module. Les
outils d'évaluation qui sont intégrés dans cette
unité sont présentés dans les figures ci-après :
La figure II.5 montre un exemple d'une activité «
remplir les blancs ».

Figure II.5 : Énoncé d'une
activité « remplir les blancs » ou texte « à trou
»
La figure II.6 donne la correction de l'activité «
remplir les blancs », les
|
réponses exactes apparaissent sur fond vert alors que
celles qui sont
|
fausses
|
apparaissent sur fond rouge. Comme il s'agit d'une
évaluation formative, si l'élève est bloqué, il
peut se faire aider en cliquant sur le bouton « Montrer les
réponses »
- 57 -
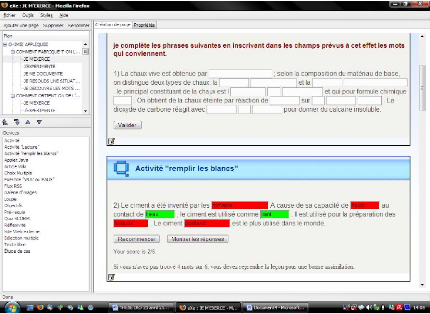
Figure II.6 : Correction de l'activité « remplir
les blancs » La figure II.7 indique un exemple de QCM

Figure II.7 : Questionnaire à choix multiple
(QCM)
- 58 -
La Figure II.8 illustre un exemple de question à deux
choix, de type vrai/faux.
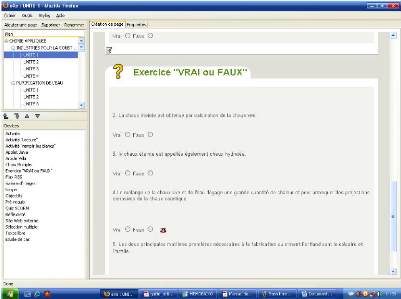
Figure II.8 : Question à deux choix
(vrai/faux)
- 59 -
La figure II.9 indique un exemple de question de type Quiz
SCORM
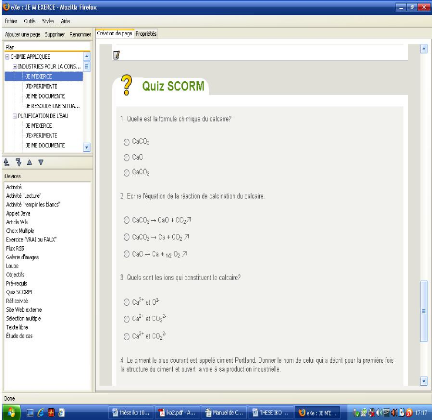
Figure II.9 : Quiz SCORM
Grâce à ces différents outils
d'évaluation formative, l'ordinateur joue le rôle de stockage et
de distribution d'exercices. L'unité 2 cadre mieux avec la
théorie béhavioriste.
- 60 -
La figure II.10 illustre le feed-back immédiat.
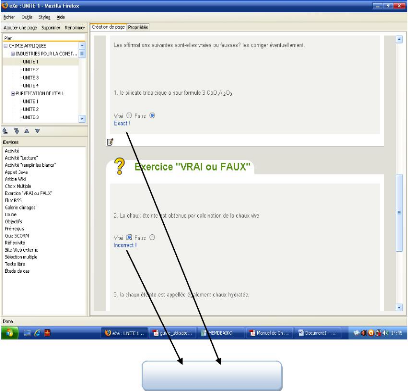
Feed-back immédiat
Figure II.10 : Feed-back
immédiat
Cette figure montre une correction instantanée aux deux
questions posées ; le renforcement positif pour une réponse
exacte et le renforcement négatif pour une réponse incorrecte.
Cette rétroaction entre dans la ligne de compte de la pédagogie
Skinnerienne fondée sur le conditionnement opérant. Ceci permet
de s'assurer si l'objectif est atteint ou non.
- 61 -
3. UNITE 3
L'unité 3 est consacrée aux activités
expérimentales telles que des travaux pratiques effectivement
réalisables par les élèves avec des manipulations
décrites de façon détaillée, les objectifs des TP
sont précisés clairement, ainsi que le matériel
nécessaire ; ces TP font l'objet de questions qui facilitent l'analyse
et l'interprétation. La figure II.11 illustre une activité
expérimentale.
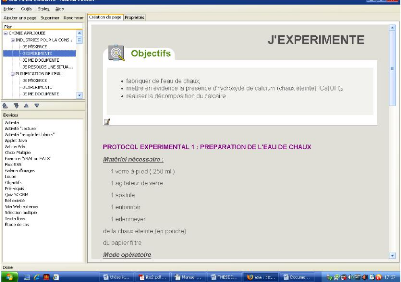
Figure II.11 : Activité
expérimentale
Cette activité vient appuyer l'aspect
expérimental du cours de chimie en proposant un protocole que
l'élève peut maîtriser et appliquer au laboratoire.
4. UNITE 4
Cette unité porte sur une activité documentaire
qui permet une ouverture pluridisciplinaire vers les sciences naturelles et les
problèmes de consommation ou d'environnement, des dossiers clairs et
illustrés proposant un rapprochement du cours avec la vie industrielle
et technique, des questions permettent de susciter une discussion autour du
thème abordé.
La figure II.12 montre une activité documentaire.
- 62 -
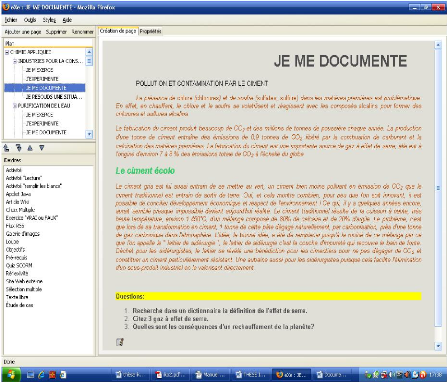
Figure II.12 : Activité
documentaire
L'activité documentaire peut faire l'objet d'un devoir
ou d'un travail collaboratif que les élèves devront
présenter et discuter dans une séance plénière en
classe. Elle offre une occasion de construction collective des connaissances ;
ce qui cadre avec l'approche socioconstructiviste.
5. UNITE 5
L'unité 5 est consacrée aux activités
d'intégration : elles consistent à placer les
élèves devant des situations de la vie courante par un
questionnement bien mené qui transforment le savoir en savoir-faire.
Dans ce savoir-faire, l'élève exerce les compétences
visées par le module. Ce sont ces activités qui donnent du sens
aux apprentissages.
- 63 -
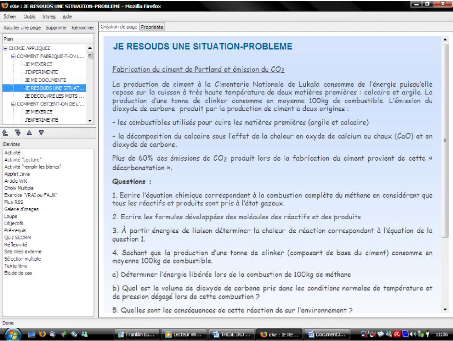
Figure II.13 : Situation-
problème
Cette unité peut constituer un exercice d'examen type
qui permet aux élèves de mobiliser les différentes
ressources afin de résoudre un problème concret. Elle se place
dans l'approche constructiviste.
6. UNITE 6
Cette unité comporte une liste des mots clés
à laquelle l'élève peut recourir pour comprendre la
signification des concepts qu'il ignore. C'est une sorte de lexique ou
glossaire qui regroupe les mots cités dans le texte dans l'ordre
alphabétique.
- 64 -
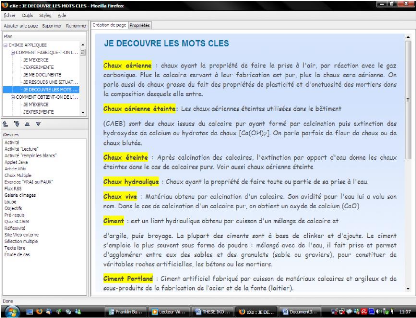
Figure II.14 : Je découvre les mots
clés
Cette unité aide les apprenants à poursuivre
leur apprentissage en cas de difficulté liée à la
compréhension des termes chimiques sans recourir à quelqu'un.
| 


