E. Les échelles
D'un point de vue scientifique, seules des catégories
très spécifiques d'information (telle que la masse, ou le contenu
énergétique) peuvent être rigoureusement
agrégées à travers des sites et des échelles
physiques, sans perte de qualité. Le plus souvent, il est
nécessaire de définir une multiplicité de niveaux
organisationnels, avec les concepts et les attributs de mesure pour chaque
niveau. Une structuration pertinente des enjeux de performance ou de
gouvernance doit prendre en compte quatre différentes formes
d'organisation des systèmes : les dimensions sociales, politiques,
économiques et environnementales.
C'est pourquoi il existe un menu des échelles, qui
fournit une liste de niveaux organisationnels pour chacune des dimensions
organisationnelles. Dans notre cas, les niveaux les plus fréquemment
employés sont l'exploitation agricole (qui est définie comme une
unité économique), la parcelle (économique
également), et le territoire (ici unité naturelle), voire parfois
l'échelle nationale et internationale pour la méthode IRENA qui
réalise un diagnostic sur l'Europe des 15.
A tous les niveaux il peut y avoir des correspondances «
horizontales » entre les types d'organisation : certains indicateurs
décrivent deux ou plusieurs types majeurs d'organisation du
système. Par exemple, des indicateurs de biodiversité sont
pertinents à l'échelle de l'exploitation agricole (dimension
économique) et à l'échelle de l'écosystème
(dimension environnementale).
De même, il peut y avoir des mouvements verticaux.
L'utilisateur est invité à considérer les changements
d'échelles descendants ou ascendants sur chacune des quatre dimensions
organisationnelles. Par exemple, le long de la dimension économique, il
est intéressant de considérer les indicateurs à
l'échelle de l'exploitation agricole et de la parcelle, le long de la
dimension sociale, on peut passer d'un individu à la famille puis
à la communauté, etc.
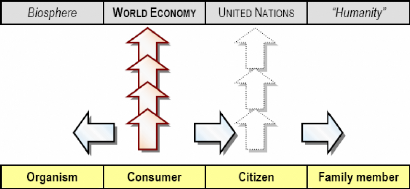

Figure 2: les relations entre échelles dans la
FKI

Figure 3: Les 42 échelles actuellement
présentes dans la FKI
F. Les axes à remplir lors de l'utilisation de
la Foire
Certains axes ont été proposés mais non
retenus en raison de la difficulté de créer un outil
générique. Nous les présentons ici car ils sont une piste
d'amélioration de la Foire.
1. Les enjeux
Il est possible, du moins sur des cas d'étude, de
classer les indicateurs en fonction d'enjeux. Par exemple, IDEA présente
6 enjeux (vivabilité, stratégies de viabilité
économique, sensibilisation et formation, cohérence des modes de
productions, communication et continuité politique, et conservation et
valorisation du patrimoine et de la biodiversité). Ces enjeux ont
été définis dans un contexte particulier, celui de la
Bergerie Nationale.
Dans le cadre du projet AGRIVISTAS, 4 études de cas
ont été réalisé et des enjeux ont été
identifiés. Parmi eux, on trouve la préservation des
écosystèmes, la valorisation de l'agriculture, la
préservation de l'identité locale, le maintien du paysage et la
gestion de l'espace, la cohérence politique et institutionnelle, la
rentabilité économique...
Mais il est difficile de définir des enjeux pour une
utilisation générique de la Foire, ils peuvent être
définis par la suite, lors de l'utilisation dans des cas concrets.
2. Les acteurs
Les acteurs peuvent être définis de nombreuses
façons, soit comme on l'a fait en fonction des branches
économiques, ou encore plus subtilement en fonction de leur appartenance
culturelle et sociale, ou de leur implication au problème à
résoudre.
Par exemple, Faucheux, Nicolaï, O'Connor, et Spangenberg
définissent une typologie d'acteurs : les parties prenantes internes,
les parties prenantes externes traditionnelles et les parties prenantes
externes élargies.
A la Bergerie Nationale, on a défini aussi des
catégories d'acteurs : la gouvernance, les partenaires commerciaux, les
partenaires territoriaux, les bénéficiaires, les
éducateurs et élèves, les producteurs et les
chercheurs.
En fait, il existe des typologies différentes en fonction
du contexte, donc encore une fois, les acteurs sont à définir
lors de l'utilisation de la Foire.
3. Les scénarios
La Foire permet de construire des scénarios qui
permettent de prendre des décisions face à un problème.
Chaque scénario doit être construit en fonction du contexte, des
enjeux et des acteurs présents.
4. Les sites géographiques
Cet axe représente en fait les cas d'étude,
c'est-à-dire chaque site sur lequel est utilisé la Foire.
| 


