3.3.- Les sections de résistivité
calculée pour un profil donné
Les sections de résistivité calculées
après inversion des données de terrain sont construites
directement par TEM-RES. Il utilise les modèles
géoélectriques 1D, dont les points de sondage sont plus ou moins
alignés, pour générer par calcul (interpolation
linéaire) des sections de résistivité suivant les profils.
Nous avons réalisé en tout 8 sections orientées Sud-Nord
à partir des 8 profils (Fig. 22). Cette orientation a été
choisie dans le but d'avoir une coupe transversale du biseau en faisant
l'hypothèse raisonnable que le biseau salé évoluerait de
la mer (du Sud) vers la lagune (le Nord).
La section présentée par la Fig. 23 est celle du
profil 3 (voir le profil 3 sur la Fig. 22), prise comme exemple. Elle montre de
façon similaire à toutes les autres sections, que les
résistivités les plus élevées se retrouvent en
surface (30 à 240 ohm.m en jaune et rouge) et les plus faibles en
profondeur (0.5 0hm.m en bleu) avec une fine épaisseur de terrain de 3
à 6 ohm.m à environ 9m de profondeur. Cette gamme de
résistivité de 3 à 6 ohm.m réapparait en dessous de
22 ou 26m
40
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
de profondeur par endroit sous des terrains de
résistivité plus faibles (en bleu profond). Ces
différentes gammes de résistivité observée à
travers les modèles géoélectriques, cartes et sondages
seront interprétées et discutées dans la suite.
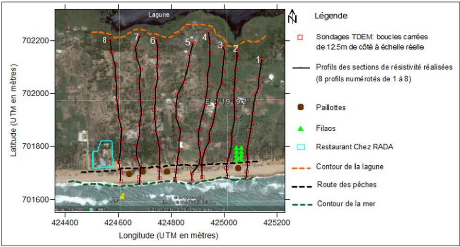
Fig. 22 : Présentation des 8 profils choisis pour la
réalisation des sections de
résistivités
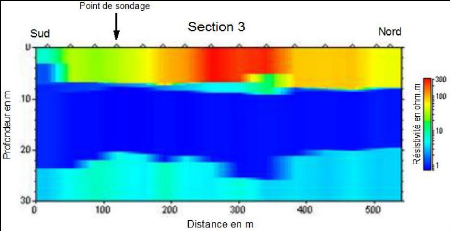
Fig. 23 : Section de résistivité calculée en
fonction de la profondeur (TEM-RES)
41
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
3.4.- Essai de délimitation des interfaces entre
les différentes eaux (eau douce, eau saumâtre et eau
salée)
Afin de tenter de traduire les différents
résultats de résistivité, il est intéressant pour
notre étude d'utiliser la loi d'Archie (1942). En effet, nous avons
choisi d'utiliser la loi d'Archie parce que le milieu étudié est
essentiellement de nature franchement sableuse (du moins pour les
premières dizaines de mètres) et donc entre dans le domaine de
validité de cette loi empirique.
La loi d'Archie, dite « à saturation »
considère S=1 (milieu saturé) et est définie
par :
???? = ??????Ø-?? (3)
On rappelle que cette formule permet de calculer la
résistivité de l'eau d'imbibition ???? ou la porosité du
sable Ø connaissant la résistivité de la formation ????
(calculée par la méthode géophysique) en fixant
arbitrairement (ou
grâce à des mesures spécifiques) les
paramètres a et m. La variation de ???? est liée à la
variation de ???? ou de Ø , si l'on considère que les
paramètres (a et m) ne changent pas dans la zone d'étude (ce qui
est une hypothèse raisonnable pour notre étude si l'on
considère les dépôts sableux comme ayant la même
origine) . La variation de résistivité des cartes et des sections
obtenues peut être alors traduite soit par une variation spatiale de ????
soit de Ø en fixant l'un ou l'autre des deux paramètres. Si le
milieu est complexe c'est à dire si ???? ou Ø sont susceptibles
de varier l'un et l'autre de façon simultanée, il devient alors
impossible de déduire ???? ou Ø des mesures de
résistivité seules.
Lorsqu'on observe la carte de conductivité des eaux de
puits (Fig. 24), on remarque une variation importante de la conductivité
et donc de la résistivité (16 à 95 ohm.m). Cette variation
confirme que ???? varie dans notre zone.
42
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.

Fig. 24 : Carte de conductivité des eaux de puits
Sachant que nous sommes dans du sable jusqu'à environ
28 m (lithologie du PU2 annexe 5), nous avons choisi de considérer comme
hypothèse de travail une porosité constante pour le site. C'est
une hypothèse forte pour cette étude, et nous verrons en
discussion comment valider cette hypothèse dans les futures
études réalisées sur la zone. Pour cette étude,
cette hypothèse d'homogénéité de porosité
est considérée comme raisonnable en l'absence d'autres
informations car les dépôts sableux sont probablement
constitués d'épisodes de sédimentation successifs
impliquant des phénomènes en jeu à l'échelle de la
côte du Bénin. On pourrait ainsi supposer que ces
dépôts présentent en moyenne des porosités
constantes d'un point à l'autre d'une petite zone comme la notre.
Pour déterminer la résistivité ????
correspondant à la formation ou le terrain qui
contient les eaux de différents types, il nous faut
alors connaître d'une part ???? de l'eau d'imbibition dont nous
voulons définir le périmètre, et d'autre part, la
porosité Ø (considérée comme constante)
ainsi que les paramètres a et m.
43
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
La valeur de la porosité n'étant pas connu, nous
l'avons estimée avec la loi
d'Archie transformée : (Ø = ????
(??????)-1/m).
Pour déterminer Ø, il faut être
en présence d'une zone du terrain où la résistivité
de l'eau d'imbibition peut être considérée comme constante
à l'échelle du sondage TDEM. C'est le cas tout proche de la mer :
le terrain est saturé en eau de mer dont nous connaissons ????
(54 700 uS/cm ou 0.18 ohm.m) en mesurant la conductivité de l'eau
de mer avec un conductivimètre. La résistivité de la
formation (sable + eau de mer) est calculée à partir
modèle géoélectrique du sondage TDEM le plus proche du
bord de mer : ( ???? = 0.8 ohm.m).
Pour les paramètres a et m, nous avons choisi ceux
donnés par Keller (a = 0.88 et m = 1.37, voir tableau 1) et, pour avoir
une autre estimation possible, ceux considérés comme «
moyens » usuellement par Archie (a = 1 et m = 2). Cette estimation nous
donne un intervalle de porosité totale des sables de 0,32 soit 32%
(Keller) et 0,48 soit 48% (Archie). Ces porosités calculées
localement, ressemblent beaucoup à celles obtenues par SERHAU/BUGEAP
(1987) à savoir : porosité supérieure à 40% pour
les sables dunaires et 35% pour les sables marins fins silteux de la plaine
littorale.
Nous avons considéré, pour la
délimitation du périmètre d'eau douce, une limite de
potabilité de l'eau qui est de 1000uS/cm, soit 10 ohm.m. En effet, la
limite de potabilité fixée par L'Union Européenne, (1998)
est de 2500 uS/cm soit 4 ohm.m. Mais, une petite enquête s'est faite sur
le site et a montré que, l'eau à 2500 uS/cm n'est pas
jugée de bon goût par la population et donc n'est pas
consommée. La limite acceptée par la population s'est
avérée être 1000uS/cm, valeur confirmée par le Dr
Jean-Michel VOUILLAMOZ (hydrogéologue et chercheur à l'IRD).
L'objectif étant de définir l'eau consommable pour la population,
nous avons donc choisi cette valeur comme limite de potabilité «
pratique » (1000uS/cm).
44
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
Connaissant la limite supérieure de la
conductivité de l'eau buvable (donc la limite inférieure de la
résistivité de l'eau de consommation) et les deux
porosités possibles estimées, nous avons déduit la limite
de résistivité Pf entre les terrains contenant de l'eau
douce et ceux contenant de l'eau saumâtre. L'eau de conductivité
supérieure à 1000uS/cm est considérée comme eau
saumâtre. Cette limite de résistivité Pf est alors
de 40 ohm.m pour une porosité de 32% et de 24 ohm.m pour 48% de
porosité. Ce qui signifie que, pour une porosité de 32% les
terrains contenant de l'eau douce et ceux contenant de l'eau saumâtre ou
salée ont des résistivités respectivement
supérieures et inférieures à 40 ohm.m. Et pour une
porosité de 48% les résistivités de ces terrains sont
respectivement supérieures et inférieures à 24 ohm.m. Cela
permet de tracer deux périmètres successifs selon nos
hypothèses de porosité. Ils sont représentés sur
les cartes et les sections (Fig. 25 et Fig. 26) par des isocontours de 40 ohm.m
et de 24 ohm.m.
Pour définir ensuite le périmètre
séparant l'eau saumâtre de l'eau salée nous avons
considéré pour les terrains contenant de l'eau de mer des
résistivités inférieures à 0.8 ohm.m. Cette
dernière a été définie par les modèles
géoélectriques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous
sommes partis de cette résistivité pour estimer la
porosité. Ce périmètre est également
représenté par l'isocontour de 0.8 ohm.m sur les cartes (Fig.
25). Il faut noter que le substratum argileux situé sous les sondages
est plus résistant que le sable saturé d'eau salée
Le jaune et le rouge représentent, pour les cartes de
résistivité, les terrains contenant de l'eau douce pour 32% de
porosité. Le vert représente les terrains contenant de l'eau
douce qui s'ajoutent à ceux de couleur jaune et rouge lorsqu'on
considère une porosité de 48%. Le bleu-ciel et le violet-clair
représentent les terrains contenant de l'eau saumâtre (entre eau
douce et eau
45
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
salée) impropres à la consommation (ou le
substratum argileux). Enfin le violet représente les zones où
l'eau est franchement salée.

Fig. 25 : Délimitation des interfaces entre les
différentes eaux à partir des cartes de
résistivités par profondeur
46
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin) ALLE C.
47
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.

Fig. 26 : Délimitation des interfaces entre les
différentes eaux à partir des
sections de
résistivité par profils
On remarque que les cartes sont quasi-identiques de 1m
à 5m, l'eau douce domine à partir des 120 premiers m en
s'éloignant de la mer jusqu'à la lagune. Les
résistivités restent les mêmes également sur les
cartes de 5m à 8m de profondeur avec une légère intrusion
de l'eau saumâtre venant de la lagune au Nord-est de la carte. A 9m de
profondeur, l'eau douce disparait subitement en laissant place à l'eau
saumâtre et à l'eau de mer. on remarque également que la
disparition de l'eau douce se fait du Sud-est vers le Nord-ouest. A 10m le
phénomène persiste et à 15m de profondeur, l'eau de mer
est observée sur toute la carte. Mais de 20m à 40m de profondeur,
on assiste à l'apprition d'un terrain
48
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
de nouveau moins conducteur de résistivité
identique à celle de l'eau saumâtre : Le bleu-ciel, et surtout le
violet-clair apparaissent de nouveau. Or, avoir de l'eau saumâtre en
dessous de l'eau salée est impossible hydrogeologiquement parlant.
Car il ne peut avoir de l'eau saumâtre (moins dense) en dessous de l'eau
salée ou eau de mer (plus dense). En nous référent
à la lithologie détaillée du PU2 (annexe 5), nous pouvons
alors émettre l'hypothèse que les sondages TDEM mettent en
évidence un terrain profond qui serait un substratum constitué
majoritairement d'argile (probablement imbibée d'eau salée). Ce
terrain présenterait une résistivité similaire à
celle du sable + eau saumâtre (environ 2 à 6 ohm.m). Ce qui laisse
croire que l'eau saumâtre réapparait, alors que c'est l'argile qui
est dévoilée (comme sur la Fig. 23).
Concernant les sections geoélectriques, nous avons
uniquement représenté les limites eau douce-eau salée pour
les deux porosités évaluées. Car, comme les cartes l'ont
montré, la résistivité de terrain contenant l'eau
saumâtre est de 2 à 6 ohm.m. Cette gamme de
résistivité n'est pas observée pour la plupart des
sections si l'on ne considère pas, bien sûr, la
réapparition de cette gamme de résistivité en dessous des
terrains contenant l'eau salée, qui représenterait une
présence d'argile (Fig. 23 par exemple).
Le contour rouge représente les terrains contenant de
l'eau douce pour 32% de porosité. Le vert et le jaune
représentent les terrains contenant de l'eau douce qui s'ajoutent
à ceux de couleur rouge lorsqu'on considère une porosité
de 48%. L'eau saumâtre n'existant présque pas, le bleu
représente alors l'eau salée ou eau de mer. On remarque que pour
toutes les sections l'épaisseur de l'eau douce ne varie quasiment pas et
reste autour de 8m. Aussi, ce terrain d'eau douce est beaucoup plus proche de
la lagune que de la mer (à partir des 120 premiers mètres de la
mer jusqu'à la lagune comme nous renseignent les cartes). Une autre
constatation est que le mur du terrain contenant l'eau douce est assez aplati
du fait de la non détection du terrain « de mélange »
(sable + eau
49
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
saumâtre). Cela se confirme avec les cartes qui montrent
une brusque disprution de l'eau douce entre 8m et 9m de profondeur.
Le front (biseau) salé est quasi vertical en bord de
côte, ce qui est une configuration inhabituelle. Le biseau salé de
notre site d'étude pourrait donc être considéré
comme rectiligne et quasi-vertical contrairement au biseau salé «
classique » qui est curviligne et arrondi, illustré par la figure
classique de l'hydrogéologie des cordons sableux littoraux qui prend
comme exemple celui du littoral nord du Sénégal (Fig. 6), sous
une pluviométrie plus faible.
La profondeur moyenne du biseau salé par rapport
à la surface du sol étant de 8 m et sachant d'une part qu'on ne
peut voir le niveau statique avec le TDEM, et d'autre part qu'on sait que le
niveau statique (NS) moyen des puits est de 2,8 m (Annexe 6), on peut alors
estimer que la lentille d'eau douce a une épaisseur de 5 m en moyenne
(NS moyen à soustraire de la profondeur du biseau). Pour les
porosités de 32% et 48% on a donc respectivement une lame d'eau douce de
1600 mm et 2400 mm. Nous avons estimé que la surface de terrain
contenant cette eau fait, avec 32 % de porosité 120 000 m2
(200 m sur 600 m) et, avec 48% de porosité 240 000 m2 (400 m
sur 600m) soit respectivement 1/3 et 2/3 de la surface du site. En
répartissant les lames d'eau calculées sur les surfaces
estimées on à respectivement pour 32% et 48% de porosité,
192 000 m3 (1.6 m * 120 000 m2) et 576 000 m3
(2.4 m * 240 000 m2) de volume d'eau douce.
La porosité considérée ici est la
porosité « totale » et non la porosité « de
drainage » donc, le volume d'eau estimé ne peut être
totalement mobilisé par forage. Mais notons cependant que pour des
gammes de porosité élevée comme dans notre cas, la
porosité de drainage pourrait être proche de la porosité
totale (De Marsily, 1986).
Cette estimation du volume d'eau douce s'applique à la
saison des pluies. En saison sèche le niveau statique pourrait baisser.
La profondeur du biseau pourrait
50
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
elle aussi diminuer (inférieur à 8m) Ainsi la
réserve d'eau douce pourrait diminuer, car la géométrie de
la lentille d'eau douce varie en fonction des précipitations et des
prélèvements, selon Martin (1970).
51
Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du
quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine
temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)
ALLE C.
| 


