6. Teneurs en sodium (Na+)
Une des stratégies de tolérance au niveau de la
plante entière consiste en une limitation de transport de Na+
vers les parties aériennes et précisément aux feuilles et
donc à une capacité de recirculation de sodium des feuilles vers
les racines via le phloème. L'accumulation de Na+ au niveau
de la feuille drapeau, associée à une mauvaise compartimentation
vacuolaire, entraine une diminution de la croissance végétative
(Munns et James, 2003 ; Poustini et Siosemardeh, 2004 ; Munns et al., 2006).
L'examen de la figure 22 montre qu'il existe une différence
significative d'accumulation de sodium aux niveaux des feuilles des
différents génotypes de blé dur étudiés.
Ainsi, tous les génotypes améliorés et les
génotypes Jneh Khottifa (2), Bayadha (7) et Ward Bled (13) accumulent
moins de Na+ dans ses feuilles que les autres génotypes dans
les conditions non stressées.
Na+ (mg/g de matière
sèche)
4
0
7
6
5
3
2
1
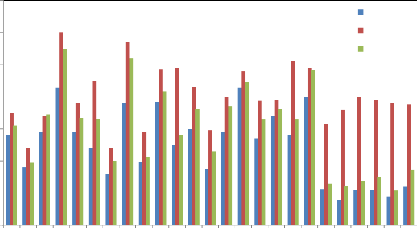
Chbika
Sidi Bouzide Souassi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25
Génotypes
Figure 22: Teneurs en Na+ au stade
anthèse au niveau de la feuille drapeau de différents
génotypes aux niveaux des trois sites expérimentaux.
L'effet des sites est significatif, en effet, l'augmentation
de la salinité des eaux d'irrigation de chaque site entraine une
augmentation des teneurs foliaire en sodium. Il est très
intéressant de noter que les génotypes améliorés
ont accumulé de très fortes doses de sodium au niveau du site de
Sidi Bouzid, bien que celui ci soit moins chargé en sel que le site de
Souassi. Il est possible que cela soit du à une plus faible dilution de
cet ions étant donné que la biomasse
55
végétale totale au stade anthèse est
relativement faible pour ce site. Par ailleurs, l'interaction Génotypes
X Environnement est significative, pour l'ensemble des génotypes on a
remarqué que les génotypes Jneh Khottifa (2), Bayadha (7) et Ward
Bled (13) ont montré une grande stabilité d'accumulation de
sodium foliaire par rapport aux autres génotypes.
7. Modèles d'élaboration du rendement
7.1. Relation entre le rendement en grain et le rendement
biologique
Le rendement en grains est étroitement
corrélé à la matière sèche
végétative élaborée à la floraison. En
effet, une corrélation linéaire significative est
préalablement présente pour les génotypes
améliorés et le coefficient de régression est de l'ordre
0,6, alors qu'elle été non significative pour les
génotypes locaux et le coefficient de régression est de l'ordre
de 0,15 (Figure 23).
t/h
Génotypes améliorés
? Génotypes autochtones

y = 0,2569x + 2,7522 R2 = 0,6044
y = 0,1722x + 0,9207 R2 = 0,1591
t/h
7
6
|
Rendement en grain
|
5 4 3 2
|
1
0
10 12 14 16 18 20
Rendement biologique
Figure 23 : Relations entre le rendement en
grain et le rendement biologique chez les
génotypes autochtones et
ceux améliorés.
Une nette différence a été trouvé
entre les deux pools géniques (amélioré et autochtones)
qui traduit bien la différence de rendement en grain. Des
résultats similaires entre le rendement en grain et la biomasse au stade
maturité ont été trouvés par Leterme et al. (1994).
En fait, ils ont déduit que l'augmentation du rendement en grain est
proportionnel à l'augmentation de la biomasse pour les
variétés améliorés. Ces résultats nous
montre que les génotypes améliorés ont des rendements en
grain est corrélé a la production de la matière
sèche, cependant
56
l'augmentation de la biomasse n'a pas d'effet sur le rendement
en grain pour les génotypes autochtones. Ces résultats
révèlent que le rendement biologique a une grande importance sur
la fertilité des épis. Il pourrait être
considéré comme un critère fiable pour l'estimation du
rendement en grain dans les environnements affectés par la
salinité ce qui est en accord avec les études de Kings et Epstein
(1984) et Menguzza et al. (2000).
| 


