CONCLUSION
A présent, certains observateurs s'aventurent à
analyser la coopération décentralisée sur la base des
instruments de mesure de la branche des politiques publiques. A vrai dire, tous
les ingrédients pour justifier de telles initiatives sont à notre
portée. D'abord la coopération décentralisée a
été institutionnalisée à travers des agences
spécialisées, il y'a ensuite un travail d'identification des
problèmes (diagnostic des territoires) et de préparation (avec
des commissions et des négociations internes et externes entres
acteurs). Les acteurs mobilisent des ressources (connaissances ou
réseaux), sont plus ou moins libres, leurs choix sont guidés par
des intérêts ou des idées. Ils mettent en place des
stratégies. Et enfin, il y'a un travail de production (mise en oeuvre)
et de suivi-évaluation. Toutes ces étapes, inhérentes
à la dynamique constitutive des politiques publiques se retrouvent dans
le processus conceptuel d'une politique de coopération
décentralisée.
Récapitulatif des phases du cycle de projet
:
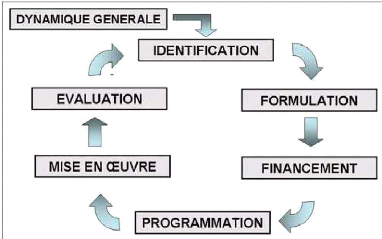
Sources : B. Husson, Coopération
décentralisée et cycle de projet, Approche méthodologique,
CIEDEL
En dépit de cette dynamique semblable, la
spécificité d'une politique de
coopération
décentralisée tient au fait qu'elle ne
mobilise pas les mêmes circuits de mise sur agenda,
qu'une politique
publique. Par exemple, une politique publique aussi controversée que
l'IVG

(interruption volontaire de la grossesse), malgré la
forte influence des milieux conservateurs ou de l'Eglise a été
adoptée, en 1974 en France, car c'était de la
responsabilité des pouvoirs publics. Alors que la coopération
décentralisée dépend entièrement de la
volonté charitable ou des ambitions stratégiques des élus
locaux du Nord et des bailleurs internationaux. Les collectivités du Sud
n'ont rien à leur exiger, sinon, à solliciter leur bonne
volonté.
Eu égard cette controverse, la coopération
décentralisée peut être analysée comme une
catégorie de politique publique afin d'examiner, plus amplement, son
évolution. Le bilan étant mitigé, il y a trois
écueils à surmonter : l'inefficacité,
l'ineffectivité et l'inefficience.
- Elle est inefficace, par ce qu'en dépit des
interventions répétées les populations sinistrées
de la région de Saint-Louis ne voient pas les finalités. Mieux,
elles se sentent léser par les acteurs locaux qui réceptionnent
les subventions. Nonobstant ce fait, l'information ne circule guère
entre le groupe des élus, agents ou acteurs et la population pourtant
des initiatives ont été prises dans ce sens, à l'instar
des comités de quartiers. Le volontarisme souhaité des acteurs
comme moyen d'impulsion du développement des collectivités du
Sud, a lamentablement échoué. Chaque intervenant campe sur ses
positions. Par ailleurs, étant donné que le plus pauvre a besoin
du plus riche, il est tiraillé entre une coopération qui lui
échappe, les besoins urgents à prendre en charge et les
stratégies d'accaparement des objectifs. Finalement la
coopération décentralisée n'est pas différente de
la coopération interrégionale car les régions traitent
avec les régions, les communes avec les communes au grand
détriment des communautés rurales de Saint-Louis qui n'ont pas
d'équivalent en France et dans le monde. Il n'y a pas une
véritable synergie entre les acteurs de Rhône-Alpes et ceux de
Saint-Louis, ni une interconnexion entre différents niveaux de
collectivités territoriales ;
- Elle est ineffective, car des dysfonctionnements sont
intervenus pendant la mise en oeuvre. Par exemple les décisions prises
conjointement, entre le Conseil régional de Saint-Louis et le Conseil
régional de Rhône-Alpes, de travailler en co-maîtrise
d'ouvrage pour la réalisation des projets ne sont pas bien
appliquées. Rhône-Alpes, préfère dans bien des cas,
confiait les exécutions à une ONG ou une association
opérateur de développement qui affiche, certes, une meilleure
connaissance des sociétés du Sud, mais qui n'en est pas moins
qu'un sous-traitant du développement. Pour bénéficier des
cofinancements du MAEE, la région Rhône-Alpes devait harmoniser
ses interventions avec les autres régions françaises en
coopération avec Saint-Louis, tout en prenant en compte les politiques
nationales ou bilatérales francosénégalaises de
développement. Mais en refusant ces cofinancements, le Conseil
régional de Rhône-Alpes montre que la coopération
décentralisée représente une forte valeur ajoutée
pour

70
sa région. Par conséquent, c'est une chasse
fortement gardée pour les représentants des collectivités
et les opérateurs qui vivent de ça ;
- Elle est inefficiente à cause de l'écart qui
existe entre les moyens mobilisés (8.245.085 € entre 1997 et 2008)
par la région Rhône-Alpes, sur fonds propres, et les
résultats obtenus. La région Rhône-Alpes a beaucoup fait
pour l'éducation et la santé dans la région de
Saint-Louis, notamment au niveau des collèges et lycées de Podor.
Toutefois, il y a un tel déséquilibre dans la région de
Saint-Louis, que si on fait une évaluation proportionnelle à
l'ensemble du territoire, les résultats obtenus à un niveau
départemental n'auront aucune valeur à un niveau
agrégé. Par exemple entre 2006 et 2007, les effectifs de
l'enseignement moyen (collège) ont augmenté de 33,8% dans le
département de Podor, alors qu'ils sont de 16,2% à Saint-Louis et
de 0,7% à Dagana25. Ce qui fait une variation totale
régionale de 16,3%, malgré les chiffres exceptionnels de Podor.
Il semblerait, alors, que les collèges de Dagana soient en situation de
très faible fréquentation, contrairement aux départements
de Saint-Louis et de Podor. A partir, de ces données le Conseil
régional de Saint-Louis devrait pouvoir réorienter ses
partenaires français afin d'éviter que de telles
déséquilibres ne persistent entre les trois départements
qu'elle administre. Cependant même si la région Rhône-Alpes,
par bonne volonté, réoriente ses actions de manière
rationnelle, il semble impossible de bâtir un développement
durable sur des ressources aléatoires. D'autant plus que les fonds
alloués à Saint-Louis par l'Etat ont été
diminués de 180 Millions de francs cfa, en 2009. Soit à peu
prés 30% a été enlevé de cette enveloppe par
rapport à 2008. Dans ces conditions si les trois partenaires
français, dont Rhône-Alpes, qui cofinancent le CRREJ
arrêtent leurs cofinancements en 2010, comment le Conseil régional
de Saint-Louis va réussir à maintenir les mêmes types de
prestations offerts à sa jeunesse, avec les maigres allocations
budgétaires de l'Etat. La région Rhône-Alpes investie,
énormément, pour le développement local de Saint-Louis,
sur fonds propres, mais jamais, elle ne va prendre en main le destin de la
population Saint-louisienne. C'est à l'Etat sénégalais que
revient le soin de s'y employer. Il doit reprendre en main le destin de ses
collectivités locales, jouer son rôle de régulateur social
et de garant des bonnes conduites, en inculquant à ses fonctionnaires
une éthique de responsabilité. Sauf l'adoption d'une approche
stratégique globale de développement, la coopération
décentralisée risque de n'être qu'un
épiphénomène sans réel impact sur la
réduction de la pauvreté qui gangrène les populations
sénégalaises et du Sud en général.
25 Sources : Evolution des effectifs du moyen par
département de 2003 à 2007, IA, Saint-Louis

| 


