3- Evolution de la taille de marché :
La taille du marché français du mobile est
aujourd'hui estimée à 40 millions d'utilisateurs. Avec un
degré de pénétration de 60 %, elle reste relativement loin
de ses voisins européens (notamment la Finlande et la Suède).
L'évolution du nombre d'utilisateurs a évolué selon les
données du graphique2 suivant :
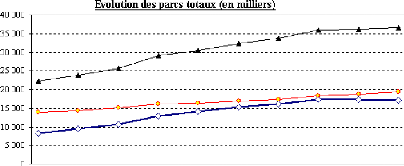

2 Source : ART

Cette augmentation a été accompagnée d'une
évolution en volume de minutes de communications, le tableau suivant
illustre cette évolution
|
En millions de minutes
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
Evolution
|
|
|
Téléphonie mobile
|
20
|
571
|
35
|
640
|
44
|
419
|
51
|
747
|
+16,5
|
%
|
|
Dont communications mobiles vers fixes
|
11
|
789
|
16
|
269
|
17
|
665
|
18
|
532
|
+4,9
|
%
|
|
dont communications on net
|
4
|
880
|
11
|
715
|
16
|
157
|
20
|
047
|
+24,1
|
%
|
|
Dont communications mobiles vers
mobiles tiers
|
3
|
609
|
6
|
840
|
9
|
521
|
11
|
916
|
+25,2
|
%
|
|
Dont communications mobiles vers
international
|
|
293
|
|
498
|
|
692
|
|
816
|
+17,9
|
%
|
|
Dont roaming out
|
|
nd
|
|
318
|
|
385
|
|
421
|
+9,4
|
%
|
Commentaire
Afin de mieux mettre en évidence l'évolution de
données précédentes, voyeons qu'elles sont les recettes
mensuelles moyennes par abonné, ainsi que le volume mensuel moyen par
abonné :
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
Evolution
|
|
Recette mensuelle moyenne par abonné *
(en euros)
|
29,1
|
25,7
|
25,0
|
24,4
|
-2,4 %
|
|
Volume mensuel moyen par abonné **
(en minutes)
|
107,7
|
118,2
|
111,1
|
114,1
|
+2,7 %
|
|
Nombre moyen de SMS par abonné
|
nd
|
4,9
|
8,2
|
13,0
|
+58,6 %
|
* CA téléphonie mobile transports de données
et SMS sur le parc moyen parc annuel
** concerne la voix uniquement (hors
transports de données et SMS)
Nous remarquons que les recettes ont tendance à baisser
alors que les temps de communications à augmenter, c'est à dire
que les prix sont en baisse. Une moyenne de 0.27 € la minute en 1999 et
0.21 € la minute en 2002.
Cette baisse traduit l'augmentation de la concurrence sur la
marché.
a té l ép h o n i e m o b i l
e
Après avoir présenter l'évolution des
données statistiques du marché français du mobile, nous
pouvons conclure que l'évolution a été vraiment au profit
du consommateur de telle manière que de plus en plus de français
se sont permis l'achat de ce produit.
1

Chapitre II : Stratégie et parts de marché
des opérateurs français
Partie 1 : Evolution de la situation stratégique
des opérateurs :
Au cours des trois phases de changement du marché
français du mobile, les opérateurs ont occupé
différentes places stratégiques par rapports à la part de
marché et au chiffre d'affaire.
Nous allons pour cela essayer de cartographier le
positionnement stratégique des opérateurs, et en s'appuyant sur
une étude réalisée par l'OMSYC, nous définissons
deux concepts par rapports auxquels on positionnera Orange, SFR, et Bouygues
Télécoms, voici les deux concepts :
- La dotation concurrentielle :
1

C'est l'écart entre la part de marché
réelle et la part de marché cible d'un
a t é l é p h o n i m o bi l
e
opérateur, ramenée en pourcentage de la part de
marché cible, c'est à dire la part de marché à
l'équipartition. Ainsi, si un opérateur a 40 % de parts de
marché sur un marché à 4 opérateurs, donc avec une
part de marché cible à 100 % / 4 = 25 %, sa dotation
concurrentielle sera égale à (40% - 25%) / 25 % = 60%
- L'écart au revenu moyen par client (ou
l'ARPU)
Le revenue moyen par client définit du point de vue de
l'opérateur, le revenu généré par l'existence et la
consommation de chaque client. L'écart au revenu moyen par client est
calculé de la même manière que la dotation concurrentielle,
c'est à dire en ramenant la différence du revenu moyen par client
de l'opérateur du revenu moyen national par rapport à ce dernier,
le tout en pourcentage.
A l'aide de ces deux concepts, l'OMSYC identifie quatre
grands
positionnements possibles ; les voici illustrés sur ce
schéma :
Ecart à l'ARPU
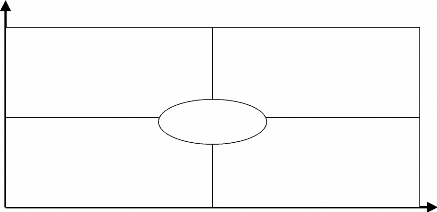
Différencié
La sous dotation en volume part de marché
inférieure à celle théoriquement atteignable est
compensée par la valeur
Entrants
Dotation concurrentielle inférieure à la moyenne
qui
s'accompagne d'un revenu moyen par client inférieur
à la moyenne
Concurrence
équilibrée
Premium mass marketer
Une part de marché supérieure à la part
de marché théorique qui s'accompagne d'un ARPU au dessus de la
moyenne
Mass marketer
Dotation concurrentielle supérieure à la cible, qui
s'explique par la faible valeur de la clientèle
Dotation concurrentielle
1- La situation initiale des opérateurs
:
En 1996, Orange occupait une position concurrentielle assez
confortable avec une dotation de 105% alors que l'écart au revenu moyen
par client (ERMC) était inférieur à 10 %, situation
logique parce qu'il détenait près de 68% de la part de
marché et de ce fait, contribuait largement à la
définition de la moyenne nationale.
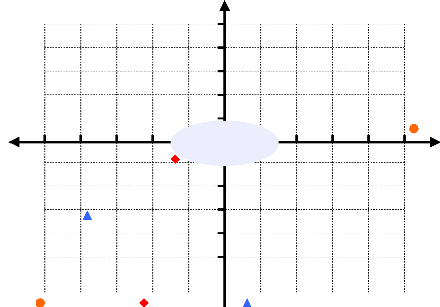
Ecart au revenu moyen par client
100%
-100%
Situation d'équilibre
Dotation concurrentielle
100%
-100%
SFR pour sa part était à près de -28% de la
dotation concurrentielle et détenait
a t é l é p h o n i e m o b i l
e
donc près de 24% de la part de marché. Son ERMC
quant à lui était négatif, même si à cette
époque, SFR affichait relativement les mêmes prix qu'Orange, sa
faible part de marché ne lui permettait pas de bénéficier
d'économies d'échelle afin d'avoir un ERMC plus
élevés.
Bouygues Télécoms, fraîchement
arrivé sur le marché détenait une dotation concurrentielle
de -77% alors que son ERMC était au deçà de -60%, ceci
ayant pour cause les tarifs pratiqués qu'on a vu nettement plus basque
ses concurrents Orange et SFR.
Orange occupait donc une position de premium mass marketer,
alors qu'SFR et Bouygues Télécoms occupaient des places
d'entrants.
Cette situation a vite évolué au profit des
entrants, ce qu'on verra dans ce qui suit. Mais positionnant d'abord les trois
opérateur en situation initiale (1996) sur le schéma suivant
1:

Orange (105, 9) SFR (68, -28) Bouygues Télécoms
(-77, -60)

1 Inspiré du modèle présenté dans
l'étude de l'OMSYC.
1

| 


