|

Année universitaire 2021 - 2022
Master 2 Métiers de l'enseignement, de
l'éducation, et de
la formation
Histoire-Géographie
Les enjeux politiques et sociétaux de
l'étude
de la guerre dans l'enseignement et les
programmes du secondaire
Présenté par : Anissa
LAICHI
Mémoire encadré par : Emilie
COTTET-DUMOULIN
P a g e 1 | 47
Sommaire
Remerciements 3
INTRODUCTION 4
Première partie : Etat de l'art. 5
1. Etudes et analyses de la guerre en Europe.
5
1.1. La théorisation du concept de guerre : de
multiples recherches scientifiques. 5
1.2. Le concept de la guerre dans l'historiographie
européenne. 8
1.3. L'épistémologie de la guerre.
12
2. L'enseignement des guerres ; enjeux et analyse
dans les programmes scolaires du
secondaires. 14
2.1. Enjeux socio-politiques de l'écriture de
l'histoire des guerres. 14
2.2. Quelle est la place de l'enseignement des
guerres dans les programmes ? 16
2.3. Quelle mise en oeuvre de l'enseignement des
guerres dans les programmes du
secondaire ? Un exemple de comparaison du programme
de Troisième et de Terminale. 20
3. L'histoire des guerres : un enseignement aux
finalités multiples 21
3.1. Guerre et citoyenneté ? La formation du
citoyen dans la société 21
3.2. Guerre et paix : une finalité morale ?
23
3.3. Guerre et mémoire ; un enjeu
mémoriel qui participe à la culture commémorative
en
France. 25
Deuxième partie : Analyse et critique du
dispositif pédagogique envisagé. 28
1. Dispositif expérimental de l'étude
de la Résistance et de la figure du résistant durant
la
Seconde Guerre mondiale. 28
1.1. Objectifs et attendus de ce dispositif.
28
1.2. Organisation de ce dispositif 30
2. Enjeux et critiques de ce dispositif
pédagogique envisagé. 35
2.1. Enjeux de ces expérimentations.
35
2.2. Réflexion critique sur le dispositif
envisagé. 35
Réflexion conclusive 38
BIBLIOGRAPHIE 40
Articles publiés sur internet 41
Sitographie 41
ANNEXES 42
1. Corpus de documents n°1 de la séance n°1.
42
2. Corpus de documents n°2 de la séance n°1.
44
3. Documents projetés au tableau en séance
n°2. 46
4. Corpus de documents travaillé à l'oral avec
les élèves en séance n°2. 46
P a g e 2 | 47
Remerciements
De nombreuses personnes ont contribué à la
rédaction de ce mémoire. Je tiens à remercier certaines
d'entre-elles.
Tout d'abord, je remercie Michel Paquier qui m'a
été d'une grande aide dans les recherches scientifiques de ce
sujet. Malgré des complications personnelles impliquant la fin de
l'encadrement de mon mémoire, il n'a cessé d'y prêter
attention en y consacrant parfois du temps pendant les grandes vacances
scolaires.
Ensuite, je remercie Emilie Cottet-Dumoulin, ma directrice de
mémoire. En effet, elle a su reprendre aisément la direction de
mon mémoire. Je la remercie pour sa disponibilité et son
investissement. Je la remercie particulièrement pour sa bienveillance et
son écoute attentive vis-à-vis de mes choix.
Je remercie également Madame Clerc, ma tutrice de
stage, qui m'a soutenue et guidée dans la rédaction de mon
mémoire et notamment dans la construction de mon dispositif
pédagogique.
Enfin, je tiens à remercier mon mari pour avoir
porté un regard extérieur sur mon mémoire, il m'a
été d'une aide par son écoute et ses conseils.
P a g e 3 | 47
INTRODUCTION
Lorsque j'ai annoncé à mon entourage ma
volonté de devenir professeur d'histoire-géographie, une de leurs
premières réactions a été de m'interroger sur les
dates de guerre telles que la guerre du Golfe ou franco-allemande. Les
personnes qui ne pratiquent pas l'histoire ont tendance à associer cette
discipline à l'étude des guerres. Je me suis alors
interrogée sur ce rapport qu'entretenait la société avec
la guerre en tant que concept mais également les guerres, au pluriel, en
tant que « fait social total » (Marcel Mauss, 1924).
Du fait de l'évolution des formes que prend la guerre,
les rapports qu'entretient la société avec celle-ci ont
profondément évolué. En effet, ce rapport n'est pas le
même qu'il y a 150 ans de même que nous n'étudions pas la
guerre de la même façon qu'au XVIIIe siècle. De ce fait, la
théorisation de la guerre et son analyse dans la société
doivent évoluer dans le même temps.
Cette évolution est d'autant marquée qu'elle a
intégré la guerre comme un sujet social et non plus seulement
militaire. De fait, le politique s'est emparé de ce sujet car conscient
de sa portée dans la société. En effet, les enjeux
sociétaux de ce sujet sont multiples. Il concerne nos aïeux mais
également les générations futures puisque notre
société est héritière des changements -ou non-
opérés par la guerre. Pour exemple, l'occupation allemande en
France durant la Seconde Guerre mondiale a soustrait la société
française de ses libertés mais, au sortir de la guerre, s'est
reconstruite et a donné cours à la démocratisation du vote
des femmes. Plus qu'important, l'enseignement de la guerre est
nécessaire pour comprendre notre société actuelle.
Aussi, dans l'enseignement du professeur
d'histoire-géographie, la guerre advient comme un
évènement clé de l'histoire, de rupture ou de changement.
Dès lors, étudier la guerre avec les élèves c'est
appréhender la durée. D'ailleurs, en témoigne cette
tendance disciplinaire à diviser le temps par les dates de guerres.
Néanmoins, ce sujet qui, justement de par son
importance dans les représentations et sa portée dans la
société, est fortement investi par le politique qui se soucie
à la fois de l'Education nationale ainsi que du traitement d'un tel
sujet dans la société. Ainsi, ce présent mémoire
vise à analyser en quoi l'étude des guerres dans l'enseignement
secondaire reflète-t-elle les choix politiques effectués dans les
programmes scolaires ainsi que les enjeux sociétaux et civiques.
Dans un premier temps, une synthèse de la
littérature scientifique ainsi qu'un développement
théorique de ce présent sujet seront établis. Dans un
deuxième temps, le développement d'une potentielle mise en oeuvre
pédagogique sera présentée à travers un dispositif
expérimental portant sur l'étude de la Résistance et de la
figure du résistant.
P a g e 4 | 47
Première partie : Etat de l'art.
1. Etudes et analyses de la guerre en Europe.
1.1. La théorisation du concept de guerre : de
multiples recherches scientifiques.
Pour commencer, nous allons étayer la
théorisation du concept de guerre en évoquant certaines des
recherches scientifiques dont elle a fait l'objet. L'analyse et le
questionnement du concept de guerre en France s'inscrivent dans de larges
études et débats qui participent à la théorisation
de ce concept. Nous pouvons préciser que la guerre est un concept
puisqu'elle est une représentation abstraite d'un ensemble de
perceptions associées au conflit, à la violence, mais
également au désaccord. Toutefois, les réflexions autour
de ce concept ont donné lieu à de multiples notions telles que la
guerre juste et la guerre totale.
Nous pouvons ainsi aborder les recherches scientifiques autour
de la guerre à travers les travaux de Carl Von Clausewitz. Carl Philipp
Gottlieb von Clausewitz est un officier ayant vécu à la fin du
XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ce
théoricien est célèbre pour ses écrits militaires,
principalement pour son traité de stratégie intitulé
De la guerre1. Cette oeuvre a une influence
considérable dans le domaine des sciences politiques et militaires, et
contribue ainsi à la définition du concept de guerre.
Cette oeuvre de la pensée de la guerre est
rédigée entre 1816 et 1830 alors que l'auteur devint directeur
des études de l'Académie militaire de Berlin après avoir
combattu durant les guerres napoléoniennes. L'ouvrage est une
conceptualisation de la guerre à travers laquelle Carl von Clausewitz
s'appuie sur diverses théories, façonnant ainsi la
définition de la guerre. Tout au long de son exposé, l'auteur
soulève plusieurs caractéristiques de la guerre qui la rendent
effective. Parmi elles, nous pouvons développer le caractère
politique en nous appuyons sur une de ses citations, tirée de son
ouvrage De la guerre « La guerre d'une communauté de
peuples entiers et notamment des nations civilisées surgit toujours
d'une situation politique et n'éclatera que pour un motif politique.
Elle est donc un acte politique. [...] Nous voyons donc que la guerre n'est pas
seulement un acte politique, mais un véritable instrument politique, une
continuation des relations politiques, un accomplissement de celles-ci par
d'autres moyens2 ».
1 VON CLAUSEWITZ Carl, De la guerre,
Paris, Les éditions de Minuits, « Collection Arguments », red.
1955, 760 pages.
2 Ibidem.
P a g e 5 | 47
Par cette définition, Carl Clausewitz affirme que la
guerre n'est pas autonome, et qu'elle répond à des objectifs et
des intentions préalablement établis par un groupe d'hommes. De
ce fait, on apprend que la guerre est le résultat d'un jeu
d'intérêt entre plusieurs groupes d'hommes. D'ailleurs, par la
dénomination de « communauté de peuples entiers », le
théoricien militaire introduit ainsi un principe populaire qui rentre
dans le jeu de la guerre ; selon lui, cela s'explique principalement par le
contexte qui continue d'animer la scène publique, à savoir un
contexte marqué par des mouvements politiques et sociaux de la
Révolution française.
D'autre part, une autre caractéristique de la guerre
est mise en lumière par Carl von Clausewitz et s'illustre à
travers la citation suivante « La guerre est un acte de violence
engagé pour contraindre l'adversaire à se soumettre à
notre volonté [...] Pour atteindre cette fin avec certitude nous devons
désarmer l'ennemi. [...] La guerre est un acte de violence, et l'emploi
de celle-ci ne connaît pas de limites. [...] La guerre du temps
présent est une guerre de tous contre tous. Ce n'est pas un roi qui fait
la guerre à un autre roi, ni une armée qui fait la guerre
à une autre armée, mais tout un peuple qui fait la guerre
à un autre peuple. ». Par-delà, Carl von Clausewitz souligne
la manifestation de la violence dans la guerre. En effet, le militaire s'est
intéressé dans son ouvrage aux « guerres populaires »
telles que la guérilla espagnole durant la guerre d'indépendance
espagnole, dans lesquelles il voit une « radicalisation de la violence
»3.
Dans le même temps, le théoricien militaire
soulève les enjeux d'organisations étatiques et sociales mises en
place pour mener une guerre. De fait, la violence n'est plus centrale dans le
déploiement de la guerre, elle apparait comme complémentaire
à toute une organisation. D'ailleurs, on l'observe durant la
Première Guerre mondiale, qui est une guerre totale4 dont le
but est de vaincre les ennemis grâce à une organisation sociale
soumise aux moyens de la guerre. Ceci s'illustre notamment par le travail des
femmes durant cette période (1914-1918) permettant la mobilisation des
hommes sur le front.
Ce traité de stratégie militaire a permis une
théorisation de la guerre contemporaine. Cependant, le concept de la
guerre a été l'objet de renouvellement et de controverses en
France. Des chercheurs questionnent et interrogent les définitions du
célèbre théoricien. Certains d'entre eux reprennent
certaines de ses définitions et les contestent. Il existe aujourd'hui
trois conceptions de la guerre. Raymond Aron a été l'un des
chercheurs qui ont interrogé la conception de la guerre de Carl Von
Clausewitz. À propos de la guerre, il a surnommé « La
Formule » ce qui faisait référence à la
définition de la guerre héritée de Carl von Clausewitz,
3 PELPRAS Samuel, « Penser la guerre avec
Clausewitz ? », GeopoWeb, 29 mai 2017.
4 LUDENDORFF Erich, La guerre totale, Paris,
Perrin, « Collection Tempus », red.2014, 224 pages.
P a g e 6 | 47
soit « La guerre est une simple continuation de la politique
par d'autres moyens »5.
Bien que Carl von Clausewitz s'est attaché à
analyser et comprendre le concept de la guerre, de nombreux points de
divergence sont soulevés par Raymond Aron concernant les
définitions de la guerre6. En effet, selon lui « La
Formule » du théoricien soulève trois définitions
possibles de la guerre à savoir ;
- « La guerre d'une communauté - de peuples
entiers et notamment des nations civilisées - surgit toujours d'une
situation politique et n'éclatera que pour un motif politique. Elle est
donc un acte politique ».
- « La guerre est un acte de violence, et l'emploi de
celle-ci ne connaît pas de limites. Chacun des adversaires impose sa loi
à l'autre. Il en résulte une interaction qui, selon la nature de
son concept, doit forcément conduire aux extrêmes. »
- « La guerre n'est rien d'autre qu'un duel
amplifié. Si nous voulons saisir comme une unité
l'infinité des duels particuliers dont elle se compose
»7.
Certains éléments soulevés apparaissent
désordonnés. Tout d'abord, lorsque Clausewitz avance que la
guerre est la « continuation de la politique », il ne définit
pas le terme « politique » laissant place à la confusion.
Aussi, il avance que la guerre est un instrument politique, or dans un autre
élément de définition il affirme que la guerre est le
résultat d'une interaction entre deux groupes d'hommes, cela apparait
confus8.
Ces questionnements modifient la perception que l'on peut
avoir de la manifestation de la guerre, c'est-à-dire soit un moment
violent entre deux groupes d'hommes, soit une « forme que prennent les
relations entre groupes organisés (...) une forme alternative des
relations entre les hommes »9. Malgré certaines
confusions soulevées par Raymond Aron, il est cependant possible
à ce stade d'identifier une caractéristique majeure de la guerre
selon Carl von Clausewitz : elle est tout à la fois un instrument
politique donnant lieu à une confrontation violente des armées et
une « des formes que prennent les interactions bilatérales entre
groupes organisés »10.
5 VON CLAUSEWITZ Carl, De la guerre,
op.cit.
6 ARON RAYMOND, Penser la guerre,
Clausewitz, Gallimard, « Collection Bibliothèque des sciences
humaines », 1976, 480 pages.
7 VON CLAUSEWITZ Carl, De la guerre,
op.cit.
8 ARON Raymond, Penser la guerre, Clausewitz,
op. cit.
9 VON CLAUSEWITZ Carl, De la guerre, Paris,
op. cit.
10 SCHU Adrien, « Qu'est-ce que la guerre ?
Une réinterprétation de la « Formule » de Carl von
Clausewitz », Revue française de science politique, 2017
(Vol.67), p 291 - 308.
P a g e 7 | 47
Par ailleurs, Carl von Clausewitz ainsi que d'autres penseurs
ont tenté de rendre compte de la diversité de la forme des
guerres au cours du temps. Aujourd'hui, on associe le concept de guerre
à un « combat intense, animé par une forte volonté
politique »11. Communément, la guerre désigne
« un conflit armé à grande échelle opposant au moins
deux groupes humains »12. Dorénavant, on distingue la
guerre conventionnelle, soit la guerre classique précédemment
définie, de la guerre non-conventionnelle telle que la guérilla
qui a la particularité d'illustrer un combat asymétrique.
D'autres théorisations de la guerre ont donc fait suite
à celles de Carl von Clausewitz. Des hommes politiques tels que
Lénine, Mao Zedong, ou Charles de Gaulle participent au
développement de la pensée de la guerre. Charles de Gaulle par
exemple, écrit des oeuvres militaires telles que Le Fil de
l'épée (1932)13 mais aussi Vers
l'armée de métier (1934)14. Dans ces deux
ouvrages, le secrétaire général de la Défense
nationale développe des théories militaires notamment sur
l'importance du renseignement en temps de guerre, mais aussi sur l'importance
de recourir à la modernisation des moyens de guerre15. Les
nombreuses recherches sur le concept de guerre ont donné naissance
à une discipline à part entière appelée «
polémologie » impulsée par le sociologue Gaston Bouthoul.
Le concept de guerre est ainsi marqué par de multiples
définitions qui ont évolué au fil du temps, mais surtout,
qui témoignent des évolutions diverses et variées du
phénomène guerrier. Dorénavant, la guerre ne se
définit plus seulement selon les théories de Clausewitz.
1.2. Le concept de la guerre dans l'historiographie
européenne.
Pour comprendre le concept de la guerre, il faut pouvoir en
établir une histoire. En effet, l'écriture de la guerre est
marquée par de nombreux renouvellement selon les époques. Le
sujet de la guerre a toujours interrogé les historiens tels que
Thucydide ou Hérodote. Ce fut un sujet considéré comme une
expérience de vie dont il faut tirer des leçons et qui a permis
d'enseigner la tactique et la stratégie aux hommes.
11 TERTRAIS Bruno, La guerre, Paris,
Presses Universitaires de France, « Collection Que sais-je ? », 2014,
128 pages.
12 Ibidem.
13 DE GAULLE Charles, Le Fil de
l'épée, Paris, Plon, « Collection les acteurs de
l'Histoire », red. 1996, 142 pages.
14 DE GAULLE Charles, Vers l'armée de
métier, Paris, Plon, « Collection les acteurs de l'Histoire
», red. 1971, 256 pages.
15 OFFENSTADT Nicolas, L'Historiographie,
Paris, Presse universitaire de France, « Collection Que sais-je ? »,
2017, 127 pages.
P a g e 8 | 47
Selon Nicolas Offenstadt16, les récits de
guerre ont longtemps été écrits par les militaires
eux-mêmes. On qualifie cela d'histoire militaire car l'écriture
est très stratégique, sans réelles réflexions.
C'était donc une histoire-bataille, c'est-à-dire centrée
sur l'événement. En cela, elle suscitait de la méfiance et
subit des critiques de la part de certains historiens tels que Hans
Delbrück (1848-1929) qui reproche à cette histoire écrite
par les états-majors d'être trop détachée du
politique, de l'économique et du culturel17.
Cette période (XIXe siècle) marquée par
les écrits des généraux est donc longtemps marquée
et influencée par l'approche clausewitzienne au détriment d'une
prise en compte des acteurs et de leurs témoignages, éloignant
ainsi les écrits de la réalité des combats. Cette tendance
se perpétue tout au long du XIXe siècle jusque-là
première moitié du XXe siècle. Les premiers traitements de
la Grande Guerre s'opèrent selon cette approche clausewitzienne comme en
témoigne l'ouvrage Penser la Grande Guerre : un essai
d'historiographie d'Antoine Prost et Jay Winter18 dans lequel
ils montrent qu'il y a eu trois configurations
historiographiques19.
Dans un premier temps, l'histoire de la Première Guerre
mondiale débute dès 1915, soit avant même que celle-ci se
termine. C'est une écriture qui mêle principalement des
récits militaires à des récits diplomatiques, et cette
tendance se poursuit après la fin de la guerre. En témoigne ainsi
la Revue d'histoire de la guerre mondiale, née en 1923, qui
réunit des articles d'historiens avec des articles de
généraux. Ce premier temps historiographique est marqué
par l'occultation des aspects économiques. Les revues telles que
Clio ou La crise européenne et la Grande Guerre ne
consacrent que très peu d'articles aux dettes et aux dépenses de
guerre. Pour autant, quelques historiens sont précurseurs de la
deuxième configuration historiographique notamment Ernest Lavisse et
Charles Seignobos. En effet, le premier, avec le dernier volume de son
Histoire de la France contemporaine20, opère une
approche moins centrée sur les aspects militaires et diplomatiques que
sur les aspects économiques. Il en est de même pour Charles
Seignobos qui suit cette tendance en montrant de l'intérêt pour
les conséquences économiques de guerre en analysant la dette
publique21. Aussi, cette deuxième configuration
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 PROST A., WINTER J., Penser la Grande Guerre. Un essai
d'historiographies, Paris, Editions du Seuil, 2004, 344 pages.
19 Ibidem.
20 LAVISSE Ernest, Histoire de la France
contemporaine, depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919,
Paris, Hachette, 1922, 10 tomes.
21OFFENSTADT Nicolas, L'Historiographie, op.
cit, page 23.
P a g e 9 | 47
historiographique se caractérise par un
élargissement de l'approche à travers une reconfiguration
sociale. Celle-ci s'illustre notamment avec une prise en compte des acteurs et
de leurs témoignages, tels que les poilus et les civils. En
collaboration, les historiens et soldats André Ducasse, Jacques Meyer,
et Gabriel Perreux écrivirent l'ouvrage Vie et morts de
Français, 1914-1918 en 195822 dans lequel la parole est
donnée aux poilus à travers le récit de leur vie
quotidienne au front, mais aussi aux civils.
Une troisième configuration historiographique de la
Grande Guerre s'opère au tournant des années 1990 avec le passage
d'une histoire sociale à une histoire culturelle. En effet, l'approche
permet l'étude de la mémoire, mais aussi du comportement au
combat. L'ouvrage de John Keegan The Face of Battle (1976) traduit cet
intérêt pour le soldat en tant qu'acteur culturel notamment
à travers l'étude du comportement de l'homme face au combat, avec
une influence anthropologique. D'ailleurs, l'auteur déclare « La
guerre est un acte culturel »23. D'autre part, des
thèses d'approches culturelles sont élaborées dans cette
troisième configuration. George Mosse étudie et analyse
l'expérience combattante et théorise ainsi la banalisation de la
violence et la brutalisation de la société à l'issue de la
Première Guerre mondiale24. Ainsi, ces études moins
centrées sur l'histoire militaire et davantage influencées par
une approche culturelle, rendent compte des réalités sociales et
sociologiques de la guerre à travers l'analyse de nouveaux types de
sources (des carnets, des journaux privés, des lettres de soldats etc.),
permettant de détailler le vécu des combattants.
Par la suite, le regain d'intérêt pour le soldat
dans une dimension culturelle se poursuit et se distingue notamment durant la
période de la microhistoria (années 1970 - 1990)25,
qui caractérisait des historiens (historiens italiens au départ)
ayant un fort intérêt pour les sciences sociales, tels que
Giovanni Levi. Au-delà du seul traitement de la Grande Guerre,
l'écriture de la guerre a pu se faire au prisme de l'histoire-bataille.
C'est le courant des méthodiques (deuxième moitié du XIXe
siècle) qui caractérise la période de l'histoire-bataille,
à savoir une histoire centrée sur l'événement,
écrite par des militaires, comme évoqué
précédemment. Cette approche, bien que contribuant à
l'élaboration d'un récit national, est vivement critiquée,
on reproche aux méthodiques de privilégier une histoire du
récit, trop technique et factuelle.
22 DUCASSE A., MEYER J., PERREUX G., Vie et mort
des Français 1914-1918, Paris, Hachette, 1959, 611 pages.
23 KEEGAN John, Histoire de la guerre, Du
néolithique à la guerre du Golfe, Paris, « Collection
Tempus », Perrin, 2019, 620 pages.
24 MOSSE George, De la Grande Guerre au
totalitarisme - La brutalisation des sociétés
européennes, Paris, Hachette, 2003, 293 pages.
25 PROST A., WINTER J., Penser la Grande Guerre.
Un essai d'historiographies, op. cit.
P a g e 10 | 47
La bataille en tant qu'objet de recherche ne cesse de susciter
de l'intérêt et bénéficie d'un renouvellement de son
traitement après les conflits mondiaux. En effet, les historiens
s'interrogent sur la nature même d'une guerre. S'effectue alors un
élargissement de l'approche autour de la guerre elle-même. En
témoigne l'ouvrage de Georges Duby Le dimanche de Bouvines en
197326, dans lequel il accorde une plus grande importance au
contexte et à la portée de la guerre. Aussi, bien que le titre
laisse paraître le contraire, cet ouvrage ne s'inscrit donc pas dans le
mouvement de l'histoire-bataille. Ce renouvellement survient durant le temps
des Annales (années 1920 - 1970), un courant de fortes critiques
à l'encontre du courant des méthodiques et de l'histoire
événementielle. En effet, ce courant intellectuel né d'une
revue du même nom, se caractérise par une mise en avant de
l'interdisciplinarité mais aussi par une promotion de l'histoire
économique et sociale, à l'inverse des méthodiques
(années 1870 -1920) qui sont centrés sur le fait historique. Du
fait de cette interdisciplinarité, l'écriture de l'histoire de la
guerre est davantage marquée par l'influence de la sociologie.
L'approche sociologique (années 1980) permet un élargissement des
recherches aboutissant sur de nouvelles observations. La Nouvelle
histoire-bataille témoigne de cette approche sociologique, comme
l'évoque Nicolas Offenstadt dans L'Historiographie, puisqu'elle
s'intéresse principalement aux acteurs « d'en bas ».
Jusque-là l'histoire bataille est centrée sur « l'histoire
des combats vue d'en haut ». Cette Nouvelle histoire-bataille vise au
contraire à analyser l'expérience du combat mais également
les relations ainsi que les pratiques durant la guerre (telles que le
ravitaillement). En témoigne par exemple l'ouvrage de Victor Hanson,
The Western Way of War Infantry Battle in Classical Greece écrit en
198927, dans lequel celui-ci étudie l'expérience de
l'hoplite au combat ainsi que ses pratiques militaires durant
l'Antiquité. En outre, le renforcement de l'approche sociologique dans
l'histoire de la guerre a conduit à exploiter des documents produits par
les soldats (lettre, journal de bord etc.), contribuant ainsi à la prise
en compte de nouvelles sources historiques. Aussi, l'approche sociologique a
permis d'interroger les violences de guerre jusque-là occultées.
Avec son ouvrage Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique
d'un massacre d'Etat, Alain Dewerpe tente d'analyser la violence en temps
de guerre (ici, guerre d'Algérie)28.
De plus, l'évolution des recherches liées
à la guerre se lit au regard du contexte
26 DUBY George, Le dimanche de Bouvines, Paris,
Gallimard, 1973, 312 pages.
27 HANSON Victor, The Western Way of War :
Infantry Battle in Classical Greece, California, University of California
Press, 2009, 271 pages.
28 DEWERPE Alain, Charonne 8 février
1962 : Anthropologie historique d'un massacre d'Etat, Paris, Gallimard,
2006, 897 pages.
P a g e 11 | 47
international. En effet, un certain intérêt pour
l'histoire de la guerre s'opère en réaction aux conflits
internationaux comme c'est notamment le cas dans les années 1980 - 1990
au moment de la chute de l'URSS. Dans un contexte mondialement marqué
par les conflits, l'histoire des relations internationales se renforce.
Initialement, ce sont les historiens de l'école des Annales qui
développèrent l'histoire diplomatique avant qu'elle ne devienne
une histoire des relations internationales. En France, Pierre Renouvin et
Jean-Baptiste Duroselle soutiennent ce développement et cet
élargissement des études diplomatiques qui se traduisent par
exemple avec l'ouvrage de Raymond Aron intitulé Paix et guerre entre
les nations29.
Par conséquent, au cours du XIXe et XXe siècle,
l'histoire de la guerre témoigne de diverses approches qui ont permis
à la fois d'approfondir la définition même de ce concept,
mais également d'interroger de nouveaux aspects inhérents
à celui-ci.
1.3. L'épistémologie de la guerre.
Nous pouvons enfin détailler l'évolution du
concept de la guerre. Ce concept est forgé au gré des
époques par divers penseurs, apportant ainsi des éléments
de compréhension et notamment des concepts et ce dès
l'Antiquité. En effet, des hommes se sont longuement interrogés
sur les modalités de la guerre mais également sur sa
portée morale. Le concept de bellum iustum (guerre juste) est
structurant dans la société romaine, s'illustrant à
travers la figure de Cicéron qui plaide pour sa cause. Théoriser
la guerre juste est un acte à la fois politique mais également
moral, et permet de régir les règles entre les hommes afin
d'encadrer la guerre.
Plus largement, la théorisation des modalités de
la guerre se retrouve également durant le Moyen Âge. Le penseur
Thomas d'Aquin a par exemple formulé un ensemble de règles qui
justifient et délimitent la guerre dans son ouvrage écrit entre
1266 et 1273 intitulé Somme théologique. Plus tard,
durant l'époque moderne, le juriste et humaniste Grotius apporte des
éléments dans la théorisation de la guerre juste. En
effet, dans un ouvrage Le droit de la guerre et de la paix (1625),
il traite de l'origine de la guerre ainsi que de ses possibles
motivations, l'amenant à aborder la distinction entre guerre publique et
guerre privé30. L'élaboration d'un tel traité
apparaît plus que nécessaire dans le contexte des guerres modernes
et permet de comprendre la réalité de l'époque moderne et
de la construction du système westphalien. Aujourd'hui, la notion de
guerre juste ne renvoie plus aux mêmes motivations de l'époque
moderne et la particularité étant qu'elle ne dépend plus
d'un seul et même paradigme. En
29 ARON Raymond, Paix et guerre entre les
nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, 794 pages.
30 GROTIUS Hugo, Le droit de la guerre et de la
paix, Paris, Presse universitaires de France, 2012, 888 pages.
P a g e 12 | 47
témoigne la diversité des formes de conflits
actuels qui sont le résultat de motivations à la fois politiques,
idéologiques et économiques.
Enfin, Carl von Clausewitz, a également forgé
des notions relatives à la guerre notamment les notions de guerre
absolue (absoluter Krieg) et guerre d'anéantissement
(Vernichtungskrieg). En effet, c'est dans son traité de
stratégie militaire qu'il théorise ces notions lesquelles font
référence à une guerre dont le but précis est
l'anéantissement total de l'ennemi. Ces notions influencent et sont
utilisées au sujet de la Première Guerre mondiale au début
du XXe siècle. Mais ce conflit mondial a lui aussi contribué
à l'ébauche de nouvelles notions telles que celle de guerre
totale désignant un conflit idéologique, engageant une
pluralité de belligérants, qui est particulièrement
meurtrier.
Quant à la deuxième guerre mondiale, elle est
aussi à l'origine de la construction de certaines notions telles que
celle de la Blitzkrieg. Signifiant « guerre éclair »,
la Blitzkrieg est développée dans les années 1930
en France, en témoignent deux ouvrages de Charles de Gaulle Le Fil
de l'épée (1932)31 ainsi que Vers
l'armée de métier (1934)32 dans lesquels l'auteur
aborde des éléments de compréhension de ce concept tels
que l'utilisation d'une armée blindée autonome. Au Royaume Uni,
l'historien Basil Henry Liddell Hart contribue à la théorisation
de la Blitzkrieg33.
Après les deux guerres mondiales, les réflexions
autour du concept de guerre et de ses conséquences poursuivent.
L'historien George Mosse interroge les conséquences de la guerre et
développe l'idée d'une « culture de guerre » qui se
manifeste par la généralisation et une acceptation de la violence
dans la société34. Il développe la notion de
brutalisation, que nous avons évoqué précédemment,
qui serait la conséquence de cette culture de guerre, soit « le
transfert de l'expérience de la violence au front vers la
société civile et sa banalisation »35. Cependant,
la notion est « critiquée », certains intellectuels reprochent
à George Mosse à la fois la non prise en compte de facteurs
extérieurs à la guerre ayant participé à
l'émergence de la violence dans le champs politique, mais
également la généralisation à tous les soldats.
Parmi les intellectuels ayant critiqué certaines thèses de George
Mosse, on peut citer Antoine Prost qui publie un article en 2004 dans la revue
d'Histoire intitulé « Les limites de la brutalisation :
31 DE GAULLE Charles, Le fil de
l'épée, op. cit.
32 DE GAULLE Charles, Vers l'armée de
métier, op.cit.
33 LLIDEL HART Basil Henry,
Stratégies, Paris, Perrin, 1998, 433 pages.
34 MOSSE George, De la Grande Guerre au
totalitarisme - La brutalisation des sociétés
européennes, op.cit. 35
https://www.reseau-canope.fr/apocalypse-10destins/fr/dossiers-pedagogiques/lexperience-combattante.html
P a g e 13 | 47
tuer sur le front occidental »36.
Ainsi, de nombreux événements et figures
intellectuelles ont contribué à la consolidation des
théories des guerres, façonnant ainsi une discipline scientifique
traitant de ce thème. En effet, la polémologie, sciences de
conflits, ainsi que l'irénologie, science de la paix impulsée par
Johan Galtung37, sont parties intégrantes des sciences
politiques.
2. L'enseignement des guerres ; enjeux et analyse dans
les programmes scolaires du secondaires.
2.1. Enjeux socio-politiques de l'écriture de
l'histoire des guerres.
Nous allons à présent aborder les enjeux
socio-politiques de l'histoire des guerres dans l'enseignement secondaire.
Avant cela, nous pouvons rappeler que, plus largement, l'écriture des
programmes scolaires d'histoire dans le secondaire répond à des
enjeux socio-politiques. Comme l'a dit Jules Isaac en 1953 «
L'enseignement historique doit tenir compte, non seulement des résultats
acquis par l'enquête scientifique, mais encore des exigences nouvelles du
milieu social »38.
Certains faits contribuent à l'évolution de
l'écriture des programmes d'histoire tels que la guerre elle-même.
Par exemple, la défaite française contre la Prusse en 1871 est
justifiée comme le résultat d'une défaillance du sentiment
national. C'est pour cela que les programmes qui font suite à cet
évènement revalorisent l'histoire nationale.
Toutefois, cette histoire nationale est controversée,
critiquée par exemple par Lucien Febvre et Marc Bloch dans les
années 1930 - 1940 qui prônent eux, une histoire scolaire qui soit
plus « élargie »39 à d'autres espaces. Le
contexte de la construction européenne (années 1950) permet
dès lors un élargissement historique. Cet enseignement s'appuie
principalement sur des points communs qui fondent l'identité
européenne. Ce grand récit européen souhaité dans
les programmes s'illustre aujourd'hui par exemple à travers
l'apprentissage de périodes et évènements ayant
marqué l'ensemble de l'Europe comme en témoigne l'intitulé
du thème 1 de
36 PROST Antoine, « Les limites de la
brutalisation : tuer sur le front occidental », Vingtième
siècle. Revue d'histoire, n°81, 2004, (p 5 - 20).
37 Politicologue norvégien, fondateur de
l'irénologie (science de la paix).
38 DOSSE François, DELACROIX Christian,
etc., Historiographies : concepts et débats, Paris Gallimard,
2010, 645 pages.
39OFFENSTADT Nicolas, L'Historiographie,
op.cit.
P a g e 14 | 47
3ème « L'Europe, un théâtre majeur des
guerres totales (1914 - 1945).40
Ensuite, l'histoire de la guerre répond à des
enjeux politiques et cela s'illustre à travers la mise en oeuvre de ces
enseignements. Cette mise en oeuvre est guidée par des outils
didactiques et pédagogiques que l'on nomme aujourd'hui « la
commande institutionnelle ». Ces documents d'instruction sont officiels et
sont du ressort du ministère. Bien que ces documents officiels ne soient
pas votés par le Parlement, ils revêtent un caractère
législatif. Ce travail est réalisé conjointement avec des
didacticiens, des historiens avant de paraître au Bulletin officiel de
l'Education.
La mise en oeuvre des programmes a toujours été
influencée par la politique. Par exemple, les programmes d'histoire
entre 1945 et 1948 dont l'intitulé comportait « jusqu'à nos
jours », s'arrêtent en réalité en 1939. Les programmes
imposent donc de ne pas traiter la période 1939 - 1945 et cela
répond à des choix politiques puisque cette période
correspond à la Seconde Guerre mondiale, période qui ne souhaite
pas être évoquée par les politiques. Le paradigme de
l'époque contraint les élèves dans le traitement de
certains faits, et la Seconde Guerre mondiale n'est étudiée
officiellement que quelques années plus tard notamment durant une
période marquée par le mythe résistancialiste dans les
années 1960. C'est une période durant laquelle domine
l'idée que tous les Français ont résisté durant le
régime de Vichy et que celui-ci n'a pas eu une forte étendue sur
la société. De ce fait, certains choix politiques ont conduit
à occulter la guerre (ici, la Seconde Guerre mondiale).
L'enjeu politique de l'enseignement de la guerre s'illustre
également à travers l'enseignement civique. En étudiant la
guerre en tant que concept dans le cadre de cet enseignement, cela participe
à l'acquisition de connaissances et de compétences qui permettent
de vivre en société par exemple grâce à
l'étude du pluralisme des opinions, des idéologies, mais
également grâce à la compréhension des règles
qui régissent une société durant une période
historique. Enfin, l'analyse de l'information et de l'image permettent
l'étude de la guerre, renforçant ainsi l'esprit critique.
Enfin, la demande sociale influence les choix politiques et de
ce fait, le politique pénètre les programmes d'histoire des
guerres. C'est le cas par exemple dans les années 1980 - 1990 durant
lesquelles la demande sociale se porte sur une prise en compte de la
mémoire. Ce « moment mémoriel »41 se
manifeste jusque dans l'espace politique, en témoigne le discours de
40 Fiche d'accompagnement Eduscol ; Programme de
3ème, 2016.
41 LEGRIS Patricia, « L'élaboration des
programmes d'histoire depuis la Libération, contribution à une
sociologie historique du curriculum », Histoire@politique,
n°21, 2013, (p 69 - 83).
P a g e 15 | 47
Jacques Chirac en 1995 visant à commémorer la
rafle du Vel' d'Hiv' ayant eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. En effet,
ce discours survient dans un contexte d'une politique de « repentance
»42 dans lequel l'Etat instrumentalise le devoir de
mémoire grâce aux médias. De ce fait, cette
médiatisation donne cours à l'intégration de ce devoir de
mémoire dans les programmes actuels d'histoire dans le secondaire, qui
s'illustre par ailleurs à travers le traitement des questions
mémorielles dans le cadre des guerres telles que celles de la guerre
d'Algérie. D'ailleurs, le traitement des questions mémorielles
relatives à la guerre d'Algérie (dans le programme de 3ème
et de Terminale depuis 1980) permet en outre de gérer certaines
polémiques d'actualité telles que celle autour de la torture
pendant la guerre, débats qui témoignent en outre d'une lecture
plus sociale et sociologique de la guerre.
D'autres politiques surgissent dans un contexte
spécifique et tentent d'influencer les programmes d'histoire des
guerres. Au tournant des années 2000, surgissent des débats sur
la portée des guerres coloniales au XXe siècle et notamment sur
le bien-fondé de certaines colonisations. Ainsi, la position
particulière de Nicolas Sarkozy en 2005 à propos du colonialisme
et de ses effets positifs a conduit à l'élaboration de la loi du
23 février 2005 portant sur la reconnaissance de la Nation et
contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Cette
loi prévoit en effet la mise en avant « du rôle positif
» de la colonisation dans les colonies françaises (et notamment en
Algérie) dans l'enseignement comme en témoigne le programme de
Première générale dans le thème 3 « La
Troisième République avant 1914 : un régime politique, un
empire colonial » et le chapitre 3 « Métropole et colonies
» durant lequel sont valorisés les échanges et contacts
commerciaux en Algérie. Cet exemple de polémique (qui concerne
ici les guerres coloniales et leur « rôle positif »)
témoigne de l'influence du politique sur les modes d'enseignement.
Par conséquent, les débats socio-politiques
impactent et influencent les perspectives d'enseignement de l'histoire des
guerres dans le secondaire. Aussi, en analysant l'écriture des
programmes d'histoire, nous pouvons ainsi saisir les choix politiques
opérés en réaction aux débats sociétaux.
2.2. Quelle est la place de l'enseignement des guerres
dans les programmes ?
À présent, nous pouvons tenter de dresser un
tableau de la présence de l'enseignement des guerres dans les programmes
de l'enseignement secondaire. Rappelons qu'avant le
42
Ibidem.
P a g e 16 | 47
secondaire, le programme primaire prévoit
également un enseignement des guerres notamment en CM1 avec le
thème 2 d'histoire intitulé « Le temps des rois »,
l'étude des rois permettant ainsi d'étudier les guerres de
religion par exemple. Le programme de CM2 prévoit également un
enseignement des guerres avec le thème 3 intitulé « La
France, des guerres mondiales à l'Union européenne »
permettant ainsi une première approche des deux conflits mondiaux.
Le tableau ci-dessous fait état de l'enseignement de la
guerre dans les classes du secondaire ;
|
Sixième
|
|
Thème 3 L'empire romain dans le monde romain.
|
|
|
ST1 Conquêtes, paix romaine et romanisation.
|
|
|
4 Thème qui traite de la guerre comme
une caractéristique dans la formation de l'empire romain
(conquêtes, colonisation etc. tout cela contribuant à l'expansion
du pouvoir romain).
|
|
Cinquième
|
|
Thème 2 Société, Église et pouvoir
politique dans l'occident féodal (XI-XVe siècles).
|
|
|
ST3 L'affirmation de l'État monarchique dans le royaume
des Capétiens et des Valois.
|
|
|
4 Sous thème 3 qui permet de traiter de
la guerre de Cent Ans (1337-1453)
|
|
sans que celle-ci ne soit centrale. Néanmoins,
étudier cette guerre permet d'analyser les modalités d'action
d'un Etat en pleine formation et affirmation.
|
|
Thème 3 Transformation de l'Europe et ouverture sur le
monde aux XVI-XVIIe siècles ?
|
|
|
ST2 Humanisme, réformes et conflits religieux.
|
|
|
ST3 Du prince de la Renaissance au roi absolu (François
Ier, Henri IV, Louis XIV).
|
|
|
4 Sous thème 3 qui permet de traiter des
guerres d'Italie et d'étudier ainsi, à
|
|
travers l'évènement qu'est la guerre, le contexte
« européen ».
|
Troisième
Thème 1 L'Europe, un théâtre majeur
des guerres totales.
P a g e 17 | 47
|
ST1 Civils et militaires dans la Première guerre
mondiale.
|
|
|
ST3 La deuxième guerre mondiale, une guerre
d'anéantissement.
|
|
|
ST4 La France défaite et occupée. Régime de
Vichy, collaboration, Résistance.
|
|
|
Thème 2 Le monde depuis 1945.
|
|
|
ST2 Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.
|
|
|
ST4 Enjeux et conflits dans le monde après 1989.
|
|
|
4 Thème 1 qui traite des guerres
mondiales avec un centrage militaire et
|
|
politique, mais avec une vision européenne d'ensemble +
pas de distinction entre civils et militaire car ce qui est mis au centre c'est
l'intérêt pour l'acteur quel qu'il soit.
|
|
4 Thème 2 qui traite de conflits qui
rythment l'actualité de l'époque. La guerre
|
|
est donc perçue dans le temps long, inhérente au
contexte international mais surtout aux évènements
antérieurs (les conflits mondiaux).
|
|
Première
|
|
Thème 4 La Première Guerre mondiale : le «
suicide de l'Europe » et la fin des empires
|
|
européens.
|
|
CHP1 Un embrasement mondial et ses grandes étapes.
|
|
|
CHP2 Les sociétés en guerre : des civils acteurs et
victimes de la guerre.
|
|
|
CHP3 Sortir de la guerre : la tentative de construction d'un
ordre des nations
|
|
démocratiques.
|
|
4 Thème 4 qui traite de l'aspect
chronologique d'une guerre ; la Première
|
|
guerre mondiale y est étudiée d'un point de vue
militaire, de fait, l'analyse des grandes batailles est nécessaire
(CHP1). Le chapitre suivant traite de l'aspect social de cette guerre et
renvoie aux acquis de 3eme (Thème 1), et enfin, le CHP3 dans une
perspective diplomatique (fait référence aussi à la
Terminale de spécialité), tend à analyser les relations au
sortir de la guerre.
|
P a g e 18 | 47
|
Terminale
|
|
Thème 1 Fragilités des démocraties,
totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945).
|
|
|
ST3 La seconde guerre mondiale.
|
|
|
Thème 2 La multiplication des acteurs internationaux dans
un monde bipolaire (de 1945 au
|
|
début des années 1970).
|
|
ST1 La fin de la Seconde guerre mondiale et les débuts
d'un nouvel ordre mondial.
|
|
|
4 Thème 1 et 2 Etude des contextes
politiques et diplomatiques à travers
|
|
l'analyse de la Seconde Guerre mondiale.
|
|
Terminale technologique
|
|
Thème 1 Totalitarismes et Seconde guerre mondiale.
|
|
|
Thème 2 Du monde bipolaire au monde multipolaire.
|
|
|
4 Thème 1 qui traite des facteurs de la
guerre (facteurs politiques) ainsi que les
|
|
conséquences de la guerre (génocide), tandis que
le Thème 2 traite des
|
|
différentes formes que peut prendre la guerre (avec la
guerre des étoiles dans le contexte de guerre froide).
|
|
Terminale de spécialité HGGSP
|
|
Thème 2 Faire la guerre, faire la paix : formes de
conflits et modes de résolution.
|
|
|
Axe 1 La dimension politique de la guerre : des conflits
interétatiques aux enjeux
|
|
transnationaux.
|
|
Axe 2 Le défi de la construction de la paix.
|
|
|
CCL Le Moyen-Orient : conflits régionaux et tentatives de
paix impliquant des
|
|
acteurs internationaux (étatiques et non
étatiques).
|
|
Thème 3 Histoires et mémoires.
|
|
|
Axe 1 Histoires et mémoires des conflits.
|
|
|
4 Thème 2 qui traite dans un premier
temps de la guerre en tant que concept et
|
|
P a g e 19 | 47
|
qui tend à analyser les caractéristiques d'une
guerre ainsi que ses conséquences (avec comme synthèse
l'étude des conflits au Moyen-Orient). D'autre part, ce thème est
le premier à interroger le concept de paix ; thème qui
étudie les objectifs et les issues de la guerre.
|
|
Tandis que le Thème 3 a une
approche sociologique et culturelle de la guerre (avec étude de la
guerre d'Algérie par exemple), c'est-à-dire que l'objectif est
d'étudier et analyser les phénomènes sociaux. Ces deux
thèmes permettent de se référer et étudier des
éléments épistémologiques et historiographiques
évoqués en partie I (évolution du concept de guerre) ;
cela est en adéquation avec les objectifs de Terminale de
spécialité qui est d'apporter un renforcement des connaissances
scientifiques mais également d'adopter une posture pluridisciplinaire
dans l'étude d'un phénomène (ici la guerre
d'Algérie et la question de la mémoire après la guerre
d'indépendance) qui est à la fois historique et sociologique.
|
2.3. Quelle mise en oeuvre de l'enseignement des
guerres dans les programmes du secondaire ? Un exemple de comparaison du
programme de Troisième et de Terminale.
A présent, il s'agit d'analyser la mise en oeuvre de
l'enseignement des guerres dans les programmes. Pour cela, nous pouvons tenter
de réaliser une analyse comparative des mises en oeuvre de
l'enseignement des guerres, préconisées par les programmes. A cet
effet, nous allons nous concentrer sur le programme de Troisième avec le
thème 1 « L'Europe, un théâtre majeur des guerres
totales » et le sous thème 3 « La deuxième guerre
mondiale, une guerre d'anéantissement »43, ainsi que le
programme de Terminale avec le thème 1 « Fragilités des
démocraties, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale (1929 - 1945)
» et le sous thème 3 « La seconde guerre mondiale
»44. Ces deux programmes proposent donc d'enseigner le
deuxième conflit mondial, mais différemment.
En effet, bien que tous deux préconisent d'enseigner ce
thème autour de notions centrales (que ce soit « crise »,
« guerre totale » ou autres), ils ont une approche
différenciée. En classe de Troisième, l'objectif est de
rendre compte des mutations sociales et politiques en mettant
43 Fiche accompagnement Eduscol ; Programme de
3e, Thème 1, 2016.
44 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de
Terminale, Thème 1, 2016.
P a g e 20 | 47
l'accent sur les phénomènes politiques et
militaires. En revanche, en classe de Terminale, l'objectif est de mettre en
exergue la violence des événements, l'accent est mis sur le
génocide ainsi que les autres crimes qui ont été commis.
De ce fait, l'approche y est plus sociologique, c'est-à-dire que
l'objectif est d'étudier davantage les phénomènes sociaux.
De fait, la perspective militaire y est moins développée. Pour
autant, les deux programmes incitent fortement à enseigner selon une
progression chronologique et à lire les événements
indépendamment des autres.
Par conséquent, nous pouvons affirmer que
l'enseignement de l'histoire, et plus précisément de la guerre,
répond à des recommandations préalablement
formulées selon un processus institutionnelle.
3. L'histoire des guerres : un enseignement aux
finalités multiples. 3.1. Guerre et citoyenneté ? La formation du
citoyen dans la société.
L'enseignement des guerres répond à plusieurs
finalités. Tout d'abord, cet enseignement participe à la
formation du citoyen dans la société, et répond donc
à une finalité civique. En effet, à travers l'étude
de la guerre et de ses mécanismes inscrits dans une époque,
l'élève acquiert une culture qui est commune à tous les
élèves en France. S'appuyant sur des événements
(ici, les guerres) constitutifs de notre nation, cette culture commune permet
donc au futur citoyen de s'intégrer pleinement dans notre
société actuelle.
L'acquisition d'une telle culture s'effectue à travers
l'étude des guerres dans l'histoire mais également à
travers l'étude de la guerre aujourd'hui, dans la société
actuelle. En effet, l'étude des guerres permet de comprendre et
d'analyser le fonctionnement d'une société antérieure, ses
mécanismes, ses rapports sociaux et ses rapports de dominations. C'est
le choix opéré en classe de 5ème avec le sous thème
« Affirmation de l'État monarchique dans le royaume des
Capétiens et des Valois »45 au cours duquel il s'agit de
mettre en lumière le fonctionnement de la société
féodale au regard des rapports de force qui s'y exercent et notamment au
travers de la guerre, phénomène qui illustre les
mécanismes décisionnels et institutionnels d'un État. De
ce fait, l'élève est en mesure de comprendre quel était le
fonctionnement à l'époque médiévale, afin de
comprendre notre système actuel lui-même héritier de ce
fonctionnement à l'époque médiéval. Avec ce
thème, le phénomène conflictuel
45 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de
5e, Thème 2, 2016.
P a g e 21 | 47
permet de comprendre une société mais aussi le
pouvoir de l'État dans la bataille de Bouvines ou dans la guerre de Cent
Ans. En outre, cela permet l'analyse de la construction de la nation
française permettant ainsi l'acquisition de références
historiques communes à tous les élèves, ainsi que la
compréhension de notre société actuelle en lien avec ces
évènements passés.
En effet, l'étude des guerres nous éclaire quant
à la société actuelle, héritée de
l'Histoire. Délivrant des clés de lecture de notre époque,
l'étude des guerres permet en outre de comprendre et analyser les
modalités de puissance d'un État. L'analyse et la
compréhension du rôle de l'Etat dans un conflit sont mises en
oeuvre en classe de Terminale de spécialité avec le thème
« Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de
résolution » avec l'axe 1 « La dimension politique de la
guerre : des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux
»46. En effet, ce thème permet de revenir sur la
pensée militaire formulée et développée notamment
par Carl Clausewitz comme nous l'avons évoqué en première
partie. Les notions forgées de Clausewitz sont notamment à
l'étude en Terminale de spécialité. Ainsi, l'étude
de la guerre à travers ce thème de Terminale permet d'aborder les
nouvelles formes de conflits qui jalonnent la période contemporaine.
L'étude des guerres contemporaines (guerres au Proche et Moyen-Orient)
permet d'analyser et constater les applications de cette pensée
militaire héritée de Clausewitz à travers l'analyse des
modalités de la guerre contemporaine (étude des
caractéristiques de la guerre irrégulière par exemple dans
le contexte des guerres au Moyen-Orient). Cette étude permet
également d'observer et comprendre l'illustration du pouvoir de l'Etat
dans la guerre (étude de la gouvernance étatique dans un
conflit), phénomène structurant de notre époque actuelle
(rôle de l'Etat central, héritier de la période
westphalienne). Par exemple, étudier la guerre contemporaine à
travers le terrorisme au Moyen-Orient permet à la fois de saisir la
complexité des nouvelles formes et finalités de la guerre
(mêlant ainsi politique, idéologie et économie et ce
parfois dans un espace non-délimité et un Etat
non-identifié comme c'est le cas avec le groupe Daesh qui se proclame
être un Etat en Syrie et en Irak), mais également de comprendre le
déploiement de la force militaire étatique et ses
modalités dans le contexte de la mondialisation marqué par une
structuration et une réglementation des relations internationales.
Enfin, cet enseignement permet de comprendre et d'analyser les
décisions politiques qui sont impulsées par l'État en
France. Le futur citoyen doit être en mesure de comprendre les
décisions diplomatiques (telles que le retrait de troupes
françaises en Afghanistan sous le mandat de François Hollande)
mais surtout les modalités d'action de l'État, avec pour but de
s'intégrer pleinement dans la société. En effet, pour
parvenir à s'intégrer dans la société mais
46 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de
Terminale, Thème de spécialité, 2020.
P a g e 22 | 47
également à comprendre les décisions
étatiques relatives aux conflits, le citoyen s'est approprié un
certain nombre de valeurs et de principes communs à tous les autres
citoyens tels que la liberté, l'égalité, le respect.
Lorsque l'Etat français décide de faire la guerre, il l'a fait au
nom d'un ensemble de valeurs et de principes auxquels les citoyens se
réfèrent. De fait, cette guerre apparaît légitime,
voire nécessaire. Par ailleurs, étudier la guerre dans nos
sociétés actuelles permet d'analyser les évolutions et la
complexité des nouvelles formes de la guerre qui ne sont plus seulement
impulsées par des Etats territoriaux comme en témoigne les
guerres du terrorisme islamiste au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne.
L'étude des ambitions de l'État s'opère
en classe de Terminale avec le thème 2 « La multiplication des
acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des
années 1970) » avec le chapitre 3 « La France : une nouvelle
place dans le monde »47. Ce chapitre ne prévoit pas
initialement l'enseignement de la guerre, pour autant le point de passage et
d'ouverture nous suggère l'étude de la guerre d'Algérie
comme objet permettant de révéler justement les ambitions de la
France dans un contexte de fin de période coloniale mais
également dans le contexte de la guerre froide.
Par conséquent, l'étude de la guerre dans
l'enseignement secondaire répond à une finalité civique,
participant ainsi à la formation du citoyen à travers
l'acquisition d'une culture commune et la compréhension des
phénomènes sociétaux durant les guerres. Parmi ceux-ci, il
y a la lutte au nom de certaines valeurs comme ce fut le cas durant le contexte
de la guerre froide à l'encontre du communisme. L'étude des
phénomènes sociétaux en temps de guerre permet de
s'interroger : qu'est-ce qui a motivé les combats ainsi que les conflits
diplomatiques ? Quelles ont été les conséquences sur la
population ? Surtout, quelle est la portée actuelle de ces principes
autrefois défendus ? Enfin, à l'échelle nationale
(France), on remarque que l'enseignement de la guerre à visée
« morale » et civique permet en outre de questionner notre rapport
à la nation ; quelles sont aujourd'hui les valeurs qui nous unissent ?
Plus encore, est-ce que nous prônons la guerre au nom de ces valeurs ?
3.2. Guerre et paix : une finalité morale ?
L'étude de la guerre suggère une analyse de la
paix, bien que celle-ci n'apparait que tardivement dans l'enseignement
secondaire (en Terminale de spécialité), elle est contenue
implicitement dans les thèmes concernés. L'enseignement de la
guerre répond alors à une
47 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de
Terminale, Thème 2, 2016.
P a g e 23 | 47
finalité « morale ». La morale désigne
un ensemble de règles de conduites, considérées comme
bonnes ou mauvaises selon des principes universels d'une
société48. Il existe ainsi plusieurs conceptions de la
morale car celle-ci se fonde sur un ensemble de préceptes jugés
« bons ou mauvais » pour la société concernée.
Ces préceptes sont déterminés selon deux logiques ; une
logique externe avec pour référentiel des dogmes religieux (tels
que les dix commandements dans la tradition judéo-chrétienne), et
une logique interne avec pour référentiel les valeurs contenues
dans les sociétés démocratiques (tels que le respect,
l'égalité, la liberté, etc.).
Répondant à une finalité « morale
», l'instruction civique opère selon une logique interne, visant
à éduquer et instruire l'élève à propos de
valeurs et principes. En effet, c'est à l'école que
l'élève apprend à dialoguer, à apprécier la
différence et à collaborer avec un individu quelle que soit son
appartenance. L'école est un lieu de formation pour
l'élève, dans lequel il apprend à s'insérer et
s'intégrer pleinement dans la société. Pour illustrer
cela, nous pouvons citer un extrait de la loi d'orientation de
l'éducation nationale de 1991 qui définit davantage le rôle
décision de l'école dans l'éducation de
l'élève et notamment « développant le sens moral et
civique de ceux qu'elle forme, elle vise à en faire des hommes et des
femmes dévoués au bien commun » (à propos de
l'éducation nationale). En outre, l'école est donc le lieu de
formation des futurs citoyens49.
Notre discipline est véritablement celle qui
prévoit un enseignement à visée morale dont l'objectif est
de développer l'aptitude à vivre et agir en communauté
dans la société. Pour cela, l'enseignement de l'histoire
prévoit l'étude et l'analyse des guerres afin de
développer une réflexion « morale » voire philosophique
parfois. En effet, c'est par une approche des guerres que l'enseignement de la
paix s'effectue, elle permet donc d'étudier la paix en tant qu'objet
historique. À ce propos, Arlette Farge a déclaré «
certes, l'histoire des hommes et des femmes regorge de guerres, [...] mais
l'aspiration à la paix sociale (...) est une réalité
visible, lisible. (...) Cette aspiration à la paix, ses modes
d'expression et de réalisation peuvent être objet d'histoire
»50. Ainsi, l'étude de la paix est une partie
intégrante de l'enseignement d'une guerre quelle qu'elle soit, et se
traduit par l'analyse des solutions souhaitées par les
belligérants par exemple. En témoigne par exemple l'axe 2 en
classe de Terminale de spécialité avec le thème 2 «
Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de
résolution »51 au cours duquel
48
Larousse.fr
49 Fiche accompagnement Éduscol ; Enseignement
morale et civique, 2018.
50 OPERIOL Valérie, « Enseigner l'histoire
des guerres. Introduction », Hypothèses, 2018.
51 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de
Terminale, Thème de spécialité.
P a g e 24 | 47
on doit analyser les traités de Westphalie,
traités qui scellent ainsi la paix en Europe au XVIIème
siècle.
Pour terminer, l'éducation à la paix apparait
indispensable dans notre société actuelle marquée par la
diversité des formes de conflits mais également par la
diversité des intérêts et opinions. Comme
évoqué précédemment, l'école est le lieu de
formation du citoyen et de son intégration dans la
société. Cette intégration ne peut se faire sans la
compréhension des faits antérieurs -notamment les guerres et tout
autre conflit. Par conséquent, comprendre les guerres permet de
s'approprier des « leçons d'histoire » (Ernest Lavisse), mais
également des valeurs et des principes, appelant à une paix
durable entre les individus.
En somme, l'enseignement de la guerre répond à
une finalité morale relative à notre société
occidentale, soit une morale qui prône les principes et les valeurs
démocratiques.
3.3. Guerre et mémoire ; un enjeu
mémoriel qui participe à la culture commémorative en
France.
L'enseignement de la guerre répond à un enjeu
mémoriel. En effet, cet enjeu mémoriel se traduit par
l'importance du devoir de mémoire présent dans les programmes
scolaires. Le devoir de mémoire désigne l'exigence
sociétale de se souvenir d'un évènement tragique au nom de
la morale. Celui-ci répond à une volonté de transmettre
les mémoires, mais également de se souvenir des
événements pour pouvoir ensuite les commémorer. À
travers les cérémonies de commémoration de la
Première ou de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de consolider
l'identité collective autour d'un évènement ayant
marqué l'histoire nationale. Aussi, lorsqu'on commémore une
guerre, c'est tout un ensemble de valeurs et de principes que l'on
réaffirme.
Ce devoir de mémoire ne peut être transmis sans
l'analyse et la compréhension des événements conflictuels.
C'est par l'acquisition de connaissances relatives à l'histoire de
France, mais également par la compréhension de certains faits que
l'élève s'identifie et se représente comme appartenant
à notre nation. Ainsi, il est important de se souvenir et de
commémorer les millions de morts de la Première ou la Seconde
guerre mondiale pour rappeler à notre société que des
hommes et femmes ont subi les conséquences de ces
évènements tragiques. D'ailleurs, un des principes fondateurs de
la Chartes des Nations Unies est le suivant : « sauver les
générations suivantes du fléau de la guerre
»52.
52 Site officiel des Nations Unies, centre
régional d'information pour l'Europe occidentale.
P a g e 25 | 47
P a g e 26 | 47
Ce devoir de mémoire est le résultat de
politiques entreprises dès les années 1990 par l'Etat et le
pouvoir public (notamment les municipalités). Aussi, les textes
officiels de cadrage d'enseignement insistent sur l'enjeu mémoriel dans
les programmes d'histoire de 2013. En effet, ceux-ci prévoient une
accentuation sur la force des événements et recommandent de
penser l'expérience de guerre, mais également d'intégrer
les mémoires des anciennes colonies. Pour cela il est recommandé
de sortir du seul cadre national et de prendre en compte d'autres individus sur
des espaces plus larges (jusqu'en Afrique avec l'exemple de l'Algérie).
Aussi, ces textes suggèrent de relier l'étude de la guerre
contemporaine à l'apprentissage de la citoyenneté et de la
démocratie.
Ces recommandations impulsées par le ministère
de l'Education Nationale prennent la forme de projets de commémoration
qui participent à la transmission de la mémoire tels que le
concours national de la résistance et de la déportation, le
concours Bulle de mémoire, le concours des petits artistes de la
mémoire portant sur la Première Guerre mondiale. D'autres projets
sont mis en oeuvre pour travailler à la mémoire nationale par
exemple la mise en place de la journée nationale de la résistance
(qui a lieu le 24 mai) qui est l'occasion d'une « réflexion sur les
valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du
conseil national de la résistance »53. On peut enfin
évoquer les visites musée-mémoriaux qui sont
également des projets mémoriels et peuvent s'inscrire dans un
projet d'enseignement sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Par
exemple, une visite du mémorial de la Résistance peut être
envisagé au cours du chapitre 4 du thème 1 intitulé «
La France défaite et occupée. Régime de Vichy,
collaboration, Résistance ». Par conséquent, ces initiatives
conduites par les pouvoirs publics contribuent à unir la nation autour
d'une mémoire commune.
Pour autant, ce concept de mémoire commune a subi de
nombreuses controverses et critiques dans les débats publics. Pour
cause, des intellectuels rejettent l'idée du devoir de mémoire et
prônent l'existence de plusieurs mémoires. Ces controverses sont
prises en compte par les pouvoirs publics qui tiennent compte des débats
durant les écritures des programmes d'histoire. Par exemple, dès
les années 2000, l'enseignement de la guerre d'Algérie tient
compte des plusieurs mémoires, tant du côté algérien
que français. Cela est d'autant nécessaire que certains
élèves, bien qu'ils soient français, sont au croisement de
deux cultures et donc de deux mémoires. D'autre part, le devoir de
mémoire est également sujet à débat ces
dernières années notamment à propos de la notion de «
devoir » qui induit une exigence universelle de se souvenir et
prévenir ainsi les potentiels erreurs commises dans le
passé54. La critique porte sur
53 Fiche Éduscol ; journée nationale de
la Résistance, 2021.
54 KATTAN Emmanuel, « Penser le devoir de
mémoire », Argument, 2003.
ce caractère injonctif et sur l'évolution du
devoir de mémoire devenu, selon l'historien Paul Ricoeur, « une
direction de conscience »55.
En somme, l'inculcation du devoir de mémoire est une
finalité importante de l'étude des guerres (notamment des deux
conflits mondiaux). Cet enseignement participe ainsi à
l'intégration de l'élève dans une mémoire
collective, bien que celle-ci soit controversée.
55
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/enseigner/memoire_histoire/05historiens1.htm.
P a g e 27 | 47
Deuxième partie : Analyse et critique du
dispositif pédagogique envisagé.
1. Dispositif expérimental de l'étude de
la Résistance et de la figure du résistant durant la Seconde
Guerre mondiale.
1.1. Objectifs et attendus de ce dispositif.
L'étude de la Résistance et de la figure du
résistant dans le cadre de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale
témoigne de la « commande » politique dans les programmes
d'histoire. En effet, comme nous l'avons abordé en première
partie (I/ Etat de l'art), les pouvoirs et débats politiques influencent
la mise en oeuvre de l'enseignement de la guerre en histoire. Alors que le
mythe résistancialiste a prévalu pendant longtemps dans les
mentalités et dans les discours politiques, celui-ci a été
revu grâce aux avancées historiographiques et politiques. Ce
dispositif illustre l'influence du politique dans les programmes d'histoire. En
effet, l'objectif premier de ce dispositif est de construire un enseignement
qui prenne en compte ces évolutions historiographiques et politique et
donc de déconstruire le mythe résistancialiste car bien qu'il ait
été la pensée dominante dans les années 1960, il
persiste aujourd'hui encore une représentation selon laquelle une part
importante des Français ont résisté, parmi les
élèves.
Cet objectif vise donc à déconstruire
l'idée d'un engagement unanime des Français dans le conflit qui
les oppose aux Allemands nazis. Pour se faire, ce dispositif tend à
analyser la diversité des situations parmi les civils et les militaires
français durant la Seconde Guerre mondiale. Cette analyse s'appuie sur
une série d'interrogations qui portent notamment sur l'inégale
répartition de l'engagement des Français, mais aussi sur la
diversité des postures prises dans le contexte du conflit mondial.
Les attendus de ce dispositif sont multiples. En effet, il
permettrait de questionner la notion de collaboration durant la Seconde Guerre
mondiale. Cette dimension du conflit mondial pourrait susciter de vives
réactions notamment d'incompréhension, de surprise, ou au
contraire du soutien ou de la compréhensibilité. Comme
évoqué précédemment, c'est justement ces
réactions qui sont à évaluer et à interroger.
Enfin, cet objectif de déconstruction du mythe
résistancialiste induit tout de même l'étude de la figure
du résistant. De ce fait, ce dispositif permet une analyse
croisée avec l'enseignement morale et civique (EMC) au cours de laquelle
il s'agit de questionner la nécessaire rébellion ou non contre un
pouvoir politique jugé illégitime. En effet, l'enseignement de la
Seconde Guerre mondiale à travers la figure du résistant permet
en
P a g e 28 | 47
outre d'aborder les notions de liberté, d'expression,
d'opinion politique qui renvoient ainsi à l'étude des fondements
de la Résistance.
Ensuite, le deuxième objectif de ce dispositif sera
d'illustrer la portée politique de l'enseignement de la guerre à
travers l'étude de la figure du résistant français comme
permettant la construction de l'identité de l'élève en
tant que français, ainsi que de son rapport à la nation
française. En effet, la mise en oeuvre de ce dispositif répond
à une finalité civique visant à construire une culture
historique, basée sur des faits de Résistance durant la Seconde
Guerre mondiale, qui est donc en lien avec l'histoire de la nation
française.
Afin d'atteindre cet objectif, ce dispositif vise à
étudier la Résistance et les résistants comme des
Français et des Françaises qui se sont engagés dans une
guerre pour leur pays, la France. De cette manière, le dispositif a pour
objectif de faire comprendre les valeurs démocratiques et
républicaines aux élèves. De ce fait, le dispositif est le
moyen d'interroger le rapport que les élèves ont avec la nation
française, et notamment le rapport à l'engagement dans la guerre
pour la nation française. De cette manière, le dispositif permet
de mesurer ce rapport à travers l'analyse des réactions qu'il
suscite ; de l'indifférence, de la fierté, ou de l'antipathie.
Les sentiments et l'expression des élèves qui découlent de
ce dispositif permettent ainsi de soulever des questions d'actualité. En
effet, dans l'hypothèse que ce dispositif soit réalisé en
classe réelle, le rapport à la nation et à
l'identité française est particulièrement incertain et
délaissé. Comme je l'ai précisé
précédemment, le collège Olympique est
caractérisé par une forte homogénéité des
élèves d'un point de vue des résultats scolaires. Ces
derniers sont, en majorité, des enfants issus de l'immigration notamment
maghrébine et africaine. L'objectif de ce dispositif serait donc d'une
part d'interroger l'existence d'un sentiment d'appartenance à une nation
ou pas à travers l'étude des motivations républicaines
d'un résistant français que nous allons mesurer grâce
à un questionnaire effectué en début et fin de
séance. Il est attendu que cette dimension du dispositif se solde par
des débats.
Enfin, l'objectif final de ce dispositif est de montrer que
l'enseignement de la guerre, plus précisément de la
Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, a une portée
sociétale et notamment civique. En effet, la mise en oeuvre de ce
dispositif a pour finalités la formation du citoyen et l'enseignement et
la diffusion des valeurs démocratiques. Ces finalités sont en
lien avec l'objectif précédemment abordé (l'appropriation
des valeurs démocratiques et républicaines). L'objectif est donc
d'étudier la notion d' « engagement » et notamment
d'engagement auprès des valeurs démocratiques dans un contexte de
guerre.
P a g e 29 | 47
1.2. Organisation de ce dispositif.
Ainsi, ce dispositif visant à atteindre les objectifs
s'étend sur trois séances.
Pour atteindre le premier objectif annoncé, nous allons
détailler l'organisation de la première séance. Celle-ci
s'inscrit en Histoire et notamment au cours du thème 1 intitulé
« L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914 -
1945) » avec le chapitre 4 « La France défaite et
occupée. Régime de Vichy, collaboration. Résistance
». Il est a noté que les élèves auront acquis des
bases notamment en classe de CM2 lors du thème 2 intitulé «
La France, des guerres mondiales à l'Union européenne » au
cours duquel ils auront abordé les bases de la Seconde Guerre mondiale
et notamment l'occupation allemande.
Cette séance s'appuie sur une activité
principale qui permet de parvenir à l'idée que tous les individus
ont une opinion différente sous le régime de Vichy
(résistance, collaboration). Cette activité permet en outre
d'interroger la diversité des actions et des postures en temps de
guerre.
Cette activité principale permet de travailler un
certain nombre de compétences telles que se repérer dans le temps
: construire des repères historiques et notamment situer et ordonner des
faits historiques chronologiquement et ce à travers
l'appréhension de la durée du régime de Vichy ; raisonner,
justifier une démarche et les choix effectués notamment se
questionner sur la prise de position dans le contexte politique du
régime de Vichy, mais également argumenter et justifier des
éléments de réponse; analyser et comprendre un document
notamment comprendre le sens général d'un document et extraire
des informations pertinentes avec l'étude sur corpus documentaire mais
également exercer son esprit critique avec l'analyse d'affiches de
propagande ; et enfin coopérer et mutualiser dans le cadre de
l'activité qui se fait en groupe.
Ce dispositif est mis en place dans le cadre d'une
séance qui succède une heure de mise en contexte chronologique de
la Seconde Guerre mondiale et de l'instauration du régime de Vichy, ce
qui aura permis d'aborder certaines notions fondamentales pour la
compréhension des documents telles que collaboration, résistance,
régime de Vichy. La séance dure 2 heures ; les 15
premières minutes sont le moment de réponse des
élèves à un premier sondage dont la question est «
selon vous, à combien s'élève le pourcentage de la
population française étant résistante ? ». Nous
n'attendons pas une réponse scientifique, mais celle-ci reflètera
les représentations des élèves vis-à-vis de la
Résistance. Le professeur ramasse les sondages et met en activité
les élèves individuellement pendant 45 minutes. Cette
première activité consiste à
P a g e 30 | 47
répondre à des questions sur un corpus de
documents portant sur la Résistance56. Au cours de
l'activité, le professeur accompagne les élèves et leur
apporte des éléments de compréhension si
nécessaire. Puis, une correction collective permet de faire participer
les élèves qui proposent des éléments de
réponse aux questions sur le corpus de documents. Cette correction, dont
les élèves prennent notes, souligne les motivations des
résistants ainsi que leurs actions tout en concluant que les
résistants ne concernaient pas tous les Français et que leur
lutte ne faisait pas l'unanimité parmi les Français.
Le professeur annonce ensuite le passage à la
deuxième activité qui dure également 45 minutes. Celle-ci
consiste également à étudier un corpus de documents mais
par groupe de 3 élèves57. Ce deuxième corpus de
documents porte sur la collaboration durant le régime de Vichy. Les
élèves doivent donc, en groupe, répondre à des
questions sur ce corpus de documents. Le professeur insiste cette fois-ci sur
la nécessité de rédiger des phrase et de justifier leurs
réponses en citant les documents. A la fin de l'activité, le
professeur annonce le passage à la correction collective qui s'appuie
sur des réponses synthétiques des élèves à
l'oral. En effet, le professeur pose la question suivante à l'oral
« avec les réponses aux questions portant sur le corpus
documentaire, peut-on affirmer que tous les Français sont
résistants ? Pourquoi ? ». Ainsi, les élèves sont
interrogés et doivent apporter une réponse synthétique
à cette question qui puisse rassembler les éléments de
réponses aux questions du corpus documentaire.
Enfin, après la correction collective dont les
élèves ont pris notes, un second sondage est distribué aux
élèves et est formulé ainsi « selon vous, à
combien s'élève le pourcentage de la population française
étant résistante ? Aussi, à combien s'élève
le pourcentage de la population française ayant collaboré durant
le régime de Vichy ? Enfin, est-ce que les activités que nous
avons faites ont permis de changer d'avis par rapport au premier sondage ?
». En effet, c'est l'analyse de ces deux sondages qui permet de
vérifier si l'objectif du dispositif est atteint.
Pour rappel, l'objectif de ce dispositif expérimental
était de déconstruire l'idée d'une France unanime dans la
lutte contre l'occupation allemande, ainsi que de démontrer qu'il y ait
eu plusieurs postures durant le régime de Vichy. On attend du premier
sondage que la majorité des élèves estime le pourcentage
de la population française résistante à plus de 30 - 40%.
En effet, avant de réaliser ce sondage en classe, j'ai effectué
un sondage oral dans mon entourage qui m'a permis de m'attendre à ce que
les élèves soient éloignés de la
réalité des chiffres
56 Voir Annexe 1.
57 Voir Annexe 2.
P a g e 31 | 47
officiels de la Résistance (environ 2% de la
population). Pour autant, en réalisant ce sondage, le professeur
s'attend également à ce qu'une part minime des
élèves puisse évaluer correctement la part de la
population française résistante.
C'est le second sondage effectué en fin de
séance qui permet de vérifier si l'objectif de ce dispositif est
atteint ou non puisqu'on attend à ce que les élèves aient
réalisé que les Français n'ont pas tous été
résistants, mais qu'en plus certains ont collaboré avec le
régime de Vichy. Ceci s'illustre à travers l'écart de
pourcentage estimé entre le premier sondage et le second. Dans
l'hypothèse où l'objectif est atteint, l'élève
aurait surévalué le pourcentage de population résistante
dans le premier sondage puis aurait rectifié cette estimation dans le
second sondage en abaissant ce taux de pourcentage et en prenant en compte
davantage l'hypothèse que les Français aient pu collaborer (ceci
se manifestant par le pourcentage important attribué aux Français
ayant collaboré). Ainsi, plus l'écart entre le sondage n°1
et le sondage n°2 est important, plus ce dispositif a participé
à la remise en cause des représentation de l'élève.
A l'inverse, le professeur prévoit également l'hypothèse
qu'il y ait un faible écart pour certains élèves,
notamment ceux qui auraient saisi la faible proportion des résistants
français parmi la population française. Dans ce cas-là,
peu probable, ce dispositif participe tout de même à une
évolution des représentations puisqu'il vise également
à rendre compte de la part importante des Français ayant
collaboré avec la régime de Vichy.
Le dispositif se poursuit avec la mise en oeuvre d'une
deuxième séance (séance n°2) qui vise à
atteindre les deux derniers objectifs énoncés (n°2 et 3).
Cette séance s'inscrit également dans le thème 1 «
L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914 - 1945) et
le chapitre 4 « La France défaite et occupée. Régime
de Vichy. Collaboration. Résistance ». Cette séance est
également en lien avec l'enseignement moral et civique (EMC). En effet,
ce lien permet ainsi de travailler deux finalités principales de la
classe de 3e qui sont « acquérir et partager les valeurs
de la République » et « construire une culture civique
».
Le mise en oeuvre de ce dispositif à travers cette
séance permet d'interroger les élèves sur leur rapport
à la nation et aux valeurs républicaines. On rappelle que ce
dispositif est construit pour être réalisé avec une classe
de 3e du collège Olympique dans la banlieue grenobloise.
Comme évoqué précédemment, c'est une classe qui est
particulièrement homogène d'une part de par la faible
mixité culturelle puisque la majorité des élèves
est d'origine étrangère et de par leur niveau scolaire.
Après observation de cette classe de 3ème , il en
résulte que certains élèves sont réfractaires aux
valeurs démocratiques. Ainsi, avec la mise en oeuvre de ce dispositif,
il s'agit de faire comprendre aux élèves que la Résistance
est le
P a g e 32 | 47
résultat d'un sentiment patriotique et
républicain, que cette lutte s'est déployée dans le cadre
d'un engagement de la part des résistants, et enfin que cet engagement
s'est traduit par des actions communes et non individuelles.
Cette séance est construite à partir de deux
activités principales qui permettent ainsi de travailler certaines
compétences telles que raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués notamment argumenter et apporter des
éléments de connaissances dans une argumentation ; analyser et
comprendre un document notamment comprendre le sens général d'un
document et exercer son esprit critique comme c'est le cas avec des documents
qui véhiculent un discours politique ; enfin pratiquer différents
langages en histoire notamment pratiquer l'oral dans le cadre d'une
présentation orale au tableau.
Cette séance dure 2 heures. La séance
débute par un bref questionnaire distribué aux
élèves. Sur ce questionnaire figurent deux questions « Selon
vous, qu'est-ce que sont les valeurs républicaines et
démocratiques ? » et « Selon vous, en quoi sont-elles
importantes ? ». La réponse à ce questionnaire ne dure que
10 minutes. On s'attend à ce qu'une majorité des
élèves peinent à définir les valeurs
républicaines et démocratiques mais surtout à
définir leur importance dans notre société. Ensuite, les
trois premiers quarts d'heure sont consacrés à un temps collectif
à l'oral entre les élèves et le professeur au cours duquel
celui-ci projette deux documents qui renvoient à l'appel du 18 juin 1940
du général Charles de Gaulle58. Il s'agit de
présenter et discuter de ces documents en vue de faire émerger
les idées d'un appel à la cohésion française face
à l'ennemi allemand et d'un appel à la lutte pour les valeurs
républicaines et démocratiques. Après avoir discuté
de ces éléments, que le professeur a pris soin de noter au
tableau, il recueille les réactions des élèves
vis-à-vis de cet appel du général de Gaulle et notamment
vis-à-vis de l'engagement pour les valeurs républicaines et
démocratiques. Parmi ces réactions, il serait probable que
certains ne comprennent pas cet engagement ce qui traduirait ainsi une distance
vis-à-vis des idées républicaines. Aussi, il discute avec
les élèves de la forme de la lutte que peut prendre la
résistance (doit-elle être armée ou non ?). Dans le cadre
du lien établi avec l'enseignement moral et civique (EMC), le professeur
fait une synthèse des idées de ce premier temps collectif et
aborde la notion de l'engagement. D'ailleurs, cette notion est centrale dans
l'enjeu de la classe de 3e qui est de former les
élèves à être des citoyens français
engagés. Le professeur poursuit son propos en concluant que pour
être intégrés dans la société et ainsi agir,
les élèves doivent disposer d'une culture commune qui leur permet
de se
58 Voir Annexe 3.
P a g e 33 | 47
repérer et de comprendre la société
française. De fait, le professeur passe au deuxième temps de
cette séance qui vise justement à travailler la notion de
l'engagement auprès de valeurs républicaines et
démocratiques.
Dans ce deuxième temps qui durera également
trois quarts d'heure, le professeur distribue un corpus documentaire aux
élèves59. Les élèves présentent
les documents et interrogent le professeur sur d'éventuelles
incompréhensions. La présentation et la lecture communes des
documents permet de faire émerger les idées principales de ce
corpus documentaire telles que l'engagement des résistants au nom de
valeurs républicaines, le caractère communautaire des luttes,
mais également les différentes formes que prennent ces luttes.
La consigne adressée aux élèves est la
suivante : à partir de ces documents et de ce qui figure au tableau (les
idées soulevées du premier temps) , construisez un schéma
heuristique avec pour notion centrale « la lutte contre l'occupation
allemande durant la Seconde Guerre mondiale ». Les élèves
s'aideront également des termes écrits au tableau par le
professeur.
Enfin, il reste quinze minutes avant que la séance se
termine durant lesquelles les élèves restituent au professeur
leur schéma heuristique. Ensuite, les élèves
répondent à un deuxième questionnaire
réalisé par le professeur. En effet, celui-ci vise à
confirmer ou infirmer si l'objectif est atteint après la mise en oeuvre
de ce dispositif. Ce questionnaire interroge les élèves quant
à leur potentiel compréhension des valeurs républicaines
et démocratiques. Sur ce questionnaire figurent les questions suivantes
« Pour quels motifs les résistants luttaient ? Pourquoi ? Comment
les résistants luttaient ? », « Trouvez-vous cette lutte
légitime ? » et enfin « est-ce que cette séance a
permis de comprendre l'importance des valeurs républicaines et
démocratiques ? ». En effet, c'est en comparant les réponses
du premier questionnaire avec les réponses du deuxième
questionnaire que l'on vérifiera si l'objectif de cette
expérience est atteint ou non. Cette expérience avait pour but de
montrer que l'étude de la Résistance permet d'apprendre et de
comprendre les valeurs républicaines et démocratiques. On attend
des élèves une réponse plus développée dans
le deuxième questionnaire ce qui traduirait ainsi de la réussite
de cette expérience.
59 Voir Annexe 4.
P a g e 34 | 47
2. Enjeux et critiques de ce dispositif
pédagogique envisagé.
2.1. Enjeux de ces expérimentations.
Les enjeux de ces deux expérimentations sont multiples.
Tout d'abord, il a été fait le choix de réaliser ces
expérimentations avec le chapitre 4 « La France défaite et
occupée. Régime de Vichy. Collaboration. Résistance »
car c'est un chapitre qui présente plusieurs atouts.
Premièrement, c'est un chapitre qui ne traite pas que des militaires au
front, il traite en majorité des civils qui ont choisi de s'engager
auprès des troupes françaises et ce de diverses façons
(clandestinité, sabotage, etc.). Deuxièmement, ce chapitre
s'inscrit à la fin du thème 1 « L'Europe, un
théâtre majeur des guerres totales (1914 - 1945) » ce qui
parait adéquat puisque les élèves ont donc acquis des
notions et des connaissances qui permettent la compréhension de ce
chapitre. Ceci permet d'ailleurs une facilité dans le déploiement
de ces dispositifs. Et enfin, ce chapitre permet de faire le lien entre
plusieurs enjeux soulevés dans l'état de l'art à savoir
l'enjeu politique de l'enseignement de la Résistance ainsi que l'enjeu
social de l'étude des figures des résistants (qui permet à
la fois la formation du citoyen ainsi que la construction d'une culture commune
et nationale).
Néanmoins, la réalisation de ce dispositif
présente quelques difficultés potentielles. En effet, il a
été difficile de trouver des témoignages de collaborateurs
du Régime de Vichy. L'utilisation d'internet permet de trouver un large
choix de documents à propos des résistants mais cela n'est pas le
cas des documents à propos des collaborateurs.
2.2. Réflexion critique sur le dispositif
envisagé.
L'organisation de ce dispositif peut faire l'objet d'une
réflexion critique notamment sur les documents choisis pour construire
les activités. En effet, dans la séance n°1,
l'activité porte sur deux corpus documentaires. Ces deux corpus
comportent des documents textuels, iconographiques, des affiches de
propagandes. Les affiches de propagande sont essentielles dans ce type de
dispositif puisqu'elles traduisent à la fois des informations
véhiculées durant le régime de Vichy ainsi que les moyens
pour les véhiculer (ici, les affiches). L'analyse d'un extrait du
journal d'Agnès Humbert permet l'étude de documents textuels. Cet
extrait de journal d'une résistante française est un
témoignage de l'action résistante. Etudier un témoignage
de résistante permet en outre de travailler la méthodologie de
présentation d'un document (auteur, titre, destinataires, source,
contexte). Les corpus comportent également une photographie (la
rencontre entre le maréchal Pétain et Hitler). Elle permet de
travailler également la
P a g e 35 | 47
méthodologie de présentation d'une photographie,
et permet également de rendre « concret » cette étude,
et rappeler qu'elle renvoie à des faits réels. La séance
n°2 s'appuie sur un ensemble de documents semblables aux corpus
documentaires de la séance n°1 (textes, affiches de propagande).
Toutefois, la critique des supports choisis soulève la
faible variété des documents puisque dans les deux
séances, nous retrouvons les documents textuels et iconographiques. Il
aurait été tout aussi envisageable de construire des
activités à partir de vidéos mettant en scène des
résistants bien que cela soit compliqué à se procurer. Par
ailleurs, le fait que les deux séances portent sur les mêmes types
de documents s'explique par la difficulté de trouver des documents
divers. En effet, l'utilisation d'internet dans la recherche de supports
adéquat se confronte à une grande variété de
propositions pédagogiques qui toutes, portent sur des documents
iconographiques ou textuels.
En outre, les ressources utilisées pour trouver ces
supports sont donc principalement internet grâce au site du réseau
Canopé, ainsi que le livre scolaire, manuel d'histoire-géographie
sur internet. En effet, le réseau Canopé permet de trouver un
ensemble de documents classés par thème ce qui facilite les
recherches. Toutefois, il aurait été préférable de
construire ses propres sources par exemple en se déplaçant dans
les archives départementales ou alors dans les musées tels que le
musée départemental de la Résistance du Vercors.
Enfin, le choix des activités est soumis à une
réflexion critique. En séance n°1, les élèves
travaillent sur un corpus documentaire (individuellement et en groupe) à
partir duquel ils doivent répondre à des questions. Il a
été fait le choix de les mettre en groupe pour travailler la
compétence « Coopérer et mutualiser ». En effet, avant
le début de l'activité, le professeur a rappelé les
consignes à propos du travail de groupe notamment sur la
répartition des tâches. Toutefois, il semble probable que la
majorité des élèves ne prennent pas en compte cette
consigne ce qui pourrait amener les élèves à ne pas
respecter le cadre du travail de groupe. Dans la séance n°2, il a
été fait le choix de travailler en collectif et principalement
à l'oral avec le professeur. L'intérêt de cette mise en
oeuvre permet d'inciter les élèves à prendre la parole
à l'oral. Aussi, puisque la trace écrite portait sur la
construction d'un schéma heuristique, l'analyse des documents à
l'oral n'était pas un obstacle à condition que les idées
soulevées à l'oral soient notées au tableau. Les limites
de ce type d'activité étant que les élèves ne
soient pas « encadrés » si ce n'est par l'intervention du
professeur. En effet, il se pourrait que des élèves, du fait que
ce soit une activité principalement à l'oral, décrochent
et n'investissent plus le cours. Par ailleurs, il a été fait le
choix de réaliser ce dispositif en deux séances de deux
P a g e 36 | 47
heures. Ces deux séances d'expérimentation ne
prévoient pas une dimension chronologique de l'histoire du régime
de Vichy et de la France occupée ce qui est pourtant
préconisé par le programme officiel. Au contraire, ces deux
séances d'expérimentation abordent le régime de Vichy de
manière thématique (résistance, collaboration, occupation
allemande). De ce fait, la mise en oeuvre de ces séances (4 heures)
laisse peu de temps pour cette dimension chronologique du chapitre.
Enfin, d'autres activités auraient pu être
envisagées notamment faire visionner un long extrait de film et
construire une activité sur un tableau à remplir par les
élèves dont les colonnes seraient problématisées du
type « Une résistance violence », « la neutralité
des Français ». Aussi, sur la séance n°1, il aurait
été envisageable par exemple d'effectuer une sortie au
musée mémorial de la résistance et y organiser un
échange entre un historien spécialiste du régime de Vichy
et les élèves sur le thème de la collaboration.
Par conséquent, nous pouvons affirmer que ce dispositif
répond à l'enjeu soulevé par l'état de l'art soit
la question suivante : en quoi l'étude des guerres dans l'enseignement
secondaire reflète-t-elle les choix politiques effectués dans les
programmes scolaires ainsi que les enjeux sociétaux et civiques ?
Ici, l'étude des guerres dans l'enseignement secondaire
concerne l'étude de la Seconde Guerre mondiale et
précisément de la Résistance durant le régime de
Vichy. La Résistance est en effet une composante de la Seconde Guerre
mondiale puisqu'elle illustre un des conflits armés dans le contexte du
conflit mondial opposant la France à l'Allemagne.
Les choix politiques effectués dans les programmes se
traduisent dans ce dispositif par la prise en compte des évolutions
historiographiques et politiques dans le traitement de l'histoire de la Seconde
Guerre mondiale soit la prise en compte de la diversité des postures
durant le conflit mondial et donc de l'étude de la collaboration. Cela
n'est pas nouveau puisque, comme nous l'avons évoqué
précédemment, cette réalité est
avérée dès les années 1970. Pour autant, il
persiste aujourd'hui une certaine représentation de la Résistance
en France comme cela est démontré par le sondage effectué
en séance n°1. Aussi, les choix politiques se reflètent
à travers la dimension républicaine qui est mise en avant dans ce
chapitre (avec l'étude de la lutte des résistants au nom des
valeurs républicaines). Ceci est étudié avec le corpus de
documents de la séance n°2. Ce dispositif témoigne
également des enjeux sociétaux et civiques de l'enseignement de
la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'enjeu sociétal de l'enseignement
des guerres est l'intégration dans la société
française et la communauté de citoyens français qui se
P a g e 37 | 47
caractérisent par une culture commune. L'analyse et la
compréhension du fait résistant en France dans le régime
de Vichy et la France occupée est une composante fondamentale de cette
culture commune puisque marquante dans l'histoire de France. Enfin, l'enjeu
civique de l'enseignement des guerres est la formation du citoyen et celle-ci
se fait par l'appropriation aux valeurs républicaines grâce
à l'activité de la séance n°2. Ceci se traduit dans
ce dispositif par l'étude de l'engagement (notion fondamentale en EMC)
auprès des valeurs républicaines.
Réflexion conclusive
En conclusion, la synthèse des lectures scientifiques a
permis d'étayer la théorisation du concept de la guerre avant
d'analyser la place de ce sujet dans les programmes de l'enseignement
secondaire. Il ressort une forte empreinte politique au vue de la portée
sociétale de cet enseignement. En effet, le sujet de la guerre dans
l'enseignement secondaire préoccupe et est investi par le pouvoir
politique. De par l'intérêt que le pouvoir politique lui porte,
cet enseignement est réaffirmé dans tous les niveaux de
l'enseignement secondaire, en témoigne sa présence quasi
systématique entre la 6e et la Terminale. Sa portée
sociétale, précisément civique et morale, le place souvent
au centre de débats voire de contestations dans la société
comme l'exemple de la prise en compte des devoirs de mémoire. Cela
participe en outre à l'évolution de l'approche de la guerre. En
effet, bien que notre société ne soit pas directement
touchée par la guerre actuellement, elle reste un sujet de
société car elle a joué un rôle dans la construction
de l'identité française.
Tout cela s'illustre concrètement dans l'enseignement
secondaire avec les élèves. Cette problématique est
illustrée dans un deuxième temps en classe de
3ème mais elle peut également être
soulevée en classe de Terminale. Le développement d'une
potentielle mise en oeuvre pédagogique en classe de
3ème basée sur l'étude de la Résistance
et de la figure du résistant a permis d'illustrer l'influence politique
et la portée sociétale de l'enseignement de la guerre. En effet,
cela s'effectue par exemple par l'étude et l'analyse de l'engagement et
l'action politique. L'étude de la Résistance dans le cadre de ce
dispositif expérimental est une exemple de l'enseignement de la guerre
puisque la Résistance est une réalité de la Seconde Guerre
mondiale, une lutte principalement armée pour contrer l'occupation
allemande. Par ailleurs, l'étude de l'engagement politique est en lien
avec l'enseignement moral et civique (EMC). En outre, ce lien avec l'EMC permet
donc la construction d'une identité française par la
compréhension des idées républicaines mais
également la formation du futur citoyen dont
P a g e 38 | 47
l'intégration dans la société
française nécessite l'acquisition d'une culture historique pour
se repérer dans le temps et dans la société actuelle.
P a g e 39 | 47
BIBLIOGRAPHIE
BIZIER Joël, Le Clausewitz de Raymond Aron :
interprétation et analyse aronienne portant sur l'oeuvre de Carl von
Clausewitz, Université de Montréal, Thèses et
mémoires électroniques de l'Université de Montréal,
2007, 113 pages.
DOSSE François, DELACROIX Christian (dir.),
Historiographies : concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010,
645 pages.
GARCIA Patrick, LEDUC Jean, L'enseignement de l'Histoire
en France. De l'Ancien Régime à nos jours, Paris, Armand
Colin, 2003, 320 pages.
HERY Evelyne, Un siècle de leçons
d'histoire. L'histoire enseignée au lycée 1870-1970, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 1999, 444 pages.
LEGRIS Patricia, L'écriture des programmes
d'histoire en France (1944-2010). Sociologie historique de la production d'un
instrument d'une politique éducative, Paris, Université
Panthéon-Sorbonne, 2010, 635 pages.
OFFENSTADT Nicolas, L'historiographie, Paris, Presses
universitaires de France, 2017, 127
pages.
PROST Antoine, WINTER Jay, Penser la Grande Guerre. Un essai
d'historiographies, Paris, Editions du Seuil, 2004, 344 pages.
SCHU Adrien, « Qu'est-ce que la guerre. Une
réinterprétation de la « Formule » de Carl von
Clausewitz », Revue française de science politique,
2017.
TERTRAIS Bruno, La guerre, Paris, Presses universitaires
de France, 2014, 128 pages.
P a g e 40 | 47
Articles publiés sur internet
HENNINGER Laurent, « La nouvelle histoire-bataille
», EspaceTemps, 1999.
LEGRIS Patricia, « L'élaboration des programmes
d'histoire depuis la Libération. Contribution à une sociologie
historique du curriculum », Histoire@politique, 2013.
LEGRIS Patricia, « L'histoire scolaire en France »,
Revue internationale d'éducation de Sèvres, 2015.
PELPRAS Samuel, « Penser la guerre avec Clausewitz »,
GéopoWeb, 2017.
TUTIAUX-GUILLON Nicole, « Mémoires et histoire
scolaire en France : quelques interrogations didactiques », Revue
française de pédagogie, 2012.
Sitographie
HEconomist, « Le devoir de mémoire : l'importance du
souvenir », 2020.
Association des professeurs d'histoire et géographie,
« Enseigner et commémorer la Grande Guerre : pourquoi ? Comment ?
», 2014.
Eduscol.education.fr.
Toutatrice.fr, espace
numérique de l'éducation en Bretagne, « Enseignement moral
et civique », 2015.
éditions-ellipses.fr,
« Fiche Chapitre 1 La Première Guerre mondiale :
l'expérience combattante dans une guerre totale ».
P a g e 41 | 47
ANNEXES
P a g e 42 | 47
1. Corpus de documents n°1 de la séance n°1.
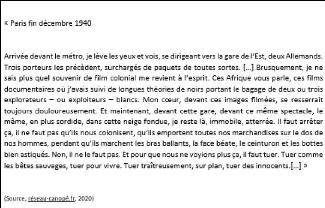
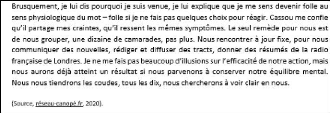
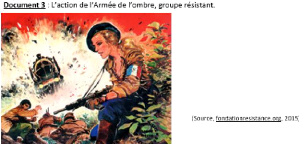
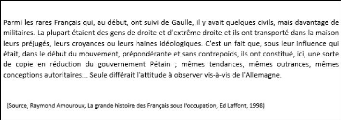
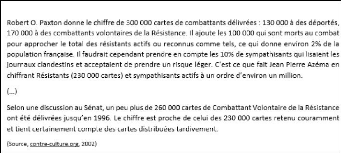

P a g e 44 | 47
2. Corpus de documents n°2 de la séance n°1.
P a g e 45 | 47
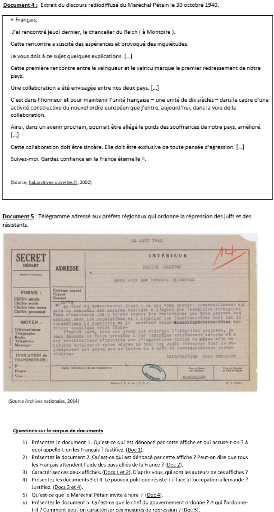
3. P a g e 46 | 47
Documents projetés au tableau en séance
n°2.
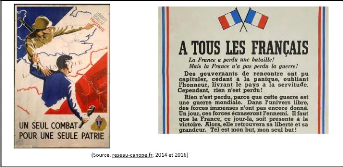
4. Corpus de documents travaillé à l'oral avec les
élèves en séance n°2.
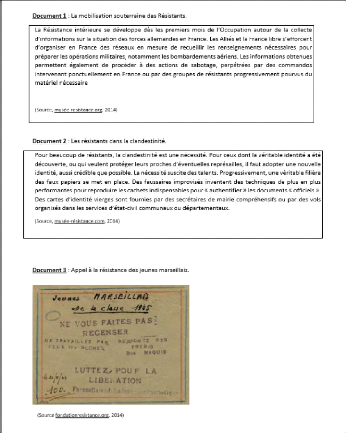
Résumé :
Ce mémoire vise à interroger les enjeux
politiques et sociétaux de l'enseignement de la guerre dans les
programmes de l'enseignement secondaire. Ces enjeux s'illustrent par le
rôle et l'influence politique dans l'écriture des programmes ainsi
que la portée sociétale et notamment civique que cet enseignement
permet. Ainsi, cet écrit se base sur une expérience qui porte sur
l'étude de la Résistance et de la figure du résistant en
classe de 3ème (cycle 4). Un dispositif expérimental
est présenté et vise à soulever les enjeux politiques et
sociétaux de l'enseignement de la guerre en situation réelle
d'enseignement.
Abstract:
This dissertation aims to question the political and societal
challenges of teaching warfare in secondary education programs. These issues
are illustrated by the role and political influence in the writing of the
programs as well as the societal and in particular civic impact that this
teaching allows. Thus, this writing is based on an experiment which focuses on
the study of the Resistance and the figure of the resistance in 3rd grade
(cycle 4). An experimental device is presented and aims to raise the political
and societal issues of teaching warfare in a real teaching situation.
Mots-clefs : Histoire - guerre - cycle 4 - 3ème
- EMC - politique - résistance - société.
Keywords: History - war - cycle 4 - 3rd - politics - resistance -
society - EMC.
P a g e 47 | 47
| 


