86
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Au cours de cette deuxième partie de notre recherche,
nous nous sommes intéressés à l'étude pratique du
comportement des habitants de Douala face aux effets induits par la
distribution informelle des médicaments. Ce travail a été
fait à travers l'étude de la spécificité du
marché informel de médicaments et une présentation de la
méthodologie qualitative mobilisée pour la recherche. Cela nous a
permis de présenter l'exploration faite sur les particularités du
marché informel des médicaments et la démarche
méthodologique.
L'étude de l'incidence du réseau de
distribution informel des médicaments sur le comportement des
consommateurs a bénéficié également d'une
curiosité profonde. Ceci à travers l'étude de l'analyse
thématique proprement dite des données recueillies aux
près des consommateurs de Douala suivi de l'analyse de l'adoption ou du
rejet de la distribution informelle des médicaments à Douala.
Selon les résultats de l'étude de terrain
l'adoption de la distribution informelle des médicaments résulte
des effets à la fois induit par le circuit de distribution informel,
propres aux consommateurs et également des facteurs appartenant à
l'environnement social, politique et économique.
Certains consommateurs pensent que les médicaments
issus du circuit informel sont identiques à ceux vendus sur le circuit
formel. Nous pouvons dire que les prix appliqués par le circuit informel
sont concurrentiels. En effet le circuit de distribution informelle semble
avoir trouvé une solution aux difficultés rencontrées par
la distribution formelle.

CONCLUSION GENERALE
87
Notre travail de recherche avait pour objectif de
vérifier si seule « Les effets induits par le mode de distribution
informelle des médicaments expliquent son adoption par les consommateurs
de la ville de Douala ? ». Ainsi durant nos investigations, l'objectif
était de répondre à cette question centrale. Pour le
faire, cette question centrale a été décomposée en
trois questions secondaires. Ces questions nous ont permis de poursuivre notre
quête. Notons que chacune de ces questions a eu des
éléments de réponse.
La première question subsidiaire porte sur « les
types d'avantages et de satisfaction offert par le circuit de distribution
informel des médicaments qui expliquent l'adhésion des
consommateurs ». Pour répondre à cette préoccupation,
une étude de la distribution informelle à travers plusieurs
angles d'analyses a été faite (Economie, Sociologie, BIT,
AFRISTAT, INS, ...). Ce secteur regroupe un certain nombre d'opérateurs
qui évoluent en marge de la règlementation mais donc leurs
actions au sein de la société est d'une importance non
négligeable. Les études menées à la fois sur le
plan théorique et pratiques ont révélées plusieurs
avantages liés au secteur informel pouvant séduire les
consommateurs. Il s'agit en premier lieu de l'organisation de la «
profession ». Le secteur informel connait une structuration qui lui permet
d'être proche physiquement et socialement des consommateurs. Les vendeurs
parlent la même langue avec les consommateurs, ont les mêmes
appréhensions des réalités locales. Les points de ventes
sont présents dans la quasi-totalité des rues. La seconde est
l'intégration du réseau de distribution informel au
système sociale. En effet le circuit informel de distribution des
médicaments a sus s'adapter aux réalités locales ;
d'où une parfaite adéquation du système aux besoins des
consommateurs. La disponibilité des médicaments recherchés
et les prix compétitifs sont aussi à mettre à l'actif du
circuit informel. Tel sont l'ensemble d'avantages offert par la distribution
informelle des médicaments qui ont facilité l'adoption de ce
circuit par le consommateur.
La seconde question subsidiaire : « les croyances des
consommateurs et comportement de consommation irresponsable expliquent-ils
l'adoption du circuit de distribution informel ? ». Comme
éléments de réponse à cette question, notre travail
de recherche a trouvé que le facteur culturel avait une grande part de
responsabilité dans l'adoption de la distribution informelle des
médicaments. Les moeurs, les coutumes des vendeurs du secteur informel
sont largement acceptées et partagé par les clients
consommateurs. En effet les
88
croyances des consommateurs, les pratiques, les habitudes de
consommations expliquent et contribues à l'adoption de la distribution
informelle des médicaments. L'étude a également
montrée que l'irresponsabilité des consommateurs était
à l'origine de l'adoption de la distribution informelle des
médicaments. Certains consommateurs n'évaluent pas le risque
lié à la consommation des médicaments issus du circuit
informel. De ce fait cette négligence de la part du consommateur le rend
irresponsable dans le processus de consommation des médicaments. On note
ainsi une parfaite adéquation entre croyance des distributeurs informel
et celles des consommateurs.
« Le contexte socioéconomique et politique
expliquent l'adoption des médicaments issus du circuit informel ?
». Telle est la troisième question subsidiaire de notre travail de
recherche. Il s'agit ici de vérifier s'il existe des effets propres
à l'environnement de la ville de Douala pouvant favorisés
l'adoption de la distribution informelle des médicaments. Face à
cette ouverture la prospection documentaire et du terrain nous ont permis de
mettre en exergue quelques facteurs propres à l'environnement capable de
faciliter l'adoption de la distribution informelle des médicaments. Il
s'agit de la fragilité du tissu économique et social. En effet
les maux tel que le chômage, l'absence d'un bon système
d'assurance santé, le faible pouvoir d'achat des habitants de Douala
sont des éléments qui ont catalysé le processus d'adoption
de la distribution informelle des médicaments. Une population soumise
à ce genre de conditions a pour seule source d'approvisionnement en
médicament le circuit informel. Car seul ce moyen leur permet d'y avoir
accès.
Il faut noter également qu'une préoccupation a
existée au début de notre recherche sur la méthodologie a
adoptée afin de fournir des éléments de réponses
à notre question centrale. Le choix des distributeurs informels des
médicaments est justifié par l'importance numérique des
intervenants (vendeurs et consommateurs), la délicatesse de cette
activité et le fort développement qu'elle connait. Pour
étudier le comportement du consommateur face à la distribution
informelle des médicaments, l'approche qualitative de recherche a
été retenue. Car cette méthode en science de gestion
permet de comprendre des phénomènes ou des comportements. La
distribution informelle est bien sûr un phénomène ayant des
emprunts socio-politico-économique et psychologique. L'analyse
qualitative peut être définie comme une démarche discursive
de reformulation, d'explication ou de théorisation d'un
témoignage, d'une expérience ou d'un phénomène.
C'est un travail complexe qui consiste à l'aide des seules ressources de
la langue, à apporter un matériau qualitatif dense et plus ou
moins
89
explicite à un niveau de compréhension ou de
théorisation satisfaisant (Paillan, cité par Bilguissou,
2014).
Les données ont été recueillies à
travers l'étude documentaire, les observations flottantes et les
entretiens semi-directifs. Les entretiens ont été faites sur fond
d'un guide préalablement conçut pour cela. Cette triangulation
était nécessaire vu la complexité du
phénomène de distribution informelle des médicaments.
Une analyse de contenu, des données brutes (discours)
a été réalisée dans le but de faire ressortir les
différents thèmes qui émergent du terrain. Cette analyse a
été faite suivant les différentes étapes tel que
prescrit par Aktouf (1987). Il préconise 7 phases importantes et
nécessaires pour la réalisation de l'analyse thématique de
contenu. Il s'agit de : « la lecture des documents », « la
définition de catégories », « la détermination
de l'unité d'information », « la détermination de
l'unité d'enregistrement », « la détermination de
l'unité de numérisation » et la « quantification
». Ce travail a mis en évidence 4 aspects majeurs qui favorisent
l'adoption de la distribution informelle des médicaments :
une réelle proximité des vendeurs et leur
efficacité, une proximité des points de ventes, les croyances de
consommateurs, le contexte socio-politico-économique.
Apres avoir réalisé l'analyse de contenue, nous
sommes passé à l'analyse proprement dite des thèmes issus
de l'analyse de contenu. Ce qui nous a permis de produire des résultats
de recherche.
Dans le même ordre d'idées, nous allons proposer
des perspectives de recherches futures. Il est naturel de dire que les limites
citées ci-dessus peuvent servir de nouvelles pistes de recherche :
ainsi, il serait intéressant de :
Ø D'adopter une approche quantitative qui permettra de
rentre plus fiable les résultats trouvés car le modèle de
recherche est généré suite à un travail qualitatif
et une revue de la littérature, de ce fait il est important de
l'améliorer ou de le renforcer par une étude de confirmation et
un test statistique approprié (test de corrélation).
Ø Détecter d'autres facteurs susceptibles de
contribuer à l'adoption de la distribution informelle des
médicaments. Le revenu du répondant, par exemple, pourrait
être une variable importante qui expliquerait l'adoption ou non de la
distribution informelle des médicaments.
Ø Il serait aussi judicieux de mener des études
analogues en prenant en considération le processus de socialisation de
la consommation des médicaments comme facteurs pouvant favoriser
l'adoption de la distribution informelle des médicaments.
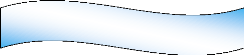
BIBLIOGRAPHIE
90
+ AFRISTAT (1999), «
Concepts et indicateurs du marché du travail et du
secteur informel », série Méthodes N02
Décembre, Bamako.
+ Aktouf O. (1987), «
Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative
des organisations, une introduction à la démarche classique et
une critique ». Montréal : les Presses de l'Université
du Québec.
+ Angbo-Effi K. O., Kouassi P. D., Yao GH. A., Douba
A. Secki R. & Kadjo A. (2011), « Facteurs
déterminant la consommation des médicaments de la rue en milieu
urbain », Santé publique 2011, volume 23, N06, p
455-464.
+ Assoumou M. O. (1999), «
Optimisation des approches qualitatives de recherche en sciences de gestion,
une approche de la régie française des eaux », in
cahier de la faculté des sciences économiques et de gestion
appliquée, Université de Douala. Tome 1 N01.
+ Astous A. (2005), « Introduction
à la recherche en marketing », In Le projet de recherche en
marketing, p 1-27. Montréal : Chenelière Education.
+ Avenier M. J. & Perret G. (2012), «
Méthodologie de la recherche en sciences de gestion
», Pearson France.
+ Badiang M. A., Lewis M. P., Nkakleu R., Biboum A. D.
(2013), « Les pratiques marketings des très
petites entreprises informelles : cas des commerçants de rue au Cameroun
», AMS African Management Studies, N 01(1), P 123-143.
+ Barbereau S. (2006), « La
contrefaçon des médicaments : un phénomène en
pleine expansion », Med Trop, N 066 : P 529-532.
+ Barthelemy P. (1998), « Le secteur
urbain informel dans les pays en développement : une revue de
littérature », Revue région et développement
N0 7.
+ Basti K. M. (2010), « Le
comportement des consommateurs dans les marchés informels: une
étude multiethnique ». Mémoire master.
+ Baxerres C. (2012), « Les usages
du médicament au Bénin : une consommation pharmaceutique sous
influences locales et globales », Revue Internationale Sur Le
Médicament. N 04(1), p14-38.
91
+ Baxerres C., Bochaton A., Brutus L., Colin J.,
Desclaux a., & D'halluin E. (2016), «
L'automédication en question: un bricolage socialement et
territorialement situé », Colloque internationale et
multidisciplinaire de Nantes.
+ Bénas J.(2010), « Les
stratégies des entreprises formelles dans le contexte d'une
économie informelle. Tentative d'évaluation de ces
stratégies et recommandations». Mémoire master 2
université du Québec à Montréal.
+ Benoist J. (2002), Petite
bibliothèque d'anthropologie médicale. Une anthologie TOME
I.
+ Bensédrine J. D. (1998),
L'approche néo-institutionnelle des organisations.
Paris: Vuibert.
+ Bernhard A. (2005),
Abécédaire du marketing. Solvay Business School.
+ Bilguissou A. (2014), « Les
pratiques marketings dans le secteur informel : une appréhension par les
détaillantes du secteur informel camerounais ». Thèse
de doctorat en sciences de gestion, université Cheikh Anta Diop de
Dakar, Sénégal.
+ BIT (1993), « Rapport de la
XVème conférence internationale des statistiques du
travail », Génève.
+ BIT (2010), « Rapport de la
conférence internationale des statistiques du travail »,
Génève.
+ Bonoma T .V (1985), « case
research in marketing opportunities, problems and a process »,
Journal of Marketing Research.
+ Borda H. (1985), « Le concept de
médicaments essentiel et sa mise en oeuvre ; Programme d'action pour les
médicaments essentiels ». World Health Organisation.
DAP/85.1.
+ Camelis C., Dano F., Goudarzi K., Hamon V. &
Llosa S. (2013), « Les rôles des `'co-clients» et
leurs mécanismes d'influence sur la satisfaction globale durant une
expérience de service », Recherche et application en
marketing. N 028(1) P 46-69.
+ Charmes J. (1989). « Quelles
politiques publiques face au secteur- informel? », ORSTOM Service de
Coopération de l'INSEE-PARIS.N°23.
+ Charreaux G. (1990),« La
théorie des transactions informelles », Économie et
sociétés, sér. sciences de gestion, N° 15 , P
137-161.
+ Commeyras C., Ndo J. R., Omar M., Hamidou K. &
Rakotondrabe F. P. (2006), « Comportement de recours aux
soins et aux médicaments au Cameroun », Cahier Santé ;
N 015, P 161-6.
92
+ Darmon L. (2006), «
Médicaments hors contrôle, un marché aux contours flous
», le journal du sida, N °191.
+ De Miras (1990), «
État de l'informel, informel et État »,
Tiers Monde, 122 : 377391. + De Soto H.(1989), «
The other parth. The invisible revolution in the third word.
» New York, Harper and Row.
+ Desjeux D. (2006), « La
consommation, Que Sais-Je ? », Presses Universitaires de France.
+ Deslauriers J.-P. (1991), «
Recherche qualitative: guide pratique », McGraw-Hill,
Montréal.
+ Djralah M., Agossou A. K., Patinovh A. &
Baxerres C. (2015), « Automédication et recours aux
acteurs privés et informels de la distribution détaillante au
Bénin », Actes des Rencontres Nord/Sud de
l'automédication et de ses déterminants.
+ Drescher M. (2014), « La dimension
pragmatico-discursive du français en contact. L'exemple des
consultations à la radio camerounaise », in Journal of
language contact, N07, P 62- 92.
+ Etoudi G. (2004), « Contribution
à la connaissance de la formulation d'un mode de positionnement
stratégique en PME: une étude de cas sur 08 PME camerounaises et
françaises ». Thèse de doctorat en sciences de gestion,
université Yaoundé II Cameroun.
+ Fassin D. (1986), « La vente
illicite des médicaments au Sénégal ». Politique
africaine ; N0 23, P 123-130.
+ Fassin D. (1992), « Pouvoir et
maladies en Afrique ». Paris: PUF.
+ Fleurbaey M. (1996), «
Théories économiques de la justice », Paris : Economica
Presses de l'Université du Québec, 4ième édition, P
619.
+ Gonzalez C., Menuet L. & Urbain C. (2011),
« Consommation socialement responsable et
représentations sociales de la consommation : Une recherche sur les
représentations et les pratiques des étudiants ».
Université de Nantes : PUF.
+ Guarnelli J., Lebraty J. F. & Pastorelli
(2016), « Prise de décision en contexte extrême
: cas des acteurs d'une chaîne des secours d'urgence », Revue
française de gestion N°257.
+ Hamel V. (2006), « Le vente
illicite des médicaments dans les pays en voie de développement:
analyse de l'émergence d'un itinéraire thérapeutique
à part entière,
93
situé en parallèle du recours classique aux
structures officielle de sante», Thèse de doctorat en
pharmacie, Université Claude Bernard - Lyon.
+ Harribey J. M. (1996), «
Théorie de la justice, revenu et citoyenneté », La
Revue du M.A.U.S.S. semestrielle, « Vers un revenu minimum inconditionnel
? », N° 7; P 188198, extrait reproduit dans Problèmes
économiques, N° 2489.
+ Hernandez E. M. (1995), «
L'entrepreneur informel africain et la démarche marketing »,
Recherche et Applications en Marketing, vol. 10, N°3, P 47-61.
+ Homans G. C. (1961), «Social
Behavior, Its Elementary Forms, » London: Routledge & Kegan.
+ Hours B. (1986), L'État
sorcier. Santé publique et Société au Cameroun,
Paris, L'harmattan.
+ Hugon P. (1996), «
Incertitude, précarité et financement local :
cas des économies africaines ». Tiers-monde N
037(145), P 13-40).
+ INS (2006a), « Rapport principal
de l'enquête sur l'emploi et le secteur informel, phase 1 : enquête
sur le secteur informel », février 2006, Yaoundé,
Cameroun.
+ INS (2006b), « Rapport principal
de l'enquête sur l'emploi et le secteur informel .phase 2 : enquête
sur le secteur informel », février 2006, Yaoundé,
Cameroun.
+ Jae H. & Gassenheimer. (2002), «
Underground Economy and Exchange, » American Marketing
Association Summer Educators' Conference Proceedings.
+ Jaffre Y. (1999), « Pharmacie des
villes, pharmacie par terre ». Bull APAD; N 0 17, P
63-70.
+ Jenner M. (2011), «International
Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution», Indiana
University Maurer School of Law. Article 10. Volume 18 Issue 2.
+ Kalika M. (1982), « Perception et
mémorisation des campagnes promotionnelles dans la distribution
», Revue Française de Marketing, N0 90, P 67-87.
+ Katz D. (1960), « The functional
approach to the study of attitudes ». The public Opinion Quarterly,
vol. 24, N0 2, P 63-204.
+ Kruglanski, A. W. (1975), « The
endogenous-exogenous partition in attribution theory », Psychological
Review, N0 82, P 387-406.
+ Latrémouille-Viau D. (2007), «
Les déterminants de la consommation de médicaments
au canada ». Mémoire master.
94
+ Lautier B. (2003), « Les limites
de l'économie informelle comme alternative à la mondialisation
libérale », La découverte 2003/1, N°21, P
198-2014.
+ Leventhal G. S. (1980), «What
should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in
social relationships», In K. Gergen, M. Greenberg, & R. Willis
(Eds.), Social exchanges: Advances in theory and research, P 27-55, New York:
Plenum.
+ Mahamé S. & Baxerres C. (2015),
« Distribution grossiste du médicament en Afrique :
fonctionnement, commerce et automédication. Regards croisés
Bénin-Ghana », Actes des Rencontres Nord/Sud de
l'automédication et de ses déterminants.
+ Maldonado C., Badiane C. & Mielot A. (2004),
« Méthodes et Instruments d'Appui au Secteur Informel
en Afrique Francophone », Genève, Bureau international du
Travail.
+ Mattern C. (2015), « Les circuits
de distribution des médicaments pharmaceutiques industriels à
Madagascar. Le cas du marché informel d'Ambohipo », Actes des
Rencontres Nord/Sud de l'automédication et de ses déterminants. P
135-145.
+ Mba F. A., Kayou T. C. & Ndeumen A. C.
(2014), « Appréhension Du Risque Et Perception Par Les
Consommateurs: Cas Des Médicaments Dans La Ville De Dschang-Cameroun
», Global Journals Inc. (USA), Volume 14, Issue 7, Version 1.
+ Mbaho N. (2015), « Pratiques
plurilingues dans le secteur informel de la santé. le cas de la vente
des médicaments dans les bus reliant douala et son arrière-pays
», Bayreuth International Graduate School of African Studies
Université de Bayreuth, Allemagne.
+ Meier O. (2009), le DICO du manager Dunod,
Paris.
+ Menard C. (1989), « Les
organisations en économie de marché », Revue
d'économie politique, N 099 (6), P 771-796.
+ Merunka & Le Roy (1991),
« Competitor : un modèle de positionnement
concurrentiel des marques appliqué à des données de panel
consommateur ». Recherche et Applications en Marketing, vol. 6,
N°2/91.
+ Miles, M. B. & Huberman (2003), «
Analyse des données qualitatives », Traduction de la
deuxième édition américaine par M. Hlady Rispal,
Burxelles, De Boeck Université.
+ Ouattara A. (2009),
«Achat de médicaments de la rue en Afrique :
essai de compréhension d'un comportement irrationnel », Market
management; N° 1.
95
+ Rawls J. (1971), « A
Theory of Justice», trad. C. Audard, Paris, Seuil,
réédition, 1987. + Rey H. (1994), «
Secteur informel et marché : Le cas de la
filière halieutique dans le Delta central du Niger », Cah.
Sei. Hum. N030 (1-2), P 289-301.
+ Rojot J. (2004),
Théorie des organisations. Documentation
française ; Cahier français paris.
+ Socpa A. (1995), « Les
Pharmacie de rue dans l'espace médical urbain. Emergence et
déterminants des stratégies informelles d'accès aux
médicaments à Douala », Thèse d'Anthropologie,
Université de Yaoundé I.
+ Socpa A. (2011), « La
« friperie » des médicaments au Cameroun : une panacée
dangereuse ? », in Koum Benjamin Alexandre (éd.), Santé
plurielle en Afrique : perspective pluridisciplinaire. Paris, L'Harmattan, P
285-300.
+ Sogbossi B. B. (2016), «
la contrefaçon et le comportement d'achat du consommateur : cas des
médicaments de la rue », Market Management, Vol. 9, P 93114.
.
+ Sossou G. (2012), «
Une approche hédonique des dépenses de
médicaments des ménages au Bénin », Revue
d'Economie Théorique et Appliquée N 0 2,2 Déc ;
P 133154.
+ Thibaut J., & Walker L. (1975),
« Procedural justice: A psychological analysis»,
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
+ Van Der Geest S. & Whyte R. (2003),
« popularité et scepticisme : opinions et contrastes
sur les médicaments », Anthropologie et
Sociétés, vol. 27, N 0 ll0 2, 2003, P 97-117.
+ Van Der Geest S. (1983),
«The Intertwining of Formal and Informal Medicine
distribution in South Cameroon, » Gezondheid en Samenlnving, N°
288.
+ Van Der Geest S. (1987b),
«Self-care and the informal sale of drugs in South
Cameroon», Social Science and Medicine N 0 25, 3, P
293-301.
+ Van Der Geest S. (1987b),
«Self-care and the informal sale of drugs in South Cameroon»,
Social Science and Medicine N 025, 3, P 293-301.
+ Wanlin P. (2017), «
L'analyse de contenu comme méthode d'analyse qualitative d'entretiens :
une comparaison entre les traitements manuels et l'utilisation de logiciels
», recherches qualitatives Hors-Série - N 0 3.
v
96
Weiner, B., Russel, D., & Lerman, D. (1979),
«The cognition-emotion process in achievement-related contexts»,
Journal Personality and Social Psychology, N037, P
1211-1220.
v Wogaing J. (2010), « De la
quête à la consommation du médicament au Cameroun
», Revue Internationale sur le Médicament, vol.3, ISSN P
1718-1534.
v Yin R. K. (1994), «Case study
research: desing and method » (applied social research), (second
edition) Newbury park, CA: sage publication.

LISTE DES ANNEXES
97
| 


