|
EPIGRAPHE
La vie, c'est comme une
bicyclette,
Il faut avancer pour ne pas perdre
l'équilibre.
-Albert Einstein-
DEDICACE
A vous mes chers parents Joseph MUHEMEDI et Clémentine
MOTINGEYA,
A vous mes frères et soeurs ; Junior MUHEMEDI,
Trésor MUNGANGA, Marc KASONGO, Cedric kASONGO, Olivier BOMEKI, Patrick
BOMEKI, Josh BOMEKI, Ally KASONGO, Jonathan FRIEDRICH, Jeff kASONGO, Jordan
HOPDIP, Mariam BINTI, Sandra FRIEDRICH, Fallonne LOMAMA, Ruth ASINA, Tina
MOTINGEYA, Mathilde BOMEKI, Jessica BOMEKI, Jenny MUNGANGA, Aurélie
MUTELA et Esther IDALI,
A vous mes neveux et nièces : Harley David
MISSAKILA, Nolan KASONGO, Marie-Andréa MASUKA, Talitha BINTI, Eyal
KASONGO, Isaiah MASUKA, Inaya MASUKA, Guillain BRAMS, Ethan IDALI,
A l'âme de mon grand père Joseph BOMEKI, mon
cousin Prospère BOMEKI et à ma tante Elysée NEGALA que
Dieu les accueille dans sa vaste demeure.
A ma meilleure amie Mel, qui depuis des années
m'encourage, me comprend et a toujours été à mes
côtés, que Dieu lui donne bonheur, santé et
réussite.
Vous ne saurez pas mesurer l'importance de vos conseils et de
votre appui tout au long de mon cursus. Je vous suis reconnaissante.
REMERCIEMENTS
Notre engagement individuel dans la réalisation de ce
travail, il nous sera difficile de mentionner les noms de toutes ces personnes
qui n'ont pas cessé de nous donner de leurs pour parler de ce travail,
entre ces lignes, veillez trouver toute notre gratitude.
Mes remerciements s'adressent particulièrement au
Professeur KALUMBA NGOY Jacques, pour son encadrement de qualité, sa
motivation, ses conseils et critiques constructives, ses corrections, sa
gentillesse et sa patience ainsi pour le temps qu'il a consacré pour la
réalisation de ce travail.
Aux autorités académiques et aux personnels de
EcoPo. Au Directeur Général, Professeur Emmanuel BANYEWESIZE, au
Secrétaire Général Académique, Mr Auguet KABWIT,
à l'appariteur Central, Mr Kahlilou DIAKO, Fréderic AMANI et
à Madame Bénédicte Tanga s'adressent nos remerciements
pour l'accompagnement et l'encouragement manifesté tout au long de notre
cursus.
Aux professeurs pour la qualité de l'enseignement
qu'ils m'ont prodigué au cours de ces trois années passées
à l'Ecole Supérieur de la gouvernance Economique et Politique
(EcoPo-Lubumbashi).
A vous, Tegra BUKASA, Kelvin MUKOMBO, Landry SAILE, Tencia
MUGANGA,Lisa MWANDI, Eurydice TSHALA, Patricia KASONGO et Modeste LULINGOMA
merci pour vos conseils, vos remarques et votre soutient nous ont
été bénéfiques.
A vous cher(e)s ami(e)s, Melissa MWENDA, Danny MBUYAMBA,
Julien NGABU, Elielle KALOMBO, Jacob SINSA, Ben NGITA, Abigaël CANON,
Sarah MWABI, David NAWEJ, Magloire KITENGE, Jonathan LUKALI, Chancel Bonheur
M'VOUTOU, Bonheur KYUNGU,Pidins KABAMBI, Mathilde CHABALA, Myriam SABINE,
Emmanuella BUKASA, Éric Marcelin KALONJI, Joseph KALASSA. S'adressent
nos remerciements pour votre soutien et encouragement durant
l'élaboration de ce mémoire.
A lui tout honneur et toute Grâce.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
LISTE DES FIGURES
VI
LISTE DES TABLEAUX
VII
NOTE DE SYNTHESE
VIII
INTRODUCTION
1
1. PHENOMENE OBSERVE
1
2. REVUE DE LITTERATURE
2
2.1 ETUDES EMPIRIQUES
2
2.2 ETUDES THEORIQUES
4
3. PROBLEMATIQUE
5
4. HYPOTHESE
5
4. OBJECTIF POURSUIVI PAR LA RECHERCHE
6
5. JUSTIFICATION ET CHOIX DU SUJET
6
5.1. Sur le plan personnel :
6
5.2 Sur le plan scientifique :
6
5.3 Sur le plan managérial
6
6. DELIMITATION DU SUJET
6
6.1 DELIMITATION TEMPORELLE
7
6.2 DELIMITATION SPATIALE
7
7. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
7
7.1 METHODES DE PRODUCTION DES DONNEES
7
7.1.1. METHODE DOCUMENTAIRE
7
7.2. TECHNIQUES DE COLLECTE DES DONNEES
7
7.3. TECHNIQUE D'INTERVIEW
7
7.3.1. Observation directe
8
7.4. METHODE ET TECHNIQUE D'ANALYSE DES DONNEES
8
7.4.1 Dépouillement du questionnaire
8
7.5. Approche qualitative
8
8. STRUCTURE DU MEMOIRE
9
CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
10
1.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS
10
1.1.1 COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
10
1.1.2. LE MARCHE ET SES ACTEURS
17
1.1.3. LE PRODUIT
19
1.1.4. INTERNET
21
1.1.5. COMMERCE ELECTRONIQUE
21
1.2. CADRE THEORIQUE
28
1.2.1. THEORIE SUR L'ASYMETRIE D'INFORMATION
28
1.2.2. THEORIE DE LA RATIONNALITE LIMITEE (Herbert
Simon 1983)
29
1.2.3. THEORIE DE MASLOW (Abraham Maslow, 1943)
30
1.2.4. THEORIE DE L'APPRENTISSAGE SOCIAL (Bandura,
1969-1977)
32
CHAPITRE 2 : CADRE EMPIRIQUE
33
2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
33
2.2 STRUCTURE ADMINISTRATIVE
33
2.3. VISION, MISSION, VALEURS et OBJECTIFS DE
L'ECOPO
36
2.4 FORMATION
37
2.5. RESSOURCE FINANCIERE
38
2.6 ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE :
L'OUTIL SWOT
38
CHAPITRE 3 : RESULTATS D'ETUDE
40
3.1. INTRODUCTION
40
3.2. PRESENTATION DES DONNEES
40
3.2.1. Présentation de
l'échantillon
40
3.3. ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION
DES RESULTATS
40
3.3.1. Présentation de
l'échantillon
40
3.4. Dépouillement des données
de l'enquête
42
3.4.1. Utilisation du E-commerce
42
3.4.2 Attitude face au E-commerce
43
3.5. Résultats de l'estimation
44
3.6. Signification pratique des
résultats :
46
3.7. DISCUSSION DES RESULTATS
46
CONCLUSION
48
BIBLIOGRAPHIE
49
ANNEXES
52
LISTE DES FIGURES
Figure 1. Modèle théorique
explicatif
3
Figure 2. Les facteurs explicatifs du comportement
du consommateur.
12
Figure 3. Les étapes du processus d'achat
16
Figure 4 : Cycle de vie d'un produit
20
Figure 5 : Etapes d'une transaction
électronique
25
Figure 6 : Pyramide des besoins de Maslow.
31
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Fréquence d'utilisation du
E-commerce
3
Tableau 4 : comparaison entre le commerce
traditionnel et le commerce électronique
24
Tableau 5 : Analyse SWOT
39
Tableau 6 : Modèle estimé
45
NOTE DE SYNTHESE
L'objectif de cette recherche est d'expliquer le comportement
des Lushois face au E-commerce. Après avoir observé un
comportement de méfiance, de réticence et une adhésion
irrégulière à la technologie de l'information et de la
communication et à tous les avantages offerts par le commerce en ligne,
et ce dans le contexte de la pandémie à Covid-19, la
présente recherche s'est fondée principalement sur les
hypothèses d'analyse de la psychologie du consommateur.
L'enquête faite sur l'échantillon de 30
personnes, principalement des étudiants de l'EcoPo et la
régression faite admettent que le comportement des Lushois est
expliqué significativement par la motivation et l'apprentissage, et ce
40% de degré d'explication.
Mots clés : comportement,
consommateurs, e-commerce
INTRODUCTION
1. PHENOMENE OBSERVE
L'e-commerce appelé aussi commerce en ligne ou commerce
électronique est un secteur en pleine croissance en République
Démocratique du Congo. Pendant cette période de Covid-19, les
consommateurs LUSHOIS se voient adopter une nouvelle habitude, étant
donné qu'ils n'ont pas encore intégré la pratique d'achat
en ligne, les chiffres en témoignent. Selon Datareportal il y'a 88.13
millions d'abonnés en RDC, la pénétration des utilisateurs
Internet 16.35 million soit 19% dans le milieu urbain et en milieu rural et
3.10 million des utilisateurs de réseaux sociaux soit 3.5% en Mars 2020.
Par ailleurs, après une enquête effectuée
sur un échantillon des étudiants de l'ECOPO, force est donc de
constater un taux faible d'adhésion au E-commerce de la part de ces
étudiants. En effet, 16,7% des étudiants admettent n'utiliser le
E-commerce très souvent et 20% qui le font souvent. Cependant ceux qui
l'utilisent rarement représentent 26,7% et ceux qui admettent l'utiliser
très rarement sont de 36,7%. Comme nous pouvons le voir dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 1 :
Fréquence d'utilisation du E-commerce
|
Très souvent
|
Souvent
|
Rarement
|
Très rarement
|
|
Effectif
|
5
|
6
|
8
|
11
|
|
Pourcentage
|
16,70%
|
20%
|
26,70%
|
36,70%
|
Source : nous-même sur base de l'enquête
C'est dans cette perspective que nous avons formulé
notre question de départ de la manière suivante :
« Pourquoi les LUSHOIS n'adhèrent-ils pas à
la nouvelle technologie qui est le commerce en ligne (E-commerce) malgré
le contexte de crise sanitaire ? »
Ce mémoire a pour objet l'éclaircissement sur la
question « comportement des LUSHOIS face au e-commerce pendant la
période de Covid-19 ».
2. REVUE DE LITTERATURE
Plusieurs auteurs ont mené des études dans ce
domaine, puisqu'il nous sera difficile d'explorer toute la littérature,
nous nous sommes proposé dans le cadre de notre étude d'explorer
celles qui sont proches de notre étude.
2.1 ETUDES EMPIRIQUES
BOUCHRA JEGHAOUI (2010),
E-commerce au Maroc,le commerce électronique marocain
continue malgré les obstacles précédents à gagner
de plus en plus de terrain. Au vu des données statistiques
récentes notamment en termes de chiffre d'affaires, il remarque que le
commerce électronique connait une hausse exponentielle
particulièrement prometteuse pour les années avenir.
Yvon MERLIERE, Dominique JACOMET et Evelyne CHABALLIER
(2011), l'impact du commerce électronique en matière
de soldes et de promotions, pour eux, le commerce électronique a
connu un fort développement au cours des cinq dernières
années : il atteint 31 milliards d'Euros en 2010, contre 8,4
milliards d'Euros en 2005, soit une multiplication par quatre en cinq ans. Ce
secteur reste cependant fragile économiquement, peu de sites
présentent une rentabilité nette positive : les taux se
situent entre -5 et +5%. Globalement, la rentabilité est faible.
Karim BOUAISSA (2007), le commerce et la
vague internet, pour lui, les enjeux principaux de l'utilisation de la
technologie de l'information et de la communication ne sont pas seulement
techniques, mais sont aussi stratégiques et managérial.
HAMZA ZINBI (2015), le comportement du
consommateur marocain face au commerce électronique, pour lui le
comportement vis-à-vis du commerce électronique est encore
taché de crainte et de méfiance à l'égard de
celui-ci, pour ceux qui ont franchi la ligne, ils considèrent comme
étant la complémentarité du commerce traditionnel et non
comme un canal d'achat à part entière.
Catherine BARBA (2020),la fin du
e-commerce ou l'avènement du commerce connecté ?
Elle montre comment les mutations actuelles du e-commerce et
du commerce constituent de nouvelles valeurs pour les commerçants. Le
monde marchand demain sera plus complexe. Il exige dès aujourd'hui les
décideurs à penser vite, multi-écrans et cross-canal, pour
faire entrer en cohérence l'online et offline. La cohérence des
preuves qu'elles leur apportent sur tous les points de contact.
Janny C. Hoekstra et Peter SH Leeflang (2020),
le marketing à l'ère du Covid-19 ; ils
discutent sur les effets de la Covid-19 sur le comportement des consommateurs
et développent les conséquences de cette perturbation pour les
stratégies marketing. Cette crise sanitaire présente des
similitudes avec les changements de comportement des consommateurs. Cependant,
il affiche également des caractéristiques qui diffèrent
des cycles de descente, comme les changements de consommations entre les
catégories et le passage accéléré du comportement
hors ligne et en ligne.
FISHBEIN (1963), afin de tenir compte de
l'environnement et dans le souci de mieux prédire le comportement de
consommateur, Fishbein a étendu son étude. C'est l'attitude face
à un comportement relié à un objet qui est mesurée.
Il évoque 2 éléments sociaux :
ï Les croyances normatives, c'est-à-dire ce qu'une
personne croit ou pense que les autres attendent de lui.
ï La tendance du consommateur à se plier aux
normes dictées par la famille, entourage ou groupe de
référence.
AL KITENGE (2020), lecommerce
électronique en RDC pose deux problèmes :
ï Le premier problème est celui de la confiance.
Tous les pays du monde ont déjà réglé ce
problème sauf la RDC. Simplement parce que nous n'anticipons pas les
choses.
ï Le deuxième problème c'est le
mécanisme de paiement. Certains pays ont déjà
résolu ce problème en mettant en place de
« Gateway » de paiement électronique et ils ont des
systèmes de sécurité pour que l'argent
dépensé sur le portail électronique arrive en
sécurité chez les destinataires. Ce n'est pas aussi
réglementé chez nous.
Le comportement des consommateurs face au e-commerce
évolue et je ne vois pas pourquoi ils auront un comportement
indifférent face à cette nouvelle habitude de consommation mais
aussi tout dépendra de la facilité d'accéder à
internet.
L'impact du covid-19 sur le comportement des
consommateurs, Janny et Peter SH LeeflangC. Hoekstra (2020), la crise
du COVID-19 affecte le comportement des consommateurs et donc la manière
dont le marketing peut être utilisé. L'utilisation du marketing
pendant (et après) la crise du COVID-19 montre (et continuera de
montrer) des similitudes avec la façon dont le marketing est
effectué pendant les ralentissements économiques.
Dekimpe et Deleersnyder (2018) ont
résumé les études les plus pertinentes sur
l'efficacité des efforts de marketing en période de
ralentissement et de reprise. Cependant, cette crise spécifique, qui
sera suivie d'une récession (contraction), présente des
caractéristiques différentes de celle associées à
une récession. Par exemple, outre une baisse de la consommation due
à une moindre confiance des consommateurs sur des revenus plus faibles,
des défauts de paiement des consommateurs sur les prêts et des
moyens financiers réduits en raison de la baisse des déplacements
de consommation se produisent également entre les catégories de
produits.
Les consommateurs sont mis au défi de
réévaluer leurs priorités de vie, ce qui peut donner lieu
à de nouvelles valeurs et critères de dépenses. Les
consommateurs se voient adoptés d'autres voies pour répondre
à leurs besoins.
2.2 ETUDES THEORIQUES
La théorie empiriste rejette les
postulats, pour ce courant, ce sont les expériences que l'individu vit,
et le milieu dans lequel il évolue, qui marquent l'individu par
conséquent ils déterminent son attitude. En d'autres termes cette
théorie fait ressortir l'idée selon laquelle l'environnement
physique de l'individu, et son expérience acquise par rapport à
un certain produit qui détermine l'attitude positive ou négative
du comportement de consommateur à l'égard de ce produit, ce qui
peut engendrer dans un cas une fidélisation de ce produit et refoulement
des autres produits. Dans l'autre cas, entraîne un détournement
vers d'autres produits.
La théorie interactionniste suppose
que la motivation naît du contact d'un individu et d'un objet dont les
caractéristiques entrent en interaction.
La théorie situationniste adopte une
perspective opposée. Selon cette théorie, les comportements sont
déterminés par des influences extérieures à
l'individu à la fois, à adopter des comportements
valorisés par le groupe. La théorie situationniste suppose que
l'individu subit l'influence externe qui oriente son comportement.
3. PROBLEMATIQUE
Selon Sem et Cornet, (2018) La problématique est une
formulation de la question de centrale de recherche. Il s'agit de l'ensemble
des questions pertinentes que se pose un chercheur sur le
phénomène observé.Pour Angeline Lotarski, (2007) la
problématique est un processus qui permet d'un thème de passer
d'une question de départ classiquement naïve des hypothèses
de travail précis.
La question de recherche est l'étape primordiale
à tout travail. Elle comprend obligatoirement un temps d'analyse et la
synthèse de la littérature qui permet de faire le point sur les
besoins du champ de l'exercice professionnelle. Il est possible de resserrer le
cadre sur une question précise pour tenter d'apporter une réponse
à un besoin spécifique d'information.
Dans un environnement incertain qui est celui du e-commerce et
une période aussi difficile qui est celui de covid-19. Les consommateurs
LUSHOIS ont besoin de plus d'assurance, d'informations concernant l'e-commerce
et d'autre part la satisfaction à leurs besoins. Au regard de tout ce
qui précède ; le problème qui nous préoccupe
dans ce sujet de recherche est celui de comprendre :
« Quelles sont les facteurs explicatifs du
comportement des consommateurs LUSHOIS face au e-commerce pendant la
période de Covid-19 ? »
4. HYPOTHESE
Selon Sem et Cornet (2018), l'hypothèse est l'ensemble
des propositions de réponses à la question de recherche. Il
s'agit d'une réponse anticipée, une affirmation provisoire qui
explique un phénomène.
Pour Dushaies (2002) cité par Kabwit (2014), une
hypothèse est un mode de raisonnement qui part d'un a priori, d'une
proposition qu'il s'agira par la suite de confirmer ou d'infirmer.
Ainsi donc, sur base des théories sur la psychologie du
comportement du consommateur, nous formulons nos hypothèses de la
manière suivante : le comportement du consommateur LUSHOIS face au
e-commerce pendant la période de COVID-19 est caractérisée
par les aspects suivant :
H1 : La motivation
H2 : La perception
H3 : L'apprentissage
H4 : La culture
H5 : La classe sociale
4. OBJECTIF POURSUIVI PAR LA
RECHERCHE
L'objectif que nous poursuivons en menant cette étude
est celui d'identifier les aspects qui influencent le comportement du
consommateur LUSHOIS face au e-commerce pendant la période de Covid-19.
5. JUSTIFICATION ET CHOIX DU
SUJET
L'intérêt que nous poursuivons dans ce travail
s'attend à trois niveaux : personnel, scientifique et
managérial.
5.1. Sur le plan
personnel :
Dans le souci de mener une étude qui met en valeur les
facteurs qui influencent le comportement des LUSHOIS face au e-commerce et de
comprendre le comportement qu'à celui-ci, étant donné que
l'e-commerce fait partie intégrante de notre domaine d'étude.
Ainsi, avec ce travail nous avons eu à réunir la théorie
dans notre milieu académique et la pratique sur terrain.
5.2 Sur le plan
scientifique :
Cette étude vient allonger la liste des
littératures existantes qui traite sur le comportement de consommateur
de e-commerce, tout en y insérant une particularité sur le
comportement des consommateurs LUSHOIS de e-commerce pendant la période
de Covid-19.
5.3 Sur le plan
managérial
Ce travail pourra servir de référence pour les
chercheurs qui veulent comprendre le comportement des consommateurs face au
E-commerce. Ainsi, elle est une contribution de notre part, pour la
compréhension du comportement des LUSHOIS face au e-commerce.
6. DELIMITATION DU SUJET
Etudier le comportement des consommateurs pendant cette
période de covid-19 n'est pas une chose facile. Pour rester pragmatique
dans ce que nous allons faire, nous délimitons notre travail, par
rapport au temps et à l'espace.
6.1 DELIMITATION TEMPORELLE
Nous travail sera basé sur les données allant de
2020-2021 afin de connaitre les réalités actuelles du
comportement des LUSHOIS face au e-commerce pendant la période de
Covid19.
6.2 DELIMITATION SPATIALE
Nous avons choisi de focaliser notre travail sur le
consommateur d'e-commerce de Ecopo-Lubumbashi précisément les
étudiants.
7. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
7.1 METHODES DE PRODUCTION DES
DONNEES
7.1.1. METHODE DOCUMENTAIRE
Méthode documentaire pour explorer ou analyser les
différentes variables qui conditionnent la compréhension de notre
sujet de mémoire en exploitant les ouvrages.
7.1.2 METHODE DE SONDAGE
Elle consiste à mener une enquête d'après
les caractéristiques d'un ensemble réduit de la population
appelée « échantillon » des personnes qui sont
représentées comme un ensemble sur lequel on souhaite
récolter les réponses des questions posées à cet
échantillon.
7.2. TECHNIQUES DE COLLECTE DES
DONNEES
Elle est définie comme un moyen de communication entre
l'enquêteur et l'enquêté, il comprend les questions
ouvertes, fermées et semi ouvertes :
ï Questions fermées l'enquêté
répond par « OUI » ou « NON »
ï Questions ouverte l'enquêté répond
alternativement en donnant son point de vue.
ï Questions semi ouvertes l'enquêté à
la faciliter de répondre librement à la question. Il s'agit de la
case autre.
7.3. TECHNIQUE D'INTERVIEW
L'interview est un procède d'investigation scientifique
utilisant une communication orale dans le but de transmettre des informations
de l'enquêté à l'enquêteur.
Elle est définie comme étant une technique qui a
pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes,
l'enquêté et l'enquêteur, et qui permet à
l'enquêteur de recueillir certaines informations de l'enquête
concernant un objet précis.
7.3.1. Observation directe
L'observation directe est une technique où le chercheur
est présent sur le terrain et récolte lui-même des
informations grâce à sa grille d'observation.
7.3.2 L'échantillonnage
Un échantillonnage est une sélection d'individus
ciblés pour réaliser un sondage. Les personnes interrogées
sont triées parmi la population de référence. Une
extrapolation permet ensuite d'appliquer les résultats à la
population prise pour cible.
7.4. METHODE ET TECHNIQUE
D'ANALYSE DES DONNEES
Pour l'analyse des données, nous allons utiliser le
dépouillement du questionnaire et la méthode de régression
logistique.
7.4.1 Dépouillement du
questionnaire
Dans l'encyclopédie illustrée du marketing, le
dépouillement d'enquête est la phase d'une enquête par
questionnaire pendant laquelle les résultats obtenus sur un support
papier sont traités manuellement et saisi lorsqu'ils sont
exploités.
7.4.2. Régression logistique
Selon Bourdonnais (2015), la régression logistique est
une méthode utilisée dans la modélisation pour
prédire ou expliquer une variable qualitative Y, c'est-à-dire
qu'elle prend des données binaires à partir d'un ensemble de
variables indépendantes Y continuent ou discontinuent, donc
quantitatives ou qualitatives. Le principe de la régression logistique
repose sur la survenance ou non d'un évènement. Nous pouvons
donc, non seulement prédire la survenance ou non d'un
évènement Y, mais aussi nous pouvons quantifier la
probabilité d'une variable à expliquer ou non
l'évènement. Ainsi, l'objectif du modèle logistique est
donc d'expliquer la survenance de Y à partir d'un certain
nombre de caractéristiques observées sur les individus
Xi. On cherche donc à quantifier la probabilité
d'apparition de l'évènement, on travaille donc
généralement en espérance.
7.5. Approche qualitative
Nous avons effectué notre travail une seule
approche :
L'approche qualitative :
(Creswelle,1998, p.14) « les écrivains
conviennent que l'on entreprend la recherche qualitative dans un cadre naturel
où le chercheur est un instrument de collecte de données qui
rassemble des mots ou des images, leur analyse inductive, met l'accent sur la
signification de participants, et décrit un processus qui est expressif
et convaincant dans le langage ». Ce type de recherche consiste
à produire et à analyser des données descriptives telles
que les paroles écrites ou dites et le comportement observatoire des
personnes Taylor et Bogdan (1984). Ainsi, cette approche nous a permis de
connaitre les facteurs de démotivations des consommateurs LUSHOIS face
au e-commerce.
8. STRUCTURE DU MEMOIRE
Notre mémoire est subdivisé en deux parties
essentielles à savoir la partie théorique et la partie pratique.
La partie théorique comporte deux chapitres :
Le premier chapitre intitulé « cadre
conceptuel et théorique », ce chapitre est consacré aux
définitions de concepts clés de notre sujet d'étude.
Le deuxième chapitre aborde « le cadre
empirique » est consacré la présentation de notre champ
empirique.
La deuxième partie du travail qui a un seul chapitre
qui est le troisième chapitre intitulé
« résultats de recherche ». Ici, il sera question de
présenter les résultats de recherche.
CHAPITRE 1 : CADRE
CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Ce présent chapitre replace les différents
concepts relatifs à notre travail et au cadre théorique.
1.1. DEFINITIONS DES
CONCEPTS
1.1.1 COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR
1.1.1.1. Généralités
L'étude de comportement du consommateur vise à
analyser comment des individus et des groupes choisissent, achètent et
utilisent des biens et des services afin de satisfaire leurs besoins.
Les responsables marketing doivent comprendre les
théories et les concepts clés du comportement du consommateur,
aussi analyser régulièrement les pratiques et les tendances de
consommation. Or, les décisions d'achat d'un consommateur subissent
l'influence de nombreux facteurs.
· Objectif de l'étude de comportement du
consommateur
Etudier le consommateur permet de connaitre, de comprendre et
de prédire ses comportements pour s'adapter à lui, pour
l'influencer.
Figure 1. Modèle
théorique explicatif
-Facteurs individuels
-Facteurs environnementaux
Comportement du consommateur Lushois face au
e-commerce
Variables explicative Variables
expliquée
- Motivation
- Apprentissage
- Perception
- Culture
- Classe sociale
Taux d'adhésions/d'utilisation du
e-commerce
Indicateur
Source : Nous-même
· Les sortes consommateurs :
- Consommateur Potentiel : nous
considérons un consommateur potentiel, comme une personne physique ou
morale qui détient le pouvoir d'achat, mais qui ne passe pas à
l'acte d'achat.
- Consommateur Virtuel : c'est quand le
demandeur se limite à une intention d'achat
- Consommateur réel : c'est
lorsque l'acheteur a déjà poser l'acte d'achat.
1.1.1.2. Les facteurs qui influencent le comportement du
consommateur
KOTLER (2015) ressort les facteurs qui influencent le
comportement du consommateur. Qui sont :
Figure 2. Les facteurs
explicatifs du comportement du consommateur.
|
Les facteurs individuels
|
Psychologiques
Personnels
|
- La motivation
- La perception
- L'apprentissage
- Les émotions
- La mémoire
- L'âge et le cycle de vie
- La profession et la position économique
- La personnalité et le concept de soi
- Les styles de vie et valeurs
|
|
Les facteurs
environnements
|
Sociaux
Culturels
|
- Les groupes et les leaders d'opinion
- Les cliques
- La famille
- Les statuts et les rôles
- La culture et les sous-cultures
- La classe sociale
|
A. Les facteurs individuels
· Motivation
Les besoins ressentis par un individu sont de nature
très diverse. Certains sont biogéniques, issus d'états de
tension psychologique tels que la faim, la protection, l'affection... D'autres
psychogéniques, engendré par un inconfort psychologique, par
exemple le besoin, de reconnaissance. La plupart des besoins, latents ou
conscients, ne poussent pas l'individu à agir. Pour que l'action
intervienne, il faut que le besoin ait atteint un niveau d'intensité
suffisant pour devenir une motivation.
· Perception
Un individu motivé est prêt à l'action. La
forme que prendra celle-ci dépend de sa perception de la situation de la
situation.
La perception est processus par lequel un individu choisit,
organise et interprète des éléments d'information externe
pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure.
· L'apprentissage
Lorsqu'il agit, un individu se trouve soumis aux effets
directs et indirects de ses actes, qui influencent son comportement
ultérieur.
La plupart de nos comportements sont appris. Face à une
motivation d'achat, et l'expérience passée va déterminer
quand, où et comment un consommateur se met en action.
· Les émotions
La réponse des consommateurs aux stimuli marketing
n'est pas uniquement cognitive et rationnelle, elle est également
émotionnelle. Des marques comme Coca-Cola et McDonald's s'appuient sur
le facteur émotionnel depuis des années. En effet un produit, une
marque peut générer chez ses clients de la fierté, de
l'excitation, de la confiance...
· La mémoire
Un processus d'activation de noeud à noeud
détermine les souvenirs qui émergent dans une situation
donnée.
· L'âge et le cycle de vie
Les produits et les services achetés par une personne
évoluent tout au long de sa vie. L'individu modifie son alimentation,
ses vêtements, ses meubles, équipements, loisirs, etc.
· La profession et la position économiques
Le métier exercé par une personne est à
l'origine de nombreux achats. Ainsi, un ouvrier du bâtiment a besoin de
vêtements solides et des chaussures de travail adaptées à
l'environnement extérieur.
La position économique détermine
également ce que le consommateur est en mesure d'acheter. Cette position
est fonction de son revenu (niveau, régularité,
périodicité), de son patrimoine, de sa capacité
d'endettement et de son attitude vis-à-vis de l'épargne et du
crédit.
· La personnalité et le concept de
soi
Tout individu a une personnalité qu'il exprime à
travers son comportement d'achat.
La personnalité est un ensemble de
caractéristiques psychologique distinctives qui engendrent des
réponses cohérentes et durables à ses stimuli externes
émanant de l'environnement.
Le concept de soi est le représentant subjectif de la
personnalité. C'est-à-dire il correspond à l'image que
l'individu a de lui-même et à la manière dont il pense que
les autres voient.
· Le style de vie et les valeurs
Des individus partageant la même sous-culture, la
même classe sociale et la même profession peuvent avoir des styles
de vie différents.
Le style de vie d'une personne est un schéma de vie
exprimé en fonction de ses activités, de ses centres
d'intérêt et de ses opinions.
Les styles de vie s'expliquent en partie par les valeurs
auxquelles aspirent les individus.
Les valeurs sont des croyances durables selon lesquelles
certains modes de comportement et certains buts de l'existence sont
personnellement préférables à d'autres. Elles permettent
à l'individu de définir son identité et de justifier ses
actes.
B. Les facteurs environnementaux
· Les groupes et les leaders d'opinion
Les groupes auxquels un individu appartient sont ceux qui
exercent une influence sur ses attitudes ou ses comportements.
L'influence des groupes intervient de trois
façons : ils proposent à l'individu des modèles de
comportement et de mode de vie ; ils influencent l'image qu'il se fait de
lui-même ; ils engendrent des pressions en faveur d'une certaine
conformité de comportement, qui peut affecter les choix de produits et
de marques.
Les leaders d'opinion se répartissent dans toute les
couches de la société et sont spécialisés : un
individu jouissant d'une certaine autorité en matière de jeux
vidéo peut être suiveur sur les vêtements.
· Les cliques
Les chercheurs en communication voient la
société comme un ensemble de cliques, de petits groupes
composés de membres en fréquente interaction.
· La famille
Le comportement d'un consommateur est influencé par les
différents membres de sa famille. Il est donc utile de distinguer deux
sortes de cellules familiales : la famille d'orientation, qui se compose
des parents et la famille procréation formée par le conjoint et
les enfants. Dans la famille d'orientation, un individu acquiert certaines
attitudes envers la religion, la politique, mais aussi envers lui-même,
ses espoirs et ses ambitions.
· Les statuts et les rôles
Un individu fait partie de nombreux groupes tout au long de sa
vie : famille, groupes d'amis, associations, clubs, etc. La position de
chacun occupe dans un groupe est en effet régentée par un statut
auquel correspond leurs rôles.
· La culture et les sous-cultures
La culture est un ensemble de connaissance de croyances, de
normes, de valeurs et de traditions acquises par l'homme en tant que membre de
telle ou telle société. Elle détermine de manière
fondamentale les désirs et les comportements des individus.
· La classe sociale
On appelle classe sociale des groupes relativement
homogènes et permanents, ordonnés les uns par rapport aux autres,
et dont les membres partagent le même mode de vie et le même
comportement.
La classe sociale constitue un indicateur composite qui
reflète la stratification sociale de la société.
Les personnes appartenant à une même classe
sociale ont tendance à se comporter de façon relativement
homogène dans leurs choix de marques et de produits sur les nombreuses
catégories telle que les vêtements ou les loisirs.
1.1.1.3. Les étapes du processus d'achat
Il est essentiel d'appréhender l'expérience du
client dans son intégralité, depuis la reconnaissance du
problème et la recherche d'information jusqu'à l'utilisation et
l'abandon du produit. La figure 3 illustre un modèle de processus
d'achat comportant 5 cinq phases : la reconnaissance du problème,
la recherche d'information, évaluation des alternatives
Figure 3. Les étapes
du processus d'achat
Reconnaissancedu problème
Comportement post-achat
Décision d'achat
Evaluation des alternatives
Recherche d'information
Source : nous-même
A. La reconnaissance du problème
Le début du processus est la révélation
du problème suite à des stimulus internes ou externes. Cette
première phase, intervient lorsque le consommateur prend conscience du
besoin qu'il ressent.
B. La recherche d'information
Les consommateurs recherchent souvent plus d'information sur
le produit et cette recherche peut porter sur différents sujets.
On distingue deux sortes de recherche : les sources
d'information et la dynamique de recherche.
· L'évaluation des
alternatives
Au moment où il reçoit de l'information,
l'individu s'en sert pour réduire ses incertitudes quant aux
alternatives et à leur attrait respectif.
· La décision d'achat
C'est le but du comportement de consommateur. L'individu qui
agit en tant qu'acheteur n'a qu'un seul but en tête, c'est satisfaire ses
besoins et ses désirs en acquérant des produits ou services.
· Le comportement d'achat
Après avoir acheté et fait l'expérience
du produit, le consommateur éprouve un sentiment de satisfaction ou, au
contraire, de mécontentement. Il peut ressentir une certaine dissonance
s'il est déçu par des caractéristiques du produit ou s'il
entend des commentaires favorables sur les marques concurrentes, il recherche
alors des informations qui confortent sa décision. La communication
marketing joue un rôle de renforcement des consommateurs dans leurs choix
antérieurs vis-à-vis de la marque.
La tâche du marketing ne s'arrête donc pas
à l'acte de vente. Il est essentiel d'étudier la satisfaction,
les actions post-achat et l'utilisation qui est faite du produit.
1.1.2. LE MARCHE ET SES
ACTEURS
Le terme « marché » défini
comme le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande pour échanger
des biens et des services en échange de monnaie. Et du point de vue
marketing :
ü Selon KOTLER, le marché est l'ensemble des
clients capables et désireux de procéder à un
échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir.
ü Selon LENDREVIE, le marché est l'ensemble des
publics susceptible d'exercer une influence sur les ventes d'un produit.
1.1.2.1. Les acteurs d'un marché
L'orientation-marché implique que l'entreprise prenne
en compte, dans son analyse, tous les acteurs et intervenants qui, de
près ou de loin, influencent la décision d'achat du client et
font donc partie du « marché » au sens large.
Il existe 5 acteurs clés du marché : clients ou
utilisateurs, distributeurs, concurrents, prescripteurs et stakeholders ou
macro-markéting.
- Le client final ou direct
La satisfaction des besoins du client final (ou du client
direct) est évidemment le premier objectif qui rejoint celui du concept
marketing traditionnel. Le client final peut être très
différent du client direct de l'entreprise, selon qu'il s'agit d'un
marché de biens de consommation ou d'un marché industriel.
- Le client distributeur
La lutte pour le contrôle de la demande et de
l'accès au marché a toujours été un enjeu
stratégique majeur pour les fabricants et les distributeurs.
Les relations fabricants-distributeurs sont restées
longtemps celles de partenaires ayant des intérêts communs. Depuis
la montée en puissance de la grande distribution dans le secteur des
biens de grande consommation, ces relations sont devenues des relations
ambiguës.
- La concurrence
Les concurrents directs, comme la concurrence des produits de
substitution, sont des acteurs clés dans les marchés puisque
c'est par rapport à eux que l'entreprise va définir l'avantage
concurrentiel sur lequel elle base sa stratégie de développement.
- Les clients prescripteurs
Dans nombreux marchés, en plus des acteurs
traditionnels-clients, distributeurs et concurrents-d 'autres individus ou
organisations peuvent exercer un rôle important en conseillant, en
recommandant ou en prescrivant des marques, des produits ou services aux
clients et/ou aux distributeurs.
Cette optique implique que l'entreprise identifie les leaders
d'opinions et les prescripteurs clés, évalue la nature et
l'importance du rôle qu'ils exercent dans le processus de formation de la
décision d'achat et mettant au point une stratégie de
communication pour les informer, les motiver et pour obtenir leur soutien.
- L'environnement macromarketing (les autres
stakeholders)
Dans tout marché, des facteurs de l'environnement
social, technologique, économique, écologique et politique
pèsent sur le développement futur de ce marché.
L'entreprise ayant adopté une orientation-marché doit donc
développer un système de suivi de son environnement
macromarketing afin d'anticiper ces changements et de faciliter l'adoption en
temps utile des contre-mesures appropriées.
1.1.2.2. Les facteurs d'évolution d'un
marché
Dans l'évolution d'un marché,
- Le produit
On appelle produit tout ce qui peut être offert sur un
marché de façon à y satisfaire un besoin.
Un produit peut être un bien tangible, un service, Le
produit est donc au coeur de l'offre. Il représente ce qui
répondra aux besoins des consommateurs. Si le produit est
défectueux, tout le reste échoue. Les attributs du produit
vis-à-vis des attributs offerts par des produits et des substituts
concurrents, sont importants dans la formulation de la stratégie de
marketing.
- Le prix
Le prix à beaucoup d'impact sur le niveau de
satisfaction de l'acheteur du service, le prix est souvent
considéré comme un indicateur de la qualité. Le prix par
rapport à la concurrence, il constitue un pôle de
référence. Pour fixer le prix des produits, l'entreprise doit se
référer à la concurrence tout en sachant que le celui-ci
à une forte influence sur le marché.
- La distribution
Elle constitue souvent un aspect complémentaire de la
valeur pour le client. Elle désigne les endroits ou une entreprise rend
son produit disponible pour ses clients cible.
- La communication
La communication est vue comme une technique visant à
influencer les comportements des consommateurs. Les objectifs de la
communication varient en fonction des cibles à atteindre, la
communication et tous ses outils ont remarquablement propulsés les
affaires et l'extension du marché.
1.1.3. LE PRODUIT
1.1.3.1. LES CARACTERISQUES DU PRODUIT
Le produit est défini comme un ensemble de
caractéristiques tangible. Les produits sont généralement
classés à partir de trois caractéristiques majeures :
leur durée de vie, leur caractère tangible ou non et les
habitudes d'achat des clients.
a) La durée de vie et la
tangibilité
Selon les deux critères, on peut distinguer plusieurs
types de produits :
Ø Les biens périssables
Ce sont biens tangibles consommés en un petit nombre de
fois (produits alimentaires, beauté, etc.). Parce qu'ils sont
achetés fréquemment, distribués dans le nombreux point de
vente et font l'objet de multiples actions de communication pour stimuler
l'achat.
Ø Les biens durables
Ce sont des biens tangibles qui survivent à de nombreux
utilisations (électroménager, réfrigérateurs). Ils
exigent un effort de ventes.
Ø Les services
Ce sont des activités intangibles et
périssables, ils exigent un contrôle de la qualité, une
certaine crédibilité du prestataire et de l'adaptation aux
besoins de chaque client.
b) Les produits de grande consommation
Ø Les produits d'achat courant
Le client à l'habitude d'acheter fréquemment et
rapidement, tels que les produits de première nécessité
qui correspond aux achats les plus courants : pain, lait, dentifrice, etc.
les produits d'achat impulsif sont acquis sans préméditation ni
effort particulier d'information, comme les chewing-gums. Ils sont disponibles
à des nombreux endroits faciles d'accès. Les produits de
dépannage sont souvent achetés lorsque le besoin s'en fait
sentir : un parapluie lorsqu'il pleut.
Ø Les produits à achat planifié
Ce sont des produits sur lesquels le client se renseigne avant
l'achat et établit des comparaisons sur des critères tels
que : la qualité, le prix, et le style.
Ø Les produits de
spécialité
Ce sont les produits aux caractéristiques uniques ou
l'image est bien définie, de sorte que de nombreux d'acheteurs sont
disposés à faire un achat particulier pour en disposer (voitures,
parfums, alcools).
Ø Les produits non recherchés
Ce sont les produits que le consommateur ne connait pas ou
auxquels il ne pense pas naturellement, comme les détecteurs de
fumée, les assurances vie. De leur nature, les produits non
recherchés nécessitent un marketing attentif, souvent
fondé sur la vente personnalisée.
1.1.3.2 Le cycle de vie d'un produit
On distingue quatre phases dans le cycle de vie d'un
produit : phase de lancement, phase de croissance, phase de
maturité et le déclin.
Figure 4 : Cycle de vie
d'un produit
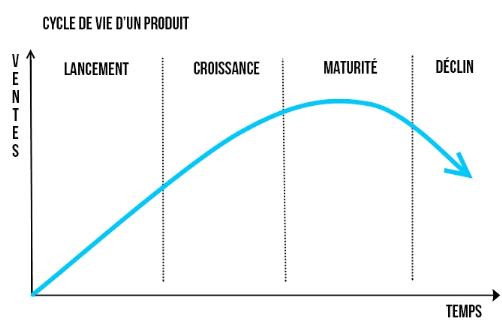
Source :
https://www.qualtrics.com
A. Phase de lancement
Le produit arrive sur le marché, les couts sont
importants et sont liés à la promotion et à la production
du produit ne lui permet pas d'être rentable.
B. Phase de croissance
Dans cette phase, le produit devient rentable, le produit
commence à gagner des parts de marché. L'objectif étant de
maintenir cette étape de croissance le plus longtemps possible, ceci en
jouant notamment sur les éléments du marketing mix (le prix, la
promotion, la distribution et la communication).
C. Phase de maturité
Le produit ne connait plus de croissance, il ne gagne ni ne
perd de part de marché. La rentabilité est forte mais elle
stagne, les couts de production sont faibles car le processus est
maitrisé. Cependant il est impératif de continuer la promotion du
produit, dont les couts ne peuvent pas être réduits car elle
garantit la longévité de ce produit. Dans cette phase
l'entreprise à tout intérêt à investir dans de
nouveaux produits en injectant les profits liés à la
rentabilité du produit mature dans l'innovation.
D. Phase de déclin
Le produit est en fin de vie, ses parts de marché et sa
rentabilité diminuent. Ce déclin est le signe d'une perte
d'intérêt des consommateurs envers ce produit ou de
l'arrivée d'un produit de substitution venant s'accaparer le
marché du produit vieillissant.
1.1.4. INTERNET
Ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui
permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer
efficacement au moyen d'un protocole de communication commun et qui permet
d'avoir accès à différent domaine et qui facilite les
capacités des recherches chez les internautes.
1.1.5. COMMERCE ELECTRONIQUE
1.1.5.1. Définition
Le e-commerce ou commerce électronique est
l'échange pécuniaire de biens, des services et d'informations par
l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment internet
également la dénomination anglaise e-commerce.
L'association pour le commerce et les services en ligne(ACSEL)
propose deux définitions du commerce en ligne restrictive et une autre
plus extensive :
1. Le commerce électronique désigne l'ensemble
des échanges commerciaux dans lesquels l'achat s'effectue sur le
réseau de télécommunications. Par commerce
électronique, on sous entends la prise de commande que l'achat avec
paiement. Et l'acte d'achat concerne autant les achats de biens que les achats
de services en ligne.
2. Plus extensive, cette définition inclut l'ensemble
des usages commerciaux des réseaux. Il est bien entendu le commerce
électronique est avant tout du commerce et que l'internet n'est qu'un
support de communication, comme entre autre, l'échanges des
données informatisées. Il recouvre toute opération de
vente de biens et de services via un canal électronique.
3. Selon Dr. Tarik Abd-Al-Aal Hammad,
« le commerce électronique est un processus d'échange
des biens et des services, et aussi ce terme comprend l'accord entre les
parties par les moyens électroniques normalement par l'internet.
De plus, le commerce électronique est l'ensemble des
opérations de la production, de la livraison et la commercialisation des
produits ». Le commerce électronique est la possibilité
de vendre et d'acheter des biens matériels ou immatériels ou des
services par le biais du réseau internet. Ce nouveau mode de
distribution ne laisse personne indifférent.
Sur un site de commerce électronique, on trouve des
informations sur le produit ou la société, mais aussi la
possibilité, de prise de commande automatique, le paiement en ligne
sécurisé, la présence d'outils marketing d'analyse du
profil consommateur, et même quelques fois la livraison du produit en
ligne comme pour la presse ou les logiciels en téléchargement.
Le commerce électronique est le résultat de la
création et de l'investissement des affaires en utilisant les
technologies de l'internet. Le commerce électronique est une
activité qui n'est pas un produit d'être en soi mais un mode
d'utilisation mis à disposition des internautes.
4. Selon Efraim Turban, « le
commerce électronique (CE) est un concept émergé qui
décrit le processus des ventes, des achats, ou des échanges des
produits, des services et d'informations par les réseaux
internet ».
Cette nouvelle technique a des avantages et des risques qui
affectent la société, les consommateurs et les entreprises. Elle
a commencé à apparaitre partout dans le monde. Certains pays ont
commencé le lancement de cette technique de cette technique dans
différents domaines d'affaires tels que : les médicaments,
les jeux vidéo, les livres, les billets d'avions... d'autres ne
commencent pas encore à implanter cette technologie, et certains sont en
train de mettre ce moyen informatique à disposition.
D'une part, le mécanisme de commerce
électronique a des profits potentiels dans les sociétés
tels que ; le développement du marché au niveau national et
international, comme par exemple la réponse rapide d'un fournisseur et
la livraison en avance d'une matière première pour fabriquer un
produit qui se reflète positivement de chiffre d'affaires d'une
compagnie.
D'autre part, des risques du commerce électronique
doivent être pris en compte.
Comme par exemple ; la restriction du marché du
fait de la nécessité d'un minimum de maitrise de l'outil
informatique de la part du client, l'efficacité relative du service
après-vente mais aussi le manque de la sécurité
complète d'un système sur un site web reflète
négativement sur la confiance d'un client qui va hésiter à
consulter ce site ou bien à acheter quelques articles.
Enfin certains pays souffrent des prix augmentés des
connexions internet et ils ont besoins d'apprendre tout ce qui concerne cette
technologie, ses fonctions, avantage et son futur...
5. Selon l'Union européenne, le
commerce électronique est un nouveau domaine qui recouvre les
échanges transfrontières de marchandises par voie
électronique. Globalement, on entend par commerce électronique la
production, la promotion, la vente et la distribution de produits par des
réseaux de télécommunications.
- Le commerce électronique direct :
c'est-à-dire la commande en ligne, le paiement et la livraison de biens
et services intangibles comme les logiciels informatiques ou les produits de
loisirs.
- Le commerce électronique indirect :
c'est-à-dire la commande en ligne de biens tangibles devants encore
être livrée physiquement et qui dépend donc de facteurs
externes tels que l'efficacité du système de transport.
1.1.5.2 Evolution et historique du commerce
électronique :
- Echange de données informatisées(EDI)
: le terme commerce électronique n'est pas totalement nouveau,
en effet, ce que l'on appelle commerce électronique ou e-commerce est en
fait la connexion électronique permettant aux acheteurs d'être en
contact avec des clients et des fournisseurs pour échanger l'information
électroniquement et pour se procurer des biens et services.
- Le passage de l'échange de données
informatisées vers le commerce électronique :
Malgré la réussite de l'EDI à simplifier
et rationnaliser les procédures commerciales internationales. Faudrait
noter que les systèmes d'EDI présentent certains
inconvénients tels que :
Ø Il n'a concerné qu'un très petit nombre
de grandes entreprises, seules à disposer des ressources pour
s'équiper d'une telle solution.
Ø Il s'est surtout cantonné à la fonction
achat de grands groupes et encore à l'achat des biens directs, il a
rarement pu être étendu aux biens indirects.
Ø L'EDI fonctionnait en réseau fermé avec
des protocoles souvent propriétaires ne facilitant pas
l'intercommunication entre les différents réseaux.
1.1.5.3. Particularités du commerce
électronique par rapport au commerce traditionnel :
Une comparaison entre le commerce traditionnel et le commerce
électronique est schématisée dans le tableau
suivant :
Tableau 4 : comparaison
entre le commerce traditionnel et le commerce électronique
|
Commerce traditionnel
|
Commerce électronique
|
|
Utilisation d'un support traditionnel : papier.
|
Utilisation d'un support informatique
|
|
Rencontre des acteurs sur un lieu physique : le
marché.
|
Lieu de commerce= marché virtuel
|
|
Rencontre physique entre les acheteurs et les vendeurs.
|
Réalisation des transactions sans à travers des
liens informatiques.
|
|
Paiement par monnaie dans la majorité des cas.
|
Règlement par transactions numérique de compte
à compte
|
Source : nous-même
Les transactions en ligne offrent de nombreux avantages que le
commerce traditionnel ne permet pas, notamment la rapidité, la
réduction importante du cycle de vente et la réduction des
coûts.
1.1.5.4. Les différents intervenants dans une
transaction électronique :
§ Les clients : sont ceux qui
veulent acquérir un bien ou un service pour satisfaire un besoin
quelconque.
Les clients peuvent effectués des achats en ligne en
utilisant leurs cartes de crédits.
§ Les vendeurs : ce sont ceux qui,
possèdent un bien ou un service et sont désireux de se
départir de ce bien ou de fournir ce service moyennant une
rémunération et utilisant, à cette fin des supports
informatiques et électroniques.
§ Les intermédiaires : ce
sont ceux qui facilitent le processus de transaction commerciale entre clients
et vendeurs. Deux types d'intermédiaires :
- Les intermédiaires techniques :
fournisseurs d'accès internet, responsables de la publication des
informations des vendeurs, de l'honnêteté des informations
- transmises par les clients.
- Les intermédiaires financiers :
les émetteurs de cartes de crédits qui effectuent les transferts
d'argent du compte du client vers celui du vendeur ou de l'entreprise.
1.1.5.5. le processus d'une transaction
électronique
Le schéma suivant détaille les
différentes étapes d'une transaction
électronique :
Figure 5 : Etapes
d'une transaction électronique

Source :
http://www.memoireonline.com
Etape 1 : Achat de biens ou de
services
Le client se connecte à un site marchand et
procède à la sélection des articles à acheter ou
aux créances à régler.
Etape 2 : Confirmation de la
commande
Une fois son choix validé, il confirme son attention de
payer par carte bancaire en cliquant sur le
bouton « Payer » et il sera orienté
automatiquement vers la page de paiement sécurisée de
l'intermédiaire.
Etape 3 :Saisie des données de
paiement
L'intermédiaire reçoit et vérifie la
conformité de la demande de paiement reçue du site marchand et
affiche au client un écran de paiement personnalisé.

Source :
http://www.memoireonline.com
Le client renseigne les informations de paiement requises,
entre autres, le type de sa carte (VISA/MasterCard/cmi/Maestro), son
numéro et sa date de validité.
Etape 4 et 5 : Demande d'authentification
de la carte et réponse par l'émetteur à la demande
d'authentification
Etape 6 à 9 : Demande
d'autorisation et réponse
En temps réel, une demande d'autorisation est
envoyée par Maroc Télécommerce au centre monétique
interbancaire(CMI) qui la transmet via son réseau Interbancaire à
la banque du porteur de la carte. Cette dernière accepte ou refuse la
demande d'autorisation et retourne le résultat de l'autorisation au CMI
qui la route vers l'intermédiaire.
Etape 10 : Répercussion de la
réponse sur le client
L'intermédiaire vérifie, enregistre le
résultat de l'autorisation et affiche en temps réel une
réponse au client :
- Reçu du paiement si réponse positive,
c'est-à-dire si l'autorisation a été accordée et
acceptée.
- Message de refus le cas échéant. Le client
sera invité à refaire sa demande de paiement.
Etape 11 : Confirmation de la transaction
au CMI.
Etape 12 : Règlement de la
transaction
Une fois la transaction validée par le
commerçant le CMI procède au règlement en débitant
le client et en créditant le commerçant.
Bref, on peut récapituler le processus d'une
transaction électronique en 3 phases :
· Shopping : le client et le marchand se mettent
d'accord à travers un site marchand sur unensemble de biens à
acheter et sur le montant à payer par le client.
· Paiement : l'intermédiaire financier CMI
procède au règlement de la transaction après
l'authentification de la carte de crédit et l'obtention d'une
autorisation de paiement auprès de la banque du client.
· Livraison : au terme de la transaction de paiement
le marchand rend au client les biens ou fourni les services
préalablement sélectionnés.
Il faut distinguer les différentes formes du commerce
électronique :
§ Le commerce inter-entreprises (le BtoB : Business
to Business) ;
§ Le commerce auprès des ménages : les
ventes de biens et services aux particuliers (le BtoC : Business to
Consumer) ;
§ Le commerce de particuliers à particuliers comme
e-Bay ou PriceMinister (le CtoC : Consumer to Consumer).
1.2. CADRE THEORIQUE
Une théorie est la réunion d'un ensemble des
lois concernant un phénomène donné en un corps explicatif
global et synthétique selon Aktouf (2016).
Depuis un certain temps, il a été observé
plusieurs mutations de l'évolution qui ont pour conséquence
nombreux changements d'attitude du comportement des consommateurs LUSHOIS qui a
été conduit à devoir changées ses habitudes de
consommations pour satisfaire ses besoins. Pour notre part, il nous a
été demandé de faire une étude sur le
phénomène observé et nous avons eu à recourir
à quelques théories :
1.2.1. THEORIE SUR L'ASYMETRIE
D'INFORMATION
On parle d'asymétrie d'information lorsque certains
participants ne disposent pas les informations pertinentes que d'autres.
George Akerlof et le marché de
tacots
Akerlof publie The Market for "Lemons" en
1970, qui met en évidence une situation d'asymétrie d'information
sur un marché. Le marché étudié est celui de
Lemons, que l'on peut traduire par « tacots »
L'asymétrie d'information décrit en ce sens une
situation dans laquelle les acteurs d'un marché ne disposent pas des
mêmes informations sur les conditions d'échange. Cette situation
est par nature contraire au standard de transparence de l'information
prédominant dans un modèle de concurrence pure et parfaite.
Dans le marché de tacots, selon l'exemple des voitures
d'occasion développé par Akerlof, « le vendeur d'une
voiture d'occasion détient plus d'informations que les acheteurs
potentiels. Dans la mesure où ces derniers savent que le marché
comporte des voitures de mauvaise qualité, ils chercheront à les
payer au prix correspondant à la qualité moyenne, ce qui conduira
les propriétaires de voitures de bonne qualité à les
retirer du marché. En contribuant à réduire de proche en
proche la qualité moyenne des véhicules vendus, ce processus peut
finir par entraîner la disparition complète du marché des
voitures d'occasion.
Selon le modèle de Taylor (1974), vise
à modéliser la décision d'achat du consommateur. Sa
théorie part du principe que le marché étant libre, le
consommateur dispose de toute latitude pour opérer un choix parmi les
biens qui s'offrent à lui. Dans ce contexte, Taylor estime que le
problème central du consommateur est celui du choix. Dans la mesure
où le résultat de ce choix ne peut être connu que dans le
futur, cela implique que l'individu est dans l'obligation prendre certains
risques. Toute la question du comportement du consommateur se centre donc sur
les mécanismes qui contribuent à générer ou
à gérer cette anxiété. D'une manière
générale, Taylor considère que le comportement du
consommateur est tiraillé entre deux objectifs contradictoires.
Dans cette perspective, le consommateur utilise et
développe des stratégies de réduction du risque. Pour
Taylor, toutes les situations de choix comportent deux types de risques. Le
premier est le risque inhérent à l'incertitude du résultat
de la décision. Si l'individu achète un bien, il est toujours
possible que ce dernier ait un défaut qui rende sa consommation
impossible. Le second est lié à l'incertitude sur les
conséquences que peuvent entraîner le fait de faire une erreur
dans son choix.
1.2.2. THEORIE DE LA
RATIONNALITE LIMITEE (Herbert Simon 1983)
La rationalité limitée est un concept
utilité en sociologie, en psychologie, en micro-économie ou
encore en philosophie. Ce concept porte sur l'étude du comportement d'un
individu, appelé, ici, un acteur, face à un choix. Il suppose que
cet acteur a un comportement rational, mais que cette rationalité est
limitée en termes de capacité cognitive et d'informations
disponibles.
En d'autres termes, l'acteur est rationnel s'il
préfère B à C et C à D permettant de déduire
ainsi qu'il préfère A à D. Cependant, lors d'un choix
complexe, il cherche moins à étudier l'ensemble des
possibilités qu'à trouver une solution raisonnable.
La rationalité individuelle est limitée par les
habitudes et les réflexes, les valeurs, la perception du contexte des
objectifs à atteindre, l'étendue des connaissances ; son
comportement est induit par l'information. Il réagit, cependant, aux
stimuli informationnels.
Les principes de la théorie des décisions et de
la rationalité limitée sont :
- L'information n'est pas parfaite et tout individu ne peut
maitriser ni traiter la totalité de l'information même lorsqu'elle
est disponible,
- L'individu ne cherche pas à atteindre le choix
optimal, mais il se contentera des situations satisfaisantes ; la
satisfaction remplace donc maximisation et l'effort d'assouvissement s'oppose
à l'effort de maximisation.
Moyen + but + informations = comportement
Pour expliquer le processus rationnel conduisant à la
prise de décision, Herbert propose une suite logique basée sur le
mécanisme IMC qui signifie :
§ Intelligence (I) : Processus de réflexion
qui délimite le problème et situe les éléments et
facteurs à prendre en compte,
§ Modélisation (M) : Identification et
évaluation des résolutions alternatives envisageables,
§ Choix (C) : Sélection des solutions et
choix de première solution satisfaisante.
Cette théorie a été choisie et
insérée dans notre travaille car elle nous permet de comprendre
les limites qui bloque l'utilisation de e-commerce chez les consommateurs
LUSHOIS.
1.2.3. THEORIE DE MASLOW
(Abraham Maslow, 1943)
La théorie de Maslow est une théorie de la
motivation élaborée par le psychologue Abraham Maslow en 1943. Il
y donna en 1970 une conclusion complète dans son ouvrage motivation and
personality. L'auteur découvrit que les besoins s'inscrivaient dans le
cadre d'une hiérarchie et que tous les besoins étaient
continuellement présents, mais que certains se faisaient plus sentir que
d'autres à un moment donné. C'est donc une représentation
en catégories des besoins humains, par ordre de priorité. Pour
l'auteur, les êtres humains possèdent des multiples besoins qu'il
va catégoriser en 5 niveaux et il existe une priorité suivant
laquelle il faut répondre ces besoins. D'après la théorie
de Maslow, chaque motivation humaine est initiée dans le but de
répondre à au moins un des besoins fondamentaux qu'il
énonce dans sa théorie.
Figure 6 : Pyramide des
besoins de Maslow.
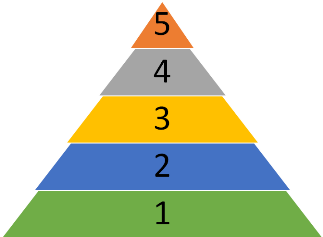
Source : nous-même
1. Besoins physiologiques
Les besoins physiologiques directement liés à la
survie de l'individu, ce sont typiquement des besoins concrets (manger, boire,
se vêtir, se reproduire, dormir...).
2. Besoins de sécurités
Les besoins de sécurité proviennent de
l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé
physiquement et moralement. Ce sont des besoins complexe dans la mesure
où ils recouvrent une part objective « notre
sécurité et celle de notre famille » et une part
subjective liée à nos craintes, nos peurs et nos anticipations
qu'elles soient rationnelles ou non
3. Besoins d'appartenance et d'affection
Ce sont les besoins d'appartenance à un groupe qu'il
soit social, relationnel ou statutaire. Le premier groupe d'appartenance d'une
personne est la famille.
4. Besoins d'estime
Les besoins d'estime correspondent aux besoins de
considérations, de réputation et de reconnaissance, de gloire. La
mesure d'estime peut aussi être liée aux gratifications
accordées à la personne.
5. Besoin de s'accomplir
Le besoin de s'accomplir correspond au besoin de se
réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel
dans tous les domaines de la vie.
1.2.4. THEORIE DE
L'APPRENTISSAGE SOCIAL (Bandura, 1969-1977)
La théorie de l'apprentissage social a
été développée par Albert Bandura (1969,1977).
Selon cet auteur, l'apprentissage social est un processus par lequel un
individu modèle son comportement en imitant celui des autres individus,
il s'agit d'un apprentissage par observation. En effet, l'individu augmente son
répertoire d'actions en voyant et/ou en entendant des individus adopter
un comportement donné. Pour les tenants de l'apprentissage social,
l'apprentissage incident (ça veut dire qui n'est pas soutenu par un
besoin qu'un individu cherche à satisfaire). En d'autres termes, le
comportement doit paraitre utile à l'individu qui l'imite.
Le processus d'apprentissage comporte quatre phases, à
savoir :
- L'attention
- La mémorisation
- La récupération en mémoire
- La reproduction
Ces phases sont celles au cours desquelles l'individu observe
des modèles en se focalisant sur les informations pertinentes, il les
enregistre ensuite dans sa mémoire, les récupère pour
enfin reproduire le comportement de son choix. Bandura montre cependant que,
tous les sujets n'exercent pas la même influence en tant que
modèle. L'auteur poursuit en disant que l'individu aura plutôt
tendance à reproduire les comportements qui conduisent à des
gratifications, et évitera d'aligner son comportement sur des
modèles qu'il juge éloignés de sa propre situation. Ainsi,
un consommateur qui adopte un produit qui plait à son entourage tire
satisfaction directe lorsqu'il reçoit des compliments positives. Par
ailleurs, cette théorie permet de mieux comprendre la naissance de
certains comportements chez certains individus.
CHAPITRE 2 : CADRE
EMPIRIQUE
Dans ce chapitre, nous présentons le champ empirique de
notre étude. Dans cette présentation il sera question de
l'historique d'EcoPo, de ses visions, mission, valeurs et objectifs ; de
la structure administrative et de l'organisation ; de la formation ;
des ressources financières et autres engagements et sélection.
2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET
HISTORIQUE
L'Ecole supérieure de la gouvernance Economique et
Politique, EcoPo en sigle est d'une manière provisoire au Collège
Imara. Situé sur l'avenue Mama Yemo, Quartier kiwele, Commune de
Lubumbashi ; province du Haut-Katanga en République
Démocratique du Congo.
L'EcoPo est une oeuvre des Salésiens de Don Bosco qui
organise des enseignements conformément aux normes internationales
connues sous l'application de « Système LMD
». Cela concerne aussi le déroulement des études,
le type de diplômes décernés et, avant tout, le niveau des
enseignements et des épreuves. Les diplômes sont reconnus au
niveau national, grâce à une convention signée avec
l'Université de Lubumbashi (UNILU) qui garantit l'équivalence des
diplômes.
Acte de création de l'EcoPo :
Un arrêté de fonctionnement du Ministère
de l'Enseignement supérieur et universitaire congolais, n°094
MINESU/CABMIN/MML/KOB/2011 est à l'origine à la création
de l'EcoPo. L'EcoPo-Lubumbashi, oeuvre de Don Bosco, a ouvert ses portes pour
la première fois le 4 octobre 2010, avec une promotion
expérimentale de 45 étudiants inscrits, après une
sélection, en Préparatoire au Master.
2.2 STRUCTURE ADMINISTRATIVE
EcoPo fonctionne encore avec une administration restreinte le
temps de finir de construire son campus propre et être dotée d'une
structure administrative complète. Ainsi EcoPo-Lubumbashi fonctionne
selon la structure suivante : Conseil d'Administration, Comité de
Gestion, Conseil de l'Etablissement, Conseil des Unités d'Enseignement
et Bureau de Coordination des Etudiants.
1. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'Administration est l'organe suprême de
conception, d'orientation, de décision et d'audit de l'école. Il
est composé de(du) :
· Représentant légal des oeuvres de Don
Bosco qui est d'office le Président du Conseil
· Vicaire provincial
· L'Econome provincial
· Représentant de chaque partenaire
Co-gestionnaire
· Directeur Général d'EcoPo
· Secrétaire Général
Académique
· L'Administration du budget.
2. CONSEIL DE L'ETABLISSEMENT
Le conseil de l'établissement est l'organe
d'orientation de la politique académique, administrative et
financière d'EcoPo. Il se réunit au moins une fois par mois
à la convocation du Directeur général qui en est
Président. Ce conseil comprend :
· Les Membres du Comité de gestion
· Le Directeur du Personnel
· Le Directeur des Finances
· Le Directeur des Affaires Académiques
· Les Responsables des unités d'enseignements
(UE)
· Un Représentant des enseignants
· Un Représentant des étudiants.
3. COMITE DE GESTION
Le comité de Gestion assure la gestion courante de
l'école sous la coordination du Directeur Général, et
à ce titre, il exécute les décisions des instances
légales de l'Enseignement supérieur et universitaire, du Conseil
d'Administration de l'ESU, du conseil d'Administration d'EcoPo, du Conseil de
l'établissement et prend toutes les mesures qui ne relèvent pas
de la compétence d'un autre organe. Le Comité de Gestion est
composé de :
· Directeur Général
· Secrétaire Général
Académique
· Secrétaire Général Administratif
· Administrateur des finances
· Attachée à l'Administration des
finances
· Responsable de la scolarité et de
l'Apparitorat
· Chargé de partenariat avec les entreprises et
des stages
4. CONSEIL DES UNITES D'ENSEIGNEMENT
Au stade actuel, l'EcoPo-Lubumbashi comprend deux cycles dont
le premier, la Licence et le second, le Master
qui compte quatre filières ; ces cycles sont
organisés et gérés comme des sections et il y a aussi de
formation continue. Le cycle de licence est ouvert à la faveur d'un
concours d'entrée, aux candidats diplômés d'Etat,
jugés après à suivre un cursus exigeant. Ce cycle est
sanctionné par un diplôme de Licence en Gestion des entreprises et
1(*)des Organisations ou en
Management commercial et Marketing. Le cycle de Master accueil les candidats
détenteurs d'une licence (système LMD) ou d'une licence
délivrée par les universités congolaises. Pour ce dernier
cycle, EcoPo propose quatre masters proportionnels qui sont :
- La Diversification et développement agroalimentaire
et Industriel.
- La Gestion des entreprises et Ingénierie
financière.
- La Gestion des Affaires publiques.
- Le Management Commercial et Marketing.
Le conseil est dirigé par un Coordonnateur de
cycle assisté par un Secrétaire, tous deux nommés et
relevés par le Directeur Général après avis du
Comité de Gestion.
5. BUREAU DE COORDINATION DES ETUDIANTS
(BCE)
Le BCE est une structure qui s'occupe de la vie estudiantine
de l'école. Son rôle est celui d'initier, d'organiser et de
réaliser des projets collectifs, des activités scientifiques,
culturelles, sportives et spirituelles susceptibles de contribuer à la
formation intégrale et à l'épanouissement des
étudiants de l'EcoPo, d'organiser l'intégration des nouveaux
étudiants (EWEDI). Bref de créer un espace d'échange
privilégié entre l'équipe de direction de l'EcoPo et les
étudiants, et entre les étudiants.
Le BCE est composé des départements
ci-après :
La coordination générale ; le
secrétariat général ; le département
d'étude des projets et publications ; le département de
sport et loisir ; le département de liturgie et chorale ; le
département de culture et art ; le département des relations
publiques, sensibilisation et communication ; le département du
social ; la trésorerie.
2.3. VISION, MISSION, VALEURS et
OBJECTIFS DE L'ECOPO
De par sa mission, EcoPo est une Ecole supérieure de la
Gouvernance Economique et Politique qui se définit comme une voie vers
la Voie de la sortie des crises qui affectent les organisations. Le
professeur Emmanuel Banywesize qui cite Edgar Morin « les voies
vers la voie sont corrélatives, interactives et interdépendantes.
La transformation des institutions politiques et économiques
nécessite une réforme de la pensée politique et
économique, laquelle suppose une réforme de la pensée
elle-même, qui suppose une réforme de l'éducation pour
former des cadres capables de relier, de globaliser, de contextualiser les
réalités auxquelles ils ont à faire et de contribuer
surtout à l'émergence d'une gouvernances économique,
politique et écologique, etc. »
EcoPo veut alors répondre aux besoins de la gouvernance
ressentie en RDC dans les trois sphères à savoir : celle de
la construction d'un Etat de droit, ensuite celle des affaires et du
renforcement des encadrements des entreprises et enfin celle des besoins
spécifiques du développement.
EcoPo s'est fixé comme stratégie compte tenu de
sa vision, sa mission, ses valeurs et objectifs ci-après :
1. La vision
La vision de l'EcoPo est celle de former une nouvelle
élite congolaise au Congo, apte à satisfaire les besoins
impérieux de gouvernance qui ne font qu'éclore dans plusieurs
secteurs du pays.
2. La mission
Comme dit ci-haut, EcoPo à la mission de former une
nouvelle élite congolaise au Congo, des cadres Supérieurs dont
les entreprises privées et publiques, et l'Administration ont besoin
pour la gestion efficace. Cette mission est d'assurer aux étudiants une
formation professionnelle de qualité dans le domaine de la gouvernance
des organisations, conduisant à une insertion professionnelle prompte et
sans ambages.
3. Les valeurs
La discipline, le travail et l'excellence demeurent les
valeurs fondamentales prônées à l'EcoPo. Ces valeurs sont
complétées par sept autres afin de lui permettre de gagner son
pari celui de mieux préparer les jeunes à affronter les
défis actuels et avenir. La formation à la compréhension
de ce qui change, de ce qui advient et les impératifs de gouvernance que
posent les changements. C'est ainsi que les étudiants sont conduits
à avoir une forte perception du bien et du mal, en vue de comprendre les
mutations du siècle présent et de bâtir leur avenir sur des
biens vertus immuables. Ces valeurs appelées DIX V pour
tous sont :
L'ambition, le travail, la discipline, la
responsabilité, la participation, l'intégrité, la justice,
le respect, la solidarité, la ponctualité.
2.4 FORMATION
Les formations proposées à l'EcoPo aux
étudiants sont constituées des cours qui se donnent en auditoire,
des visites en entreprises, des conférences et des stages en entreprise
suivant ce programme :
· Licence 1 (tous) : 21 cours repartis sur deux
semestres et un stage d'insertion professionnelle de 2 mois ;
· Licence 2 (tous) : 18 cours repartis sur deux
semestres et un stage d'insertion professionnelle de 2 mois
· Licence 3(tous) : 13 cours repartis sur deux
semestre ; un stage professionnel de 4 mois ; un mémoire de
Licence à rédiger ;
· Master 1 : 18 cours repartis sur deux
semestres ; un stage d'insertion professionnelle de 2 mois ;
· Master 2 : 15 repartis sur deux semestres ;
un stage professionnel de 4 mois ; un mémoire de master à
rédiger.
ü 1 crédit à l'EcoPo représente
15heures de cours ;
ü Les horaires sont repartis de lundi à vendredi
comme suit :
- Licences : de 8h00' à 16h00'
- Masters : de 17h00' à 21h00'
Et samedi de 8Hoo' à 12h00
ü En ce qui concerne l'évaluation, la moyenne de
note pour valider une année académique à l'EcoPo et passer
de promotion pour une matière d'une unité d'enseignement(UE) est
de 60%, c'est-à-dire que l'étudiant doit réaliser une
moyenne de 12/20 dans tous les cours.
2.5. RESSOURCE FINANCIERE
Fonctionner dans le système LMD nécessite la
mobilisation de grands moyens au regard des exigences que requiert ce
système. Pour ce faire EcoPo trouves ses ressources financières
principalement des partenaires et du minerval des étudiants. EcoPo est
une oeuvre qui reste ouverte, depuis le début, à toutes les
entreprises, les sociétés et les bonnes volontés,
résolues à contribuer à la formation de la jeunesse et des
cadres supérieurs aptes à relever les défis de la bonne
gouvernance économique et politique de la société
congolaise et des entreprises (voir site
www.ecopo.org). EcoPo organise le
payement de minerval de manière à permettre aux étudiants
de s'acquitter facilement de ce devoir. Le minerval est appliqué durant
toute l'année académique sans pour autant subir des ajustements.
Il inclut tous les frais académiques notamment les frais de productions
des notes ainsi que l'internet.
2.6 ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT
INTERNE : L'OUTIL SWOT
Voici la construction de la matrice SWOT de l'école de
la gouvernance Economique et Politique, EcoPo énumérant les
forces, faiblesses, opportunités et menaces de cette dernière.
Tableau 5 : Analyse
SWOT
|
FORCES
ü Réputation
ü Suivi individualisé
ü Diplôme
ü Accessibilité
ü Transparence dans la gestion des
côtes
|
FAIBLESSES
ü Carence des auditoires
ü Difficulté d'alimenter toutes les salles en cas
de coupure
ü Le manque d'un programme menant à un
diplôme doctoral
ü Manque de vie sur le campus
|
|
OPPORTUNITES
ü Employabilité élevée des
étudiants
ü Sur le plan international, le diplôme est
acceptable
|
MENACES
ü Concurrence institutionnelle
ü Baisse de motivation d'étude
ü Crise économique et financière
ü Crise sanitaire
|
CHAPITRE 3 : RESULTATS
D'ETUDE
Dans ce chapitre nous allons présenter les
résultats obtenus, puis suivra la discussion de ces résultats et
en fin les suggestions.
INTRODUCTION
Ce chapitre porte sur l'optique de connaitre les facteurs
explicatifs qui poussent les consommateurs à n'est pas adhérer au
e-commerce. C'est ainsi, que nous avons commencé par la
présentation de l'échantillon sur lequel repose la
réalisation de notre enquête par un questionnaire en ligne et la
production des données récoltées. Ensuite, l'analyse des
données et enfin, par les suggestions.
3.1. PRESENTATION DES DONNEES
3.2. ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Nous allons, dans ce point, présenter les
résultats obtenus au cours de notre enquête sur les 30
consommateurs. Sur les 30 consommateurs ciblés comme échantillon,
tous ont répondu correctement à l'ensemble du questionnaire en
ligne, et de cette manière, ils constituent l'échantillon
réel.
3.3.1. Présentation de
l'échantillon
L'échantillon de notre étude est de 30
étudiants
3.3.1.1. Répartition du genre des
enquêtés
Graphique 1 : Répartition des
enquêtés selon le genre
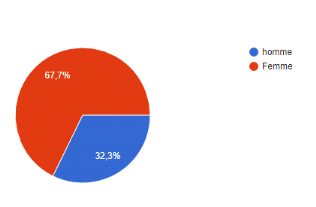
Commentaire :Nous pouvons remarquer par le
graphique ci-dessus que 67,7% des répondants sont des femmes, contre
32,3% des hommes, soit 20 femmes contre 10 hommes.
3.3.1.2. Répartition de l'âge des
enquêtés
Graphique 2 : Répartition des
répondants selon leur âge
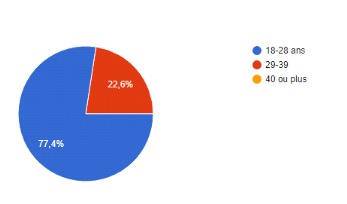
Commentaire : les personnes ainsi
échantillonnées ont principalement entre 18-28 ans et 29 et 39.
Ainsi, le premier groupe représente 77,4% des enquêtés,
contre 22,6% qui ont entre 29 et 39 ans.
3.3.1.3. Répartition de la promotion des
enquêtés
Graphique 3 : Répartition des
répondants selon leur promotion
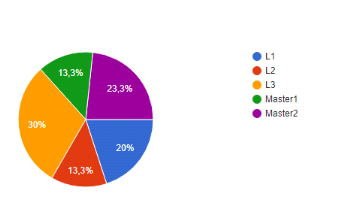
Commentaire :
Etant donné que notre public cible est composé
des étudiants, on remarque que la majorité est composée
des étudiants de Licence 3 (soit 30%), suivis de ceux de Master 2
(23,3%), les étudiants de Licence 2, Master 1 et Licence 2
représentent respectivement le 13,3% (pour Licence 1 et Master 1) et
20%.
3.3. Dépouillement des données de
l'enquête
Dans cette section, nous présentons les avis des
étudiants en fonction de leur réponse quant à la
fréquence d'utilisation du E-commerce et leur attitude.
3.3.1. Utilisation
du E-commerce
Graphique 4 : fréquence d'utilisation du
E-commerce
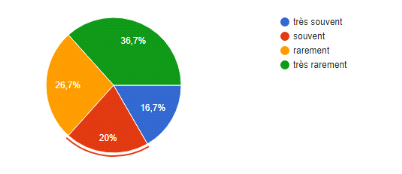
A cette question, une échelle de mesure a
été proposée à 4 niveaux : très
souvent, souvent, rarement, très rarement.
On peut remarquer ce qui suit :
· 36,7% des personnes interrogées admettent
utiliser le E-commerce très rarement
· 26,7% utilisent le E-commerce rarement
· 20% des personnes admettent l'utiliser souvent
· 16,7% des personnes admettent utiliser le E-commerce
très rarement
Ainsi, on peut remarquer qu'effectivement le E-commerce n'est
pas partie intégrante dans la vie des LUSHOIS (avec un total de 63,4%
qui utilisent rarement contre un total de 36,6%).
3.4.2 Attitude face au
E-commerce
Graphique : proportion sur l'attitude face au
E-commerce
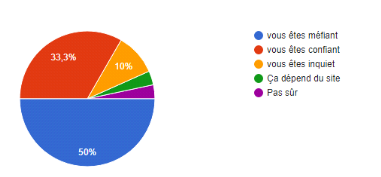
Sur cette question, quatre items ont été
proposés. On peut donc remarquer que :
· 50% des personnes enquêtées admettent
être méfiants
· 33,3% disent être confiants
· 10% admettent être inquiets
· 6,7% disent que cela dépend du site et ne sont
pas du tout sûr (à proportion équitable).
3.4. Résultats de l'estimation
Notre étude se base sur la recherche des facteurs
explicatifs du comportement des LUSHOIS. Les hypothèses de notre
recherche supposent : la motivation, la perception, l'apprentissage, la
culture et la classe sociale. Ces variables ont été
mesurées par des échelles qui vont de 1 à 5.
Tableau6 :
Modèle estimé

Source : résultats de
l'estimation sous EVIEWS
Sachant que nous avons un total de 30 personnes
échantillonnées. Ainsi :
· Pour ce qui est de la motivation, on peut remarquer un
coefficient estimé de 1,220241. La probabilité critique
associée de 0,0258 (inférieure à 5% de seuil) permet de
valider le coefficient obtenu. Ainsi, la motivation impacte significativement
sur le comportement des LUSHOIS face au E-commerce.
· Pour ce qui est de la perception, nous avons un
coefficient estimé de -1,624837. Cependant, la probabilité
critique associée de 0,139 (supérieure à 5%) permet de
rejeter le coefficient estimé. Ainsi la perception n'impacte pas sur le
comportement des LUSHOIS face au E-commerce
· Pour ce qui est de l'apprentissage, nous avons un
coefficient estimé de 1,169706. Cependant, avec une probabilité
critique de 0,0439 (inférieure à 5%), le coefficient obtenu est
statiquement significatif. Autrement dit, l'apprentissage impacte
significativement sur le comportement des LUSHOIS.
· Pour ce qui est de la culture, avec un coefficient de
0,128175 et une probabilité critique de 0,8149, le coefficient obtenu
n'est pas significatif
· Pour ce qui est de la classe sociale, avec un
coefficient de 0,614406 et une probabilité critique de 0,2074, le
coefficient obtenu n'est pas significatif.
En analysant le modèle globalement, on remarque ce qui
suit :
· Le R2 de McFadden de 0,409531 signifie que le
comportement des LUSHOIS est expliqué à 40,95% par les
différentes variables significatives trouvées
· La probabilité critique associée de 0,055
valide le modèle. Ainsi, 40,95% du comportement LUSHOIS dépend de
la motivation et de l'apprentissage
3.5. Signification pratique des résultats :
Ayant considéré que le comportement des LUSHOIS
face au E-commerce est influencé par la motivation, la perception,
l'apprentissage, la culture et la classe sociale, nous avons estimé un
modèle dont les résultats sont repris dans le tableau ci-dessus.
Ainsi nous obtenons un résultat selon lequel, la probabilité
d'utiliser le E-commerce fréquemment est expliquée, donc
conditionnée à 40% par la motivation qui pousse les LUSHOIS
à l'utiliser, mais aussi l'apprentissage, car en effet, la motivation
est corrélée à l'apprentissage.
3.6. DISCUSSION DES RESULTATS
Plusieurs études ont traité à ce jour de
la problématique de l'adhésion au E-commerce, et même du
comportement des consommateurs face à cette technologie.
Pour rappel, BOUCHRA JEGHAOUI (2010), trouve que
le commerce électronique marocain continue malgré les obstacles
précédents à gagner de plus en plus de terrain. Au vu des
données statistiques récentes notamment en termes de chiffre
d'affaires, il remarque que le commerce électronique connait une hausse
exponentielle particulièrement prometteuse pour les années
avenir. Par ailleurs, pour HAMZA ZINBI (2015), le comportement
vis-à-vis du commerce électronique est encore taché de
crainte et de méfiance à l'égard de celui-ci, pour ceux
qui ont franchi la ligne, ils considèrent comme étant la
complémentarité du commerce traditionnel et non comme un canal
d'achat à part entière. Enfin, pour ne citer qu'eux,AL
KITENGE (2020), montreque lecommerce électronique en RDC pose
deux problèmes : Le premier problème est celui de la
confiance. Tous les pays du monde ont déjà réglé ce
problème sauf la RDC. Simplement parce que nous n'anticipons pas les
choses. Le deuxième problème c'est le mécanisme de
paiement.
Ainsi, pour notre part, le comportement de consommateurs Lushois
face au e-commerce est expliqué, et ce à 40%, par la motivation
qui pousse les Lushois à l'utiliser, mais aussi l'apprentissage, car en
effet, la motivation est corrélée à l'apprentissage.
Pour ainsi dire, nous nous éloignons donc de la
littérature déjà existante, en apportant une pierre
à l'édifice du monde scientifique quant à la
problématique sur le E-commerce.
3.5. SUGGESTIONS
Nos recommandations sont principalement formulées vers
les entreprises de la Haute-Technologie (H-Tech) et les sociétés
de télécommunication. Ainsi, au vu des résultats
trouvés, nous pouvons leur recommander :
Ø De procéder à des campagnes de
mobilisation de la populationen vue de leur adhésion aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication,
Ø D'organiser des séances de formation
appropriées, dans le but d'inculquer à la population la culture
du commerce en ligne, et de tous les avantages y afférents.
Nous pouvons donc constater que ces recommandations vont dans
le sens d'accroître la motivation de la population quant à leur
adhésion au commerce en ligne, mais aussi l'apprentissage. Il y a en
effet une corrélation entre la motivation et l'apprentissage.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail qui a porté sur
le « comportement du consommateur Lushois face au
e-commerce pendant la période de Covid-19 »
Nous avons observé quependant la période de
Covid-19, les consommateurs lushois se voient adopter une nouvelle habitude,
étant donné qu'ils n'ont pas encore intégré la
pratique d'achat en ligne. Les consommateurs n'adhèrent pas à la
nouvelle technologie qui est le commerce électronique.
Voulant comprendre cela, nous avons procédé
à une pré-enquête à EcoPo auprès des
étudiants.
Dans l'objectif de justifier scientifiquement notre recherche,
nous avons parcouru des ouvrages et articles du domaine de marketing et de
psychologie.
C'est ainsi, après exploitation que nous avons formuler
notre question de départ comme suit :
« Pourquoi les LUSHOIS
n'adhèrent-ils pas à la nouvelle technologie qui est le commerce
en ligne (E-commerce) malgré le contexte de crise sanitaire
? »
Ainsi donc, sur base des théories sur la psychologie du
comportement du consommateur, nous formulons nos hypothèses de la
manière suivante : le comportement du consommateur LUSHOIS face au
e-commerce pendant la période de COVID-19 est caractérisée
par les aspects suivant :
H1 : La motivation
H2 : La perception
H3 : L'apprentissage
H4 : La culture
H5 : La classe sociale
Les résultats obtenus à l'issue de notre
analyse,les hypothèses énoncées ci-dessus confirment que
le comportement des LUSHOIS face au E-commerce pendant la période de
e-commerce est influencé par la motivation, la perception,
l'apprentissage, la culture et la classe sociale, nous avons estimé un
modèle dont les résultats sont repris dans le tableau ci-dessus.
Ainsi nous obtenons un résultat selon lequel, la probabilité
d'utiliser le E-commerce fréquemment est expliquée, donc
conditionnée à 40% par la motivation qui pousse les LUSHOIS
à l'utiliser, mais aussi l'apprentissage, car en effet, la motivation
est corrélée à l'apprentissage
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
1. Alain d'Astous, P. B. N. D. e. C. B., 2006.
comportement du consommateur. Montréal : France Vandal.
2. Gavard-Perret, M. G. D. H. C. J. A., 2012.
Méthodologie de la recherche: réussir son mémoire ou
sa thèse en science de gestion. paris : Pearson Education.
3. Grampp, L. Z. e. D. M., 2017. Impact de la
numérisation sur le comportement des clients dans le domaine du commerce
de détail en suisse. Le consommateur a l'ère numérique
.
4. Hammad, D. T. A.-A.-A., 2004-2005. le commerce
électronique, définitions-expériences-défis..
s.l.:s.n.
5. KUBWINAMA, G., 1978. Extension des marchés comme
condition de l'industrialisation de l'Afrique tropicale. Kinshasa: PUZ.
6. lendrevie LINDON, B. e. L., 2001. Mercator.
Dalloz: Dunod.
7. Pascal Sem Mbimbi, A. c., 2018. Méthodes de
recherche en science économiques et de gesti. Sarrebruck-Allemagne:
International book market .
8. philip kotler, k. k. e. D. M., 2000. Marketing
Management 14ieme édition. paris, France: Pearson.
MEMOIRES
1. NTAMBWE, E. K., 2012. La problématique dela
publicité et son impact sur le comportement du consommateur sur le
marché concurrentiel cas de miss Vodacom saison 1. s.l.:s.n.
2. ZHOU, W., 2019. Les motivations et freins des
consommateurs à vivre les étapes du parcours client en ligne
versus hors-ligne. trois-rivières: université de QUEBEC .
3. ZINBI, H., 2015. Le comportement du consommateur
marocain face au commerce électronique. s.l.:s.n.
4. barba, C. (2020). la fin du e-commerce ou
l'avénement du commerce connecté.
5. BOUAISSA, K. (2007). le commerce et la vague internet.
6. jeghaoui, b. (2010). e-commerce au maroc.
7. Merlière, Y. (2011). l'impact du commerce
électronique en matière de soldes et de promotions.
8. ZINBI, H. (2015). le comportement du consommateur marocain
face au commerce électroniqu
ARTICLES
1. Grampp, L. Z. e. D. M., 2017. Impact de la
numérisation sur le comportement des clients dans le domaine du commerce
de détail en suisse. Le consommateur a l'ère numérique
..
2. Mapon, M. P., 2020. Impact sanitaires et économiques
fu Covid-19 en République Démocratique du Congo. Etude
impacts Covid en RDC.
3. SH, H. J. C. L. P., 2020. Le marketing à
l'ère du Covid-19.
4. Mapon, M. P. (2020). Impact sanitaires et
économiques fu Covid-19 en République Démocratique du
Congo. Etude impacts Covid en RDC.
5. Al KITENGE. (2020), ce qu'il faut savoir du E-commerce en
RDC.
SITES INTERNET
1. Définitions marketing :
http ://www.definitions-marketing.com consulté le 20 mars 2021
2. http ://www.scholarvox.com consulté le 23 mars
2021
3. http ://www.freebook.com consultée le 23 mars
2021
4. http ://www.wikipedia.org/wiki/ «the market for
lemons » George Akerlof consultée le 28 mars 2021
5. http://
www.ecopo.org consulté
plusieurs fois
6.
http://www.memoireonline.com consulté plusieurs fois
7.
https://www.qualtrics.comconsulté plusieurs fois
ANNEXES
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
Mes dames et Messieurs je suis étudiante de L3 Management
commerciale et Marketing et je mène une recherche sur « le
comportement du consommateur Lushois face au e-commerce pendant la
période de Covid-19 »
Sexe :
o Homme
o Femme
Tranche d'âge :
o 18-28
o 29-39
o 40 ou plus
Promotion :
o L1
o L2
o L3
o Master1
o Master2
Connaissez-vous le "e-commerce" ou "commerce en ligne" ?
o Oui
o Non
Avez-vous déjà effectué un achat en
ligne?
o Oui
o Non
A quelle fréquence effectuez-vous un achat en ligne?
o Très souvent
o Souvent
o Rarement
o Très rarement
Quelle est votre attitude lorsque vous effectuez un achat en
ligne ?
o Vous êtes méfiant
o Vous êtes confiant
o Vous êtes inquiet
Dans l'e-commerce quel est le mode de paiement souhaitez-vous?
o Cash
o Paiement par carte
o Paiement par deux tranches (une avant la livraison et une autre
à la livraison)
Quelles sont les inconvénients du e-commerce ?
.........................................................................
.........................................................................
A quel niveau les facteurs ci-dessous influencent votre
comportement face au e-commerce
Motivation :
o Très fortement
o Fortement
o Moyennement
o Faiblement
o Très faiblement
Perception
o Très fortement
o Fortement
o Moyennement
o Faiblement
o Très faiblement
Apprentissage
o Très fortement
o Fortement
o Moyennement
o Faiblement
o Très faiblement
Culture/habitude
o Très fortement
o Fortement
o Moyennement
o Faiblement
o Très faiblement
Classe sociale
o Très fortement
o Fortement
o Moyennement
o Faiblement
o Très faiblement
ANNEXES
1. Résultat EVIEWS complet

* 1 Voir mot du Directeur
Général de l'EcoPo, le Pr. Emmanuel Banywesize lors de la
cérémonie d'ouverture de l'année académique
2013-2014, www.ecopo.org.
| 


