|
LES STRATEGIES CAMEROUNAISES DE GESTION DES CONFLITS EN
AFRIQUE CENTRALE : ENJEUX ET DEFIS.
Mémoire présenté et soutenu en vue
de l'obtention d'un Master II en Science Politique option : Institution,
Relations internationales et Etudes Stratégiques
Par :
Ghislain Marceau BANGA
Sous la direction de :
Eustache AKONO ATANGANE
Docteur en Science Politique
Chargé de cours à l'Université de
Yaoundé II
2015
AVERTISSEMENT
L'Université de Yaoundé II n'entend donner
ni approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire.
Elles doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
DEDICACES
AVERTISSEMENT
A mon père M. BANGA MFOULOU Enoch,
qui m'a imprégné du culte de l'effort et de la recherche de
l'excellence.
A ma mère Mme BANGA, née ASSENGONO
Bertille Prisca qui m'a appris la persévérance,
l'humilité et le partage.
A mon frère et à ma soeur Avenant
Carel MFOULOU et Audrey Marcelle MVOTTO, qui n'ont
jamais cessé de m'encourager.
REMERCIEMENTS
Pour ce mémoire, nous voulons remercier du fond
du coeur notre directeur, le Docteur Eustache AKONO ATANGANE, pour sa
disponibilité et sa patience dans le suivi de ce travail.
Nous voulons aussi remercier le corps enseignant du
département de Science Politique, pour la qualité de la formation
dont nous avons bénéficié.
Notre sollicitude va également à l'endroit
des Professeurs André AKAM AKAM et Gérard Martin PEKASSA NDAM,
qui nous ont fait comprendre la valeur du travail bien fait.
MM. Gérard ESSO EBENGUE, Isaac ILOUGA,
André Noel ESSIANE pour leur soutien multiforme, pour la bonne humeur
qu'ils nous ont toujours transmis chaque fois que nous étions à
leur côté.
Merci à la famille Véronique Carole ZAM,
pour l'encadrement et la chaleur familiale.
Enfin, qu'il nous soit permis de remercier ici
Mademoiselle Marvis AMBOMU EBITOH pour son soutien indéfectible. Merci
également à tous ceux dont nous n'avons pas cité les noms,
vous occupez une place particulière dans notre coeur.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
AAPS : Architecture Africaine de Paix et de
Sécurité
AFRICOM : Commandement Américain pour l'Afrique
AMISOM : Mission de l'Union Africaine en Somalie
BEMS : Brevet d'Etudes Militaire Supérieur
BGFT : Bureau de Gestion du Fret Terrestre
BIR : Brigade d'Intervention rapide
BLC : Base Logistique Continentale
BONUCA : Bureau d'appui des Nation Unies pour la
consolidation de la paix en Centrafrique
BSA : Bataillon Spécial Amphibie
BTA : Bataillon des Troupes Aéroportées
CAPED : Centre Africain d'études
stratégique pour la Promotion de la Paix et du Développement
CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale
CEEAC : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale
CGG : Commission du Golfe de Guinée
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale
CER : Communauté Economique Régionale
CESA : Centre d'Etudes Stratégiques de
l'Afrique
CICR : Comité International de la Croix Rouge
COPAX : Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Afrique Centrale
CPPJ : Centre de Perfectionnement à la Police
Judiciaire
CPS : Conseil de Paix et de Sécurité
CPTMO : Centre de Perfectionnement aux Techniques de
Maintien de l'Ordre
CREPS : Centre de Recherche d'Etudes Politiques et
Stratégiques
CSID : Cours Supérieur Interarmées de
Défense
DGSN : Délégation Générale
à la Sûreté Nationale
DOT : Défense Opérationnelle du
Territoire
DSR : Détermination du Statut de
Réfugié
EIFORCES : Ecole Internationale des Forces de
Sécurité
FAA : Force Africaine en Attente
FDC : Forces de Défense Camerounaise
FDP : Force Démocratique et Patriotique
FPAE : Fondation Paul ANGO ELA
FOMAC : Force Multinationale en Afrique Centrale
FOMUC : Force Multinationale en Centrafrique
HCR : Haut- Commissariat aux Réfugiés
IRIC : Institut des Relations Internationales du
Cameroun
MARAC : Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique
Centrale
MINATD : Ministère de l'Administration
Territoriale et de la Décentralisation
MINDEF : Ministère de la Défense
MINREX : Ministère des Relations
Extérieures
MINSANTE : Ministère de la Santé
MINUAD : Mission des Nations Unies Au Darfour
MINURCA : Mission des Nations Unies en République
Centrafrique
MINUSCA : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation
de la Centrafrique
MISCA : Mission Internationale de Soutien à la
Centrafrique
MSF : Médecin Sans Frontière
MUAS : Mission de l'Union Africaine au Soudan
OMAOC : Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre
OMI : Organisation Maritime Internationale
OMP : Opération de Maintien de la Paix
ONG : Organisations Non Gouvernementales
ONU : Organisation des Nations Unies
ONUCI : Organisation des Nations Unies en Côte
d'Ivoire
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PM : Premier Ministre
RCA : République Centrafricaine
RDC : République Démocratique du Congo
RECAMP : Renforcement des Capacités Africaines
pour le Maintien de la Paix
RMIA : Région Militaire Interarmées
SG : Secrétaire Général
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne
RESUME
La position géographique du Cameroun dans sa
sous-région, du fait de sa centralité, l'expose à de
nombreux problèmes sécuritaires. En effet, le Cameroun est
perçu comme un îlot de stabilité dans un
« océan » de turbulence. Le défi majeur pour
ce pays, c'est de préserver cette stabilité qui est
bousculée par la transnationalisation des menaces issues des conflits
qui « déchirent » les pays qui lui sont voisins.
Ainsi, quel est l'intérêt du Cameroun dans ses actions
menées en matière de gestion des conflits en Afrique centrale
CEEAC ? L'approche systémique fondée sur le raisonnement
stratégique des acteurs au sein d'une organisation, démontre
qu'ils ont des stratégies qui leurs sont propres. Cela nous permis de
percevoir qu'en effet, les actions de gestion des conflits du Cameroun au sein
de la CEEAC déterminent sa sécurité interne. Le Cameroun a
donc mis sur pieds un certain nombre de stratégies qui lui permettent de
gérer les conflits qui se déclarent en Afrique centrale CEEAC.
L'esprit de cette action est de déployer dans une dynamique qui vise
à assurer à l'extérieur, sa sécurité
interne. Mais les écueils sont importants, et ils sont d'autant plus
exacerbés à cause du souverainisme sécuritaire qui
caractérise les pays de la sous-région. En somme, le défi
sécuritaire auquel fait face la sous-région sera mieux
géré seulement si les Etats membres ont la réelle
volonté de collaboration, qui demande d'aller au-delà de l'ordre
Westphalien de la souveraineté.
ABSTRACT
Due to itscentrality in the sub-region, the geographical
position of Cameroonisexposed to numeroussecurityproblems. In
effectCameroonisperceived as an island of stability in an
« ocean » of turbulence. The major challenge
Cameroonface'sis to preservethisstabilitywhichisstrapped by
trans-nationalization of threatscomingfromconflictswhich
« destroys » itsneighboring countries. To thiseffectwhatis
the interest of Cameroon in its actions reached in the management of
conflictwithin Central Africa ECCAS ? The systemicapprochbased on
strategicreasoning of actorswithin an organization shows they have
particularstrategies. This enabled us to realizethat in effectCameroon's action
within ECCAS in the management of conflictsdeterminesitsinternalsecurity.
Cameroon has therefore put in place numerousstrategiesenablingher to manage
conflictsspringing in central Africa ECCAS. The spirit of these actions is to
deploy in a dynamicwhichaimsatensuringfromwithtoutitsinternalsecurity. But its
challenges are important ; they are more over exacerbedbecause of the
sovereigncharacter of securitywhichcharacterizes countries of the sub-region.
In sum the security challenges faced in the
sub-regionwillonlybeefficientlymanaged by member States if thereis a real sense
of collaboration whichdemandsgoingbeyond the Westphalianorder of
sovereignty.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE...............................................................1
PREMIERE PARTIE : La stratégie camerounaise de
gestion des conflits en Afrique centrale : entre logiques internes
d'intérêt national et dynamiques externes de recherche de la
paix...............................................................................................22
CHAPITRE 1ER : Le Cameroun dans la gestion des
conflits en Afrique centrale : analyse d'une posture
rationnelle................................................................................24
Section 1 : Entre la défense des
intérêts économiques et la gestion des
intérêts
politico-institutionnels.......................................................................................26
Section2 :L'attitude géostratégique du
Cameroun..........................................33
CHAPITRE 2: Le Cameroun dans la gestion des conflits en
Afrique centrale: une dynamique conjoncturelle sous régionale de
recherche de la paix........................................41
Section 1 : L'Afrique centrale comme zone
d'instabilité permanente et rémanente...43
Section 2 : La contribution du Cameroun aux efforts sous
régionaux de gestion des conflits en Afrique centrale : la
conjoncture au-dessus de l'intérêt
national ?...........................................................................................52
DEUXEME PARTIE : la stratégie camerounaise dans la
gestion des conflits en Afrique centrale : une adaptation actuelle aux
problématiques sécuritaires
contemporaines.................................................................................60
CHAPITRE 3 : Les dynamiques opérationnelles de la
participation du Cameroun dans la gestion des
conflits..................................................................................................61
Section 1 : Des missions de formation : entre mise
à disposition de structures de formation et participation aux exercices
conjoints............................................................62
Section 2 : ...À l'envoi des unités
constituées sur le théâtre des
opérations...............70
CHAPITRE 4 : Analyse des stratégies camerounaises
de gestion des conflits en Afrique
centrale..................................................................................................85
Section 1 : Examen des capacités camerounaises de
gestion des conflits en Afrique centrale
CEEAC..................................................................................................86
Section 2 : Perspectives de rationalisation et de
coordination avec les pays de la
sous-région....................................................................................................97
CONCLUSION
GENERALE......................................................................103
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES.........................................................106
LISTE DES
ANNEXES..............................................................................113
TABLE DES MATIERES.............................................................................122
INTRODUCTION GENERALE
A - PRESENTATION DU SUJET
Le thème de la conflictualité et de la gestion
des conflits enAfrique centralefascine et intéresse encore plus les
études de sciencepolitiqueaujourd'hui, à l'heure où il
règne dans cette sous-région une insécurité et une
instabilité accrues.
Depuis les indépendances jusqu'à nos jours,
l'Afrique a connu d'insoutenables atrocités liées aux
conflits1(*), un
phénomène récurrent dans cette partie du monde.
Les questions sécuritairesenAfrique centrale
commencent àse poser avecinsistance audébut des années 90,
années où la plupart des Etats de la sous-région sont
lancés dans un processus de démocratisation. Les conflits quiy
naissent et s'ydéroulent se voient aggraver par la combinaison de
plusieurs facteurs2(*) aussi
bien internes,qu'externes. Ainsi, la première initiative de
sécurisation de la sous- région est pensée avec la
création du Comité ConsultatifPermanent des Nations Unies sur les
questionsde sécurité, piloté par les Nations Unies. La
CEEAC est donc la première plate-forme de gestion des questions
sécuritaires3(*)enAfrique centrale.Néanmoins, les
récurrences conflictuelles dans cette partie du globe et
particulièrement la situation critique de la République
Centrafricaine des années 2000, vont nécessiter une gestion plus
rapprochée et plus efficace des conflits, donnant ainsi à la
CEMACune opportunité de s'affirmer, à travers la Force
Multinationale enAfrique Centrale(FOMAC). La CEEAC reprendra la direction des
opérations de sécurité grâce au transfert de
compétences entre elle et la CEMAC en 20084(*).
C'est dans le cadre de ces différents
mécanismes de l'Afrique centrale que le Cameroun se
déploie, dans le but de contribuer efficacement à la
gestion des conflits. Cela n'est pas toujours aisé dans un
contexte où le souverainisme sécuritaire règne en
maître absolu, toute chose qui a motivé une pareille
étude.
L'ambition de cette étude intitulée
« Les stratégies camerounaises de gestion des
conflits enAfrique centrale :enjeux et
défis »est d'analyser l'action du Cameroun dans
la gestion des conflits en Afrique Centrale,et à travers
cela,d'entrevoirquelles sont ses ambitions géostratégiques.
Il s'agit ici,decomprendrecomment le Cameroun s'implique,
et quels instruments mobilise-t-ilen ce quiconcerne la gestion des conflits
dans sa sous-région, au vu desa positiongéostratégique.Si
les conflits sont désignés comme le principal frein à
l'émergence économique et social de l'Afrique centrale, il va
sans dire que la problématique de la gestion de ces conflitsen son
sein5(*)s'impose pour le
Cameroun; surtout quand les conflitsgénérés dans les pays
voisins sont des conséquences néfastespour ses
intérêts nationaux.
Finalement, ce qui se joue pour le Cameroun à travers
sa politique de résolution des conflits enAfrique Centrale, c'est
l'établissement de la sécurité le long de ses
frontières. Etant entendu que les périodes conflictuelles sont
aussi des moments qui favorisent des flux importants de réfugiés,
il est aussi important de densifier le contrôle des mouvements de
bandes armées qui échappent le plus souventaux forces
militaires chargées de sécuriser les frontières. Au
regard de l'actualité conflictuelle dans certains paysvoisins du
Cameroun, et notammentlaRCA où il règne depuisquelques
années uneinstabilité chronique, le Cameroun est clairement
affecté d'une certaine façon. Si on associe à cela
l'insécurité transfrontalière qui se manifeste par la
montée en puissance du phénomène
«BokoHaram »6(*),et les exactions des « coupeurs de
route », on comprend pourquoi le Cameroun a modifié sa
carte sécuritaire .Il s'est posé pour le pays, la
nécessité d'agir à travers un appareillage
politico-institutionnel, diplomatique, voire militaire, support de
légalisation de son action dans la sphère conflictuelle de la
sous-régionAfrique Centrale.
B - INTERET DE L'ETUDE
Cette réflexion revêt un double
intérêt : un intérêt scientifique et un
intérêt pragmatico-politique.
L'intérêt scientifique de ce travail
réside dans le fait qu'il apporte une autre lecture de la
gestion des conflits en Afrique Centrale par le Cameroun, donc une
compréhension complémentaire à l'encadrement du
dispositif textuel sur le plan de sa responsabilité et de
l'étendue des interventions des acteurs étatiques en
matière de gestion des conflits.
L'intérêt pragmatico-politique, et même
stratégique de cette étude, repose sur le fait qu'elle
pourra permettre d'évaluer le dispositif sécuritaire
camerounais, mais surtout, son dispositif de prévention et de
gestion des conflits conformément aux engagements juridiques
internationaux y relatifs7(*). Scientifiquement, cette étude permet de
ressortir la portée des actions prises par le Cameroun sur les
questions de gestion des conflits, faire une relance du débat
à ce niveau ;sans invalider les travaux antérieurs
sur la question. Il s'agit donc de s'inscrire à la suite des
débats en cours, tout en y apportant notre vision de la
situation.
Les décideurs camerounais peuvent, s'ils le
jugent important, faire des ajustements sur le plan managérial,
en créant un nouvel agenda des politiques publiques de leurs
stratégies de gestion des conflits en Afrique centrale,
basé sur les analyses et recommandations émises dans le
cadre de ce travail.
Il est question ici de mettre en lumière les
dysfonctionnements des stratégies de gestion des conflits du
Cameroun en Afrique centrale, afin de mieux les viabiliser.
C - CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES
La recherche en sciences sociales et tout
particulièrement en science politique, pose le problème
fondamental de la maîtrise des concepts qui,
généralement donnent lieu à plusieurs
interprétations de la réalité sociale.
Les concepts sont des objets complexes, construits et
produits pour rendre compte d'une réalité. Pour
comprendre et expliquer le fondement de la recherche en science
politique, toute étude gagnerait avant d'être
engagée, de satisfaire à une exigence de clarification des
mots et vocables clés. Ceci permet une bonne lisibilité
ainsi qu'une bonne compréhension du sujet et de sa
thématique, opérationnalise les concepts, tout en fixant
par les différentes définitions qu'elle propose, le
lectorat sur le sens sous lequel lesdits concepts seront compris dans
le cadre d'un travail scientifique.
Ainsi, c'est dans un souci de limiter toutes
confusions, que la définition de chaque concept opératoire
s'impose à nous. Emile DURKHEIM ne soulignait-il pas
déjà que « la première démarche
du sociologue ( et de tout homme de science ) doit être de
définir les choses dont il traite, afin que l'on sache et
qu'il sache de quoi il est question? »8(*). Pour cet auteur en effet,
c'est la première et la plus indispensable condition de toute
vérification.
C'est pourquoi en accord avec ces quelques
prescriptions d'ordre méthodologique, nous avons jugé
nécessaire, voire indispensable, de clarifier les concepts de
« stratégie », de « gestion des
conflits », « l'Afrique centrale » mais aussi les
notions d'« enjeux » et de « défis »
.
1 - Le concept de
« stratégie »
Le Général français André
BEAUFRE9(*), pense que la
stratégie est la dialectique des volontés employant la
force pour résoudre un conflit.
Mais le dictionnaire des relations
internationales10(*),
présente la stratégie comme étant la partie de la
science militaire qui concerne la conduite générale de la
guerre et l'organisation de la défense d'un pays ;
opérations de grande envergure, élaboration des plans
offensifs et défensifs en fonction des effectifs, des moyens
logistiques, du potentiel industriel, des données
géographiques à grande échelle, des facteurs
diplomatiques, politiques, etc.
La question que pose la plupart des stratèges
militaires est : comment parvenir, au moindre coût et le
plus rapidement possible, à mettre hors de combat - ce qui ne
signifie pas nécessairement détruire - les forces
armées adverses ?
Il faut néanmoins dire que ce concept n'a pas
qu'une dimension politico-militaire. En réalité, on parle
de stratégie dans plusieurs autres domaines tels que
l'industrie, l'entreprise, la finance. On parle également de
stratégie électorale, industrielle, commerciale etc. Force
est donc de constater que la stratégie a subi à chaque
fois une adaptation en fonction des divers champs où l'on
l'utilise. Thierry DE MONTBRIAL quant à lui, définit la
stratégie comme« la science (si l'on choisit de
mettre l'accent sur le savoir et sur la méthode,) ou l'art
(si l'on privilégie l'expérience) de l'action humaine
finalisée, volontaire et difficile »11(*). On perçoit ici une
forte dimension politique qui renvoie à une
« ligne de conduite, c'est-à-dire un enchainement de
prises de positions et une séquence cohérente d'actions
et comportements »12(*), en vue de la réalisation d'un objectif
précis et déterminé.
Dans notre travail, nous allons considérer la
stratégie comme une manière d'organiser, ou de mener une
action pour arriver à un résultat probant.
2 - Le concept de« gestion des
conflits »
Les conflits, selon Thierry TARDY13(*), sont des oppositions
entre individus, groupes ou Etats sur des idées, valeurs, biens
matériels ou positions de pouvoir. « Le conflit
sous-entend l'idée d'interaction entre acteurs dont les positions
sont antagonistes et le changement dans leurs rapports de
force »14(*). C'est une « hostilité ou
lutte entre groupessociaux, entre Etats, n'allant pas jusqu'au conflit
armé et sanglant, que l'on oppose souvent à la guerre
politique militaire »15(*). Il n'implique pas par définition une
relation violente, mais sous-entend le plus souvent l'idée
d'intentions hostiles dont la traduction en action violente fait
partie des hypothèses d'évolution ou de sortie de
conflit. Ainsi, un conflit entre personnes, groupes sociaux ou parties
politiques peut être violent ou non. Le conflit peut être
appréhendé comme un état pathologique ou comme un
état de fait inhérent aux rapports sociaux, relevant de
processus et de décisions rationnels ou non16(*).
Ainsi donc,la gestion des conflits implique une
série d'actions visant au rétablissement d'une forme de
normalité. Thierry TARDY pense que « Dans son
acception contemporaine, c'est-à-dire telle
qu'appréhendée depuis la fin de la Guerre froide, la
gestion de crise et de conflit décrit l'ensemble des politiques
mises en oeuvre par un ou plusieurs acteurs externes à la
crise et visant à prévenir la crise, à traiter
une crise ou un conflit ouvert et ses conséquences, ou
à aider les Etats et sociétés touchés par
une crise ou un conflit à rétablir une situation de
normalité ou à consolider la paix après que le
conflit a cessé. »17(*)
La gestion de conflit est un ensemble
constitué de la prévention des conflits et la
médiation, le rétablissement, l'imposition et la
consolidation de la paix. Elle consiste non seulement à l'envoi
des émissaires avant, pendant et après un conflit ;
mais également à l'envoi des contingents constitués
pour une interposition ou une imposition de la paix. Ces contingents
peuvent aussi avoir des spécialistes ayant pour rôle, la
formation des militaires aux techniques de guerre et au respect du
droit de la guerre. Enfin il y a le volet de la prise en charge
des victimes et des réfugiés de guerre.
3 - Le concept d'« Afrique
centrale »
L'Afrique centrale est la région médiane de
ce continent qui va du Sud du Sahara à la vallée du
rift, en passant par l'est du bouclier ouest-africain. L'Afrique
centrale comprend les pays suivants : l'Angola, le Cameroun, le
Gabon, la Guinée équatoriale, la République
centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao
Tomé-et-Principe et le Tchad ; mais parler de l'Afrique
centrale revient également à parler des deux instances
communautaires qui s'y trouvent.
Le référent « Afrique
centrale » véhicule une ambiguïté certaine
due au fait que, dans cette sous-région, l'on retrouve deux
instances différentes qui prétendent représenter
l'identité sous régionale. Il s'agit en l'occurrence, de
la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale
(CEMAC) et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale (CEEAC).
Au-delà de la synonymie dans les
appellations, on note une confusion des missions que s'assignent ces
structures. Ainsi, la mission essentielle de la CEMAC est de
promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le
cadre d'une Union Economique et d'une Union Monétaire, tandis
que la CEEAC a pour objectif ultime d'établir un marché
commun aux Etats de l'Afrique centrale. On voit à
l'évidence que toutes les deux, ces organismes recherchent le
développement économique de la sous-région et
poursuivent des objectifs certes, diffèrent dans
l'énonciation, mais identiques dans le
fond »18(*).
Nous concentrerons notre étude à
la CEEAC, au sein de laquelle on peut noter une certaine
activité du Cameroun en matière de gestion des conflits
en Afrique centrale, et qui est le cadre adéquat défini
par le plan de Lagos de l'OUA en 1982. La CEMAC quant à
elle, ne comporte pas les mêmes particularités, et ne
saurait donc nous satisfaire dans le cadre de cette recherche.
4 - Le concept d'« enjeu »
Le dictionnaire Larousse définit l'enjeu
comme étant une somme d'argent,que l'on met en jeu en
commençant la partie et qui doit revenir au gagnant. C'est un
objet que l'on risque dans une partie de jeu ou encore ce que l'on
peut gagner ou perdre dans une entreprise19(*). Cette définition
donne déjà évidemment un bon aperçu du
concept, ce qui nous convient d'appréhender comme une
projection faite par un individu, inscrit dans un système de
jeu, dans lequel il mobilise un ensemble de ressources, des
opportunités et des avantages en vue d'obtenir des gains
matériels ou immatériels.
Dans cet ordre d'idée, la théorie des
jeux20(*) qui, elle se
décline en une trilogie structurée en trois tendances dont
la première porte sur le jeu à somme non nul ;
ici, les individus engagés dans le jeu s'inscrivent dans une
logique éminemment conflictuelle dans laquelle certains sont
appelés à gagner ou à perdre. La deuxième
est celle du jeu coopératif et non coopératif, où
on étudie la formation de coalitions entre les joueurs afin
d'obtenir de meilleurs résultats pour les membres et enfin le
jeu mixte, celui-ci implique plutôt aux logiques du marchandage,
voire de chantage. Pour ainsi dire, le concept d'enjeu renvoie
directement aux stratégies, aux planifications à
l'organisation et à la coordination par un acteur, d'un ensemble
d'actions en vue d'atteindre un objectif pertinent.
5 - Le concept de
« défi »
Un défi peut être
considéré comme étant une entreprise difficile, qui
met à l'épreuve les capacités ou les
compétences d'une personne ou d'un groupe de personnes dans un
domaine particulier. C'est un problème que pose une situation
et que l'on doit surmonter.
Il s'agit ici de montrer les difficultés
auxquelles le Cameroun fait face, quant à ce qui est de son
action en matière de rétablissement, d'imposition et de
consolidation de la paix.
D - DELIMITATION DU CHAMP D'ETUDE
Le présent travail sera
délimité dans une double dimension, à savoir :
la délimitation spatiale(1), et la
délimitation temporelle (2).
1 - Délimitation spatiale
Cette étude s'appesantira sur l'espace
géographique qu'est l'Afrique centrale, qui elle-même est
tout un concept. Ce concept peut être considéré
comme étant à « géométrie
variable »21(*), c'est dire que l'Afrique centrale n'a pas
d'objet géographique clairement identifié. Le concept est
variable selon les contextes, les auteurs et les époques. En
effet, l'Afrique centrale renferme en son sein, deux organisations
à savoir : la CEMAC, qui a un caractère plus
économique et la CEEAC qui, bien qu'ayant elle aussi une
certaine vocation économique, est une instance disposant d'un
organe spécialisé dans la promotion, le maintien et la
consolidation de la paix et de la sécurité22(*), d'où
l'intérêt que nous lui portons dans le cadre de ce
travail. La CEEAC se compose donc de onze Etats : l'Angola,
le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Congo
Démocratique,le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda,
Sao Tomé & Principe, et le Tchad. Tous ces pays couvrent
une superficie de 6 666 938Km², et une population de
134 119 063 d'habitants23(*). Avec ses diverses ressources naturelles,
l'Afrique centrale est un foyer de conflits (dus parfois aux convoitises
suscitées par ses multiples richesses) multiformes, allant des
crises de gouvernance aux crises frontalières, en passant par
celles dites sociales.
Notre intérêt pour cette zone de
l'Afrique tient également au fait que plusieurs mécanismes
de gestion des conflits y ont été mis sur pieds par
l'ONU, mais ont connu des résultats mitigés.
2 - Délimitation temporelle
Bien que les problèmes sécuritaires aient
commencé à se poser avec insistance dans les
années 1990, avec l'effondrement du bloc communiste, et la fin
de la guerre froide, nous allons nous intéresser à cette
période qui va de 1990 à 2014, mais en mettant une
emphase sur l'année2008.
Cet intérêt tient au fait que
l'année 2008 a été marquée par l'envoi par le
Cameroun, des contingents constitués en lieu et place
d'observateurs comme par le passé. En effet, « le
22 mai 2008, des unités constituées de l'armée
camerounaise prennent pour la première fois part à une
OMP en République Centrafricaine, dans le cadre de la Force
Multinationale de la CEMAC (FOMUC) »24(*). Il serait
intéressant de voir comment le Cameroun s'est
déployé dans le but de gérer non seulement cette
situation, mais aussi les différentes crises qui surviennent en
Afrique centrale.
Notre travail n'a pas pour but de faire une
compilation exhaustive des conflits et de leur gestion en Afrique
centrale, il ne se recoupe pas non plus aux seules Opérations
de Maintien de la Paix (OMP), mais porte plutôt sur un plan
plus globalisant qu' est la gestion des conflits dans toute sa
dimension par le Cameroun, avec les différentes étapes
qui la constitue. Il s'agit de voir en effet, comment le Cameroun
intervient dans la sous-région Afrique centrale, et si ces
interventions lui permettent d'atteindre ses objectifs de paix, de
sécurité et de préservation de ses
intérêts nationaux.
E - REVUE DE LA LITTERATURE
« Lorsqu'un chercheur entame un travail, il
est peu probable que le sujet n'ait jamais été
abordé par quelqu'un d'autre auparavant, au moins en partie ou
indirectement. On a souvent l'impression qu'il n'y a « rien
sur le sujet » mais cette opinion résulte
généralement d'une mauvaise information. Tout travail de
recherche s'inscrit dans un continuum et peut être situé
dans ou par rapport à des courants de pensée qui le
précèdent et l'influencent. Il est donc normal qu'un
chercheur prenne connaissance des travaux antérieurs qui portent
sur les objets comparables et qu'ils soient explicite sur ce qui se
rapproche et sur ce qui distingue son propre travail de ces courants
de pensée. »25(*)
La question de la gestion des conflits en
Afrique Centrale a suscité l'intérêt de nombreux
chercheurs, les étudiants et même les ONG ne sont pas
restées insensibles aux problèmes y relatifs. Aussi, la
littérature sur cette question est assez diversifiée.
Malheureusement, peu de publications évoquent l'action du
Cameroun dans ce domaine. Malgré cette carence, quelques travaux
ont retenu notre attention.
Ces travaux soulèvent des
thématiques fondamentales à la compréhension des
« mutations » en matière de gestion des
conflits en Afrique médiane. Chacun dans sa
spécificité adopte une approche particulière.
Dans le cadre de notre travail, nous avons
répertorié des travaux à la fois
généraux sur les opérations de maintien de la paix
(OMP) et d'autres sur l'action de l'armée camerounaise.
Ainsi, certaines productions ont retenu notre attention,
il s'agit notamment des travaux de Master II en stratégie,
défense, sécurité, gestion des conflits et des
catastrophes de ASSILA TSED. Les travaux de Master II en Relations
Internationales, option Diplomatie de AHOUDOU GARBA nous ont
également intéressé, tout comme ceux de EKINDI
NGWEN Manfred François et les travaux de MEVONO NGOMBA
Dieudonné Jules26(*)
Pour ASSILA TSED27(*), il s'est agit de donner les modalités
du déploiement militaire camerounais dans le processus
international de reconstruction de la paix au Soudan.
Il relève ainsi trois principales
difficultés liées à ce déploiement, et dues
à l'environnement : il s'agit des difficultés
conjoncturelles, politiques et logistiques qui entravent
considérablement ce type d'opérations pour les forces
armées camerounaises. ASSILA TSED pense que des
« aménagements structurels » s'imposent
au sein de l'armée, pour capitaliser de manière efficiente
toutes les ressources offertes par cette projection des forces
armées sur la scène internationale.
AHOUDOU GARBA28(*) quand à lui, pense que «
le Cameroun est un acteur mineur et inhabituel dans le champ des
opérations de maintien de la paix. Il mobilise la
théorie réaliste pour dire que les dynamiques
internationales ont forcément une influence sur la politique
interne, mais qu'il est important de toujours préserver sa
volonté de faire valoir ses intérêts. Pour lui, le
Cameroun doit revoir sa stratégie de moindre implication dans
les OMP, pour pouvoir tirer avantage des bénéfices
symboliques que confèrent l'implication dans le champ complexe
de celles-ci.
Notre intérêt s'est également
porté aux travaux de EKINDI NGWEN Manfred
François29(*),ce
dernier s'intéresse à l'action du Cameroun dans la
prévention des conflits en Afrique centrale. Il présente
ainsi la conférence des Chefs d'Etats tenue en février
1999 à Yaoundé au Cameroun, comme l'un des moments
majeurs liés à cette action. En effet, la
conférence de Yaoundé a été le cadre de
mise en place du Conseil de Paix et de sécurité en
Afrique centrale, en abrégé COPAX qui est un
« organe politico-militaire de la CEEAC en matière de
promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la
sécurité au niveau sous régional ».
C'est un travail qui, en ce qui est de la
participation du Cameroun dans la mise en place des mécanismes
de prévention des conflits, apporte certains
éclaircissements, mais un travail qui reste plus descriptif
qu'analytique. De plus, il ne s'intéresse pas aux
stratégies de gestion des conflits en Afrique centrale
déployées par le Cameroun.
Nous avons enfin porté notre attention
aux travaux de MEVONO NGOMBA Dieudonné Jules30(*). Il mobilise les
théories réalistes, l'interdépendance et le
constructivisme, pour présenter sa pensée. MEVONO postule
en effet que 2008 est une année charnière pour le
Cameroun, car le 22 mai 2008, l'armée camerounaise a
effectué pour la première fois, une opération de
maintien de la paix ; c'était en République
Centrafricaine. Pour lui, « en décidant d'engager
d'avantage son armée dans la recherche de la paix en zone
Afrique centrale, l'Etat camerounais a inscrit les fondements de son
action dans une logique qui oscille entre la préservation de
ses intérêts vitaux et la recherche d'une paix
durable »31(*).
De ce qui précède, il se
dégage deux principales tendances : d'abord ceux qui pensent
que l'action du Cameroun est minime, vu que c'est un acteur
inhabituel dans la construction de la paix. Ensuite il y a la frange
de ceux qui pensent que le Cameroun commence à s'impliquer de
façon plus importante.
Au lieu de se poser sur l'un de ces deux
courants, nous avons opté pour une approche différente.
En effet, les conflits entrainent plusieurs fluctuations et des
contraintes. Ces aspects sont pris en compte avant pendant et
après les conflits. Nous nous proposons de voir quelles
institutions interviennent, et comment elles le font. Cette gestion
est-elle bénéfique pour le Cameroun ?
Il est question d'inscrire la présente
étude dans une approche historique dont la finalité sera de
saisir dans le temps, les stratégies du Cameroun en matière de
gestion des conflits en zoneCEEAC. Cela nous permettra par la suite
d'évaluer la constance de ses interventions qui,routinisées,
permettrons probablement au final d'en arriver à la conclusion de
l'existence d'une véritable stratégie de gestion des conflits du
Cameroun en zone CEEAC.
F - cadre théorique de l'étude
La théorie est un corps de savoirs permettant
d'ancrer la recherche dans la suite de l'immense masse de ce qui
est déjà su. Ainsi, au plan théorique, la
nécessité d'intégrer notre travail dans le champ
d'investigation des relations internationales et du jeu de la
puissance, nous invite à convoquer les théories
réaliste(1), et
constructiviste(2).
1 - Le réalisme
Thomas HOBBES, et d'autres réalistes
comme lui considèrent la société internationale comme
une société anarchique, par opposition aux
sociétés nationales au sein desquelles il existe un
pouvoir organisé par l'Etat, garant de l'ordre et de la paix
sur la base du contrat social. L'impossibilité d'une telle
organisation sur la scène internationale entraine une situation
d'anarchie caractérisée par la méfiance entre les
Etats et le recours à l'usage de la force plutôt que la
confiance et le droit.
Le réalisme en terme
d'intérêt national, devrait nous permettre d'expliquer les
attentes et aspirations du Cameroun en Afrique centrale à
résoudre ou à gérer d'éventuels conflits qui
surviendraient dans la zone. D'ailleurs Yves LACOSTE32(*) dit, pour
interpréter les comportements des Etats sur la scène
internationale, que ces derniers sont en permanente rivalité,
cherchant à obtenir ou développer les moyens de la
puissance en contrôlant des territoires et les peuples qui les
détiennent. Par ailleurs, toute action de l'Etat s'inscrit dans
une logique permanente de survie, avec pour expression par excellence
dans le concept d'intérêt. « pris dans un
sens rationnel, il postule le calcul de l'investissement dans l'action
pour en apprécier la rentabilité attendue. Trop
coûteuse, il faut l'éviter, bénéficiaire, il
faut l'engager »33(*). Avec pour finalité, d'assoir sa
puissance face aux autres acteurs des relations internationales.
2 - Le constructivisme
Le constructivismeest employé dans cette
démarche pour l'analyse constructiviste des stratégies
camerounaises de gestion des conflits. Cette théorie aborde la
formation particulière d'analyse constructiviste
développée par l'école de Copenhague, qui
s'intéresse précisément à l'étude des
questions de sécurité.
Les auteurs tels que Emile DURKHEIM à
travers son explication des faits sociaux, Max WEBER et sa
compréhension des faits et la construction sociale de la
réalité de Peter BERGER et Thomas LUCKMANN, ont
certainement contribué à donner de la consistance au
constructivisme.
Emile DURKHEIM postule que l'explication d'un
fait doit être de nature sociologique. Selon lui, « la
cause déterminante d'un fait social doit être
recherchée parmi les faits sociaux antécédents, et
non parmi les états de la conscience
individuelle »34(*). La sociologie compréhensive de WEBER
permet d'avoir une autre conception de la réalité
sociale. Selon lui, une « activité est un
comportement humain ( peu importe qu'il s'agisse d'un acte
extérieur ou intime d'une omission ou d'une tolérance ),
quand et pour autant que l'agent ou les agents lui communiquent un
sens subjectif. Et par activité « sociale »,
l'activité qui, d'après son sens visé par l'agent
ou les agents, se rapporte au comportement d'autrui, par rapport
auquel s'oriente son déroulement »35(*). Peter BERGER et Thomas
LUCKMANN pensent que la réalité sociale est une
construction. Autrement dit, la réalité sociale n'est pas
exclusivement une donnée figée, elle peut aussi être
une construction.36(*)
Le constructivisme postule que les structures sociales
sont prioritairement déterminées par les idées que
partagent les agents plutôt que par les rapports matériels
existant entre eux. Ainsi, les intérêts et les
identités des acteurs sociaux ne sont pas des données
préalables aux interactions sociales et qui s'imposent une fois
pour toutes aux acteurs, mais ils sont construits par les
idées, normes, valeurs, connaissances, que ces derniers
partagent, par cette culture dans laquelle ils sont ancrés.
Qu'il soit moderne ou structuraliste, le constructivisme repose sur
quatre postulats : 1) les intérêts et les
motivations des Etats ne sont pas donnés mais constitués
par des identités, 2) les Etats agissent selon des
identités et donc des croyances ou des normes
« intersubjectives » car rationnelles, 3) la
signification de ces identités et de ces relations évolue
historiquement par la pratique et les discours, les interactions des
Etats, 4) enfin, la structure du système international influence
les comportements des Etats autant que ceux-ci sont capables
d'influencer la structure de leur environnement.37(*)
Les stratégies camerounaises de gestion des
conflits sont susceptibles de faire l'objet d'une construction, en
fonction des intérêts et de l'identité des acteurs
de la société dans laquelle se trouve le Cameroun.
G - La problématique et les
hypothèses
Il s'agit ici de présenter notre
problématique (1) et nos hypothèses de
travail (2) qui certainement, seront les matrices de
notre réflexion.
1 - La problématique
L'objectif visé par la présente
étude faut-il le rappeler, est de mettre en évidence
l'action du Cameroun dans les opérations de gestion des
conflits en Afrique centrale.A cet effet, il est judicieux pour nous d'avoir
pour point de départ, un questionnement qui nous permettra de
mener à bien notre démonstration.
Raymond QUIVY et Luc VAN CAMPENHOUDT perçoivent
la problématique comme étant «... l'approche
ou la perspective théorique que l'on décide d'adopter pour
traiter le problème posé par la question de
départ » 38(*). C'est
également « définir un objet et opter
pour un mode d'approche de cet objet, (...) c'est bien enfin le
cadre personnel à partir duquel se précise la question
de départ »39(*). Partageant ces préalables, tout en
gardant à l'esprit que la recherche ouvre la voie à la
théorisation, et que la théorie mène à la
science, les deux permettant d'identifier des connaissances nouvelles
et de mettre au point des outils de travail nouveau, nous tiendrons
compte de la pesanteur des problématiques existantes dans le
champ social de la gestion des conflits. L'observation de la
contribution du Cameroun permet d'être attentif sur les angles
d'approche de son action dans la mesure où la théorie
n'est pas un savoir fixe.
Si l'on peut « constater d'une part,
la multiplicité et la récurrence des conflitset des
situations conflictogènes et belligènes qui divisent
davantage les pays de la sous-région et, d'autre part une
diversité de projets (FOMUC, FOMAC) pilotés par des
initiatives différentes et concurrentes (CEMAC, CEEAC),
poursuivant certes le même objectif mais évoluant dans des
logiques différentes et parfois contradictoires40(*), il est intéressant
de savoir comment se comporte le Cameroun face aux questions de
gestion des conflits dans sa sous-région. Ainsi, la question
principale qui a retenu notre attention est celle de savoir :
quel est l'intérêt du Cameroun dans ses actions
menées en matière de gestion des conflits en Afrique
centrale CEEAC ?
Deux interrogations subsidiaires peuvent
également être soulignées à ce niveau. La
première question est celle de savoir si l'implication du
Cameroun est-elle construite dans le cadre d'une vision
stratégique, ou est-elle une adaptation conjoncturelle?la
seconde question est celle de savoir sile Cameroun dispose
des moyens adéquats pour s'impliquer efficacement dans la
gestion des conflits en Afrique centrale ?
Ces perspectives théoriques constituent les
axes d'interprétation du réel que nous avons choisis pour
la formulation de nos hypothèses de recherche.
2 - Les hypothèses de travail
Eléments fondamentaux de tout travail
scientifique, les hypothèses sont des tentatives de
réponses anticipées, aux questions théoriques ou
observations empiriques posées par la problématique.
D'ailleurs, à ce sujet, Raymond QUIVY et Luc VAN
CAMPENHOUDT41(*)
écrivent qu' « il n'est d'observation ou
d'expérimentation qui ne repose sur des
hypothèses ». Ils concluent qu'« une
hypothèse est une proposition provisoire, une
présomption qui demande à être
vérifiée ». Etant donnée qu'elle est
l'explication provisoire d'une réalité, l'hypothèse
prend naissance dans la problématique et, doit être
confirmée ou infirmée à la fin par les
résultats de l'étude, ce qui fait d'elle un outil de
sélection pour le chercheur car elle aide ce dernier à
choisir les faits, à les interpréter et à
suggérer les procédures de recherche.
L'hypothèse centrale autour de laquelle
s'aménage notre travail de recherche est quele Cameroun
s'engage dans la gestion des conflits pour la préservation de
ses intérêts nationaux et pour garantirla paix et la
sécurité sous régionale.
Les hypothèses secondaires retenus sont
les suivantes : les interventions du Cameroun
épousent bien une vision stratégique construite sur le
plan institutionnel. En outre, on pourrait dire que le
Cameroun, au vue de sa participation de plus en plus importante
dans le processus de gestion des conflits, dispose des moyens
nécessaires pour mener à bien sa politique d'intervention
en Afrique centrale.
H - METHODE ET TECHNIQUES D'ANALYSE
Toute entreprise de recherche scientifique, invite
toujours le chercheur à faire recours à des
méthodes et techniques, qui conviennent à l'étude
de son objet d'analyse.
Par définition, « La
méthodeest perçue comme l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à
atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre, les vérifie »42(*) ;c'est le
préalable à toute discipline scientifique. L'on ne saurait
parler de science sans méthode car, elle en constitue la
caractéristique fondamentale, l'essence qui clarifie la
démarche adoptée ou à adopter. Dans ce sens,
Gaston BACHELARD affirmait fort opportunément que
« la méthode est la politesse
élémentaire de l'esprit scientifique »43(*). Il s'agit au sens large
d'aider le chercheur à comprendre, non pas le résultat
de la recherche scientifique, mais le processus de la recherche
lui-même. Les considérations méthodologiques
comprennent à la foisle modèle
opératoire(1) et l'approche
méthodologique(2).
1 - Modèle opératoire
Pour rendre compte de notre objet
d'étude, nous avons utilisé la méthode
systémique. L'approche qui nous semble pertinente pour atteindre
nos objectifs est celle du raisonnement stratégique,
telle que présentée par Michel CROZIER et Erhard
FRIEDBERG. En effet, le Cameroun appartient à une organisation
qui est la CEEAC et, « les participants d'une
organisation peuvent être considérés comme des
acteurs ayant chacun leur propre stratégie (...) du point de
vue des objectifs que prétendent ou même que semblent
poursuivre ces acteurs, leur comportements peuvent paraître
irrationnels. Ils ne prennent de sens que si on relie aux chances
de gains et de pertes qu'ils avaient réellement dans le ou
les jeux qu'ils jouent les uns avec les autres. (...) Le
phénomène sociologique fondamental de l'intégration
des comportements du même ensemble social se trouve ainsi
analysé dans le cadre organisationnel comme un processus indirect
par lequel les acteurs se trouvent contraints, s'ils veulent gagner
ou au moins minimiser leurs pertes, d'adopter une
stratégie « gagnante », c'est à dire
rationnel pour eux de se plier aux exigences du jeu et qu'ils en
arrivent ainsi, quelles que soient leurs motivations de départ,
à concourir finalement aux buts communs »44(*). Il n'est donc pas exclu
que le Cameroun se comporte en acteur stratégique au sein de
la CEEAC.
2 - L'approche méthodologique
L'approche méthodologique comporte d'une part
les techniques de recherches (a) et d'autre part, les
techniques d'analyse des données (b) .
a - Les techniques de recherche
Dans le cadre de ce travail, nous avons opté
principalement pour la technique documentaire. Elle consiste
essentiellement à la recherche dans les bibliothèques et
sur internet. Ainsi, nous avons consulté un nombre important de
documents dans les bibliothèques de la fondation Paul ANGO ELA
(FPAE), du centre de recherche d'études politiques et
stratégiques (CREPS) à l'Université de
Yaoundé II, de l'Institut des Relations Internationales du
Cameroun (IRIC) et du centre africain d'études
stratégiques pour la promotion de la paix et du
développement (CAPED), toutes choses qui nous ont permis de
mener à bout cette recherche.
En plus de cette recherche documentaire, il faut
également dire que nous avons eu recours aux entretiens avec
des responsables de certaines structures, telles que le
Ministère des relations extérieures (MINREX), le
Ministère de l'administration territoriale et de la
décentralisation (MINATD), à travers la Direction de la
protection civile, et aussi les responsables du Ministère de la
défense (MINDEF).
2 - L'analyse des données
Dans cette phase, notre objectif est d'obtenir un
corpus d'informations qualitatives devant nous permettre de
vérifier la vraisemblance des explications théoriques que
nous avons énoncées. Une fois élaboré, ce
corpus d'informations doit comporter la liste détaillée
des faits et des référents concrets des explications
théoriques puisque c'est à travers leur correspondance que
nous allons confirmer nos hypothèses.
I - ANNONCE DU PLAN DE TRAVAIL
Partant des hypothèses de travail avancées
et en nous fondant sur l'analyse des données collectées,
notre raisonnement s'est bâti sur deux principales parties,
chacune articulée autour de deux axes. La première partie
consiste à montrer que la gestion des conflits en Afrique
centrale du Cameroun est motivée par la préservation de
ses intérêts nationaux (Chapitre 1) et que son action dans
cette gestion relève d'une dynamique conjoncturelle (Chapitre 2).La
deuxième partie quant à elle s'attèle à
montrer d'une part la recomposition des problématiques
sécuritaires et le redimensionnement de l'action du Cameroun dans
la gestion des conflits en Afrique centrale (Chapitre 3), et d'autre
part, elle fait une évaluation des capacités
camerounaises de gestion des conflits dans la sous-région
Afrique centrale (Chapitre 4).
Les deux grandes articulations sus mentionnées se
déclinent sous les formulations suivantes :
Première partie : La
stratégie camerounaise de gestion des conflits en Afrique
centrale : entre logiques internes d'intérêt national et
dynamiques externes de recherche de la paix.
Deuxième partie : La
stratégie Camerounaise dans la gestion des conflits en
Afrique centrale : une adaptation aux problématiques
sécuritaires contemporaines, entre potentialités et
insuffisances.
PREMIERE PARTIE :
LA STRATEGIE CAMEROUNAISE DE GESTION DES CONFLITS
EN AFRIQUE CENTRALE : ENTRE LOGIQUES INTERNES D'INTERET NATIONAL ET
DYNAMIQUES EXTERNES DE RECHERCHE DE LA PAIX
De 1990 jusqu'au début des années 2000,
un certain nombre d'initiatives allant dans le sens de la
construction de la paix ont été mises en oeuvre45(*). Il s'agissait
effectivement pour le système international, d'enrayer le cycle
de production de la violence, qui a été observé
avec le déclenchement des première et deuxième
guerre mondiale. Plus encore, les conflits sont devenus monnaie
courante dans différentes parties du monde, requérant
ainsi l'implication des organisations sous régionales à
l'instar de la CEEAC en Afrique centrale, et d'autres organisations
à travers le monde. Les Etats ont sans doute une forte
partition à jouer dans cette recherche de la paix et de la
sécurité, il va donc sans dire que chaque Etat a un
ensemble de stratégies de gestion des conflits qui lui sont
propres ; la sécurité étant d'abord individuelle
avant d'être collective.
Il est important de comprendre que « les
facteurs de risque, d'instabilité, de vulnérabilité
et les menaces qui pèsent dans un environnement, sont complexes
et interdépendants. Les menaces sapent la sécurité
à tous les niveaux. Sur le plan horizontal, elles touchent aux
domaines sociaux, politiques, économiques, environnementaux, et
ciblent une collectivité locale, une nation, une
communauté régionale ou mondiale. »46(*). Ainsi, il se pose la
nécessité de voir la posture du Cameroun dans la
gestion des conflits en Afrique centrale : analyse d'une posture
rationnelle (chap. 1) et la gestion de ces conflits
comme une dynamique conjoncturelle (chap. 2).
CHAPITRE I
LE CAMEROUN DANS LA GESTION DES CONFLITS EN AFRIQUE
CENTRALE : ANALYSE D'UNE POSTURE RATIONNELLE.
La posture rationnelle de l'Etat du Cameroun en
matière de gestion des conflits en Afrique centrale, se traduit
par une posture duale dans les interventions camerounaises. Cette
dualité est une vision globale qui associe les dimensions
internes et externes de la sécurité face aux menaces
sous régionales multiples. C'est ainsi que le dispositif
sécuritaire du Cameroun est passé d'une posture de garde,
à une posture d'avant-garde. Cette réactualisation a
été conceptualisée par Ernest Claude
MESSINGA47(*).
Le défi ici, est de pouvoir combiner de
manière satisfaisante, la politique de déploiement de
l'armée camerounaise sur le terrain des opérations de
maintien de la paix, mais aussi plus globalement, sa stratégie
de gestion des conflits en Afrique centrale et sa posture qui se
veut rationnelle pour bénéficier durablement des
retombées de ces interventions dans la sous-région.
Il s'agit donc d'une adaptation des stratégies
camerounaises qui visent le renforcement de la défense interne,
tout en projetant ses troupes dans la gestion des crises des pays
voisins, mettant ainsi en relief la dynamique d'enchevêtrement du
« dedans » et du
« dehors » sécuritaire ; le but
étant d'anticiper sur les menaces asymétriques qui
pourraient nuire aux intérêts économiques et
politico-institutionnels du Cameroun (Section 1) et déteindre sur
sa posture géostratégique (Section 2).
SECTION I : ENTRE DEFENSE DES INTERETS ECONOMIQUES
ETGESTION DES INTERETS POLITICO-INSTITUTIONNELS
Dans un contexte sous régional marqué par
plusieurs conflits et d'importants mouvements des populations, la
sécurisation des populations et de leurs biens ; la
sécurisation des investissements, la protection des institutions
étatiques s'imposent pour le Cameroun. Bien que résolument
engagé dans le processus de recherche, de construction et de
consolidation de la paix dans la sous-région, le Cameroun met
également un point d'honneur à la défense de ses
intérêts socio-économiques (A) et la défense
de son appareil politico-institutionnel (B).
A - LES INTERETS SOCIO-ECONOMIQUES
Les périodes de conflits dans un pays sont
toujours des moments d'importants flux de réfugiés dans
les pays voisins ;l'arrivée massive des réfugiés
dans n'importe quel pays implique toujours de grands changements sur
le plan socio-économique. Au Cameroun, le flux de
réfugiés est important depuis quelques années et
encore plus important depuis 2008. Rufin DIZAMBOU affirme que
« le Cameroun a hébergé selon le World
Refugee Survey 2008 du Comité Américain pour les
immigrants, près de 97400 réfugiés et demandeurs
d'asile, dont environ 49300 provenant de la République
Centrafricaine, 41600 du Tchad et plusieurs milliers du Nigéria,
du Rwanda, de la République Démocratique du Congo, du
Burundi, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du
Libéria et d'autres pays »48(*). Selon le rapport inter
agences sur la situation des réfugiés centrafricains en
date du 29 septembre au 05 octobre 2014, commandé par la
Direction de la protection civile, il a été
enregistré au Cameroun 132 650 nouveaux réfugiés
à partir de janvier 2014. Ce qui précède est
très souvent le début du bouleversement des données
démographiques, des compétitions et pressions
foncières, toutes choses qui sont de nature à
créer un climat d'insécurité notable non seulement
pour les personnes et les biens (1), mais aussi pour les
investissements économiques (2).
1 -La sécurité des personnes et des
biens
La notion de sécurité implique une
situation où il y a une absence relative de danger pour les
personnes ; leurs biens, et qui détermine la confiance.
Cette sécurité est le plus souvent la
responsabilité combinée de la Police Municipale, de la
Police Nationale, le Corps National des Sapeurs-Pompiers et de la
Gendarmerie Nationale, qui assurent la protection des personnes et des
biens en temps de paix. La sécurité des personnes est
donc globalement assurée par l'Etat et cela est rappelé
dans le préambule de la constitution camerounaise en ces
termes : « la liberté et la
sécurité sont garanties à chaque individu dans le
respect des droits d'autrui et de l'intérêt
supérieur de l'Etat ». Depuis plusieurs
années maintenant, l'insécurité dans les
différentes villes du Cameroun n'a pas laissé
indifférents les pouvoirs publics qui ont pris un certain
nombre de mesures pour la protection et la sécurisation des
personnes et des biens. Au compte de ces mesures ont peut noter le
renforcement de ce que Yves Patrick MBANGUE NKOMBA49(*) appelle le
redimensionnement de la Police de proximité, à travers la
création des unités spécialisées. Ce
redimensionnement est à l'origine de la note de service N°
00108 du 30 décembre 2004 du Délégué
Général à la Sûreté Nationale (DGSN)
Edgard Alain MEBE NGO'O, qui crée une Equipe
Spécialisée d'Intervention Rapide pour répondre
à la volonté politique de combattre et d'endiguer
l'insécurité. Les recompositions sociopolitiques des Etats
voisins au Cameroun sont de nature à impacter sur le cadre
sécuritaire du pays. Les déplacements massifs des
populations des Etats en crise vers le Cameroun est toujours un
moment de hausse importante de ce qui est convenu d'appeler
« la criminalité de subsistance », et
même d'autres types de criminalité tel que le
phénomène des coupeurs de route... La paupérisation
à laquelle sont soumises ces populations-là, est un
facteur de reconversion de celles-ci en de véritables
« hors la loi » qui menacent la
sécurité des personnes et des biens.
2 - La sécurisation des investissements
économiques
Dans sa politique nationale d'investissement, le
Gouvernement camerounais a fixé le cap de son
« émergence » à l'année
2035. C'est une vision qui implique de gros efforts pour être
bien menée de bout en bout ; et la sécurité
sur les sites de ces grands chantiers, une question
d'intérêt national. Il s'agit entre autre, des projets
hydroélectriques de Lom-Pangar ; Mekin ; Memve'ele, mais
aussi des projets tels que le port en eau profonde de Kribi, la
construction du pont sur le fleuve Wouri à Douala qui est le
garant d'une compétitivité économique, la centrale
à gaz naturel de Ndogpassi etc...
Outre cette vision de l'émergence en 2035 des
dirigeants camerounais, il y a la sécurisation des
échanges économiques entre le Cameroun et les pays
voisins qui est un véritable problème. En effet, le
Cameroun possède une façade maritime qui le place au
centre de l'économie de sa zone géographique d'Afrique
centrale, et lui donne par la même occasion un poids
économique majeur comparativement à la Centrafrique et au
Tchad. Un conflit sous régional durable serait de nature
à déstructurer l'activité économique sous
régionale qui est tributaire d'un réseau d'échanges
entre les différents Etats de la sous-région, et
notamment entre le Cameroun et la RCA ; mais aussi entre le
Cameroun et le Tchad. Le Transcamerounais est un corridor qui a
été construit pour desservir le Tchad et la RCA, en
leur offrant un accès à la mer à travers le port
de Douala. Ce corridor « part de N'Djamena (Tchad) ou
Bangui (Centrafrique) pour aboutir à Douala. Le corridor
comprend un itinéraire entièrement routier et un
itinéraire mixte route-fer. Voie ferrée entre Douala et
Belabo (pour la RCA) ou entre Douala-N'Gaoundéré (pour le
Tchad). Par ailleurs, un oléoduc d'une longueur de 1.070 km
(et d'un diamètre de 760mm) entièrement enterré, a
été construit pour transporter les produits
pétroliers extraits des champs pétrolifères du
bassin de Doba au sud du Tchad jusqu'à Kribi au
Cameroun »50(*). C'est un corridor qui montre l'importance des
échanges entre le Cameroun et ses voisins.
Il faut également dire que ces échanges
vont au-delà du simple passage portuaire. En effet, il existe
une importante activité transnationale commerciale qui peut
à tout moment subir un ralentissement et d'importantes pertes
économiques en cas d'instabilité. Tel a été
le cas lors de la crise politique survenue en RCA en mars 2013.
Selon le Bureau de Gestion du Fret Terrestre (BGFT), les pertes
mensuelles ont été estimées à près de
4 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le BGFT a annoncé
que cette instabilité a été néfaste pour le
commerce entre les deux pays, car elle a mis « [...] en
péril les 55 milliards de marchandises qui circulent chaque
année entre les deux pays, selon les statistiques de la douane
Camerounaise »51(*).De ce qui précède, force est de
remarquer qu'une instabilité sous régionale prolongée
et même passagère, a un impact sur le Cameroun, à
travers des pertes économiques directes.
B -LES INTERETS POLITICO-INSTITUTIONNELS
Le déficit sécuritaire, conduit parfois
à l'instabilité politique et institutionnelle des voisins
immédiats du Cameroun, c'est une véritable source
d'inquiétudes de contagion pour le pays. Il faut donc tenir
à distance le déficit sécuritaire qui est
susceptible de créer une fragilité politique, ce que P.
STEWART qualifie comme étant l'incapacité de
« fournir à sa population l'un des services
suivants qui lui incombent de manière naturelle : la
sécurité nationale, les institutions politiques
légitimes, le bien-être économique et
social »52(*). Faire face à cette fragilité
revient à revisiter la question des normes organisationnelles et
fonctionnelles (1) dans un premier temps, et dans un second temps
parler de la protection des institutions nationales (2).
1 - La question des normes organisationnelles et
fonctionnelles
L'autrichien Hans KELSEN, est l'un des
théoriciens du normativisme, ayant fait de la norme la base de
la relation sociale. Les normes sont ce qui donne un sens à
la volonté et aux idées. Elles servent de
baromètre aux déviances tout en permettant à toutes
les parties de se reconnaître dans ce qui est fait. La mise
en place, ou alors, la codification de l'institutionnalisation de
l'organisation se fait par le biais des normes organisationnelles qui
définissent et structurent les organisations en tant
qu'idée d'oeuvre dotée de moyens pour accomplir un
objectif ou un but spécifique. Les normes définissent et
désignent le compartimentage technique d'une idée comme la
préservation des intérêts nationaux. Elles attribuent
le rôle à chaque acteur et pérennisent de ce fait
le statut d'abord individuel, ensuite collectif au sein de
l'institution. C'est donc un défi énorme pour les
politiques et les diplomates qui doivent s'atteler au respect et au
bon fonctionnement des normes organisationnelles, qui sont la
matérialisation de la volonté de projection pour la
préservation des intérêts nationaux.
Les normes fonctionnelles
d'opérationnalisation, tout comme les normes organisationnelles
reflètent la volonté des acteurs de matérialiser une
solution face à un problème qui leur tient à
coeur. Les normes fonctionnelles accompagnent les normes
organisationnelles comme gage de faisabilité qui enlève
l'idée de la simple incantation à la
matérialité. Robert k. MERTON conceptualisait cela en
affirmant que « les fonctions seules donnent vie aux
structures »53(*). Le déficit des normes fonctionnelles
d'opérationnalisation au Cameroun, découle de la
déstructuration organique de l'idée de la
préservation des intérêts nationaux et notamment de
la question du leadership en Afrique centrale.
2 -la protection des institutions nationales
Les institutions sont l'ensemble des structures
fondamentales d'organisation sociale, telle qu'elles sont établies
par la loi ou la coutume dans un groupe humain. Plus
spécifiquement, l'institution peut se présenter sous la
forme d'une personne morale de droit public (Etat, Parlement), ou de
droit privé (association), ou d'un groupement non
personnalisé ou d'une fondation, ou d'un régime
légal54(*).
Lors de son discours prononcé à l'occasion
du 40ème anniversaire des Forces Armées
camerounaises, les 29, 30 et 31 mars 2000, le Président Paul
BIYA déclarait que « En effet, notre armée,
véritable ciment de notre unité nationale, a toujours
été et demeure le rempart de nos institutions et de
notre souveraineté »55(*). Ces propos consacrent l'armée comme
étant la principale force protectrice des institutions
nationales, tout ceci sous la conduite du Président de la
République. En effet, la loi N° 67/LF/9 du 12 juin 1967,
portant organisation générale de la défense stipule
en son article 6 que : « Le Président de la
République veille à la sécurité
intérieure et extérieure de l'Etat. Il définit la
politique de défense et pourvoie à sa mise en
oeuvre ». Par ailleurs, le décret N° 69/DF/61
du 21 février 1969 oblige les élèves de certaines
grandes écoles à la formation militaire ; l'article 2
de ce décret stipule que : « avant d'être
admis à effectuer leur stage d'admission à la fonction
publique fédérale, les jeunes gens diplômés
d'une faculté ou école donnant accès à la
catégorie A sont tenus, s'ils ne justifient pas d'un
diplôme, brevet ou certificat de préparation militaire,
à effectuer une période de service militaire de quatre
mois qui est pris en compte dans les durées du stage et des
services des intéressés ».
La politique de défense du Cameroun a
été mise sur pied, compte tenu de la
nécessité de défense du territoire camerounais. Mais
cette protection, pour être globale et complète, a besoin
de la participation des citoyens, de la nation toute entière.
C'est ainsi que la constitution camerounaise du 18 janvier 1996,
consacre dans son préambule tous les citoyens comme des acteurs
de la sécurité nationale. Il y est dit ceci :
« tous les citoyens contribuent à la défense
de la patrie » ; mais avant elle, le
préambule (partie - II Défense) du décret
N°75/700 du 6 novembre 1975 portant règlement de discipline
générale dans les Forces Armées disposait
déjà que : « la nation toute
entière participe à l'effort de défense en vue
de : dissuader tout agresseur éventuel, s'opposer par tous
les moyens, soit à l'invasion du territoire national
[...] ». Ainsi, le Cameroun à travers la
préservation de ses intérêts politico-institutionnels
et plus précisément le maintien de ses normes
organisationnelle et fonctionnelles et la protection de ses
institutions nationales, montre que la paix conditionne tout
développement.
Toute situation d'insécurité se
répercute indubitablement sur ses institutions. Cela a
été vu avec les attaques de certains édifices
publiques tels que les banques (Limbé), les postes de
gendarmerie (au Nord), et même la capture, l'enlèvement
des autorités par des malfrats (zone frontalière de
Bakassi). C'est sans doute ce qui justifie son attitude sur la
scène internationale, notamment son implication dans la gestion
des conflits en Afrique centrale.
SECTION II :L'ATTITUDE GEOSTRATEGIQUE DU
CAMEROUN
La zone bordière de l'Atlantique en Afrique
Centrale, selon Eustache AKONO ATANGANE56(*) se présente comme une superposition
d'aires géographiques à la fois composites et composantes
dont l'occupation territoriale et humaine se détermine par des
réalités stratégiques qui assignent à cette
sous-région une place géostratégique indéniable
en Afrique. Le maillage géopolitique, distribué de la
sorte, débouche sur un certain nombre d'ensembles dont le poids
stratégique fonde leurs comportements sur l'échiquier sous
régionale. Ainsi, Stéphane ROSIERE considère les
acteurs géopolitiques comme « toute entité qui
élabore des représentations territoriales, qui exprime ces
représentations, agit sur un territoire et entre en
compétition avec d'autres acteurs »57(*). Il est alors
intéressant de voir comment le Cameroun, en fonction de ses
intérêts sécuritaires peut passer d'une posture
à une autre dans le but de défendre ceux-ci.
L'attitude présentée plus haut n'est
pas une exclusivité camerounaise. En effet, Pascal BONIFACE
démontrait fort opportunément que le comportement d'une
entité est fonction de ses aspirations, mais surtout de son
environnement. Il dit d'ailleurs que plus loin de nous,
« Aristote estimait que l'environnement naturel avait un
impact sur le caractère humain des citoyens et sur les
nécessités militaires et économiques d'un Etat
idéal. Pour lui, le climat et le caractère national
étaient très liés,
l'hétérogénéité d'un territoire
nourrissait l'hétérogénéité parmi la
population et empêchait l'unité et la paix dans le
pays »58(*). Ce qui précède montre à
suffisance que l'attitude du déploiement du Cameroun sur la
scène continentale, qui adopte une attitude qui tend au
maintien de son statu quo sécuritaire (A) et éventuellement
à son changement ou à son bouleversement (B), n'est
qu'une logique des Etats lorsqu'ils se projettent sur la scène
internationale.
A - LE MAINTIEN DU STATU QUO
La locution "statu quo" est une abréviation
francisée de l'expression latine "in statu quo ante" qui
signifie dans la situation où cela était auparavant. Elle
sert à désigner une situation figée ou un
état d'immobilisme. Le statu quo est considéré
comme la référence légitime par rapport à
laquelle les performances d'autres options doivent être
calculées. L'aversion du risque et des pertes fait de tout
changement par rapport à la situation actuelle, un risque qu'il
n'est pas évident de prendre. En outre, le statu quo se
révèle moins impliquant qu'une prise de décision
qui fait courir le risque de l'erreur ou de l'échec59(*). Le maintien du statu quo
sécuritaire pour le Cameroun, lui est important pour la
préservation de ses intérêts sociaux et
économiques.
Les Etats dans leur politique extérieure, ont
pour objectif principal la défense des intérêts
nationaux. La notion d'intérêt national étant
difficile à cerner objectivement, elle donne une ouverture
à des compréhensions diverses. Ainsi, tous les Etats
cherchent à préserver un certain équilibre encore
appelé le « statu quo ». La position
géographique du Cameroun, qui se situe à la
croisée de deux grands ensembles régionaux : l'Afrique
de l'ouest et l'Afrique centrale est de nature à faire subir
au Cameroun les soubresauts des aléas sécuritaires de ses
voisins. En effet, le Cameroun est frontalier du Nigéria sur
2100 Km60(*), et il
désenclave également par son accès maritime deux
autres Etats voisins : le Tchad et la RCA. Les deux
paramètres cités plus hauts sont de nature à
compromettre la stabilité et la sécurité du
Cameroun, qui est souvent considéré comme un îlot
de paix dans l'océan conflictuel de l'Afrique centrale. Ainsi
le défi est clair, il s'agit pour le Cameroun de mettre sur
pieds des mécanismes visant à maintenir sa
sécurité (1) et sa stabilité (2), afin
d'éviter toute ingérence extérieure de la part
d'autres Etats.
1 - Le maintien de la sécurité
nationale
La sécurité nationale désigne
l'objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter
atteinte à la vie d'une nation. Il s'agit notamment d'assurer
la protection de la population, l'intégrité du territoire
et la permanence des institutions de la République.
En tant qu'outil militaire subordonné au pouvoir
politique, la mission de sécurisation du territoire est
dévolue à l'armée. Mais la sécurité ne
concerne pas seulement la défense militaire et les forces
armées, mais aussi toutes les administrations responsables de
grandes catégories de fonctions ou de ressources essentielles
à la vie du pays. Elles incluent notamment : ordre public
et sécurité civile, relations extérieures et
diplomatie, finance, matières premières, énergie,
alimentation et produits industriels, santé publique, transport
et télécommunications, travaux publics et
sécurité des systèmes d'information61(*).
La sécurité d'un Etat est d'abord interne,
et est assurée en premier lieu par la police et la
gendarmerie qui interviennent lorsque l'Etat fait face à des
troubles sociaux, à la criminalité, au terrorisme et
à l'instabilité politique. La gestion de la
sécurité est très souvent extravertie à cause
d'un certain nombre de phénomènes, notamment la
globalisation et la faillite de l'Etat qui sont de nature à
favoriser l'ingérence dans les affaires intérieures. Ces
deux phénomènes sont devenus pour moult Etats et
organisations internationales, des instruments de politique
extérieure62(*) ; ce qui fait du maintien de la
sécurité interne un enjeu des plus importants pour les
Etats. Assurer soit même le maintien de la sécurité
de son territoire, ne pas subir les interventions externes est un
pan de ce maintien, qui est indissociable de la stabilité (2),
la maîtrise parfaite des deux constituant pour un Etat comme
le Cameroun le maintien du statu quo sécuritaire.
2 - Le maintien de la stabilité
Le maintien de la stabilité participe d'une
action qui vise à « [...] la neutralisation
d'ambitions contradictoires »63(*). En effet, la stabilité désigne
le caractère de ce qui demeure dans le même état.
Il s'agit de la continuité, la fermeté, la
solidité, la constance et la permanence des institutions,
gouvernementale, ministérielle. L'éventualité d'une
menace extérieure serait de nature à bouleverser cet
équilibre, d'où la nécessité de contenir tout
débordement d'un conflit ou d'une situation conflictuelle hors
des frontières nationales. Dans une autre mesure, la
stabilité est aussi sociale. L'on sait que les périodes
de conflits sont des moments de grands mouvements des populations qui
fuient les affres de la violence provoquée par
l'instabilité. Les réfugiés qui viennent s'installer
dans le pays qui les accueilles sont appelés à partager
certaines ressources64(*)
avec les nationaux. Cette situation est de nature à
créer des heurts entre les communautés locales et les
communautés des réfugiés.
En somme, le maintien du statu quo
sécuritaire pour le Cameroun, vise à préserver la
sécurité nationale et la stabilité interne, en
mettant sur pieds des stratégies pouvant empêcher la
contamination, ou alors le débordement des conflits nés
dans les pays voisins. La posture rationnelle du Cameroun est ainsi
mise en exergue en matière de gestion des conflits en Afrique
centrale. Manifestement, il s'agit pour le Cameroun de préserver
sa paix et sa sécurité intérieures. Toutefois, la
récurrence des conflits dans la sous-région et notamment
chez ses voisins directs a conduit le Cameroun à un changement
et un bouleversement du statu quo (B), à travers deux importants
changements internes de son armée, à savoir : la
grande réforme des armées de 2001 et la nouvelle
orientation de la doctrine militaire camerounaise.
B - LE CHANGEMENT ET LE BOULEVERSEMENT DU STATU QUO
Sile statu quo est le maintien d'une situation
stratégique importante qu'on a pas intérêt à
voir changer, il peut toutefois advenir que la configuration des
forces en présence change et bascule en faveur d'un camp ou
d'un autre. Cet état de choses peut conduire soit à un
changement du statu quo, ou alors au bouleversement de celui-ci,
toutes les deux situations visant à se réajuster et se
réadapter aux nouvelles configurations. L'intérêt
national peut justifier la révision conséquente de la
position stratégique d'un Etat, que ce soit sur le plan
national ou sur le plan international.
La re-contextualisation au regard des mutations
survenues depuis la fin de la guerre froide, est une réponse
des autorités camerounaises visant à adapter les forces
armées camerounaises aux nouvelles formes de menaces. Cette
réadaptation passe nécessairement par une réforme de
l'armée (1) et par une réorientation de la doctrine
militaire camerounaise (2).
1 -La grande réforme des armées de
2001
La réforme des armées camerounaises de
2001 marque une rupture avec la pensée de l'armée
originelle. En effet, c'est à partir de cette année
qu'on parle véritablement de la modernisation et de la
professionnalisation de l'armée, ce qui se traduit à par
la recherche de la cohérence et la souplesse
organisationnelle ; la recherche de l'efficacité
opérationnelle par le souci du contrôle et du
renseignement du territoire et ses approches, ainsi qu'une
capacité de réaction rapide en cas de troubles ; la
professionnalisation et le rajeunissement ; la modernisation des
équipements.
Il est recherché à travers cette
réforme, une adéquation entre nouvelles formes de menaces
et une riposte conséquente et même une anticipation de
l'armée sur les menaces extérieures. Cette réforme
a vu le jour à travers le décret N° 2001/178 du
25 juillet 2001 portant organisation générale de la
défense et des Etats-Majors centraux. En son article
1er , le décret de 2001 stipule que les Forces de
Défense placées sous l'autorité du Ministère
chargé de la Défense comprennent : Les Forces de la
Gendarmerie Nationale ; les Forces de l'Armée de
Terre ; les Forces de l'Armée de l'Air ; les Forces
de la Marine Nationale.
L'un des changements majeurs de cette réforme
est que la Police Nationale devient une force civile sous
l'autorité de la Délégation Générale
à la Sûreté Nationale (DGSN) et le Corps National
des Sapeurs-Pompiers devient une formation militaire spécifique
de protection civile placée sous l'autorité du Ministre
de la Défense et mis à la disposition du Ministre de
l`Administration Territorial et de la Décentralisation.
L'armée de terre qui a pour mission d'assurer en tout temps,
en toutes circonstances et contre toutes formes d'agressions la
sécurité et l'intégrité du territoire
national ; le respect des accords internationaux ; des
traités et des agréments ; certains services
publiques ; la participation aux opérations humanitaires.
L'armée de Terre est désormais
composée de trois régions militaires interarmées et
dix secteurs constitués d'unités de combats, d'intervention
de soutien et spéciale de réserve. Il y a aussi le
renforcement structurel de l'Etat-major de l'Armée de
Terre ; la création du Bataillon d'Intervention Rapide
(BIR) ; la combinaison des Bataillons d'Infanteries
Motorisées et des Bataillons d'Intervention Rapide ; la mise
à jour des de l'artillerie des Bataillons dans les
régions ; la présence active des unités
spécialisées sur le terrain : le Bataillon
Spécial Amphibie (BSA) ; le 3ème BIR, le
Bataillon des Troupes Aéroportées (BTA).
L'armée de l'air a pour mission : la
surveillance, la protection et la défense de l'espace
aérien ; le soutien et l'appui aux autres forces de
défense ; la surveillance et la protection des installations
aéroportuaires en liaison avec le Ministère des
transports, est désormais structuré en trois sous-ensembles.
Ces sous-ensembles sont constitués de : Forces
aériennes composées d'escadrons, qui sont une importante
réserve en terme de puissance de feu ; les forces
terrestres de protection et de combat qui ont pour mission de
surveiller et de protéger les installations aériennes, les
points sensibles et de mener des opérations de type
commando ; les éléments de soutien et de formation
que sont les bases aériennes, les organismes logistiques et les
centres d'instruction qui contribuent activement aux missions de
l'armée de l'air.
La Marine Nationale a pour missions fondamentales :
la surveillance, la protection et la défense des espaces
maritimes nationaux, fluviaux et lacustres, des installations
essentielles à la vie de la Nation placées à
proximité immédiate du littoral ; la conduite de
l'action de l'Etat en mer, en liaison avec les autres
administrations ; le soutien des autres forces de défense.
La Gendarmerie Nationale quant à elle, participe
en temps de paix à l'élaboration du cadre de
Défense Opérationnelle du Territoire (DOT). En temps de
guerre, elle assure l'engagement de ses unités mobiles et
territoriales, l'exécution des missions de défense du
territoire nationale et la protection des points sensibles. En somme,
la Gendarmerie en temps de paix assure le maintien et le
rétablissement de l'ordre et en temps de guerre, elle reste
sur place pour assurer le fonctionnement des institutions, sans esprit
de trahison65(*).
La protection de l'intégrité territoriale
du Cameroun reste donc une priorité, et c'est ce qui justifie
les changements au sein de son armée, et le nouveau
déploiement observé. Compte tenu du fait que la partie
septentrionale est vaste et éloignée du centre de
décisions, cette nouvelle disposition de l'armée permet un
rapprochement entre le commandement et le théâtre des
opérations. L'objectif ici est d'apporter des réponses
adéquates et en temps réel, aux menaces qui se
présentent le grand Nord avec un quadrillage efficace du
territoire.
Une réforme aussi importante impose
nécessairement une doctrine militaire nouvelle, pour mieux
s'adapter aux nouvelles formes de menaces.
2 -la nouvelle orientation de la doctrine militaire
camerounaise
L'esprit et l'orientation de la doctrine de
l'armée camerounaise ont connu de grandes mutations depuis
l'indépendance du pays, jusqu'à nos jours. À
l'origine, l'armée camerounaise avait pour point d'encrage et
premier fondement « la paix et le
développement » aujourd'hui, cette doctrine tourne
autour du concept « armée et nation, ensemble pour
consolider la paix et le développement » dont
l'essentielle de la pensée a été exposé dans
le numéro spécial du Magazine des forces de
défense camerounaise de mai 2009.
Les idéaux de « paix »
et de « développement » restent
fortement encrées dans la doctrine militaire, sauf qu'il y a
désormais le souci d'associer réellement la nation
à ces deux idéaux. L'évolution s'est faite par
étape. L'armée est passée de la recherche de la
stabilité et de la sécurité de l'Etat, à la
modernité et à la sécurité globale, en
passant par l'opérationnalité et la citoyenneté de
celle-ci. Wullson MVOMO ELA66(*) explique que la première phase de la
doctrine militaire camerounaise, qui fut la recherche la
stabilité et de la sécurité de l'Etat, a eu cours
en 1960. La doctrine militaire camerounaise privilégiait
l'efficacité et la victoire militaire sur le théâtre
des opérations, en vue de la réalisation des objectifs
politiques à savoir : la paix, l'unité nationale et
le développement.
La deuxième phase de cette doctrine, au
début des années 1970, s'est manifestée par le
retour de l'armée à ses missions classiques de
défense nationale, tout en restant attentive à
l'évolution de la situation intérieure. En effet, les
défis de l'Etat en ce moment étaient principalement
centrés sur la paix, l'unité nationale à consolider
et le développement à construire. La troisième
phase de la doctrine militaire camerounaise se décline depuis
1990. Toujours selon MVOMO ELA67(*), la reconfiguration du monde et la
poussée de la démocratie libérale s'accompagnent
d'une mutation du paradigme sécuritaire, notamment
l'atténuation des risque de guerre totale et la montée
des menaces asymétriques et non conventionnelles. Dans cet
environnement, la doctrine militaire camerounaise est restée
encrée dans ses fondements premiers « la paix et
le développement ». Paix à l'intérieur
avec les soubresauts inhérents à l'apprentissage
démocratique, ensuite paix avec ses voisins et notamment le
Nigéria dans la résolution du conflit avec lequel le
Cameroun, respectueux du droit international, a mis sur pied une
stratégie permettant à la fois de circonscrire
l'occupation et de maintenir la dynamique opérationnelle à
un niveau lui permettant de peser sur le rapport de force
bilatéral et multilatéral sur la presqu'île de
Bakassi.
De ce qui précède, nous pouvons
dire que la stratégie du Cameroun en matière de gestion
des conflits en Afrique centrale obéit à une logique
rationnelle. Cela se traduit notamment par la priorité que le
pays accorde à la protection de ses intérêts
socio-économiques et politico-institutionnels. Toutefois, au vu du
caractère conflictuel de la zone Afrique centrale et tenant
compte du caractère « contagieux » des
conflits, le déploiement du Cameroun, force est de le constater
obéit à une dynamique conjoncturelle.
CHAPITRE II
LE CAMEROUN DANS LA GESTION DES CONFLITS EN AFRIQUE
CENTRALE : UNE DYNAMIQUE CONJONCTURELLE SOUS-REGIONALE DE RECHERCHE DE LA
PAIX
L'Afrique Centrale constitue un site de conflictualité
et ces conflits sont tels que leur gestion ne peut plus se faire par un seul
Etat. En effet, Les pays d'Afrique centrale ont souvent été
considérés comme les pays les plus bouleversés et les
plus touchés, à l'échelle du continent, par des conflits
et des crises internes profondes. Les guerres génocidaires au Rwanda et
au Burundi, la série de coups d'Etat et les tensions conflictuelles en
République du Congo-Brazzaville, ainsi que la guerre civile en
République démocratique du Congo, laquelle a
évolué, au fil des années, en conflit international, la
crise Centrafricaine, sont autant de manifestations qui mettent en
évidence les problèmes d'instabilité auxquels l'Afrique
centrale a été confrontée depuis la dernière
décennie.68(*) Au
regard de ce qui précède, la gestion de cette
conflictualité multiple ne peut être le seul fait des Etats
concernés mais relève beaucoup plus d'un effort de conjugaison
régionale des efforts au travers de l'intégration
régionale.69(*) Le
Cameroun fait partie de l'Afrique Centrale et la dynamique de
conflictualité mise en évidence plus haut ne lui échappe
pas.
Cette dynamique du dehors oblige le Cameroun à
être un acteur de la gestion des conflits en Afrique Centrale. Dans le
cadre de ce chapitre, il s'agit de montrer que la participation du Cameroun
à la gestion des conflits en Afrique Centrale relève d'une
conjoncture sécuritaire dont les impacts peuvent être
négatifs même pour les Etats qui ne sont pas en crise. La
participation du Cameroun à la gestion des conflits en Afrique Centrale
s'inscrit donc au-delà de l'intérêt national
(Section II) et procède du fait que cette zone
constitue un site de conflictualité (Section I).
SECTION I : L'AFRIQUE CENTRALE COMME ZONE DE
CONFLICTUALITE PERMANENTE ET REMANENTE
L'Afrique Centrale est une zone qui permet de témoigner
des dynamiques sociopolitiques à l'oeuvre sur le continent africain. Ces
dynamiques confirment de manière spectaculaire qu'au processus de
démocratisation de la fin des années 1980 et du début des
années 1990
succède
une dynamique de conflictualisation.70(*) Cette dynamique de conflictualisation appelle sans
doute un cadre institutionnel (B) de traitement en vue de
restaurer l'« ordre ».71(*) Seulement, pour comprendre l'action d'un tel cadre
institutionnel, il faut revenir sur les la géopolitique même de
cette conflictualité (A).
A- LA GEOPOLITIQUE DES CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE
Il s'agit de voir dans cette partie quelles sont les causes de
la conflictualité en Afrique Centrale (1), quels en
sont les principaux acteurs ainsi que leurs stratégies
(2).
1- Les causes de la conflictualité en Afrique
Centrale
Une tentative d'analyse des causes de la
conflictualité en Afrique Centrale commande de convoquer
l'enchevêtrement entre des causes structurelles et des
éléments conjoncturels, qui constituent de véritables
catalyseurs d'antagonisme.72(*)Au rang des causes structurelles, se classent la
question de l'héritage de la colonisation, notamment son impact sur la
distribution dupouvoir. On pourrait aussi y classer l'attention portée
aux différences ethniques comme mode démobilisation.73(*)
La colonisation a un lien avec les conflits en Afrique
Centrale en ce sens qu'elle a orienté la configuration actuelle des
sociétés politiques qui sont des anciennes colonies et cette
configuration n'est pas sans critique. En effet, le découpage de
l'Afrique résulte de l'impérialisme européen. Celui-ci est
une forme de domination qui passe par une division sociale et territoriale des
entités traditionnelles unies pour des raisons linguistiques, ethniques,
religieuses, géographiques, politiques et historiques.74(*)La modification de la
cartographie de l'Afrique qui s'accompagne d'un découpage
socio-territorial balkanisé est aujourd'hui à l'origine des
conflits frontaliers et sociaux constatés en Afrique et
particulièrement en Afrique Centrale. A l'observation, l'une des
caractéristiques communes des conflits en Afrique Centrale, c'est la
distance séparant la capitale du pays concerné du lieu de la
rébellion. Pratiquement toutes les rébellions prennent racine et
débutent dans les zones frontalières avec des pays voisins.
Cette constante est une conséquence de l'organisation territoriale des
pays africains héritée de la colonisation et donc de la
distribution du pouvoir. De fait, la construction des centres administratifs et
économiques s'est faite dans des zones stratégiques au
détriment de l'arrière-pays.75(*) Une telle construction, au fil du temps devient
source de division et de mécontentement, de la part de ceux qui se
sentent délaissés dans la gestion du pouvoir. C'est donc à
partir d'une telle dynamique que naissent et se construisent les antagonismes
qui finalement débouchent très souvent sur une escalade peu
maitrisable car, au fond, il y a des répercussions politiques que sont
des disparités en termes d'infrastructures, de développement et,
surtout, en termes de contrôlede l'Etat sur certaines
régions.76(*) De
plus, les sociétés politiques post coloniales en Afrique Centrale
sont loin de refléter l' « anima
collectiva »77(*) ou encore le « spirit of
community ».78(*) Autrement dit, les Etats d'Afrique Centrale sont loin
de remplir le préalable de la nation et quand bien même le
sentiment national est perceptible, il se trouve toujours plombé par le
poids des solidarités ethniques, couloir par excellence dans lequel
évoluent ces Etats.
La colonisation catalyse aussi les conflits en Afrique pour
une autre raison presque liée aux premiers développements. En
effet, au-delà de la territorialisation contestée issue de la
conférence de Berlin, il y a une logique de construction de l'Etat en
Afrique Centrale, qui n'est pas moins productrice de conflictualité.
C'est que, le modèle opératoire à partir duquel ces Etats
fonctionnent, trahit un système d'affection tribale.79(*) La conséquence d'une
telle situation c'est la consécration de l'ethnie comme site d'affection
et comme enjeux de mobilisation politique, non sans constituer un potentiel
facteur de crise. A ce sujet, il convient de rappeler que, s'ilest difficile de
nier que les tensions ethniques ou religieuses n'existaientpas avant les
conflits en Afrique, il faut tout de même reconnaitre que ces tensions en
elles même ne constituent pas l'élément déclencheur
du conflit mais c'est l'usage qu'on en fait en termes de mobilisation qui est
plus tôt dangereux.
L'agrégation de peuples distincts dans une même
entité « ethnique », comme la partition de certains
groupes en peuples distincts, sont les deux faces de la même
stratégie de contrôle et de domination des populations depuis la
période coloniale jusqu'à nos jours. Autant on peut observer des
rassemblements factices de nombreux peuples dans les mêmes
« champs de concentration » sémantiques et
territoriaux80(*), autant
des exemples illustrant la stratégie de dépècement des
groupes ne sont pas moins nombreux. En Afrique du Sud par exemple, la
Population Registration Act, promulguée en 1950 par le
gouvernement afrikaner répartit la population en deux grands
groupes : Les Blancs et les Noirs qui eux-mêmes sont divisés
en 9groupes ethniques : les Xhosas, les Zoulou, les Tswanas, etc. Les
groupes seront ensuite répartis, en fonction de leurs identités
ethnolinguistiques, dans des bantoustans ou homelands, prétendument en
vue de préserver et même de promouvoir le génie naturel et
culturel de chacun. Or non seulement certains groupes considérés
comme homogènes rassemblaient des peuples ayant des parlers
différents (les Xhosas), mais aussi d'autres groupes
considérés comme distincts ont des langues communes (les Nguni et
les Sotho). Les développements qui précèdent ne sont pas
anodins, ils ont plutôt pour but de mettre en lumière les usages
de la variable ethniques dans la production de la conflictualité en
Afrique Centrale. C'est que, l'appartenance ethnique ou religieuse
s'avère avant tout unoutil de mobilisation pour des mouvements rebelles
et des gouvernements contestés en quête de soutien
populaire.81(*)
Il faut aussi préciser que les éléments
d'analyses qui ont été évoqués plus haut
relèvent beaucoup plus d'une dimension structurelle de la
catégorie Afrique Centrale. Il existe aussi des éléments
d'analyses dit conjoncturels. En effet, la proximité entre provinces en
rébellion aux frontières renforcela probabilité d'une
alliance ad hoc entre les mouvements rebelles et les pays avoisinants82(*) même si cet aspect des
conflits africains est généralement sous-estimé.
Au-delà de cet aspect de la réalité, il y a que l'Afrique
Centrale représente un fort potentiel en termes de ressources
naturelles, ce qui forcément va conduire à des divisions
liées à la gestion et au partage des ressources. L'histoire des
liens entre ressources naturelles et conflits est du domaine de la longue
durée. Depuis des siècles, sociétés et Etats ont
utilisé certaines ressources naturelles afin de promouvoir leurs
intérêts et de poursuivre leurs objectifs politiques.83(*) Jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle par exemple, le bois a été d'une
importance primordiale pour les puissances navales. De nos jours, c'est le
pétrole qui fait la une des médias internationaux, aussi bien
comme élément indispensable à la politique des grandes
puissances que comme source de conflit. Il est question d'une véritable
géopolitique des conflits liés aux ressources
naturelles.84(*)Même
lorsque les gouvernements africains souhaitent mieux encadrer ou
réglementer les ressources naturelles de leur pays, ils n'en ont souvent
pas les moyens. C'est le cas de la Centrafrique ou encore de la
République Démocratique du Congo.
La tentative d'analyse des causes de la conflictualité
en Afrique Centrale ne saurait faire sens si parallèlement on ne
s'arrêtait pas sur les acteurs de ces conflits ainsi que leurs
stratégies, c'est à cela que s'attèle la suite de la
réflexion.
2. Acteurs et stratégies de la
conflictualité en Afrique Centrale
Si les acteurs des conflits peuvent être nombreux, leur
implication effective dans les conflits n'a pourtant pas le même niveau.
En recourant au schéma établi par L. Reychler, trois grands
groupes d'acteurs sont identifiables dans les conflits en Afrique
centrale : les parties primaires, secondaires et tertiaires.
Les acteurs primaires constituent en cercle qui rassemble les
parties «dont les intérêts dans la situation de conflit
sont contradictoires ou sont présentés comme contradictoires et
qui dépendent les unes des autres pour satisfaire leurs
intérêts». Ils sont directement concernés par les
conflits et leur engagement est partisan.85(*) Au rang de ces acteurs on a les États (les
régimes) touchés, les «groupes ethniques», les groupes
armés, les partis politiques ou d'autres «groupes», avec
notamment la part prise par la jeunesse.86(*) C'est le cas de la rébellion Selaka en
Centrafrique même de l'Etat Centrafricain.
Les acteurs dits secondaires rassemblent des parties qui ne
sont pas directement concernées par le conflit, mais ont un
intérêt direct dans une issue bien déterminée du
conflit et sont donc par là-même partisanes. Dans la
classification de REYCHLER, on distingue dans cette catégorie trois
types d'acteurs à savoir, les tiers qui observent avec
résignation et ne veulent pas être impliqués dans le
conflit, mais en subissent les conséquences négatives (exode des
réfugiés, interruptions des relations commerciales, contrecoups
des sanctions économiques internationales, etc.), c'est le cas de la
Centrafrique. Il y a aussi les tiers non intéressés, non
impliqués et qui désirent se maintenir à l'écart
(comportement de la partie la plus forte). En fin, il y a les tiers qui
s'impliquent activement dans la transformation constructive du conflit. Ce sont
donc des acteurs indirects, investis du rôle de «garde-fous» et
sont supposés se poser en général de manière neutre
en essayant de rétablir la paix par la médiation. On trouve dans
ce cercle: la «Communauté internationale» : l'O.N.U. et
ses différentes missions ainsi que ses organismes
spécialisés ; les O.N.G. des pays occidentaux.La
«Troïka» occidentale : les USA, la France et la Belgique
qui sont les «maîtres et bailleurs des fonds» des
États de la région. Leurs rôles financiers et
«techniques» les ont souvent obligés à
«s'interposer» ou à «s'impliquer»
d'une façon ou d'une autre lors des conflits. La Troïka et la
Communauté internationale, souvent confondues l'une avec l'autre par les
peuples africains parce que leurs missions respectives lors des guerres sont
maldéfinies ou se recoupent, sont les principaux acteurs de la
mondialisation des conflits grâce à leurs puissants moyens
médiatiques. Dans le contexte de la guerre froide, leurs implications
étaient nettement orientées et définies.87(*)
On le voit, l'Afrique Centrale constitue un site de
production de conflits, ces conflits mettent en scène plusieurs acteurs
et résultent aussi d'une variété de causes. A la
lumière de ce qui précède donc, il convient de voir quel
est le cadre de gestion des conflits en Afrique central.
B. LE CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE GESTION DES
CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE
La résolution et la gestion institutionnelles des
conflits en Afrique Centrale obéissent à un cadre dual qui
comprend aussi bien la CEEAC que la CEMAC. D'ailleurs la nature duale de ce
cadre montre clairement la complexité institutionnelle de
l'intégration régionale en Afrique Centrale. Dans le cadre cette
analyse, il s'agit d'étudier aussi bien les mécanismes au pan
normatif (1) mais aussi au plan institutionnel et opérationnel (2).
1. Les aspects normatifs du cadre de gestion des
conflits en Afrique Centrale.
La gestion des conflits en Afrique centrale ne relève
pas d'une autonomie ex-nihilo mais plutôt du principe de
subsidiarité sur la base du quel fonctionnent les organisations
régionales pour assurer la paix et la sécurité dans leurs
périmètres respectifs.88(*) C'est dire que le cadre de gestion des conflits en
Afrique Centrale procède d'un méso niveau d'autant plus que le
macro niveau se situe dans l'architecture de paix et de sécurité
de l'Union Africaine. L'Acte constitutif de l'Union Africaine fut adopté
lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement africains des 6 au 11
juillet 2000 au Togo. L'institution ainsi créée devait donc
s'inscrire dans la perspective du renforcement de la résolution des
conflits en Afrique.89(*)Prenant ainsi acte de l'incapacité de l'OUA
à proposer des solutions opérantes et crédibles pour
sortir le continent de l'insécurité et reconnaissant que le
fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle au
développement, les signataires du Traité
instituant l'UA ont placé les questions de la prévention, de la
résolution et de la gestion des conflits au coeur de leur projet de
renaissance politique africaine.90(*) Cette philosophie africaine de
la paix s'est donc traduite à travers un cadrage normatif incarné
par le Protocole relatif à la création du CPS, le 9 juillet 2002
à Durban. A partir de ce document, ont été établis
les principaux piliers de l'architecture de paix et de sécurité
africaine (APSA ou AAPS) appelée à constituer le nouveau cadre
dans lequel les crises vont être gérées sur le
continent.91(*)Aussi
peut-on y classer le Protocole d'accord de coopération entre l'UA et les
CER/Mécanismes régionaux, signé le 28 janvier 2008, qui
articule l'essentiel de l'APSA92(*).
Cette architecture constituée de quatre piliers
principaux: le CPS lui-même ; le Groupe des
sages; le Système Continental d'Alerte Rapide (SCAR); la Force Africaine
en Attente (FAA) - ou « pré
positionnée » (selon l'article 2, alinéa 2 du
protocole), se trouve complétée par les mandats et
activités des organisations sous-régionales (CER) reconnues pour
abriter les brigades constitutives de la FAA : CEDEAO, SADC, CEEAC, IGAD et
UMA. C'est à ce titre qu'il existe un cadre normatif de gestion des
conflits en Afrique centrale.
En effet, l'article 16, alinéas 1 et 3, du Protocole du
CPS traduit avec emphase les développements qui précèdent
en ce sens que « les mécanismes régionaux
[pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits
- le COPAX en Afrique centrale] font partie intégrante de
l'architecture de sécurité de l'Union (APSA en
l'occurrence) » d'une part ; et d'autre part,
«Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes régionaux
concernés doivent, à travers le Président de la
Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité pleinement et
régulièrement informé de leurs activités et
s'assurer que ces activités sont étroitement coordonnées
et harmonisées avec le Conseil de paix et de Sécurité
(...) ».
En outre, l'article 7 (j) du même texte conforte
la conviction, lui qui tend à indiquer la prééminence du
CPS sur le COPAX93(*) en ces termes : Le CPS « assure une
harmonisation et une coopération étroites entre les
mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien
de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Afrique». Le cadre normatif de gestion des conflits en Afrique
centrale repose donc sur le Pacte du 8 juillet 1996, « Pacte de
non-agression entre les Etats membres de la Commission Consultative des Nations
Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale »94(*) (UNSAC). Dans son préambule les Chefs
d'Etat de cet ensemble régional indiquent l'étroitesse de leurs
liens avec le Mécanisme du Caire, en ces termes
: « Considérant la déclaration (...) de la
vingt-neuvième session ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'Organisation de l'Unité Africaine, de juin 1993, portant
création au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine d'un
mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits en Afrique, (...) ». Et son article premier, les
mêmes Etats membres « (...) s'engagent à ne pas
recourir, dans leurs relations réciproques, à la menace ou
à l'emploi de la force, ou à l'agression (...), soit de toute
autre manière contraire (...) à la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine (...) ». A priori, cette disposition du
préambule est la première, parmi les textes endogènes
à l'Afrique centrale, à établir un lien entre un
instrument d'Afrique centrale voué à sa sécurité et
le mécanisme continental : le Pacte de non-agression de l'Afrique
centrale et le Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion
et le règlement des conflits en Afrique.
Le Protocole relatif au Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), adopté à
Malabo, le 24 février 2000, bien avant l'institution du CPS rentre
également dans le cadre normatif de la gestion des conflits en Afrique
Centrale. Ce texte constitue d'ailleurs le fondement juridique central du
Mécanisme d'Afrique centrale de prévention et de règlement
des conflits. Son association avec le Pacte de non- agression et le Pacte
d'assistance mutuelle constitue l'architecture juridique d'Afrique centrale en
matière de paix et de sécurité.
Au-delà des aspects normatifs du cadre de gestion des
conflits en Afrique Centrale, il existe aussi des aspects institutionnels et
opérationnels.
2. Les cadres institutionnels et opérationnels
de gestion des conflits en Afrique Centrale
Le raisonnement est le même que dans les
développements précédents dans la mesure où on est
toujours dans une logique qui consacre une imbrication entre tous les niveaux
micro (Afrique Centrale), méso (Union Africaine) et macro(ONU) de la
gestion institutionnelle des questions de paix et de sécurité, le
plus petit niveau devant respecter le niveau supérieur. Dans le cas
précis de nôtre étude, c'est le CEEAC qu'il convient
d'étudier.
Si la CEEAC a été créé le 18
octobre 1983 par les Etats-membres de l'Union Douanière des Etats de
l'Afrique Centrale (l'UDEAC) et les Etats-membres de la Communauté
Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) ainsi que Sao Tomé et
Principe. L'Angola a rejoint le groupe en 1999 après avoir
été observateur pendant 16 ans, et en fin 2007, le Rwanda a
définitivement quitté la communauté. En effet la CEEAC
avait à l'origine pour mandat la promotion du dialogue politique dans la
région, la création d'une union douanière ainsi que
l'établissement de politiques sectorielles communes. Seulement,
après avoir compris l'apport important d'un climat de
sécurité dans le processus de développement
économique, elle va introduire dans son champ d'intervention, les
questions sécuritaires. Ainsi, en Février 1999, lors de la
conférence au sommet du Comité Consultatif permanent pour les
questions de sécurité en Afrique centrale, les Etats membres ont
décidé de créer un mécanisme chargé de la
promotion, du maintien et de la consolidation de la paix et de la
sécurité en Afrique Centrale. Ce mécanisme baptisé
« Conseil de Paix et de Sécurité en Afrique
Centrale (COPAX) » verra le jour le 24 Février 2000 suite
à la ratification du protocole y relatif et aura la
responsabilité de développer des capacités de maintien de
la paix et de prévention des conflits en Afrique Centrale.
Le COPAX se compose
de trois organes techniques qui sont la FOMAC, Le CDS (commission pour la
défense et la sécurité) et le MARAC (mécanisme
d'alerte rapide en Afrique Centrale). Le MARAC est un mécanisme pour
l'observation, la surveillance et la prévention des crises et des
conflits qui sont l'objet de l'activité au sein de la CEEAC,95(*)Il est responsable de la collecte des données
et de leurs analyses afin de prévenir les conflits.96(*)Le CDS,
conformément à l'article 13 du protocole relatif au COPAX, est un
organe consultatif composé des chefs d'état-major des forces
armées ou de leurs représentants ; des chefs de polices ou
de leurs représentants ; des experts des ministères des
affaires étrangères en matière de relation
extérieure ; des experts des ministères de la défense
et des forces armées ; des experts des ministres de
l'intérieur et de la sécurité ; des experts d'autres
ministères invités en vue de l'ordre du jour de la commission. Quant à la FOMAC, c'est une force composée
de services interétatiques, de la police, des contingents de la
gendarmerie et des éléments civils des Etats membre de la CEEAC,
en vue de la réalisation de la paix, de la sécurité et de
l'assistance humanitaire. Mais la FOMAC peut aussi
recevoir des renforts d'unités civiles provenant des organisations non
gouvernementales et des associations agréées par le
secrétaire général de la CEEAC.97(*)
Elle a pour mission : L'observation et la surveillance; la restauration et
le maintien de la paix ; l'intervention humanitaire après une
catastrophe ; l'application des sanctions prévues par la
réglementation en vigueur le déploiement préventif ;
la consolidation de la paix, du désarmement et de la
démobilisation; les activités de police, y compris le
contrôle de la fraude et de la criminalité organisée ainsi
que toutes les autres actions à condition qu'elle soit mandatée
par la conférence des chefs d'Etats.
L'Afrique Centrale est un site de conflictualité
permanente et rémanente, ce qui a conduit à la mise sur pied d'un
cadre institutionnel et normatif de paix et de sécurité. Plus
que cette conflictualité permanente en Afrique Centrale relève
d'une conjoncture sécuritaire transnationale échappant à
la seule rationalité du Cameroun, quel est donc la contribution du
Cameroun à la mise en oeuvre de ce cadre.
SECTION II : LA CONTRIBUTION DU CAMEROUN AUX
EFFORTS SOUS REGIONAUX DE GESTION DES CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE : LA
CONJONCTURE AU DESSUS DE L'INTERET NATIONAL ?
La participation du Cameroun aux efforts sous régionaux
de gestion des conflits en Afrique Centrale relève d'un impératif
sécuritaire supranational (A) qui traduit les nouvelles dynamiques des
relations internationales sous (B).
A. LA PARTICIPATION DU CAMEROUN COMME IMPERATIF SECURITAIRE
SUPRANATIONAL
A partir du moment où le Cameroun ne vit pas en vase
clos au sein de la communauté des Etats de l'Afrique Centrale, il
devient difficile d'imaginer une action pour de simples raisons
d'intérêt national. Même si l'intérêt national
n'est pas à négliger, il ne faut non plus écarter le poids
des dynamiques sécuritaires extranationales sur l'action du Cameroun.
C'est que, le caractère régional des conflits en Afrique Central
transcende le cadre national et nécessite une réaction
concertée (1), ce qui permettra de consolider les capacités en
conjurant les faiblesses individuelles des Etats (2).
1. Des réponses régionales aux conflits
régionaux... : le Cameroun dans la spirale sécuritaire supra
Etatique.
Au Cameroun, au Gabon, en RCA et au Tchad, la stabilité
se voit surtout menacée par le fait que ces Etats ne sont pas
suffisamment capables de garantir la sécurité de leurs
populations. Ceci est entre autre à mettre en rapport avec la nouvelle
conception élargie de la sécurité. Face à l'ampleur
de certains défis ou à leur nature transnationale, l'Etat en
Afrique Centrale ne peut plus seul, répondre à l'ensemble des
besoins sécuritaires de ses ressortissants.98(*)Le régionalisme dans ce
cas se montre comme une approche adéquate pour parer aux menaces de
déstabilisation. Il se pose cependant le problème selon lequel
malgré leur relance dans les années 1990, les processus de
régionalisation n'ont toujours pas permis de dégager les
capacités nécessaires pour une approche efficace des défis
contemporains, d'où la nécessité pour tous les Etats de
participer à l'effort régional de construction d'un espace de
paix.
La décennie 1990, marquée par la chute du mur de
Berlin, et la fin de la guerre froide a donné lieu à un
reprofilage des engagements internationaux en vue du maintien ou de la
restauration de la paix et la sécurité sur les terrains instables
du continent. En effet, l'écroulement de la menace soviétique sur
les espaces d'influence des puissances occidentales en Afrique est allé
de pair avec la réduction drastique des interventions militaires
occidentales.
Le changement s'est ainsi opéré en donnant lieu
simultanément à une multiplication d'initiatives et
résolutions visant une plus grande responsabilisation des gouvernements
et armées africaines dans la gestion des crises sur le
Continent.99(*) C'est au
nom de cette responsabilité que les Etats d'Afrique Centrale, y compris
le Cameroun, doivent agir parce que la conjoncture s'impose à eux. De
nombreuses actions aux quelles le Cameroun a participé sont à
relever. Par exemple, afin de rendre opérationnels le COPAX et ses
organes, l'exercice multinational BARH-EL GAZEL auquel le Cameroun a
participé a été organisé au Tchad en novembre 2005.
D'autres exercices ont suivi depuis lors, rentrant dans le cadre de la
certification de la brigade sous régionale, en vue de
l'opérationnalisation de la force africaine en attente il s'agit de
l'exercice SAWAqui a eu lieu en 2006Douala (Cameroun) : manoeuvre
multinationale sous régionale, bien que s'inscrivant dans le cadre du
programme français RECAMP dont il constituait la cinquième
édition cet exercice.
Du 10 au 17 novembre 2007 à Moussoro au Tchad, a eu
lieu un exercice multinational interarmées de maintien de la paix auquel
ont participé les forces armées des pays de la CEEAC et du Togo,
invité par le Tchad, du nom de BARH-EL-GAZEL, cet exercice est venu
clôturer le cycle des manoeuvres militaires du même nom
commencées en 2005. Il visait à identifier les capacités
opérationnelles de la CEEAC et à évaluer la
capacité de maintien de la paix et d'assistance humanitaire des
commandements nationaux dans le cadre de la brigade régionale en
attente. Il devait permettre d'évaluer et de valider les
procédures opérationnelles ainsi que l'opérabilité
de la brigade régionale en attente. Cet exercice a constitué une
innovation quant à la capacité de mobilisation et de projection
des forces à brève échéance dans un cadre conjoint
interafricain. Il a mis en action une brigade légère de 1 600
hommes placés sous le commandement d'un état-major
intégré des Etats participants. Il a été l'occasion
pour la brigade de la CEEAC de se mettre en phase avec les autres brigades
régionales constituant la force africaine en attente.
En Angola, du 22 mai au 10 juin 2010, à l'instar des
autres manoeuvres d'envergure, a eu lieu l'exercice KWANZA qui s'inscrivait en
fin de phase d'opérationnalisation et de certification de la FOMAC, en
vue de sa participation aux missions de paix de la CEEAC ou de l'Union
africaine, voire des Nations Unies. Cette manoeuvre militaire conjointe qui a
rassemblé près de 4 000 hommes issus des trois unités
(terre, marine, air) et des policiers des pays de la CEEAC constituait la
dernière étape d'évaluation de la brigade sous
régionale avant la validation de la force continentale en attente qui
interviendra lors de l'exercice grandeur nature AMANI AFRICA.KWANZA 2010 a
été précédé d'un séminaire de cinq
jours, organisé en juillet 2009 à Yaoundé au Cameroun et
visant à simuler la prise de décision d'engagement de la FOMUC
dans une opération de paix.
2. ...À la conjuration des faiblesses
individuelles des Etats d'Afrique Centrale : agir collectivement pour
trouver une réponse à la crise de l'Etat
Pour Thierry TARDY100(*), en termes généraux, la crise est une
situation d'anomie provoquée par le changement. La notion de «
crise » s'oppose en principe à celle de «normalité
».
« Il ya dix ans, l'Etat était très
largement considéré comme un instrument destiné à
résoudre les problèmes ; aujourd'hui, nombreux sont ceux
pour qui le problème c'est l'Etat ».101(*) Ces propos constituent une
image représentative de l'idée que l'on se fait de l'Etat
aujourd'hui en Afrique Centrale, relativement à sa dimension
capacitaire. On est là dans l'expression d'une
statolitémolle102(*) Autrement dit, l'Etat aujourd'hui en Afrique
Centrale est malade car il n'arrive plus à assurer ses missions
régaliennes, traduisant ainsi un monopole désuet.103(*)Préciser de quel Etat
s'agit-il lorsqu'on évoque la crise de l'Etat, c'est évacuer tous
les biais méthodiques qui empêcheraient de mieux cerner le
réel étudié. Il s'agit en l'espèce de l'Etat
providence qui jouait les protecteurs dans tous les aspects de la vie sociale
et politique du territoire y afférent mais qui aujourd'hui n'arrive plus
à se poser de façon capacitaire comme le démontrent bon
nombre d'Etas en Afrique Centrale. Le détour que nous venons de faire
permet de saisir exactement à quel niveau peut-on percevoir la crise de
l'Etat. Il suffit alors de faire une petite équation simple en se
demandant quels sont les attributs à partir des quels l'Etat agit. Les
développements précédents permettent de répondre
que ces attributs sont la territorialité et la souveraineté dont
la somme pourrait correspondre à la statolité et s'il y a crise
de l'Etat, c'est simplement que les éléments constitutifs de la
statolité sont devenus inopérants et fragiles.104(*) C'est là même
tout le sens de la catégorie Etat fragile qui constitue un signifiant
pertinent de la statolité stérile et du monopole désuet.
L'Etat fragile renvoie à un type de pays faisant face à des
défis dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance
et de la provision de services de base à ses citoyens. Cette notion est
entrée dans levocabulaire de l'aide au développement
audébut des années 90 à l'époque où
lagouvernance se désintégrait en Somalie.
Desmilliers de gens ont été victimes de la
violenceet des millions sont morts de faim.Cependant, les politiques de
développementne s'intéressaient pas aux États fragiles.
Lespays donateurs dispensaient l'essentiel deleur aide à quelques pays,
en particulier àceux qui pratiquaient une bonnegouvernance.La situation
a radicalement changé aprèsl'attaque du World Trade Center
à New Yorkle 11 septembre 2001. Brusquement, les Étatsfragiles se
sont vu accorder la priorité dans lecalendrier du développement.
Avant cetévénement (connu désormais sous le nom de9/11),
être actif dans les États fragiles étaitsouvent
considéré comme un effort ingrat etune perte de ressources. Il
est clairaujourd'hui que les besoins dedéveloppement de certains
États fragiles nepeuvent être ignorés. Depuis 9/11,
denombreux donateurs ont élaboré desstratégies pour
travailler dans et avec cespays.105(*)
Le Comité d'Aide au Développement (CAD)de l'OCDE
considère qu'« un État est fragile lorsque le
gouvernementet les instances étatiques n'ontpas les moyens et/ou la
volonté politiqued'assurer la sécurité et la protection
descitoyens, de gérer efficacement les affairespubliques et de lutter
contre la pauvreté ausein de la population. »106(*) Face à une telle
situation, l'intégration régionale et sous régionale se
posent comme des cadres pertinents de conjuration de la fragilité et
tous les Etats y sont impliqués. C'est à ce titre que le Cameroun
agit dans la gestion des conflits en Afrique Centrale. Une telle action peut
constituer non plus une logique d'intérêt national mais un apport
dans la mutualisation des efforts visant à intervenir dans les Etas en
crise. C'est là le sens de la conjoncture sécuritaire qui
échappe au cadre limité de l'intérêt national. On
peut donc voir l'apport du constructivisme dans cette recherche dans la mesure
où il permet de saisir le rôle de du Cameron sous le prisme des
valeurs de paix qui sont partagées au plan sous régional et
régional.
Si la participation du Cameroun à la gestion des
conflits en Afrique Centrale relève d'un aspect conjoncturel de
recherche de la paix, cela ne tient pas seulement au fait qu'il y a un
impératif sécuritaire qui se situe au-delà de
l'intérêt national. Il y a aussi la traduction d'une nouvelle
dynamique des relations internationales.
B. L'EXPRESSION D'UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DES RELATIONS
INTERNATIONALES : LA REGIONALISATION DES INITIATIVES SECURITAIRES
L'expression de cette nouvelle dynamique des relations
internationales se traduit par le fait que la régionalisation constitue
aujourd'hui un site de dépassement des intérêts nationaux
(1) en même temps qu'elle produit de la stabilité politico
économique (2).
1. La régionalisation sécuritaire comme
moyen de dépassement des intérêts nationaux
L'intégration régionale est un
phénomène aujourd'hui répandue. Elle est « le
regroupement, plus ou moins formalisé au plan institutionnel, de
plusieurs Etats appartenant à une aire géographique
délimitée, à des fins de coopération
économique et/ou politique à long terme »107(*). Cependant, la
définition la plus évoquée par les théoriciens est
celle d'Ernest Haas, l'un des pères fondateurs des études sur
l'intégration européenne. Ce dernier définit
l'intégration non pas comme un état que l'on dira statique, mais
comme un « processus par lequel les acteurs politiques dans plusieurs
ensembles nationaux sont persuadés de modifier leurs loyautés,
leurs attentes et leurs activités politiques vers un nouveau centre,
dont les institutions possèdent ou demandent autorité sur les
Etats nationaux préexistants »108(*). C'est là le sens du
dépassement de l'intérêt national et dépassement est
d'autant plus nécessaire que le Cameroun agit en fonction d'un
repère axiologique qui communément partagé à
l'échelle sous régionale : c'est la recherche de la paix.
Pour le Cameroun, il n'est donc pas fatal que la régionalisation se
présente comme un site de dépassement des intérêts
nationaux car on est en face de processus positif permettant la constitution
d'une communauté de sécurité109(*), d'une
interdépendance économique accrue, d'une identité
partagée favorisant, dans une aire géographique
particulière, le développement d'actions collectives
institutionnalisées. Les actions collectives sécuritaires dans ce
sens peuvent donc justifier à partir du constructivisme, les raisons
conjoncturelles de la participation du Cameroun dans la gestion des conflits en
Afrique Centrale car, la notion de communauté de sécurité
est aujourd'hui au coeur d'un important programme de recherche
constructiviste.110(*)
Ce qui précède montre fort pertinemment que le dépassement
des intérêts nationaux pour la production d'un ordre
sécuritaire sous régional est une construction à laquelle
le Cameroun adhère fortement.
A partir de la construction d'un espace sécuritaire
au-delà de l'intérêt national, la régionalisation
sécuritaire peut aussi se présenter comme un tremplin de
stabilité politique et économique.
2. La régionalisation sécuritaire comme
moyen de production d'une stabilité politico économique.
La récurrence des crises politico-militaires reste un
défi majeur pour le continent africain dans son ensemble et la
région Afrique Centrale en particulier. Les efforts de
développement économique sont handicapés par l'existence
et ou les séquelles de multiples foyers de troubles sociopolitiques,
crises post électorales, mutineries, rebellions et autres guerres
civiles qui ont généré des pertes importantes en vies
humaines, un nombre élevé de personnes réfugiées ou
déplacées, des violations massives des droits humains et une
destruction à grande échelle des systèmes et moyens de
production. Tout ce qui précède est révélateur de
l'instabilité politique et économique111(*) et pour y remédier,
l'intégration régionale se pose comme un préalable dans la
mesure où elle obligerait tous les Etats de l'Afrique Centrale à
agir. La raison étant que l'insécurité de plus en plus
transnationale peut sévir dans Etat et avoir des répercussions
dans l'autre. L'exemple du Cameroun relativement à la crise
centrafricaine en est assez révélateur. Dans ce cas donc, le
Cameroun n'est pas porté à agir dans la gestion conflits en
Afrique Centrale pour la pure défense de ses intérêts mais
pour la construction d'un ordre politique stable profitant à toute la
sous-région.
Le développement peut être obtenu par l'union ou
la coopération accélérée. Ce qui signifie que
l'intégration régionale favorise la croissance économique
et le développement des États membres du fait qu'elle offre un
vaste marché et d'énormes possibilités
d'amélioration de productivité. On ne saurait donc atteindre un
tel état de croissance si les efforts pour la construction d'une
ingénierie politico-sécuritaire ne sont pas conjugués
entre les Etats d'Afrique centrale, toute chose que le Cameroun a
intégrée dans sa politique étrangère en Afrique
Centrale, agissant ainsi dans la résolution des conflits.
En définitive, notre but ici était de montrer
que la participation du Cameroun aux efforts sous régionaux de gestion
des conflits obéit bien à une logique rationnelle, mais aussi
qu'elle n'est pas seulement confinée à une logique
d'intérêt national. Elle peut aussi s'inscrire dans une dynamique
conjoncturelle de recherche de la paix au sein de la sous-région Afrique
Centrale. C'est dire que cette participation qui ne rentre pas totalement dans
le registre d'une statolité rationnelle est elle-même liée
à la nature conflictogène de l'Afrique Centrale. C'est que, cette
sous-région est un site de conflictualité permanente et
rémanente. Pour répondre à cette conflictualité
dont la géopolitique est assez révélatrice en termes
d'acteurs et de stratégies, des réponses normatives et
institutionnelles ont été imaginées et le Cameroun y joue
un grand rôle à travers sa participation aux exercices
opérationnels. Au-delà du fait que la sous-région
à laquelle appartient le Cameroun soit conflictogène, nous avons
pu montrer dans cette partie que, l'action du Cameroun dans la gestion des
conflits en Afrique Centrale relève au-delà de
l'intérêt national, d'une action collective. L'action collective
sécuritaire permet de s'inscrire dans les nouvelles dynamiques des
relations internationales qui posent l'intégration régionale
comme catégorie analytique et opérationnelle pertinente d'autant
plus que c'est par là que peut passer la stabilité et la
croissance économique.
DEUXIEME PARTIE
LA STRATEGIE CAMEROUNAISE DANS LA GESTION DES CONFLITS
EN AFRIQUE CENTRALE : UNE ADAPTATION ACTUELLE AUX PROBLEMATIQUES
SECURITAIRES CONTEMPORAINES.
Dans cette deuxième partie, il s'agira de
présenter dans un premier chapitre (chapitre 3), comment le Cameroun se
déploie pour être présent dans la gestion des conflits,
à travers des missions de formation et des structures y
afférentes, mais aussi en terme d'actualisation de sa carte militaire.
Nous ne négligerons pas la coordination avec les Etats de l'Afrique
centrale, au sein des différentes institutions de cette région de
l'Afrique (chapitre 4).
CHAPITRE III
LES DYNAMIQUES OPERATIONELLES DE LA PARTICIPATION DU
CAMEROUN DANS LA GESTION DES CONFLITS
Le Cameroun comme la plupart des Etats au
21ème siècle est préoccupé par les
questions de paix et de sécurité tant celles-ci ont un impact
direct sur ses perspectives de développement. Pays au potentiel
immense112(*) mais
miné par de nombreuses situations conjoncturelles difficiles, le
Cameroun dans la sous-région d'Afrique ne peut pas se permettre comme on
l'a vu, le luxe d'un interventionnisme militaire propre au comportement
hégémonique113(*) ; même si pour beaucoup, ce pays est ou
devrait être la puissance stabilisatrice de la sous-région. Au
contraire, dans une équation assez complexe, le Cameroun tente tant bien
que mal, au gré des conjonctures, de ses intérêts mais
aussi des principes de non-ingérence et de respect de
l'intégrité territoriale (qu'il défend et promeut) de
peser sur l'agenda sécuritaire de la sous-région d'Afrique
centrale. Sur le plan opérationnel cela se traduit par une participation
étagée et méticuleusement calculée au maintien de
la paix dans la sous-région qui implique une contribution non seulement
au plan de la formation (Section I), mais aussi au niveau du déploiement
des missions de paix (Section II).
SECTION I : DES MISSIONS DE FORMATION : ENTRE
MISE A DISPOSITION DE STRUCTURES DE FORMATION ET PARTICIPATION AUX EXERCICES
CONJOINTS...
L'analyse de la contribution camerounaise au maintien de la
paix et de la sécurité en Afrique met en lumière deux
pools principaux, l'un relevant du niveau stratégique et l'autre de
niveau opératif. Le premier pool dont il sera question dans cette
section nous permet de voir qu'en matière de contribution au maintien de
la paix et de la sécurité dans sa sous-région, le Cameroun
a su contourner l'obstacle des principes qu'il défend qui de fait,
limitaient ses perspectives d'intervention en faveur de la paix sans les pays
de la sous-région.
En effet, le Cameroun opte pour une équation
d'intervention au plan stratégique qui lui permet de peser
énormément sur les processus et structures centrales de maintien
de la paix en Afrique centrale, sans pour autant avoir nécessairement
besoin de se poser en hégémon susceptible d'intervenir à
outrance dans les pays voisins en crise. Cette équation fondée
sur la mise à disposition par le Cameroun des structures
spécialisées de formation en matière de maintien de la
paix (A) est consolidée par une contribution tactique à travers
la participation aux exercices conjoints organisés par l'instance
communautaire responsable au nom de la sous-traitance stratégique, des
questions de paix et de sécurité dans la sous-région
d'Afrique centrale (B).
A -LA MISE A DISPOSITION DE STRUCTURES DE FORMATION
SPECIALISEES
La stratégie camerounaise en matière de paix et
de sécurité a su dès le départ se passer d'un plein
emploi de la puissance au sens le plus classique du terme comme outil de paix.
Non seulement parce que cela irait à l'encontre des principes de
non-ingérence et de respect de l'intégrité territoriale
pour lesquels le Cameroun se pose volontairement défenseur, mais aussi
parce que l'état de ses moyens aujourd'hui ne lui permettent pas une
telle initiative. Toutefois, les différentes conjonctures et la
nécessité de protéger son intérêt a
poussé le Cameroun à imaginer des solutions de substitution parmi
lesquelles la volonté et même la tentative de peser ou d'impacter
sur la formation d'une culture stratégique commune en Afrique
centrale.
Cette volonté des autorités camerounaises les a
amenés très tôt à ouvrir l'entrée dans sa
célèbre et mythique Ecole Militaire Interarmées (EMIA)
à des soldats originaires des autres pays d'Afrique Centrale et
même au-delà. C'est dans cette veine que cette Ecole
spécialisée a accueilli des personnalités telles que le
Défunt Thomas SANKARA et l'ancien Président Burkinabé
Blaise COMPAORE. Cette stratégie camerounaise va monter d'un cran avec
la création et la montée en puissance du Cours Supérieur
Interarmées de Défense (CSID) (1) et de l'Ecole Internationale
des Forces de Sécurité (EIFORCES) (2). Ces deux structures sont
depuis leur création, progressivement devenues des
références sous régionales en matière de formation
dans le domaine de la paix et de la sécurité.
1 - Le Cours Supérieur Interarmées de
Défense (CSID)
Le rôle des écoles de formation militaire dans la
formation de la culture stratégique des forces armées n'est plus
à démontrer114(*), ces écoles constituent de ce fait des lieux
par excellence de prise en compte et même d'ailleurs de facilitation de
la mise oeuvre de l'interopérabilité dans les futures actions des
forces sous régionales. Nous analyserons dans cette partie le Cours
Supérieur Interarmées de Défense désormais connu
sous le nom d'Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Simbock.
Le CSID est créé par décret
présidentiel le 13 janvier 2005. Regroupant les futurs brevetés
de l'enseignement militaire supérieur du 2nd degré des
trois armées et de la gendarmerie, le CSID a pour mission de
préparer les officiers supérieurs à assumer de hautes
responsabilités au sein de leur armée d'appartenance, dans les
états-majors de haut niveau, les grandes directions et les organismes
interarmées, interalliés et internationaux et
éventuellement à mettre au service de la FAA. C'est pourquoi
après une première année purement nationale, le CSID a
accueilli en 2006 trois stagiaires étrangers venant du Burkina Faso,
Gabon, Niger ; puis sept en 2007. En 2008-2009, la 4e promotion
était composée de 33 stagiaires de 19 nationalités et
finalement on est arrivé avec La 6e promotion de 20
nationalités différentes dont un français et un
américain. En mars 2009 l'Ecole fut récompensée par la
CEEAC qui l'a distingué en la rangeant parmi ses institutions
d'excellence « de niveau stratégique dans le cadre de la
formation du soldat de la paix ».
L'Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Simbock
offre une formation d'une durée de dix mois sanctionnée par
l'attribution du Brevet d'Etudes Militaire Supérieur (B.E.M.S)115(*). Conformément au
décret N°2005/015 du 13 janvier 2005, le CSID est placé sous
l'autorité d'un commandant, assisté d'un commandant en second,
exerçant les fonctions de Directeur de l'enseignement, officier
nommé par décret du Président de la République. La
direction des études et programmes assure : la préparation,
la programmation et l'organisation de l'enseignement ; les études
relatives à l'évolution des programmes et du contenu des
enseignements.
L'enseignement général de défense
dispensé au CSID intègre la stratégie, la
géopolitique, le droit, les relations internationales, le management, la
communication, l'économie...cet enseignement vise à enrichir la
culture générale des officiers stagiaires, à approfondir
leur réflexion sur la défense et l'institution militaire,
à développer l'ouverture vers des instances extérieures,
civiles et militaires, nationales et internationales. L'enseignement
opérationnel, quant à lui a pour objectif de donner aux
stagiaires les connaissances indispensables à la planification et
à la conduite des opérations interarmées nationales ou
multinationales. A cet effet, l'enseignement dispensé porte sur :
les études opérationnelles communes ; les études
opérationnelles spécifiques à chaque armée. C'est
ce justement qui permet aux stagiaires de développer une culture
stratégique collective, laquelle permettrait de faciliter
l'interopérabilité dans le cadre d'actions militaires communes.
On le voit donc, la place du CSID dans le maintien de la paix et de la
sécurité en Afrique centrale.
2 - L'Ecole Internationale des Forces de
Sécurité
Comme avec les structures de formation militaire au plan
stratégique et opérationnel, le Cameroun a également mis
en place une de structure de formation militaire au plan tactique. Il s'agit de
l'Ecole Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES).
L'EIFORCES du Cameroun a été créée
par Décret présidentiel116(*) et elle s'occupe de deux activités
principales à savoir la formation de policiers et de gendarmes et la
recherche fondamentale dans les domaines liés à la
sécurité intérieure et aux opérations de maintien
de la paix.117(*) Ces
dernières années, l'EIFORCES est montée en puissance
grâce à son centre de perfectionnement aux techniques de maintien
de l'ordre (CPTMO) qui a déjà formé plus d'une centaine de
cadres de commandement d'unités de polices constituées d'une
vingtaine de pays africains.
Cette école entend développer une vision
partagée de la sécurité c'est-à-dire des
réponses à apporter à un certain type de menaces, elle
participe surtout à développer les capacités des gendarmes
et policiers en matière d'opérations de maintien de la paix, de
gouvernance des services de sécurité et de coopération
policière internationale. L'EIFORCES est un concept structuré
autour de trois fonctions que sont la formation des agents individuels et
d'unités constituées, la recherche et la documentation sur les
conflits et la sécurité humaine et surtout le
développement de normes et de standards communs pour les forces de
sécurité des Etats de la CEEAC ce qui faciliterait
particulièrement l'interopérabilité dans un possible
contingent multinationale. En outre, le projet EIFORCES c'est aussi un centre
de perfectionnement à la police judiciaire (CPPJ) de la Gendarmerie et
l'Ecole Nationale Supérieure de Police.
Ayant l'ambition de fournir aux stagiaires une formation
conforme aux standards de l'ONU et de l'UA, l'EIFORCES se pose comme une
référence en Afrique centrale et comme toutes les autres
structures de formations analysées plus haut elle participe à la
construction d'une culture stratégique commune en Afrique centrale voire
dans le contient entier, laquelle culture permettrait sans doute une meilleure
implémentation de l'interopérabilité entre et au sein des
forces communes de la FOMAC et dont au sein de la composante police de ces
forces. A partir de là, les exercices conjoints organisés par la
FOMAC apparaissent alors comme des lieux d'expérimentation de cette
interopérabilité, permettant de corriger les écarts qui ne
manquent pas de subsister. Là également, on voit que le Cameroun
en créant l'EIFORCES a su développer un outil lui permettant
d'agir de manière indirecte, à l'amont de toute gestion de la
paix en Afrique centrale.
B -LA PARTICIPATION CAMEROUNAISE AUX EXERCICES MILITAIRES
CONJOINTS
Pour le Cameroun, participer aux exercices militaires
conjoints de la Force Multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC) obéit
à une logique d'influence du processus de gestion des conflits
clairement définit. Comme nous l'avons déjà
précisé, le Cameroun sait parfaitement que c'est une occasion
sérieuse d'influencer le maintien de la paix dans la sous-région
dans la mesure où ces opérations permettent aux forces en attente
de l'Afrique centrale de se projeter. Le Cameroun a déjà ainsi
participé à plusieurs de ces exercices.. Il s'agit non seulement
de BIYONGHO 2003 au Gabon, de BAHR-EL GAZAL 1 en 2005 au Tchad et SAWA 2006 au
Cameroun (A), mais aussi de BAHR-EL GAZAL 2 en 2007 au Tchad, de KWANZA 2010 en
Angola et prochainement de FOMAC-CONGO 2014 en République du Congo
(B).
1. Les exercices BIYONGHO 2003, BAHR-EL GAZAL 1 ET SAWA
2006
Les exercices militaires conjoints en Afrique centrale
rentrent dans le cadre de la construction de l'Architecture Africaine de Paix
et de Sécurité (AAPS ou APSA), le plus ambitieux programme de
sécurité jamais développé en Afrique118(*) et du programme de global de
renforcement des capacités africaines pour le maintien de la paix
(RECAMP). Il s'agit en général de tester la capacité de
déploiement rapide des forces. Ces exercices nous intéresserons
dans ce cadre en ce sens où ils permettent sans doute
d'expérimenter et d'évaluer le niveau
d'interopérabilité au sein des forces conjointes et dont dans la
composante police de ces dernières. Les tout premiers exercices de ce
type en Afrique centrale sont BIYONGHO 2003, BAHR-EL GAZAL 1 et SAWA 2006.
En ce qui concerne BIYONGHO 2003, il faut dire que c'est un
exercice qui s'est tenu en juillet 2003 dans la province du Haut-Ogooué
au Gabon. Il faisait suite à BIYONGHO 98 qui n'avait pu se tenir pour
des raisons financières119(*). BIYONGHO 2003 qui a réuni près d'un
millier d'hommes venant de huit pays d'Afrique centrale avait pour but de
préparer ces derniers à des interventions militaires de
sécurisation en situation de crise. Si les résultats en termes de
cohésion entre les différents soldats n'étaient totalement
satisfaisants, on a pu faire mieux qu'au cours de l'exercice « Gabon
2000 » qui avait déjà eu lieu en l'an 2000.
BAHR-EL-GAZAL 1 apparaissait à ce moment comme une
occasion de corriger les manquements de BIYONGHO 2003. BAHR-EL-GAZAL 1 s'est
tenu en novembre 2005 et était porteur de grands espoirs quant à
l'amélioration des capacités de l'Afrique centrale qui
était faut-il le préciser la sous-région la moins
avancée en termes de certification des forces africaines en attente.
C'est pourquoi le Secrétaire Général des Nations Unies
lui-même a tenu à encourager l'initiative en ces mots
« J'ai suivi avec intérêt les
délibérations des chefs d'état-major des États
membres de la CEEAC qui se sont réunis à Luanda les 11 et
12 avril 2005 en vue de mettre en place la Force africaine en attente
(FAA) et des Brigades régionales. Lors de cette réunion, les
chefs d'état-major ont aussi décidé d'organiser au Tchad
en novembre 2005 le deuxième exercice multinational « Barh
El-Gazel 2005 ». En donnant votre aval à cette
initiative, indispensable à la sécurité et à la
stabilité de l'Afrique centrale, vous montrerez votre
détermination à rendre opérationnels le Conseil de paix et
de sécurité de l'Afrique centrale et son Mécanisme
d'alerte rapide »120(*).
La manoeuvre d'envergure suivante s'est organisée au
Cameroun sous le nom « SAWA 2006 ». Celle-ci, bien qu'ayant
beaucoup plus mis l'accent sur l'aspect civil, n'est pas moins
intéressante en ce qui concerne l'évaluation du niveau
d'interopérabilité. En effet, L'occasion a été
donnée de voir et d'évaluer sur le terrain l'aspect civil et les
projets de développement conçus et réalisés par les
militaires dans le cadre d'une opération de maintien de la paix.
L'inauguration de nombreux projets de développement
réalisés par des militaires dans certaines villes du Cameroun
pendant l'exercice Sawa 2006 visait ainsi à renforcer dans l'imagerie
populaire l'action humanitaire des militaires. Ces projets sociaux comprenaient
la réalisation d'adduction d'eau, la construction de centres de
santé et des salles de classe et une aide médicale significative
aux populations dans le besoin... de toute évidence, des progrès
étaient perceptibles dans tous les domaines et donc dans celui de
l'interopérabilité.
2. BAHR-EL GAZAL 2, KWANZA 2010 et FOMAC-CONGO 2014
Comme avec les trois précédents, les exercices
suivants ont au-delà des objectifs officiels de l'UA et de la CEEAC -
à savoir évaluer les capacités de FOMAC à
déployer dans un délai très court, une force de maintien
de la paix - permis d'éprouver et de tester
l'interopérabilité entre et au sein des forces multinationale de
la CEEAC. Ces exercices sont BAHR-EL GAZAL 2, KWANZA 2010 ET FOMAC-CONGO 2014
qui doit se tenir en juillet 2014.
En ce qui concerne BAHR-EL-GAZAL 2, il faut dire qu'il se
situe dans la continuité de BAHR-EL-GAZAL 1. L'objectif était
bien sûr d'identifier et de redresser les insuffisances et les
défauts qui doivent l'être pour faire évoluer la FOMAC vers
la certification. Les manoeuvres BAHR-EL-GAZAL qui se sont tenues du 10 au 17
novembre 2007 à Moussoro au Tchad ont vu la participation non seulement
des commandements nationaux de la Brigade régionale en attente, mais
aussi des troupes venues du Togo invitées par le Tchad. L'exercice
devait finalement Il devait permettre d'évaluer et de valider les
procédures opérationnelles ainsi que l'opérabilité
de la brigade régionale en attente. Cet exercice a constitué une
innovation quant à la capacité de mobilisation et de projection
des forces à brève échéance dans un cadre conjoint
interafricain. Il a mis en action une brigade légère de 1 600
hommes placés sous le commandement d'un état-major
intégré des Etats participants. Il a été l'occasion
pour la brigade de la CEEAC de se mettre en phase avec les autres brigades
régionales constituant la force africaine en attente121(*).
A la suite de ces exercices, l'Angola a été
désignée pour abriter l'exercice suivant connu sous le nom KWANZA
2010. Celui-ci s'annonçait déjà comme un exercice de
très grande envergure, le commandant en chef122(*) des forces armées
angolaise en parlait comme un « exercice militaire de manoeuvre
multinationale et multidimensionnelle et de mission intégrée
comportant des composantes politiques et diplomatiques ainsi que des
composantes d'observation militaire et de police et d'action
humanitaire »123(*). Au Cameroun, le Ministre
Délégué en charge de la Défense expliquait que ces
manoeuvres devaient rentrer dans l'optique de l'évaluation des
avancées de la Force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC) en
matière de gestion de crises au sein de la sous-région124(*). KWANZA s'est finalement
tenu du 22 mai au 10 juin 2010 et a rassemblé près de 4000 hommes
issus des trois unités (terre mer et air) d'une armée et de
policiers venant des pays de la CEEAC125(*). Actuellement, on annonce un autre exercice qui
devrait se tenir en République du Congo au titre de l'année 2014
sous le nom de code FOMAC-CONGO 2014. L'exercice sera dédié comme
l'a précisé le général de Brigade François
Ossélé, coordonnateur du groupe de réflexion pour
FOMAC-CONGO 2014 et par ailleurs directeur des opérations de
l'état-major des Forces Armées Congolaises (FAC), à
l'atteinte de l'objectif de certification de la capacité de
déploiement rapide en 2014. Objectif essentiel réaffirmé
avec force par l'Union Africaine (UA) à l'occasion du cinquantenaire de
cette organisation continentale.
Ce qui se dégage à travers cette Section est
que, les Etats membres de la CEEAC ont entrepris un certain nombre d'efforts
qui, même s'ils n'avaient pas pour objectif premier
l'interopérabilité au sein de la composante police de la FOMAC,
permettait quand même la réalisation de celui-ci à travers
la recherche d'un niveau élevé de cohésion et de
cohérence dans les actions des forces de la brigade en attente de
l'Afrique centrale, lesquelles cohésion et cohérence sont
absolument nécessaires si l'on veut avoir un minimum d'efficacité
dans le déploiement rapide des missions de paix dans les
théâtres d'opérations. Ces efforts comme on l'a vu se sont
manifestés non seulement par la construction d'un cadre normatif
susceptible de faciliter l'interopérabilité entre et au sein des
composantes nationales des troupes de la FOMAC et la mise en place de
structures de formation militaires distillant la même culture
stratégique aux stagiaires, mais aussi à travers l'organisation
de manoeuvres conjointes qui apparaissent dès lors comme des cadres
d'expérimentation de l'interopérabilité entre et au sein
des différentes composantes de la FOMAC et donc dans sa composante
police.
SECTION II :...ÀL'ENVOI DES UNITES
CONSTITUEES SUR LE THEATRE DES OPERATIONS
La participation du Cameroun dans les conflits en Afrique,
s'inscrit dans une perspective aujourd'hui suffisamment routinière et
ritualisée qu'elle semblerait apparaitre comme une institution. Dans
certains cas de figure, cette contribution est proche du symbole dans le sens
où elle se limite à un envoi au minima des forces en vue de la
simple représentativité ; tandis que dans d'autres cas, les
plus nombreux, elle s'inscrit dans une logique majoritaire dans laquelle le
Cameroun, du moins, ses forces armées et sa police arrivent à
jouer un rôle déterminant ; c'est-à-dire structurant.
Les cas des crises en RCA (A) et en RDC (B) l'attestent à suffisance.
A - le cas de la crise centrafricaine
Le simple prononcé de la crise centrafricaine renvoie
dans les imaginaires, à une situation de
« désordre » politique et constitutionnel qui
s'est enracinée depuis la période des indépendances. Dans
ce pays, les changements anticonstitutionnels de gouvernement par le truchement
des coups d'Etats sont devenus légions. Il va s'agir dans cette
perspective d'analyse et d'étude de la stratégie camerounaise de
gestion des conflits, de rappeler davantage ces situations ou épisodes
de conflits ou crise en RCA (1), avant d'en préciser l'essence
même de cette contribution (2).
1. De la rétrospective sur les crises politiques
en République centrafricaine...
La RCA est la cible depuis des années de groupes
rebelles et de bandes de pillards venus des pays voisins (Tchad, Soudan,
Ouganda, RD Congo notamment). La situation s'est à tel point
dégradée ces dernières années que l'on parle
désormais d'Etat failli. La RCA, l'un des pays les plus pauvres au
monde, dispose de ressources naturelles largement inexploitées et ne
revêt pas de réel intérêt stratégique, ce qui
a autorisé son effondrement progressif.
Le 24 mars 2013, la Séléka, une coalition de
groupes rebelles venus du Nord de la République centrafricaine mais
comptant des combattants à la fois centrafricains, tchadiens et
darfouris, prenait le pouvoir, renversant le président François
BOZIZE. Les motivations de la Séléka ont pris un tour religieux
depuis le mois de septembre dernier lorsque des milices chrétiennes se
sont formées en réaction à ses exactions. Le
président de transition que la Séléka a porté au
pouvoir, Michel DJOTODIA, a dissous le mouvement à la suite des
exactions commises par les membres des différentes forces qui le
composaient. Mais les bandes armées semant la terreur dans les rues de
la capitale sont toujours légion, leur capacité de nuisance
n'ayant pas été altérée par leur intégration
à ce que le gouvernement de transition présente comme les
nouvelles forces de sécurité centrafricaines. Michel DJOTODIA
joue lui-même un jeu trouble, à la fois débordé et
tenu en respect par les bandes de pillards qui l'ont placé au pouvoir.
Les autres responsables politiques en poste à l'époque de la
prise de pouvoir de DJOTODIA ont été laissés en place,
notamment le premier ministre Nicolas TIANGAYE, et sont aujourd'hui visiblement
dépassés par une situation qui ne fait qu'empirer et qu'ils n'ont
pas activement combattue.
Face à la dégradation de la situation, la France
a soumis une proposition de résolution au Conseil de
sécurité des Nations unies visant à renforcer la Mission
Internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA), force africaine
présente en RCA. Cette résolution autorise également la
France à soutenir la MISCA militairement, avec la possibilité que
cette dernière devienne ultérieurement une force onusienne si les
soldats africains ne devaient pas parvenir à gérer la situation.
La MISCA renforcée doit se déployer pour une période de
douze mois, révisable au bout de six mois, et aura un mandat
l'autorisant à recourir à la force, un mandat de chapitre VII de
la Charte des Nations unies.
Le premier ministre centrafricain, Nicolas TIANGAYE,
interlocuteur principal de la communauté internationale depuis le
début de la crise et interface avec le président DJOTODIA, avait
lui-même appelé à un vote donnant à la MISCA et son
appui français un mandat de chapitre VII. Figure militante de la
défense des droits de l'homme en Centrafrique, M. TIANGAYE semble
espérer une sortie de crise orchestrée par la communauté
internationale. La résolution 2127 a été votée
à l'unanimité par le Conseil de sécurité le 5
décembre 2013. Un conseil de défense a été tenu en
France le même jour, à l'issue duquel François Hollande a
annoncé l'envoi immédiat des troupes visées par la
résolution onusienne. Il s'agit ici pour la France d'appuyer une force
déjà existante et non d'entrer en premier, ce qui fait une
différence notable avec l'opération Serval au Mali.
L'ONU a menacé de sanctions certains membres de
l'ex-Séléka, dont son numéro deux et homme fort,
Noureddine Adam. Un embargo sur les armes à destination de Bangui fait
également partie de la résolution.
Le nom donné à l'opération
française en Centrafrique, lancée le 5 décembre, est
Sangaris. Cette opération est dirigée par le
général Francisco Soriano et les troupes qui la composent ont
été déployées très rapidement. Les troupes
françaises ont en effet déjà atteint 1.600 hommes et
doivent se stabiliser à ce chiffre pour demeurer sur place
jusqu'à ce que la mission soit remplie. Lors d'une conférence de
presse en marge du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique
samedi dernier, François Hollande a annoncé que la mission
première des troupes françaises serait de désarmer les
milices et de rétablir la sécurité pour permettre la tenue
d'élections libres.
Dès l'annonce du déploiement de renforts
français pour épauler la MISCA, de nombreux
ex-Séléka avaient quitté Bangui. La situation à
Bangui semble plus calme depuis samedi matin, la présence des
Français dans la ville dissuadant les groupes de s'affronter dans le
centre-ville. Mais les violences et massacres continuent dans les faubourgs
populaires de Bangui, les soldats français doivent donc maintenant
ramener l'ordre dans ces quartiers. Les troupes françaises ont entrepris
ces derniers jours de se déployer hors de Bangui, notamment à
Bossangoa, ville du Nord du pays très touchée par les
affrontements. Lors du mini-sommet sur la situation en Centrafrique le 7
décembre, en marge du sommet sur la paix et la sécurité en
Afrique qui se tenait à Paris, le président français a pu
s'entretenir avec ses partenaires sur le dossier. Se trouvaient notamment
à ce mini-sommet BAN KI-MOON, le premier ministre centrafricain Nicolas
TIANGAYE et les dirigeants des pays voisins. Le Secrétaire
général de l'ONU a à cette occasion chaleureusement
salué l'implication de la France dans la réaction internationale
face à la crise.
De leur côté, les partenaires africains de la
France dans cette opération font montre d'un volontarisme certain. La
MISCA compte 2.500 hommes venus des pays voisins (Gabon, Cameroun, Congo et
Tchad) et doit être portée à 3.600 soldats africains,
épaulés par un millier de soldats français, dans les
prochaines semaines. Il a même été annoncé que la
force africaine coordonnée par l'UA devrait atteindre 6.000 hommes, ce
qui semble être un objectif de plus long terme.
La France a obtenu le soutien de l'Union européenne,
Hermann VAN ROMPUY ayant notamment témoigné son adhésion
à l'action française. L'UE a également annoncé
qu'elle entendait soutenir la MISCA, notamment financièrement. Le
déploiement du Battle group européen aurait
également été évoqué dans les discussions
mais ne serait pas à l'ordre du jour, la France n'ayant pas
sollicité une telle aide. Le Royaume-Uni va de son côté
fournir des avions de transport militaire pour soutenir l'intervention
française. L'Allemagne a également proposé son aide
à la France en matière de transport aérien.
Les Etats-Unis sont très réticents au possible
basculement de la mission en force de maintien de la paix de l'ONU,
considérant que les forces africaines de la MISCA pourront gérer
seules la situation, dans une logique affichée de sécurisation de
l'Afrique par les Africains. Mais le Secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon a fait part de ses préoccupations, affirmant que 6.000
à 9.000 hommes correctement entraînés et
équipés seraient nécessaires pour ramener la situation
sous contrôle.
Les affrontements entre chrétiens et musulmans,
essentiellement dans la partie Nord du pays, sont très violents et ont
fait des milliers de morts et des dizaines des centaines de milliers de
déplacés (un dixième de la population centrafricaine selon
les dernières estimations). La situation sécuritaire est telle
que les journalistes ne sont plus autorisés à s'y rendre ; les
comptes rendus concernant cette partie du pays émanent donc d'ONG de
défense des droits de l'homme telles que HumanRights Watch. Les milices
d'auto-défense chrétiennes, appuyées par une partie des
anciennes forces armées demeurées fidèles au
président BOZIZE, disposent aujourd'hui des mêmes armes que la
Séléka et les combats entre les groupes paramilitaires sont
extrêmement violents.
A Bangui, la situation est également très
tendue, des pick-up transportant des combattants de groupes difficilement
identifiables paradant et semant la terreur dans la ville. Les restes des
forces loyales à l'ancien président BOZIZE, alliées avec
les milices chrétiennes, s'opposent notamment aux combattants de
l'ex-Séléka. Les centaines de corps jonchant les rues de Bangui,
évacués par la Croix Rouge, témoignent de ces combats
à l'arme lourde. La crainte est qu'une insurrection
générale ait lieu à Bangui contre
l'ex-Séléka, avec pour résultat des pogroms contre la
population musulmane considérée par les chrétiens comme
proche et complice de la Séléka. Les agences des Nations unies se
sont dites particulièrement préoccupées par la
dégradation de la situation humanitaire en Centrafrique, qui pourrait
entraîner davantage encore de déplacements de population et une
aggravation du chaos ambiant.
L'Etat centrafricain ne survit depuis mars que grâce
à l'aide très substantielle fournie par la République du
Congo de Denis SASSOU NGUESSO, et un redressement même relatif de la
situation d'ici aux élections générales annoncées
pour 2015 semble très improbable. La situation sécuritaire
empêche la plupart des ONG humanitaires qui étaient
précédemment présentes d'oeuvrer en Centrafrique. Les deux
dernières qui sont restées sont MSF et le CICR, ce qui est
insuffisant pour faire face à la crise.
Des ONG de défense des droits de l'homme comme
HumanRights Watch font état depuis plusieurs mois, d'attaques et de
pillages systématiques contre des villages, notamment au Nord, et du
recours par les bandes armées à des enfants de moins de 15 ans
pour des tâches diverses en lien avec les attaques (transporter le
matériel, les armes, participer aux attaques, etc.). De nombreuses mises
en garde ont été lancées par ces acteurs pour
prévenir de la possibilité de la mutation du conflit en guerre
interreligieuse et de la sanctuarisation terroriste de la partie nord du
territoire, ce qui semble une menace réelle. Les razzias visant les
populations villageoises, principalement les non-musulmanes, ainsi que les
pillages et agressions sont en effet très fréquents. Les forces
de sécurité et les représentants des autorités
étatiques et locales sont inexistants, faisant de la RCA une zone de
non-droit où le chaos ne trouve aucune entrave.
2. ... à la participation des forces
armées camerounaises à leur dénouement.
Alors qu'il était en route pour la République
centrafricaine (RCA) où la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation en
République centrafricaine (MINUSCA) prend le relais de la Mission
internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA), Hervé
Ladsous, nouveau secrétaire général adjoint aux
opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies
(ONU), a été reçu en fin de matinée samedi dernier
par le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang. A l'issue
de l'entretien, le chef du département des opérations de maintien
de la paix à l'ONU a déclaré à la presse126(*) être « venu pour
rencontrer les autorités camerounaises avant de se rendre en
Centrafrique où nous allons reprendre le flambeau de l'Union africaine
après-demain. Le diplomate onusien a ajouté qu'il voulait
adresser au gouvernement camerounais un message de profonde reconnaissance pour
tout ce que le Cameroun a fait au fil des années pour soutenir l'action
de la communauté internationale ».
D'après Hervé LADSOUS, « le Cameroun le
fait en fournissant des troupes et des policiers qui se comportent bien sur le
terrain »127(*).
Plus que jamais, a-t-il poursuivi, « nous devons travailler la main dans
la main pour faire sortir la RCA de l'ornière profonde et douloureuse
dans laquelle elle s'est enfoncée ces dernières années
». Parlant de ce qui va changer en RCA avec l'avènement de la
MINUSCA, Hervé Ladsous a révélé que l'ONU y apporte
des troupes supplémentaires qui viennent d'autres parties du monde, des
Marocains, des Sri-lankais, des Pakistanais, etc. En plus de
l'élargissement des contributions, il a ajouté que les missions
de maintien de la paix des Nations unies apportent une perspective à la
fois politique et intégrée, en étant un vecteur de
promotion des droits de l'homme et de l'Etat de droit, puis en accompagnant les
processus de désarmement et de démobilisation des ex-combattants.
Diplomate chevronné de nationalité française, Hervé
LADSOUS était accompagné samedi par le représentant
spécial du SG de l'ONU pour la RCA, le Général Babacar
GAYE. Avant de se rendre chez le PM, M. LADSOUS a été reçu
plus tôt samedi par le ministre délégué à la
présidence de la République chargé de la Défense,
Edgard Alain MEBE NGO'O.
Les différents contingents camerounais ont souvent
été constitués de militaires, de policiers, d'observateurs
militaires et autres. Toutefois, comme le relève le colonel
YAMBA128(*) de la
2ème Région militaire du Cameroun, « la participation
des Forces de défense du Cameroun (FDC) aux opérations de
maintien de la paix (OMP) à travers le continent africain, revêt
tantôt la forme individuelle, tantôt la forme collective, selon les
niveaux stratégiques, opératifs et/ou tactiques des OMP».
Selon cet officier supérieur de l'armée camerounaise, la
participation individuelle aux OMP est une participation minimale en hommes,
car ce sont des militaires ou policiers qui ont des contrats individuels et
travaillent, soit au niveau opératif, soit au niveau stratégique.
Pourtant, la participation collective, quant à elle, renvoie à la
participation par unités constituées, ce sont des contingents
dont les membres évoluent ensemble.
Dans l'ensemble, la participation des FDC dans les OMP en
Afrique est assez souvent individuelle, comme cela a été le cas
au Darfour, en Angola, en RDC, au Rwanda, en RCA, en Côte-d'Ivoire et au
Mali. Dans ces cas, de nombreux sous-officiers et officiers des FDC ont
été envoyés sur demande de l'ONU et/ou de l'UA à
titre d'observateurs, comme nous l'avons démontré au
préalable. Ils arrivent souvent à se retrouver au niveau
opératif et même stratégique, soit à cause de leurs
compétences individuelles, soit alors par le biais des places
réservées au Cameroun », a confié le colonel Louis
Marie KOUMA129(*). Pour
Joseph Vincent NTUDA EBODE, le gouvernement camerounais a mis à la
disposition de la Mission des Nations Unies en République Centrafricaine
(MINURCA), le 8 février 1999, un personnel pour la formation de la
police civile.
A l'expiration du mandat de la MINURCA en février 2000,
un officier supérieur camerounais occupait les fonctions de chef de
l'instruction de la police civile, fonction qui ont été
maintenues dans le cadre du bureau d'Appui des Nations Unies pour la
Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (BONUCA). En
juillet 2009, un autre élément des FDC occupait le poste
d'officier supérieur chargé de la logistique au sein de la
Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM). Toujours dans le cadre de
leur participation individuelle en Afrique, les Forces de défense
camerounaise sont intervenues par contingent de quatre officiers pour le compte
de l'UA au Sud Soudan (MUAS au Darfour) dans le cadre du `'Darfour DESK''
(programme de suivi des opérations pour le compte de l'UA). Dès
2005, des contingents portés à 10, puis à 20 observateurs
s'y sont succédé. Depuis le passage de la Mission de l'Union
Africaine au Soudan (MUAS) à la Mission des Nations Unies au Darfour
(MINUAD), ce sont des groupes de cinq officiers qui se relayaient. En Ethiopie,
un officier camerounais fait partie de l'état-major de la Force
africaine en Attente (FAA), et en Côte d'Ivoire depuis 2003, un autre
fait partie de l'état-major de la mission de l'Organisation des Nations
Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) en qualité de représentant
militaire du Président de la Commission de l'UA », précise
un enseignant permanent à l'Institut des Relations internationales du
Cameroun (IRIC), Jean KENFACK130(*).
L'on se souvient aussi que des policiers
camerounais étaient de la mission humanitaire à Goma (Zaïre)
en 1994 et 1998-2000, et plus tard dans le cadre de la MONUC en RDC en 2006.
Par ailleurs, les FDC n'ont pas souvent participé aux
OMP de manière collective en unité constituée. Le cas de
la RCA reste encore unique. A ce propos, depuis 2008, le Cameroun est
présent en RCA aux côtés des autres pays de la CEEAC pour
la mission de consolidation de la paix dans ce pays. Il s'agit d'un contingent
de 107 personnes en sus de 4 officiers d'état-major et de 12 personnels
d'appui et du chef d'état-major. Et depuis juin 2013, dans le cadre de
la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous la conduite
africaine (MISCA) décidée par le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA), le Cameroun a encore
envoyé 517 militaires et 320 policiers, soit au total 837
éléments , a souligné le colonel YAMABA. A en croire cet
officier ; « c'est la première fois que le Cameroun sorte avec
un aussi grand effectif depuis sa participation dans les missions de maintien
de la paix en Afrique »131(*). Et comme une cerise sur le gâteau, ce sont
deux généraux de brigade camerounais qui se sont
succédé à la tête de ces missions en RCA,
respectivement en 2009 où Hector Marie TCHEMO était commandant de
la MUNURCA et depuis 2013, TUMENTA CHOMU Martin, est le commandant de la
Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA).
A en croire les sources militaires, les FDC participent aussi
aux OMP dans le cadre de la formation et des activités de
préparation aux OMP. En effet, avec la création de la Force
africaine en attente (FAA) et la mise sur pied des brigades régionales
devant la composer, le Cameroun prend une part active à sa montée
en puissance au sein de la force multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC,
institution de la CEEAC) et du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique
Centrale (MARAC, institution de la CEMAC). Le Cameroun est également en
compétition avec l'Algérie pour abriter la Base logistique
continentale (BLC) où devrait être stocké le dispositif
logistique appelé à être affecté aux missions de
paix initiées et conduites sous la bannière des institutions
africaines. Sur le plan de la logistique, le Cameroun qui, dans sa
coopération avec l'ONU et l'UA, met ses infrastructures portuaires et
aéroportuaires à la disposition des OMP, ne dote pas toujours ses
troupes de leurs logistiques propres, compte tenu du coût
élevé des équipements militaires. L'Etat doit d'abord
équiper complètement ses militaires en matériels divers et
attendre plusieurs mois pour obtenir le remboursement par l'ONU ou l'UA des
dépenses souvent lourdes qu'il a engagé.
Selon des sources militaires et du ministère des
Relations extérieures (MINREX), même si les effectifs (non
disponibles) des troupes régulièrement mobilisées par le
gouvernement camerounais n'ont pas encore inscrit le pays au registre des
principaux contributeurs en hommes au sein des contingents multinationaux de
maintien de la paix en activité sur le continent africain, le rendement
des Forces de défense camerounaises est très
apprécié par les organisations onusiennes et africaines qui
coordonnent le déroulement de ces missions de maintien de la paix.
Mais, il demeure encore de nombreux problèmes à l'instar de celui
de celui du financement des missions ou du paiement des militaires
engagés dans ces terrains d'opérations. A ce titre, l'on apprend
à la lecture du journal camerounais « Mutations »,
que la tension est croissante au sein du contingent camerounais de la Mission
internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA)132(*). Car, depuis deux mois, le
contingent camerounais, constitué de 850 soldats, tous originaires des
brigades opérationnelles de la force africaine en attente, n'ont pas
perçu de salaire. Une situation qui intervient à un moment
où les luttes confessionnelles entre chrétiens et musulmans
s'accentuent à Bangui et dans le reste du pays.
Si aucun mouvement n'est pour l'instant à l'ordre du
jour, (rien n'exclut) l'intention des camerounais de quitter les positions
qu'ils occupent aujourd'hui. Notamment dans l'Ouest du pays et principalement
sur les axes qui mènent à la frontière avec le Cameroun.
Le général camerounais, Martin TUMENTA CHOMU, commandant
militaire de la MISCA est au courant de cette situation, mais semble avoir les
bras liés du fait qu'il ne s'occupe pas des questions financières
qui relèvent de la compétence de l'Union africaine. Le
gouvernement de la République du Cameroun dément toute
responsabilité dans la situation que vivent « nos »
soldats. Une source133(*) au Ministère de la Défense affirme
d'ailleurs que «le Cameroun a toujours remplit ses engagements financiers.
Il continue à ravitailler ses soldats».
Les mêmes sources indiquent que: «Lorsque les
soldats camerounais agissaient pour le compte de la Force multinationale
d'Afrique centrale, ils étaient régulièrement payés
par les pays membres de la Communauté économique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC). Chaque Etat apportait sa contribution». Un
soldat de la FOMAC coûtait par jour 9 600 FCFA à la CEEAC.
Après la décision du Conseil de sécurité des
Nations unies datée du 5 décembre 2013 de créer une
mission internationale de la paix en RCA, les charges financières
liées au paiement des soldats sont passés sous contrôle de
l'Union africaine.
Car, les accords entre les Européens et les
Africains stipulent que l'Union européenne, qui a apporté
dès le départ une contribution de plus de 32 milliards de FCFA,
devait se charger du transport des troupes, de l'alimentation et du
casernement. Tandis que les Africains se chargeaient de l'armement et des
munitions. Mais l'argent de l'Union européenne doit transférer
par l'Union africaine, qui agit en tant que sous-traitant. C'est donc
l'organisation panafricaine qui est chargée de la paie des soldats de la
MISCA.
Sur le terrain, un gendarme camerounais a été
blessé dans des affrontements avec des insurgés. Il a reçu
plusieurs balles au niveau de la hanche. Evacué rapidement en direction
du Cameroun, il séjourne depuis vendredi à l'hôpital
militaire de Yaoundé, où il est pris en charge par le colonel
ABENG MBOZO'O, spécialiste en radiologie et imagerie médicale.
Jusqu'ici, aucun soldat camerounais (agissant sous la MISCA) n'a trouvé
la mort sur le sol centrafricain. La MISCA va s'étendre sur douze mois.
Début décembre 2013, l'Union africaine a déployé
2500 soldats venus du Gabon, du Cameroun et du Tchad. A cela s'est
ajouté les 1600 militaires français qui interviennent
également en renfort dans le cadre de «l'opération
Sangaris». Le 19 décembre, la MISCA a officiellement
succédé à la FOMAC. Ses effectifs sont passés
à 4 500 hommes, dont 850 soldats du Burundi et du Rwanda. Ils doivent
atteindre 6000 ce mois.
B - la crise en République du Congo
La République Démocratique du Congo, tout comme
la République Centrafricaine et plusieurs autres pays d'Afrique est un
Etat qui n'a cessé depuis son indépendance en 1960 de connaitre
de sérieuses crises politiques et militaires dont la plupart ont
débouché sur des affrontements armés violents.
Après ce qu'on a qualifié de première guerre du Congo, ce
pays a traversé plusieurs autres crises majeures pour lesquelles le
Cameroun a participé à la résolution. Il convient dans
cette partie d'analyser dans un premier mouvement la dynamique du conflit en
République du Congo (1) avant de voir dans une seconde entrée, le
rôle du Cameroun dans la résolution de ce conflit (2)
1 - La dynamique du conflit en République du
Congo
La guerre civile qui a affecté le Congo-Brazzaville en
trois phases (1993-1994 ; 1997 ; 1998- 1999) remonte à la
démocratisation qui s'est produite à Brazzaville au début
des années 90. Elle a opposé tout d'abord Pascal LISSOUBA
à son challenger des élections présidentielles de 1992,
Bernard KOLELAS. Contestant la valeur des résultats du premier tour des
élections législatives de 1993, KOLELAS appelle ses partisans
essentiellement les « Lari » des quartiers sud de la capitale
à boycotter la suite du scrutin, puis à ne pas reconnaître
le gouvernement formé par le nouveau Premier Ministre Jacques Joachim
YOMBI OPANGO (ancien président du Congo de 1977-1979). L'armée
divisée ethniquement et politiquement refusa d'obéir aussi
aveuglement au chef de l'Etat Pascal LISSOUBA d'ailleurs en rupture avec son
prédécesseur, Dénis SASSOU NGUESSO qui l'avait pourtant
fait élire134(*).
En 1993, les premiers combats entre milices rivales se
produisirent au départ dans Bacongo et
Makélékélé, où les paisibles populations
vouées à la cause de ces deux leaders vivaient jadis en parfaite
harmonie. On assista pour la première fois à la destruction des
habitats des populations des unes dans les zones sous contrôle des autres
et vice-versa, au déplacement des citoyens fuyant la guerre, aux tueries
et autres exactions. La guerre gagna aussi les régions du Pool (fief de
Bernard KOLELAS). Dans ces régions en conflit, le mode d'action fut le
même que celui utilisé par les milices à Brazzaville. Cette
guerre causa la mort de 2000 personnes et de plus de 100.000
déplacés135(*).
Les miliciens « Cobras » de SASSOU NGUESSO,
malgré leur présence dans les combats au côté des
« Ninjas » se sont manifestées dans les zones nord de
Brazzaville par les actes de terreur isolés, faisant ainsi du quartier
Mpila et ses environs une zone à haute insécurité.
L'atténuation de ces tensions et affrontements armés fut
manifeste avec la nomination de Bernard KOLELAS au poste de Maire de la ville
de Brazzaville. Ce dernier se rallia plus ou moins à la coalition
présidentielle. La deuxième phase de la guerre commença
lors de la visite de Denis SASSOU NGUESSO à Owando le 12 mai 1997,
visite qui a fait place à des règlements de comptes entre les
partisans de YOMBI OPANGO et ceux de SASSOU NGUESSO, ayant ainsi donné
la mort à 12 personnes et occasionné le déplacement de
plus de 4000 personnes qui vont trouver refuges à Oyo, village natal de
Denis SASSOU NGUESSO. Le 02 juin 1997, un convoi militaire à destination
de Brazzaville, composé des proches de YOMBI OPANGO est attaqué
à Oyo, bilan 4 morts et 10 blessés. Dans la nuit du 04 au 05 juin
1997, les armes neuves sont partagées dans les quartiers supposés
être les fiefs de SASSOU NGUESSO et les FDU. Dans la matinée du 05
juin, la force publique équipée par les engins blindés
encercle la résidence de SASSOU NGUESSO. Cette guerre a fait plus de
10.000 morts et provoqué le déplacement de près de 800.000
personnes dont 50.000 réfugiés.
La troisième partie de cette guerre commence le 29
Août 1998, par la réaction violente des miliciens Ninjas à
la suite d'exécution de trois de leurs membres accusés de
braquage. Cet événement a été un détonateur
de la rébellion armée qui a repris dans le pool avant de
s'étendre dans la région sud-ouest du Congo
contrôlées par les Cocoyes fidèles à Pascal
LISSOUBA, puis le sud de Brazzaville. Après cet événement,
les Ninjas ont riposté par la tuerie à Goma Tsé-tsé
de 6 personnes, membres d'une délégation du Ministère de
la recherche scientifique en mission dans la localité.
Ce qui a été suivi par l'exécution de
toutes personnes supposées travailler pour le compte de SASSOU NGUESSO
et de son gouvernement. Au lieu d'assurer la sécurité de la
population civile du Pool, les forces armées gouvernementales
appuyées par les ex-faz, de l'armée Angolaise et des milices des
FDU (Cobras) se sont livrés au pillage et à la destruction des
maisons des particuliers et des villages entiers, à diverses exactions,
aux exécutions arbitraires et règlement de compte tant dans les
pays du Niari. Les rebelles par contre ont procédé à des
opérations terroristes qui se manifestent par la destruction des
infrastructures sociales et étatiques, au sabotage des lignes
électriques, au pillage, aux assassinats et à l'utilisation du
bouclier humain, tout en semant la terreur au sein de la population
vouée à leur cause. Ce qui a contraint les populations de ces
contrées à chercher refuge dans les forêts, à
Pointe-Noire et dans les pays environnants, livrées à des
conditions sanitaires et matérielles précaires et sans
bénéfice d'aucune assistance humanitaire à l'exception de
ceux qui se sont faits déclarés réfugiés dans les
localités du sud du pays.
Deux mois après le début de la guerre civile, le
camp de SASSOU NGUESSO ouvre une station de radio-télévision
dénommée Radio-Telé Liberté, qui défend sa
ligne politique et ses thèses sur la guerre et fait le contrepoids aux
médias d'état qui oeuvrent exclusivement pour LISSOUBA. Alors que
la guerre civile s'enlise et que les négociations arbitrées par
Omar Bongo patinent, une recomposition politique s'opère à
Brazzaville, avec la création en septembre 1997, de l'Espace
Républicain pour la Défense de la Démocratie et
l'Unité Nationale (ERDDUN). Il est composé de l'ensemble des
partis politiques qui ne luttent pas aux côtés des Forces
Démocratiques et Patriotiques (FDP) constituées par SASSOU
NGUESSO après le déclenchement des hostilités :
l'UPADS, le MCDDI, le RDPS, RDD, UFD, etc.
La présidence du nouvel ensemble politique est
confiée à KOLELAS. Officiellement, l'objectif de l'ERDDUN est
d'oeuvrer pour le retour à la paix, mais en réalité, il
constitue un front anti SASSOU NGUESSO. Le 13 septembre, sur proposition de
l'ERDDUN, LISSOUBA nomme Bernard KOLELAS au poste de Premier Ministre. D'une
apparence de neutralité au début de la guerre, le
Président du MCDDI vient de se ranger dans le camp de LISSOUBA. Pour
sauver les apparences, KOLELAS fait mine de réserver 5 portefeuilles au
PCT dans le gouvernement de 46 ministres qu'il forme. Juste après sa
nomination, KOLELAS engage ses Ninjas dans la bataille aux côtés
des forces de LISSOUBA. Les Cobras contrôlent toute la partie Nord et
Centre du pays, mais le renfort de la milice de KOLELAS et l'emploi
d'hélicoptères de combat procurent à LISSOUBA un avantage
certain sur le terrain.
À l'instigation de la France, une réunion au
sommet est organisée le 16 septembre à
Libreville par Omar
BONGO. Les présidents
Abdou DIOUF du
Sénégal,
GNASSINGBEEYADEMA
du
Togo,
Alpha OMAR
KONARE du
Mali,
Mathieu KEREKOU du
Bénin,
Ange-Félix
PATASSE de
Centrafrique,
Teodoro
OBIANG NGUEMA MBASOGO de
Guinée
équatoriale et
Idriss DEBY du
Tchad y prennent part.
L'objectif du sommet est de réunir les deux protagonistes de la guerre
civile congolaise pour trouver une solution de sortie de crise. En
dernière heure, LISSOUBA choisit de se faire représenter par son
Premier Ministre KOLELAS, alors que SASSOU NGUESSO est bien présent. Le
sommet ne produit aucun résultat concret.
Le 14, Brazzaville tombe aux mains des Cobras et de
l'armée angolaise. Le lendemain, Pointe-Noire est occupée sans
heurts par les troupes angolaises. C'est la fin pour le régime de
LISSOUBA. Les dignitaires s'enfuient le plus vite possible vers les pays
voisins. Le Président de la République lui-même transite
par Nkayi et Sibiti avant de traverser la frontière gabonaise. Le 24
octobre 1997, Denis SASSOU NGUESSO s'autoproclame Président du Congo et
promulgue un Acte fondamental qui aménage une transition flexible.
2 - La contribution du Cameroun dans les
opérations de soutien à la paix en République du
Congo
Tout comme avec le conflit centrafricain, le conflit qui
frappe le pays de la Rumba menace directement la paix et la stabilité au
Cameroun. Plusieurs cas de violation des frontières par des
éléments armés venant de la République du Congo
sont signalés. Le Cameroun se retrouve bientôt dans la
nécessité d'intervenir pour préserver la paix et la
sécurité à l'intérieur de ses frontières en
cherchant à les rétablir à l'extérieur de
celles-ci.
L'action du Cameroun en faveur de la paix en République
du Congo peut s'analyser sous trois angles : au niveau de la gestion des
flux de réfugiés congolais sur le territoire camerounais ;
au niveau du financement de des opérations de paix dans ce pays et enfin
au niveau de l'envoi de soldats et d'appui en termes infrastructurels.
CHAPITRE IV
ANALYSE DES STRATEGIES CAMEROUNAISES DE GESTION DES
CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE
La position géographique du Cameroun le place
dans une configuration qui le rend vulnérable aux
dégradations sécuritaires venant des pays voisins, au vu
du caractère transnational de l'insécurité dans la
sous-région Afrique centrale. La stabilité politique et
institutionnelle observée au Cameroun, lui confère une
place singulière que le pays veut conserver en essayant de
contenir hors de ses frontières, les soubresauts de la violence
générée dans les pays voisins. Cette volonté
a gagné en intensité et s'est notamment manifestée
par le déploiement international de l'armée camerounaise,
des contingents constitués dans les OMP depuis 2008.
L'armée camerounaise ainsi, pour faire face aux nombreuses
menaces sous régionales, a basculé son dispositif
d'armée de garde pour adopter une posture d'avant-garde, tel que
le conceptualise si bien Ernest Claude MESSINGA136(*). Il s'agit ici de
questionner l'efficacité de cette action de gestion des conflits
et des stratégies pour la rendre meilleure au sein de la
sous-région, ce qui nous donne en (Section I) le titre
suivant : examen des capacités camerounaises de gestion des
conflits en Afrique centrale CEEAC ; il est aussi
intéressant de voir si cette action permet de façon
durable, l'endiguement des conflits ; mais aussi de plancher sur
les perspectives de rationalisation et de coordination avec les Etats
de la sous-région (Section II).
SECTION I : EXAMEN DES CAPACITES
CAMEROUNAISES DE GESTION DES CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE CEEAC
Il s'agit dans cette section, de voir quelles sont
les capacités du Cameroun en ce qui est de la gestion des
conflits en Afrique centrale. Cet examen va se décliner en
deux mouvements à savoir : l'attitude du Cameroun face aux
menaces éventuelles (B), ce qui permettra de voir exactement
les différentes mesures prises par le Cameroun pour parer aux
différentes menaces et les juguler durablement. La
deuxième partie quant à elle va présenter la
gestion des personnes qui subissent les affres des conflits. En gros,
nous parlerons de l'approche camerounaise de gestion des conflits
(B).
A - L'ATTITUDE CAMEROUNAISE FACE AUX MENACES SUSCEPTIBLES
DE COMPROMETTRE LA PAIX SOUS-REGIONALE
Le redimensionnement stratégique du Cameroun ne
s'est pas seulement opéré sur le plan international, il
s'est également fait sur le plan interne pour mieux faire face
aux nouvelles formes de menaces. Parmi ces menaces, il y a le
phénomène des coupeurs de route, la piraterie maritime et
le terrorisme internationale qui connait depuis les attentats de
septembre 2011, une croissance exponentielle. C'est à l'aune de
ces nouvelles menaces que les Etats repensent leur
sécurité.
Les nouvelles formes de menaces remettent en cause la
dichotomie classique entre sécurité intérieure et
sécurité extérieure, remettant au goût du
jour, la dynamique du « dedans » et du
« dehors ». Face donc à ces
différentes menaces, le Cameroun a apporté un certain
nombre d'ajustements pour mieux les combattre, préserver ses
intérêts nationaux et assurer par la même occasion
la paix sous-régionale. Il s'agit entre autre de la
modification de sa carte militaireet les facilitations liées
à l'utilisation de son territoire (1), et l'organisation des
colloques et des conférences (2) pendant lesquelles doivent
être arrêtées des stratégies communes de lutte
contre toutes les formes de menaces et pendant lesquelles il faut
mettre sur pieds des perspectives d'avenir attirantes pour essayer
d'atteindre une « paix durable », ou construire une
« communauté de sécurité ».Le
terme « communauté de sécurité »
fait référence à un groupe de pays qui ont sans
doute des conflits, mais qui n'imaginent pas utiliser la violence, ou
l'utiliser comme menace pour régler leurs conflits.
L'utilisation de la violence y est devenue impensable. Dans un tel
environnement, il est caractéristique que les conflits ont une
chance de se transformer d'une manière constructive137(*). Le défi de la
construction de la sécurité s'impose ainsi au Cameroun.
1 - La modification de sa carte militaire et les
facilitations liées à l'utilisation du territoire
camerounais
La modification de la carte militaire du
Cameroun est intervenue dans un contexte bien particulier. Cet acte
correspond à la montée en puissance de la secte
islamique « BokoHaram, » qui a fait plusieurs
incursions dans la partie septentrionale du Cameroun, menaçant
ainsi la sécurité et l'intégrité du
territoire. En effet, la création de la 4ème
région militaire a pour objectif de répondre efficacement
et durablement à une menace bien réelle qui de plus en
plus gagne en importance. Il était donc nécessaire et
urgent de renforcer et d'améliorer le dispositif
déjà en place.
Jusqu'à la moitié du mois
d'août 2014, le Cameroun comptait 3 régions militaires. La
RMIA4, ou 4ème région militaire a vu le jour
après la signature le 14 août 2014 par le chef de
l'Etat, d'un texte qui éclate la RMIA3 en deux régions
militaires. La RMIA3 couvre le territoire des régions
administratives du Nord et de l'Adamaoua, avec poste de commandement
à Garoua, le département du Mayo-Louti dans la
région du Nord quant à lui dépend de la RMIA4.
Selon le Lieutenant-Colonel Didier BADJECK, « la
3ème région militaire interarmées
était très grande et compte tenu de la
réalité géostratégique actuelle, il
était difficile de pouvoir assurer une fluidité des
ordres entre le chef-lieu de région alors que certaines
opérations se déroulaient au niveau de
l'Extrême-Nord »138(*). La Gendarmerie Nationale est également
organisée en quatre commandements territoriaux
dénommés régions de gendarmerie. Chaque région
de gendarmerie a le même ressort territorial que la
région militaire interarmées. Tous les secteurs militaires
terrestres sont désormais transformés en secteurs
militaires interarmées qui englobent la marine nationale,
l'armée de l'air, l'armée de terre et les soldats du
feu.
Cet ensemble de mesures prises à travers
la signature du Décret N° 2014/308 du 14 août 2014
portant modification du décret n° 2001/108 du 25 juillet
2001 portant réorganisation du commandement militaire territorial,
montre que l'Etat du Cameroun tente d'adapter son déploiement
pour répondre efficacement aux nouvelles formes de menaces.
2 - L'organisation des colloques, conférences et
rencontres au sommet
Les différents colloques et
conférences organisés par le Cameroun sur les question de
paix et de sécurité, montrent bien que les
autorités camerounaises ont le souci de la pacification de la
sous-région.
Le 23 juin 2013 par exemple, il fut
organisé par le Cameroun à Yaoundé, un sommet qui
a réunis 24 chefs d'Etat (plus le Premier Ministre d'Ethiopie),
des pays membres de la CEEAC, de la CEDEAO et de la CGG.
L'objectif principale de cette rencontre était d'harmoniser leurs
réponses face à la délicate question de la
sûreté et de la sécurité maritime dans le
Golfe de Guinée. Ce sommet avait le soutien des Nations Unies
et de l'Union Africaine. L'Union Européenne (UE), l'Organisation
Maritime Internationale (OMI), l'Organisation Maritime de l'Afrique de
l'Ouest et du Centre (OMAOC), le Commandement Américain pour
l'Afrique (AFRICOM), le centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique
(CESA) et l'Institut d'études sur la sécurité ont
pris part à ce sommet en qualité d'observateurs, en tant
que partenaires techniques.
L'enjeu de ce sommet était de trouver
une réponse coordonnée au niveau régional et
international, aux défis de la piraterie maritime, les trafics
de drogues, les vols à main armée et les autres
activités illégales dans le Golfe de Guinée.
L'une des rencontres les plus importantes qui
s'est tenue au Cameroun est sans conteste la conférence des
Chefs d'Etats organisée en février 1999 à
Yaoundé. Cette conférence a été le cadre de
mise en place du COPAX. Le COPAX (Conseil de Paix et de
Sécurité de la CEEAC), est un organe politico-militaire
de la CEEAC en charge de la promotion du maintien et de
consolidation de la paix et de la sécurité au niveau
sous régional.
Par ailleurs, le Cameroun a reçu la
visite du Président tchadien Idriss DEBY ITNO, en mai 2014. Il
a échangé avec le Président camerounais sur la
situation sécuritaire alarmante dans la partie septentrionale,
avec l'aggravation de la menace « BokoHaram ». Il
était évoqué dans le cadre de ces concertations,
des pistes de mutualisation des forces des deux pays. Au vu de ce
qui précède, force est de constater l'ensemble des
efforts fournis par le Cameroun pour organiser des concertations
autour de la sécurité sous régionale, gage du
développement de chaque Etat pris individuellement.
B - L'APPROCHE CAMEROUNAISE DE GESTION DES REFUGIES
L'approche camerounaise de gestion des
réfugiés peut se comprendre sous le prisme de son
adhésion à la déclaration universelle des droits de
l'homme, et à celle de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples. Il n'est donc pas étonnant de voir que
le Cameroun tente de gérer tant bien que mal, le flux de
réfugiés qui, de plus en plus est important du fait des
guerres et conflits qui frappent les pays avoisinants. Par ailleurs,
on peut faire une autre lecture de cette disponibilité du
Cameroun à recevoir les réfugiés étrangers,
par la nécessité d'engranger des retombées
symboliques sur le plan international en tant qu'Etat stable et
« protecteur » des réfugiés. Il y a
donc une dimension stratégique à la réception de
ces hommes, femmes et enfants qui, chaque jour, arrivent par
centaines, aux frontières du Cameroun (2), des entrées
qui demandent une action particulière de la part des
autorités camerounaises (2). Ainsi, le Cameroun a un certain
nombre de devoirs vis-à-vis de ces gens qui relèvent
dès lors qu'ils sont installés au Cameroun, de sa
responsabilité.
1 - L'action de l'autorité administrative et du
HCR
La gestion des réfugiés au Cameroun
relève principalement de la compétence de deux
ministères à savoir : le MINATD et le MINREX.
Toutefois, ces deux institutions reçoivent l'appui d'autres
institutions telles que le MINSANTE ; le Ministre chargé de
mission, le Secrétaire Permanent du Conseil National ; le
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense,
chargé de la Gendarmerie Nationale et le Directeur de la
Recherche Extérieure. Cette configuration a été
adoptée officiellement après la signature par le Chef de
l'Etat camerounais, de l'Arrêté N° 269 du 13 mars
2014, portant création d'un comité interministériel
ad hoc chargé de la gestion des situations d'urgence concernant
les réfugiés au Cameroun.
Ce comité est notamment chargé
d'examiner les défis humanitaires, socio-économiques,
sanitaires et sécuritaires découlant de la présence
massive des réfugiés au Cameroun, à l'effet de
proposer au Gouvernement les mesures appropriées pour y faire
face. Le comité sert également de cadre de concertation
entre le Gouvernement et les institutions internationales pour une
gestion harmonieuse de la situation des réfugiés, tenant
dûment compte des préoccupations légitimes des
communautés locales d'accueil. Il est aussi chargé de
proposer toutes autres mesures utiles dans le cadre de la gestion
des situations d'urgence concernant les réfugiés au
Cameroun.
L'autorité administrative n'est pas seule
partie dans la gestion des afflux des réfugiés, elle est
accompagnée dans cette mission par les institutions
internationales, à l'instar du HCR.
La coopération entre le Cameroun et le
HCR commence en 1978. En effet, cette année marque
l'arrivée massive des milliers de ressortissants
équato-guinéens, fuyant le régime de Macias
NGUEMA139(*).
Favorisé par l'arrivée en 1979 à KOUSSERI, de plus
de 100. 000 réfugiés tchadiens fuyant la guerre civile,
l'accord de siège du HCR au Cameroun interviendra en 1982. La
même année, le HCR installe au Cameroun une
délégation à Yaoundé, et une
sous-délégation à Garoua. Les missions du HCR au
Cameroun sont les suivantes :
· La protection internationale des
réfugiés et demandeurs d'asile conformément aux
normes et principes internationaux ;
· La promotion des droits des
réfugiés ;
· Le rapatriement librement consenti des
réfugiés ;
· La réinstallation vers des pays
tiers ;
· L'intégration sur place ;
· L'amélioration de la gestion des programmes
en faveur des réfugiés à travers la formation du
partenaire de mise en oeuvre aux séminaires organisés par
le HCR.
Bien qu'apprécié à cause de sa
relative sécurité par les réfugiés et les
demandeurs d'asile de la sous-région et de la région des
Grands Lacs, le Cameroun reste dans un contexte juridique
dominé par l'absence d'une législation nationale
garantissant les droits des réfugiés et fixant la
procédure d'éligibilité au statut de
réfugiés. « Le Cameroun a ratifié tous
les principaux textes internationaux et régionaux relatifs aux
questions de réfugiés notamment la convention de
Genève de 1951 et son protocole de 1967 d'une part, et la
convention de l'O.U.A de 1969 sur les aspects spécifiques sur
les réfugiés en Afrique d'autre part. Mais, sur le plan
interne, le Cameroun ne dispose ni d'une législation
spécifiquement consacrée aux réfugiés ni d'une
Commission Nationale d'Eligibilité au statut de
réfugié. Certes la loi de 1997 sur les conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers
contient des dispositions sur la carte d'identité du
réfugié valant carte de séjour. En effet, ce
décret prévoit, l'octroi d'une carte d'identité au
réfugié garantissant le droit de séjour sur le
territoire camerounais, mais reste muet sur les aspects liés
à la Détermination du Statut de Réfugié
(DSR), au principe de non refoulement, et autres droits des
réfugiés garantis par les normes internationales. En
outre, le gouvernement a créé par décret N°
91/262 du 30 mai 1991, un service des Affaires Spéciales et
des Réfugiés au sein du Ministère des Relations
Extérieures, ministère de tutelle. Ce service est
chargé d'assurer le suivi des problèmes des
réfugiés en liaison avec le HCR. Toutefois, son impact
sur la gestion des réfugiés reste très
limité »140(*).
2 - Au niveau des frontières Est et Nord
Le rapport inter agences sur la situation des
réfugiés centrafricains du 29 septembre au 05 octobre
2014, fait état d'un flux de 132 650 réfugiés
enregistrés depuis janvier 2014 à la frontière Est
du Cameroun. Toujours selon ce rapport, 66 296
réfugiés vivent en dehors du site spécialement
aménagé par les autorités camerounaises, contre
61 900 en août 2014. Ces chiffres montrent bien que les
réfugiés ont tendance à s'aventurer en dehors des
zones prévues à cet effet, ce qui crée de
nombreux problèmes, notamment la circulation des armes et autres
objets illicites. Au mois d'août 2014, sur instruction des
autorités locales, les forces de défense et de
sécurité ont lancé une opération de bouclage
de la ville de KENTZOU pour rechercher des armes et autres
effets/objets illicites. Il faut dire que quelques mois auparavant,
des individus non identifiés avaient été
arrêtés dans la zone en possession d'armes et de
munitions141(*). Les
autres sites tels que GBITTI ; KETTE ; MBILE ;
LOLO ; TOKTOYO, font aussi face aux mêmes problèmes,
notamment l'augmentation des cas de conflits agropastoraux entre les
populations locales et les réfugiés ; la
surexploitation des ressources naturelles (bois, eau, terres arables),
l'intensification de la prise des stupéfiants (colle, tramol).
Des problèmes qui sont gérés tant bien que mal
par les autorités camerounaises.
Le problème sécuritaire est un
problème majeur dans ces camps de réfugiés, mais
il n'est pas le seul. En effet, le Cameroun a pour principaux
défis : de nourrir, loger, soigner, éduquer les
réfugiés qui s'installent au Cameroun, et la tâche
s'avère ardue au vu du nombre important de
réfugiés présents sur son territoire.
Au niveau de la frontière Nord les
difficultés qui affectent les réfugiés
nigérians sont presque de même nature que celles
évoquées dans les camps de la frontière Est.
D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, le mois de mars 2014 a vu l'arrivée de
près de 7 500 réfugiés en provenance du
Nigéria. Les réfugiés qui prennent
« d'assaut » les villes camerounaises de FOTOKOL, de
MORA, et de KOLOFATA ont pour la plupart fuit les Etats
nigérians d'ADAMAWA, de YOBE et de BORNO, où les
attaques des groupes armés persistent. Le chiffre de 7 500
n'est qu'un aperçu de l'afflux des réfugiés
à cette frontière, leur nombre important fait qu'ils ont
d'énormes difficultés nutritionnelles.
Afin d'améliorer les conditions des
réfugiés, le gouvernement camerounais gagnerait à
poursuivre et à renforcer l'assistance alimentaire et
nutritionnelle en cours durant au moins un an pour écarter
l'insécurité alimentaire . En outre, il est important de
poursuivre une assistance sous une approche centrée sur le
développement intégré (santé, économie,
sociale etc.) ce qui favorise davantage l'intégration
socio-économique des réfugiés qui désirent de
plus en plus rester au Cameroun.
SECTION II : PERSPECTIVES DE RATIONALISATION ET DE
COORDINATION AVEC LES PAYS DE LA SOUS-REGION
Nicolas TENZER pense que « la politique est
à la fois un art mais aussi une
technologie »142(*). C'est dire que pour lui, elle intègre
l'instinct et l'intuition tout aussi bien que la rationalisation qui
s'expriment dans les infrastructures et les architectures
institutionnelles. Il s'agit donc de voir ici, comment se manifeste
la rationalité du Cameroun dans son déploiement au sein
des différentes commissions et autres communautés (A), le
but étant de préserver ses intérêts et
garantir la sécurité. Tout ceci doit nécessairement
se faire dans un élan de coordination avec les autres Etats
de la sous-région (B).
A -LA RATIONNALISATION DES ACTIONS CAMEROUNAISES
Les conflits inter étatiques et infra
étatiques, tout comme les nouvelles formes de menaces ( coupeurs
de route ; piraterie maritime ; terrorisme etc. ),sont autant
de risques pesant sur la sécurité individuelle et
collective des Etats. Il est évident que face à ces
problèmes sécuritaires, les Etats africains pris
individuellement, ne peuvent pas y apporter une réponse
adéquate et satisfaisante. Cela est dû à un certain
nombre d'insuffisances liées aux armées africaines, telles
que la faiblesse humaine et matérielle ; la faiblesse
liée à la formation et le manque de professionnalisme.
L'intérêt du Cameroun est de
construire un cadre sécuritaire viable, au vue de sa position
centrale en Afrique, et donc des menaces externes engendrées
dans d`autres pays, et qui pèsent sur lui. Ainsi, pour
rentabiliser ses actions dans la sous-région, le Cameroun a
choisi d'agir au sein des institutions qui s'y trouvent, à
l'instar du cadre réduit qu'est la CBLT (1) et aussi dans un
cadre plus important tel que la CEEAC (2), mais il y a
nécessairement un devoir d'amélioration de cette
implication à travers une volonté politique
affirmée.
1 - Au sein de la CBLT
Créée en 1964 par les Etats
riverains du Lac Tchad, la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT)
comprend au départ quatre (04) Etats parmi lesquels le
Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad. Ils seront
rejoints en 1994 par la République centrafricaine, qui en
deviendra le cinquième membre. Aujourd'hui, avec l'adhésion
de la Lybie, on compte désormais six (06) Etats ;
l'Egypte, le Soudan, la République du Congo et la
République Démocratique du Congo sont membres observateurs.
La CBLT est une institution, ou une agence intergouvernementale
chargée de faciliter l'utilisation durable des eaux du bassin,
de coordonner le développement régional et de
résoudre les conflits locaux nés de l'usage des
ressources du bassin.
De plus en plus le problème de la
gestion des ressources du bassin n'est plus le seul pan des
défis auxquels font face les Etats membres de la CBLT. La
sécurité est désormais une véritable
préoccupation pour ces Etats, au vu de la montée en
puissance de nouvelles formes de menaces et notamment de la secte
islamique « BokoHaram ». Le mardi 7 octobre 2014
à Niamey au Niger, il s'est tenu un sommet régional
dont le prélude s'est fait par les Ministres de la
défense des pays membres de la CBLT et du Benin. Ce sommet
qui était axé sur la lutte contre le groupe
« BokoHaram », avait pour but d'élaborer une
stratégie commune et des mesures consensuelles pour faire face
aux défis sécuritaires dans le bassin. Il a donc
été question au cours de ce sommet, de la mise sur
pied d'une force armée multinationale pour lutter contre
« BokoHaram », tel que le prévoyait le plan
adopté cinq mois auparavant par les chefs d'Etat de cette
organisation à Paris. Selon le plan, il fallait une
présence militaire de 700 soldats autour du Lac Tchad. Le
Cameroun a pris une part active dans ces travaux pour définir
les contours de cette force multinationale.
2 - Au sein de la CEEAC
Créée par le Traité du 20 octobre
1983 signé à Libreville au Gabon et entrée en
vigueur le 18 décembre 1984, puis fonctionnelle depuis 1985, la
CEEAC se doit d'être l'organe de coordination des efforts de
développement de l'ensemble des Etats de la sous-région
dans une perspective d'intégration à moyen et à
long terme. C'est donc une organisation d'Etats143(*), régie par les
principes de souveraineté et de consensualisme, mais aussi de
la « Pacta Sun Servenda » qui caractérise
l'inter gouvernementalisme144(*), soumise aux mêmes caractéristiques
que toutes les autres organisations.
L'instrument le plus important de prévention
et de règlement des conflits de la CEEAC est le COPAX, pour
lequel le Cameroun a signé. Originairement instituée pour
gérer le volet économique des pays d'Afrique centrale,
l'insécurité et l'érection de formes de menaces
diverses vont amener la CEEAC à mettre sur pieds son conseil
de paix et de sécurité. Le COPAX est mis en oeuvre en
cas de menace grave à la paix et à la
sécurité dans la sous-région145(*). C'est l'instrument par
excellence pour la gestion des situations de crise en Afrique
centrale.
B - LE DEFICIT DE COORDINATION ENTRE LES ETATS
Le souverainisme sécuritaire, sans
être une exclusivité africaine, encore moins de l'Afrique
centrale, marque le profond attachement classique wébérien
à l'idée d'Etat, monopolisant au sens de Norbert
ELIAS146(*). Ainsi,
les Etats cherchent à s'accommoder à la
préservation de leurs intérêts tout en
ménageant l'opinion publique nationale. L'épisode de la
coordination échouée entre le Cameroun et le
Nigéria pour la lutte contre « BokoHaram » est
un exemple édifiant, car on a l'impression que l'Etat
nigérian ne lutte pas efficacement contre la secte
islamique ; les exactions de ce groupe semblent être
instrumentalisés à des fins de politique interne.
Cette vision disparate des Etats essayant de
préserver leurs propres intérêts déstabilise
souvent les tentatives de gestion des conflits, car les Etats
privilégient leurs préoccupations spécifiques au
détriment de la paix et de la sécurité sous
régionale. Le déficit de coordination dont nous parlons
ici, se traduit entre autre par une défaillance du partage des
informations (1), et une collaboration quasi inexistante (2).
1 - Une défaillance du partage des informations
entre les différents pays sur les menaces potentielles
La faible structuration d'une diplomatie
sécuritaire convergente dans l'espace géographique Afrique
centrale n'est plus à démontrer. Cela est en partie
dû à ce que nous avons appelé plus haut
souverainisme sécuritaire et souverainisme tout court. Cet
état de choses empêche une interopérabilité
entre les différents pays, toute chose qui pourrait conduire,
le cas échéant à une gestion efficace des conflits
et de fait, à une amélioration du cadre
sécuritaire de l'Afrique centrale. Le manque d'organisation est
à mettre également au registre des griefs du
défaut communicationnel.
L'information et son traitement lors des conflits
permet une meilleure gestion de toute éventualité. Une
cellule de veille informationnelle avait déjà
été pensée au niveau de l'UA, mais manifestement,
son fonctionnement est inopérant.
En effet, le Conseil de Paix et de
Sécurité (CPS), dans le cadre sous régional dispose
d'un mécanisme d'alerte précoce chargé de recueillir
toutes les informations utiles pour prévenir les crises et les
conflits. Le CPS utilise donc le système d'alerte
précoce pour faciliter une réponse opportune et efficace
à des situations de conflits ou de crises en Afrique147(*). En tant qu'observatoire
des situations de crise sur le continent, son rôle est de
compiler et d'analyser les indicateurs sociologiques, économiques,
militaires et humanitaires sur des situations de crise et de
proposer des modules d'alerte rapide ainsi que des recommandations
d'actions à entreprendre. En plus, il publie quotidiennement un
bulletin d'information sur les situations de crise148(*). Toutefois un constat
s'impose, c'est celui selon lequel cette structure du CPS ne parvient
pas encore à disposer d'une base de données fiable pour
alerter la communauté africaine sur d'éventuelles menaces
qui affecteraient le continent.
Le rapt de ressortissants étranger et
même des locaux, qui se retrouvent quelques fois dans les pays
voisins, montre bien qu'il y a une nécessité d'avoir des
structures interconnectées pour partager et coordonner l'ensemble
des informations ayant trait à de potentielles menaces sur le
continent. L'interconnexion des uns et des autre est aujourd'hui une
nécessité impérieuse pour pouvoir prendre à
temps les mesures idoines pour lutter efficacement contre toutes les
formes de menaces.
Bien que paralysé par le manque de moyens
et des rivalités entre les CER et l'UA, ce mécanisme
pourrait jouer un rôle déterminant dans la gestion des
crises et des conflits. Les Etats devraient donc s'en inspirer et
l'améliorer pour avoir un cadre viable de partage des
informations, pouvant permettre une meilleure collaboration en
matière de gestion des conflit.
2 - Une collaboration insuffisante
Les pays africains ont des problèmes pour
harmoniser leur disparité militaire tant sur le plan
matériel (communication et système d'armes) que de la
ressource humaine (volonté de combattre et aptitude
opérationnelle). Le manque de collaboration entre les Etats de
l'Afrique centrale, peut en partie être expliqué par le
fait que le continent a une faible capacité
financière ; mais le plus grand frein à cette
collaboration est la non domination de la conception westphalienne de
la sécurité qui prévaut en au sein de chaque
Etat.
Le contexte géopolitique qui est celui
des zones à forte concentration des conflits, et les
intérêts particuliers des Etats font que les engagements
des différentes forces mises sur pieds, ne reçoivent pas
toujours l'adhésion des Etats. En effet, la décision de
déployer une mission relève trop souvent de
considérations et d'opportunismes politiques visant à
défendre des intérêts nationaux. C'est l'exemple de
l'Afrique du Sud qui s'est engagée en République
Centrafricaine, pour la préservation de ses intérêts
économiques, fragilisant ainsi la FOMAC qui est la force
légitimement mandatée par la CEEAC pour la consolidation
de la paix en Centrafrique.
Ces querelles de positionnement ou
d'intérêts particuliers des Etats anéantissent souvent
tous les efforts menés pour améliorer le processus
d'intégration sécuritaire à l'échelle sous
régionale et même continentale. Il faut savoir que
« pour combattre efficacement la multiplication des actes
terroristes, leur caractère et leurs effets internationaux
croissants, les Etats doivent renforcer leur coopération en ce
domaine, en particulier en rendant systématique l'échange
d'informations sur la prévention du terrorisme et les moyens de
le combattre [...] »149(*). Ce qui précède montre à
suffisance qu'en évoluant en rangs dispersés, les Etats
pris individuellement, ne peuvent pas parvenir à lutter
efficacement et durablement contre les différentes formes de
menaces existantes. Pour l'heure, l'Afrique centrale évolue
encore dans ce que l'on pourrait appeler les égoïsmes
étatiques, qui jusque-là empêchent une collaboration
franche. Toute chose qui freine une véritable intégration
sécuritaire dans la sous-région.
CONCLUSION GENERALE
Il nous a été donné de mener une
réflexion sur les raisons stratégiques de l'implication du
Cameroun dans la gestion des conflits en Afrique centrale, mais
aussi de voir quels sont les défis à relever dans le
cadre d'une telle entreprise.
La problématique sur laquelle s'est
adossée ce travail est la suivante : quel est
l'intérêt du Cameroun dans ses actions menées en
matière de gestion des conflits en Afrique centrale CEEAC ?
à cette problématique, nous avions deux
problématiques secondaires : l'implication du Cameroun
est-elle construite dans le cadre d'une vision stratégique, ou
est-elle une adaptation conjoncturelle ? le Cameroun dispose-t-il
des moyens adéquats pour s'impliquer efficacement dans la
gestion des conflits en Afrique centrale ?
L'hypothèse centrale postulait que le
Cameroun s'engage dans la gestion des conflits pour la
préservation de ses intérêts nationaux et pour
garantir la paix et la sécurité sous régionale.
Dans un environnement conflictuel comme celui de
l'Afrique centrale, est-il possible de trouver des esquisses de
solution à l'insécurité et de gérer les
conflits qui s'y déroulent ? que peut faire un Etat comme
le Cameroun dans une dynamique de gestion des conflits dans la
sous-région, et avec quels moyens ?
Ce travail a tenté de répondre à
ces différents questionnements en montrant que la faiblesse des
Etats à assurer leurs fonctions régaliennes de
défense est un véritable problème ;
l'insécurité s'est installée, les conflits
déchirent l'Afrique. Ces conflits et grandes menaces
prospèrent d'avantage d'une part à cause d'un certain
nombre de lacunes telles le manque de démocratie, la mal
gouvernance etc., mais aussi à cause du manque de coordination
des Etats et des disparités souverainistes qui les
caractérisent d'autre part.
Pour le Cameroun comme pour la plupart des
Etats d'Afrique en général et de la sous-région
Afrique centrale en particulier, le véritable défi est de
parvenir à une autonomisation des financements, d'avoir des
effectifs importants et bien formés, d'avoir un matériel
de qualité et une importante logistique. Bien entendue, le
Cameroun et les autres pays de la sous-région doivent mettre
sur pieds, de véritables stratégies communes, de gestion
des conflits et de lutte contre toutes les formes de menaces. C'est
un pari important, difficile à réaliser, mais pas
impossible.
Bien sûr, la pauvreté est un
handicap important qui se dresse devant les Etats, pour la
réalisation de ce pari. D'où la relation
d'interdépendance entre le développement, la
sécurité et l'intégration.
En définitive, le Cameroun et les autres
Etats de la sous-région gagneraient à construire une
véritable « communauté de
sécurité », débarrassée de
l'application béate des principes de Westphalie, toute chose qui
permettra d'assoir une coopération durable et efficace pour un
meilleur développement de l'Afrique.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
OUVRAGES GENERAUX
· ADLER E., Constructivism and
International Relations, CARLNES W. ; RISSE T.
and SIMONS B. , Handbook of International
Relations, London, Sage publications, 2002, p. 95-118, T. HOPF, The
promise of Constructivism in International relations, International
security, vol. 23, n° 1, 1998, p.171-200
· BELY Lucien, l'Europe des
traités de Westphalie, Paris, PUF, 2000, 632p.
· BERGER Peter; LUCKMANN
Thomas, The social construction of reality: a treatise in the
Sociology of knowledge, Garden City, NY: Anchor Books, 1966, p.87
· BONIFACE Pascal, La
géopolitique les relations internationales, Eyrolles, Paris, 2011,
p. 6
· BRAUD Philippe, Sociologie politique,
4e éd, Paris, L.G.D.J, 1998, p.15
· BRINKERHOFF Derrick, Capacity
Development in Fragile States, ECDPM, 2007, p.67.
· CROZIER Michel ;
FRIEDBERG Erhard, L'acteur et le système,
Paris, Editions du Seuil, 1977, pp.230-231
· DE MONTBRIAL Thierry, L'action et
le système du monde, 2e éd mise à jour,
Paris, Quadrige, 2008, p.129
· DURKHEIM Emile, Les règles
de la méthode sociologique, PUF, Paris,
13ème éd, 2007, p.34
· ELIAS Norbert, La dynamique
de l'Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975.
La société des individus, Paris,
Fayard, 1991.
· GRAWITZ
Madeleine, Méthodes des sciences sociales,
Paris, Dalloz, 11ème Ed, 2011, 1019 pages.
· HAAS Ernst B., The Uniting of
Europe. Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957, Stanford
(Calif.), Stanford University Press, 1968 (2eéd.), p. 16.
· KING MERTON Robert,
Eléments de théorie et de méthode sociologique,
Paris, Armand Colin, Collection U, 1997.
· LACOSTE Yves, Dictionnaire de
géopolitique, Flammarion, Paris, 1999, p. 108
· NGUYEN QUOC Dinh, sur la bonne foi
dans les relations internationales, Droit international public, Paris,
LGDJ, 1975.
· QUIVY Raymond ; VAN
CAMPENHOUDTLuc Manuel de recherche en sciences sociales
Paris, EditionDunod, 1995, pp. 42-43.
·
Reyntjens, L'Afrique des grands lacs en crise, Rwanda-Burundi,
1988-1994, Paris, Karthala, 1996.
· ROSIERE Stéphane,
Géographie politique et Géopolitique. Une grammaire de
l'espace politique, Ellipses Editions, Paris, 2000, p. 216.
· SINDJOUNLuc,lapolitique
d'affection en Afrique noire : société de
parenté, 'société d'Etat' et libéralisation
politique au Cameroun, Boston : GRAF, 1998.
· SMOUTSMarie Claude,BATTISTELLA
Dario, VENESSON Pascal. Dictionnaire des
relations internationales. Paris, DALLOZ, 2ème
éd, 2006, p.515
· TENZER Nicolas, Qu'est-ce que la
politique ?, Paris, PUF, Collection Que sais-je ? 124 p.
· WEBER Max, Economie
Société 1, Paris, Pocket, Agora les classiques, 1995, p.
28
OUVRAGES SPECIALISES
· ADLER Emanuel, BARNETT Michael
(eds), Security Communities, Cambridge, Cambridge University
Press, 1998.
· ANGO ELA Paul, La
prévention des conflits en Afrique centrale, Prospective pour une
culture de la paix, KARTHALA, Paris, 2001, 218 p.
· BEAUFRE André, Introduction
à la stratégie, ECONOMICA, Paris, 4e éd,
1985, P.16
· BEDZIGUI Yann,
AnnuaireFrançais de Relations Internationales, 2008, volume IX,
p.163.
· BIRNBAUM Pierre,
« Conflits », in Raymond BOUDON (dir), «
Traité de sociologie », Paris, PUF, 1992 :
SIMMEL Georges, Le conflit (1912), Circé de poche,
1995.
· BOUTHOUL G. ,
« Traité de sociologie. Les guerres,
éléments de polémologie »,
Paris, Fayard 1961, p. 35
· DEJAMET Alain, « Que
reste-t-il de la sécurité collective ? », in
Faire la paix la part des institutions internationales, (dir.) Guillaume DEVIN,
Presses de Sciences Po, Paris, 2009, p. 32.
· LANOTTE Olivier, Guerres sans
frontières, GRIP / Complexe, Bruxelles, 2003, p. 94.
· LE BILLON P., « The
Geopolitical Economy of «Resource Wars» »,
dansGeopolitics of Resource Wars, Ph. Le Billon (ed.), London; New
York, Frank Cass, 2005, pp. 1-28.
· MARTRES Jean Louis ;
BERGER Peter (dir), penser les relations internationales
Paris, l'Harmattan, 2008, 472p.
· MVIE MEKA Elie, Architecture de la
sécurité et gouvernance démocratique dans la CEEAC,
Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, 2007, p.66.
· REYCHLER Luc, « Les
conflits en Afrique : comment les prévenir ? »
in Conflits en Afrique Analyse des crises et pistes pour la prévention,
Bruxelles, coédition Grip-Editions Complexe, 1997, p.36.
· REYCHLER Luc,
PAFFENHOLZThania, (dir), Construire la paix sur le
terrain, Mode d'emploi, Bruxelles, GRIP-Complexe, 2000, p.
32.
· SCHELLING
Thomas,« stratégie du
conflit »,Paris, PUF, 1986, p.3
· TARDY Thierry,
« Gestion des crises, maintien et consolidation de la
paix : acteurs, activités et
défis »Bruxelles, De Boeck Université, 2009 p.17
· TENENBAUM
Charles,
« Négociations et médiations dans la résolution
des conflits » in PETITEVILLE Franck (dir) Négociations
Internationales, Paris, Presses de Science po, 2013, pp.257-284.
· WOLFGANG DEUTSCH Karl, Political
Community and the North Atlantic Area. International Organization in the Light
of Historical Experience, Princeton (NJ), Princeton University Press,
1968.
THESES
· MESSINGA Ernest Claude, Les forces
armées camerounaises face aux nouvelles formes de menaces à la
sécurité : d'une armée de garde vers une armée
d'avant-garde 1960-2010, thèse de doctorat Ph. D en science
politique soutenue à l'Université de Yaoundé II SOA,
2011.
· MEYER Angela, L'intégration
régionale et son influence sur la structure, la sécurité
et la stabilité d'Etats faibles, L'exemple de quatre Etats
centrafricains, Thèse de Doctorat en Science Politique, Institut
d'Etude Politiques de Paris, Décembre 2006, p.50.
MEMOIRES
· ASSILA TSED La
participation des forces de défense camerounaises à la mission de
paix au Darfour (DESS) en Stratégie, Défense,
Sécurité, Gestion des Conflits et des Catastrophes,
Université de Yaoundé II, 2005-2006
· EKINDI NGWENManfred F.
L'implication du Cameroun dans la prévention des conflits
en Afrique centrale Master en Stratégie, Défense,
Sécurité, Gestion des Conflits et des Catastrophes,
Université de Yaoundé II, 2005-2006
· GARBA AHOUDOU La
participation camerounaise à l'opération de maintien de la paix
de l'ONU au Cambodge, (DESS) en Relations Internationales, option
Diplomatie, juillet 2000.
· MBACK WARAAbel Hubert, La
prévention des conflits dans la dynamique de l'intégration sous
régionale en Afrique centrale. Mémoire de D.E.A en science
politique, Université de Yaoundé II, 2007.
· MBANGUE NKOMBA Yves Patrick, La
dynamique de sécurisation des biens et des personnes dans la ville de
Yaoundé par l'action d'une unité spécialisée des
forces de sécurité camerounaises : le cas des équipes
spéciales d'intervention rapide (ESIR), Mémoire de master
Université de Yaoundé II, 2008.
· MEVONO NGOMBAJules Dieudonné
La participation de l'armée camerounaise aux
opérations de maintien de la paix : entre la défense des
intérêts nationaux et la recherche d'une paix durable en Afrique
centrale. Mémoire de D.E.A en science politique, Université
de Yaoundé II, 2008-2009, p 3.
· NGUIMBI Rahim Jhan, La place de
l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité
africaine (APSA), Mémoire de Master2 en Contentieux international,
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), 2012.
· PEMBOURA Aicha, Le processus de
formation de la culture stratégique camerounaise : Analyse du
rôle des Ecoles militaires, Mémoire de Master2 en Science
Politique, Université de Yaoundé 2-Soa, 2005.
· SALIF
KA, Laproblématique des conflits en Afrique: le cas de la Somalie, de la
Côte d'Ivoire et de la RDC, Mémoire de Maitrise en science
politiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis, 2012, p.17.
ARTICLES
· AKONO ATANGANE Eustache,
« Les problèmes de délimitation des espaces
maritimes en Afrique centrale », in Revue africaine
d'études politiques et stratégiques N° 4, Université
de Yaoundé II, 2007, p. 247
· AYISSI Anatole, « Le
maintien de la paix en Afrique : responsabilité et responsabilisation du
continent », in Paul Ango Ella (dir.), La prévention des
conflits en Afrique centrale. Prospective pour une culture de la paix,
Paris, Karthala, 2001, pp. 177-188.
· BACH Daniel et SINDJOUN
Luc, ordre et désordre en Afrique, Polis, vol. 4, n.2,
1997/11, p.2.
· BATTISTELLA Dario,
« L'apport de Karl Deutsch à la théorie des relations
internationales », Revue internationale de politique
comparée, vol. 10, no 4, 2003,
p. 567-585
· BERTHELEMY Jean-Claude, AZAM
Jean-Paul, Calipel Stéphane. Risque politique et croissance en
Afrique. In: Revue économique, Volume 47, n°3, 1996. pp.
819-829.
· CHOUALA Yves-Alexandre,
«Patriotes rebelles. Légitimation et civilisation patriotiques des
luttes politiques armées en Afrique», Revue juridique et
politique, n° 4, 2006, p. 563.
· DIZAMBOU Rufin, « Les
mouvements migratoires dans l'espace UDEAC/CEMAC de 1964 à nos
jours : une conséquence de la fragilité des Etats d'Afrique
Centrale », Enjeux, Bulletin d'Analyses Géopolitiques pour
l'Afrique Centrale, n° 38, janvier-mars 2009, p. 59
· FOGUE TEDOM Alain, « L'Union
Africaine face au défi titanesque de la prévention, du
règlement et de la gestion des conflits », in
Juridis, n° 75, janvier-aout-septembre 2008, p.77.
· KENFACK Jean, « le Conseil
de Paix et de sécurité de l'Union africaine », in
De la Paix en Afrique au XXIe siècle, Presses de l'UCAC,
Yaoundé, 2007, p 147.
· KONTCHOU KOUOMEGNIAugustin « De
la statolité en Afrique à la recherche de la
souveraineté » Revue science et technique, vol VI,
n° 3-4, Juillet-Décembre 1989, p. 19-33.
· McMILLAN D.W, Sense of community.
Journal of Community Psychology, 24(4), 1996, pp.315-325.
· NTUDA EBODE Joseph Vincent,
« le pétrole est-il une source
conflictogène en Afrique centrale ? » ,
Revue Africaine de Défense n° 2, Avril-Juin 2000, pp.
104-118.
· NTUDA EBODE Joseph Vincent,
« Les Forces en Attente de l'Afrique Centrale : Point de
situation et défis »http://www.operationspaix.net
consulté le 03 novembre 2014 à 02h22.
· PETITEVILLE Franck, « Les
processus d'intégration régionale, vecteurs de structuration du
système international ? », Etudes
internationales, 28 (3), 1997, p. 512.
· POUTRIER R., « les raisons
d'une guerre incivile », Afrique Contemporaine n°166, avril-juin
1998, p.17
· TSHIYEMBE Mwayila, « Les
principaux déterminants de la conflictualité », in
La prévention des conflits en Afrique centrale, Prospective pour
une culture de la paix, (éd.) P. ANGO ELA, Karthala, Paris, 1999,
p. 23.
· YERO BA (A), « Fléau
des conflits et défi sécuritaire en Afrique » in
RJPIC, n° 1, 55e année, janvier-avril, 2001,
p.24.
JOURNAUX
· BERTOLTBoris, « Cameroun -
Crise centrafricaine: Les 850 soldats camerounais sans salaires »,
Mutations, Yaoundé, 12 Février 2014.
· EIFORCES, Bulletin Trimestriel d'Analyse
Stratégique et Prospective de l'EIFORCES, N° 001, Décembre
2013,
· HAMAN J., « commerce
illicite, des produits détruits à
N'Gaoundéré », Cameroun Tribune n°
10383/6584 du 15 juillet 2013, p. 13.
· Magazine des forces armées camerounaises,
numéro spécial, mai 2009
RAPPORTS ET PROTOCOLES
· BEDOUM Alassoum, « Les
Conflits en Afrique Centrale : un défi pour le
PNUD », Rapport du PNUD décembre 2003.
· Protocole relatif à la création du
conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, 9 juillet
2002, Art 2. 2.
· Rapport du secrétaire des Nations Unies sur les
conflits, Les causes des conflits et promotion d'une paix et d'un
développement durables en Afrique En 1970.
· Rapport inter agences sur la situation des
réfugiés centrafricains-Cameroun, 18-24 Août 2014.
· Résolution 49/60 du 9 décembre 1994
de l'ONU.
WEBOGRAPHIE
· http://aspd.revues.org/255
·
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/dossier_etats_fragiles_tcm313-108566.pdf
·
http://french.peopledaily.com.cn/International/6994400.html
·
http://www.afrique-express.com/homesafex/pagesaccueil/defensesecurite/247exercicemilitaire.htm
·
http://www.operationspaix.net/15-fiche-d-information-de-l-organisation-ua.html
· http://www.unic-tunis.intl.tn/sgreportaaf.htm
· www.cameroon-tribune.net
· www.ceeac-eccas.org
· www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-642_en.html
·
www.psi.ulaval.ca/publications/sécurité_mondiale/
· www.toupie.org/Biais/Biais_statu_quo.html
·
www.wikipedia.org/wiki/sécurité_nationale
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : CARTE DES MENACES QUI PESENT SUR LE
CAMEROUN
ANNEXE 2 : CARTE DE LA CEEAC
ANNEXE 3 : EMPLACEMENTS DES CAMPS DE REFUGIES
CENTRAFRICAINS AU CAMEROUN.
ANNEXE 4 :
Décret
N°2014/308 du 14 août 2014 portant modification du décret
n°2001/180 du 25 juillet 2001 portant réorganisation du
commandement militaire territorial
ANNEXE 1 : CARTE DES MENACES QUI PESENT SUR LE
CAMEROUN
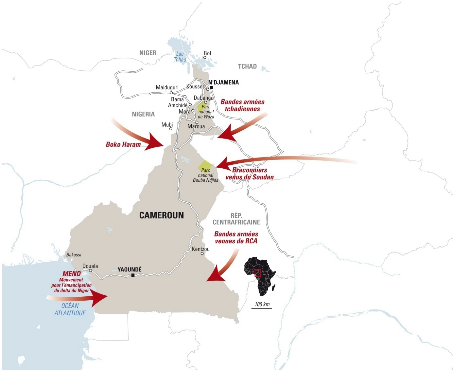
Source :
http://www.jeuneafrique.com/photos/042013/024042013130732000000cam.jpgconsulté
le 27 novembre 2014.
ANNEXE 2 : CARTE DE LA CEEAC

Source :
http://radiookapi.net/tag/ceeac/page/2/consulté
le 27 novembre 2014 à 15h30.
ANNEXE 3 : EMPLACEMENTS DES CAMPS DE REFUGIES
CENTRAFRICAINS AU CAMEROUN.

 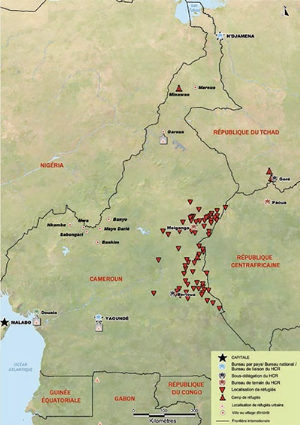
 Source :
http://www.unhcr.fr/images/operationsMaps/country-cmr-400.jpgconsulté
le 27 novembre 2014 à 16h. Source :
http://www.unhcr.fr/images/operationsMaps/country-cmr-400.jpgconsulté
le 27 novembre 2014 à 16h.
ANNEXE 4 :
Décret
N°2014/308 du 14 août 2014 portant modification du décret
n°2001/180 du 25 juillet 2001 portant réorganisation du
commandement militaire territorial
Décret N°2014/308 du 14 août 2014 portant
modification du décret n°2001/180 du 25 juillet 2001 portant
réorganisation du commandement militaire territorial
Le Président de la République,
décrète :
Article 1er : Les dispositions des articles
1er, 3, 10, 25, 26, et 28 du décret n° 2001/180 du 25 juillet 2001
portant réorganisation du commandement militaire territorial sont
modifiées ainsi qu'il suit :
Chapitre premier :
Généralités
Article : 1er (nouveau)
1°) Sur le plan militaire, le territoire national est
divisé en :
-Quatre régions militaires interarmées (RMIA)
;
-Quatre régions de gendarmerie.
2°) A chaque région militaire interarmées
correspond une région de gendarmerie.
3°) L'organisation et le fonctionnement des
régions de gendarmerie font l'objet de textes particuliers.
4°) Un arrêté du ministre chargé de
la Défense fixe en tant que de besoin les modalités de
coordination du service de garnison.
Chapitre II : Des régions militaires
interarmées
Article : 3 (nouveau) :
1°) Les ressorts territoriaux et les postes de
commandement des régions militaires interarmées sont
fixées ainsi qu'il suit :
Première région militaire interarmées
(RMIA1)
Ressort territorial : Région du Centre, Région
de l'Est, Région du Sud ;
Poste de commandement : Yaoundé ;
Deuxième Région militaire interarmées
(RMIA2)
Ressort territorial : Région du Littoral,
Région du Sud-Ouest, Région de l'Ouest, Région du
Nord-Ouest.
Poste de commandement : Douala
Troisième Région militaire interarmées
(RMIA3)
Ressort territorial : Région de l'Adamoua,
Région du Nord hormis le Département du Mayo-Louti
Poste de Commandement : Garoua
Quatrième région militaire interarmées
(RMIA4)
Ressort territorial : Région de l'Extrême-Nord,
département du Mayo-Louti dans la région du Nord
Poste de commandement : Maroua
2°) Toutefois le Président de la République
peut, par décret, modifier, en tant que de besoin, le ressort
territorial d'une région militaire interarmées. Il peut
également, par décret, modifier l'implantation du poste de
commandement d'une région militaire interarmées.
Article 10 (nouveau)
1°) Sont directement rattachés au commandement de
la région militaire interarmées :
-Le secrétariat particulier ;
-Le bureau des relations publiques ;
-L'Antenne de la sécurité militaire ;
-Le bureau budget-finances ;
-Le bureau du sport et des activités culturelles ;
-Le bureau de la communication ;
-Le service social ;
-La cellule des transmissions
2°) Sont fixés par des textes particuliers,
l'organisation et le fonctionnement de la cellule de transmission, de
l'informatique et de la téléinformatique.
Chapitre III (nouveau) : Des secteurs militaires
Article 25 (nouveau)
1°) Les secteurs militaires constituent des subdivisions
de la région militaire interarmées.
2°) Chaque secteur militaire couvre le ressort
territorial d'une région administrative.
Article 26 (nouveau)
1°) Les ressorts territoriaux et les postes de
commandement des secteurs militaires sont fixés ainsi qu'il suit :
Première région militaire interarmées -
Yaoundé :
Premier secteur militaire (SM1)
Ressort territorial : Région du Centre ;
Poste de commandement : Yaoundé
Septième secteur militaire (SM7)
Ressort territorial : Région du Sud ;
Poste de commandement : Ebolowa ;
Huitième secteur militaire (SM8)
Ressort territorial : Région de l'Est ;
Poste de commandement : Bertoua.
Deuxième région militaire
interarmées-Douala :
Deuxième secteur militaire (SM2)
Ressort territorial : Région du Littoral ;
Poste de commandement : Douala
Sixième secteur militaire (SM6)
Ressort territorial : Région du Nord-Ouest ;
Poste de commandement : Bamenda
Neuvième secteur militaire (SM9)
Ressort territorial : Région de l'Ouest ;
Poste de commandement : Bafoussam.
Dixième secteur militaire (SM10)
Ressort territorial : Région du Sud-Ouest ;
Poste de commandement : Buea ;
Troisième région militaire
interarmées-Garoua :
Troisième secteur militaire (SM3)
Ressort territorial : Région du Nord :
Poste de commandement : Garoua
Cinquième secteur militaire (SM5)
Ressort territorial : Région de l'Adamaoua ;
Poste de commandement : Ngaoundéré.
Quatrième région militaire
interarmées-Maroua :
Quatrième secteur militaire (SM4)
Ressort territorial : Région de l'Extrême-Nord
;
Poste de commandement : Maroua.
2°) Toutefois le Président de la République
peut, par décret, modifier le ressort territorial d'un secteur
militaire. Il peut également, par décret, modifier l'implantation
du poste de commandement d'un secteur militaire.
Article 28 (nouveau)
1°) Le commandement de secteur militaire est
chargé :
-De la discipline générale des personnels
militaires et civils du secteur ;
-De l'organisation matérielle des opérations de
recrutement des personnels et en liaison avec la légion de gendarmerie,
du suivi de la mobilisation des réserves ;
-Du recueil, de la centralisation et de la diffusion du
renseignement militaire et du renseignement de défense.
2°) Le commandant de secteur militaire, par
délégation du commandant de la région militaire
interarmées, assure le contrôle, la surveillance et la protection
des organismes, des établissements, des ateliers, des magasins,
des dépôts et des infrastructures militaires ministériels
communs ou spécialisés implantés dans le secteur et
placés sous sa responsabilité.
Le reste sans changement
Article 2 : Le ministre
délégué à la présidence chargé de la
Défense est chargé de l'application du présent
décret qui sera enregistré, puis publié au Journal
Officiel en français et en anglais.
Fait à Yaoundé, le 14 août
2014
Le Président de la
République
(é) Paul BIYA
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT..............................................................................i
DEDICACE.......................................................................................ii
REMERCIEMENTS.............................................................................iii
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS..................................................iv
RESUME.............................................................................................vii
ABSTRACT..........................................................................................viii
SOMMAIRE......................................................................................ix
INTRODUCTION
GENERALE......................................................................1
PREMIERE PARTIE : LA STRATEGIE CAMEROUNAISE DE GESTION
DES CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE : ENTRE LOGIQUES INTERNES D'INTERET
NATIONAL ET DYNAMIQUES EXTERNES DE RECHERCHE DE LA
PAIX..........................................................................................22
CHAPITRE 1ER : LE CAMEROUN DANS LA GESTION DES
CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE : ANALYSE D'UNE POSTURE
RATIONNELLE.......................24
Section 1 : Entre la défense des
intérêts économiques et la gestion des
intérêts
politico-institutionnels....................................................................................26
A -Les intérêts
socio-économiques............................................................26
1) La sécurité des personnes et des
biens...............................................27
2) La sécurisation des investissements
économiques.................................28
B - Les intérêts
politico-institutionnels......................................................30
1) La question des normes organisationnelles et
fonctionnelles.....................31
2) La protection des institutions
nationales.............................................32
Section2 :L'attitude géostratégique du
Cameroun..........................................33
A - Le maintien du statu
quo..................................................................34
1) Le maintien de la sécurité
nationale..................................................35
2) Le maintien de la
stabilité.............................................................36
B - Le changement et le bouleversement du statu
quo.....................................37
1) La grande réforme des armées de
2001..............................................37
2) La nouvelle orientation de la doctrine militaire
camerounaise...................39
CHAPITRE 2 : LE CAMEROUN DANS LA GESTION DES CONFLITS EN
AFRIQUE CENTRALE : UNE DYNAMIQUE CONJONCTURELLE SOUS-REGIONALE DE
RECHERCHE DE LA
PAIX....................................................................41
Section 1 : L'Afrique centrale comme zone
d'instabilité permanente et rémanente...43
A -La géopolitique des conflits en Afrique
centrale.........................................43
1) les causes de la conflictualité en Afrique
centrale .................................43
2) Acteurs et stratégies de la conflictualité en
Afrique centrale.....................44
B - Cadre normatif et institutionnel de gestion des conflits
en Afrique centrale.......48
1) Les aspects normatifs du cadre de gestion des conflits en
Afrique centrale....48
2) Les cadres institutionnels et opérationnels de
gestion des conflits en Afrique
centrale...................................................................................50
Section 2 : La contribution du Cameroun aux efforts sous
régionaux de gestion des conflits en Afrique centrale : la
conjoncture au-dessus de l'intérêt
national ?..........................................................................................52
A - La participation du Cameroun comme impératif
sécuritaire supranational.........52
1) Des réponses régionales aux conflits
régionaux : le Cameroun dans la spirale sécuritaire supra
étatique...............................................................53
2) À la conjuration des faiblesses individuelles des
Etats d'Afrique centrale : agir collectivement pour trouver une
réponse à la crise de l'Etat........................55
B -L'expression d'une nouvelle dynamique des relations des
relations internationales : la régionalisation des initiatives
sécuritaires........................................................57
1) La régionalisation sécuritaire comme moyen de
dépassement des intérêts
nationaux......................................................................................57
2) La régionalisation sécuritaire comme moyen de
production d'une stabilité
politico-économique....................................................................................58
DEUXEME PARTIE : LA STRATEGIE CAMEROUNAISE DANS LA
GESTION DES CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE : UNE ADAPTATION ACTUELLE AUX
PROBLEMATIQUES SECURITAIRES CONTEMPORAINES.............................60
CHAPITRE 3 : LES DYNAMIQUES OPERATIONNELLES DE LA
PARTICIPATION DU CAMEROUN DANS LA GESTION DES
CONFLITS.........................................61
Section 1 : Des missions de formation : entre mise
à disposition de structures de formation et participation aux exercices
conjoints...............................................................62
A - La mise à disposition de structures de structures
de formation............................63
1) Le cours supérieure interarmées de
défense (CSID).....................................64
2) L'école internationale des Forces de
Sécurité (EIFORCES)...........................65
B - La participation camerounaise aux exercices militaires
conjoints.........................66
1) Les exercices BIYONGHO 2003, BAHR-EL GAZAL 1 et SAWA
2006.....67
2) BAHR-EL GAZAL 2, KWANZA 2010 et FOMAC-CONGO
2014............68
Section 2 : ...À l'envoi des unités
constituées sur le théâtre des
opérations............70
A -Le cas de la crise
Centrafricaine..........................................................71
1) De la rétrospective sur les crises politiques en
République centrafricaine......71
2) ...À la participation des forces armées
camerounaises à leur dénouement.....75
B - La crise en République du
Congo.........................................................80
1) La dynamique du conflit en République du
Congo.................................81
2) La contribution du Cameroun dans les opérations de
soutien à la paix en République du
Congo..................................................................................84
CHAPITRE 4 : ANALYSE DES STRATEGIES CAMEROUNAISES DE
GESTION DES CONFLITS EN AFRIQUE
CENTRALE......................................................85
Section 1 : Examen des capacités camerounaises de
gestion des conflits en Afrique centrale
CEEAC...............................................................................................86
A - L'attitude camerounaise face aux menaces susceptibles de
compromettre la paix sous
régionale.............................................................................................87
1) La modification de sa carte militaire et les facilitations
liées à l'utilisation du territoire
camerounais................................................................................88
2) L'organisation des colloques, conférences et
rencontres au sommet.............91
B - L'approche camerounaise de gestion des
réfugiés.......................................92
1) L'action de l'autorité administrative et du
HCR....................................93
2) Au niveau des frontières Est et
Nord.................................................95
Section 2 : Perspectives de rationalisation et de
coordination avec les pays de la
sous-région..............................................................................................97
A - La rationalisation des actions
camerounaises...........................................97
1) Au sein de la
CBLT.....................................................................98
2) Au sein de la
CEEAC...................................................................98
B - Le déficit de coordination entre les
Etats................................................99
1) Une défaillance du partage des informations entre
les différents pays sur les menaces
potentielles...............................................................................100
2) Une collaboration
insuffisante.......................................................101
CONCLUSION
GENERALE................................................................103
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES...................................................106
LISTE DES ANNEXES
......................................................................113
TABLE DES
MATIERES.....................................................................122
* 1 Rapport du
secrétaire des Nations Unies sur les conflits, Les causes des
conflits et promotion d'une paix et d'un développement durables en
Afrique En 1970 (ndlr : c'est-à-dire 10 ans après
l'indépendance fictive de la plupart des pays africains), il y a eu sur
le continent africain, plus de 30 guerres, qui dans leur vaste majorité
ont pour origine les conflits internes.
En 1996, seulement 14 des 53 pays d'Afrique ont connu des
conflits armés, responsables de plus de la moitié de tous les
décès causés par des conflits dans le monde entier et
provoquant plus de 8 millions de réfugiés et de personnes
déplacées, http://www.unic-tunis.intl.tn/sgreportaaf.htm
consulté le 03 Novembre 2014 à 01h05
* 2Alassoum BEDOUM,
« Les Conflits en Afrique Centrale : un défi pour le
PNUD », Rapport du PNUD décembre 2003.
* 3Joseph Vincent NTUDA
EBODE, « Les Forces en Attente de l'Afrique Centrale : Point
de situation et défis » http://www.operationspaix.net
consulté le 03 novembre 2014 à 02h22.
* 4 Le transfert de
compétence entre la CEMAC et la CEEAC a été
décidé le 30 Octobre 2007, lors de 13ème
conférence des chefs d'Etats et de Gouvernements de la CEEAC à
Brazzaville. Il a été implémenté le 12 Juillet
2008.
* 5 Sous la réserve du
respect de l'article 33 alinéa (g) de l'Acte constitutionnel de
l'U.A.
* 6 Mouvement Islamiste
alliant insurrection religieuse et politique, révolte sociale et
radicalisation sous forme de protestations meurtrières, des musulmans du
nord du Nigéria et dont les velléités se font ressentir au
nord du Cameroun.
* 7 Convention de Vienne, 18
avril 1961 et protocoles additionnels ; Agenda des Nations Unies pour la
paix, 17 juin 1992.
* 8 Emile DURKHEIM, Les
règles de la méthode sociologique, Paris, PUF,
13ème éd, 2007, p.34
* 9 André BEAUFRE,
Introduction à la stratégie, Paris, ECONOMICA,
4e éd, 1985, P.16
* 10 Marie Claude SMOUTS,
Dario BATTISTELLA, Pascal VENESSON, Dictionnaire des relations
internationales, Paris, DALLOZ, 2ème éd, 2006,
p.515
* 11 Thierry DE MONTBRIAL,
L'action et le système du monde, Paris, Quadrige, 2e
éd, 2008, p.129
* 12 Philippe BRAUD,
Sociologie politique, 4e éd, Paris, L.G.D.J, 1998, p.15
* 13 Thierry TARDY,
« Gestion des crises, maintien et consolidation de la paix :
acteurs, activités et défis »Bruxelles, Editions
De Boeck Université, 2009 p.17
* 14 Pierre BIRNBAUM,
« Conflits », in Raymond BOUDON (dir), «
Traité de sociologie », Paris, PUF, 1992 :
Georges SIMMEL, Le conflit (1912), Circé de poche, 1995.
* 15 G.
BOUTHOUL,« Traité de sociologie. Les guerres,
éléments de polémologie », Paris,
Fayard, 1961, p. 35
* 16 Thomas SCHELLING,
« stratégie du conflit », Paris, PUF,
1986, p.3
* 17 Thierry
TARDY« Gestion des crises, maintien et consolidation de la
paix : acteurs, activités et défis», Op. cit. p.
21
* 18 Abel Hubert MBACK
WARA, La prévention des conflits dans la dynamique de
l'intégration sous-régionale en Afrique centrale,
Mémoire de D.E.A en science politique, Université de
Yaoundé II SOA, 2007.
* 19 Dictionnaire Larousse,
Paris, Larousse, 2008, p. 147
* 20 Cette théorie a
été énoncée par Albert W. TUCKER à
Princeton, en 1950,
www.wikipedia.com,
consulté le 28 Septembre 2014 à 7h00.
* 21Joseph Vincent NTUDA
EBODE, « le pétrole est-il une source
conflictogène en Afrique centrale ? » ,
Revue Africaine de Défense n° 2, Avril-Juin 2000, pp.
104-118.
* 22 Le conseil de paix et
de sécurité de la CEEAC, en abrégé COPAX, est un
mécanisme qui a été créé au sein de l'OUA,
adopté lors de la 29ème session ordinaire de l'OUA à la
conférence des chefs d'Etat et de gouvernement tenue au Caire en Egypte,
du 28 au 30 juin 1993, et incorporé à l'UA pendant la
conférence tenue à Lusaka en Zambie du 9 au 11 juillet 2001. Le
COPAX a pour vocation la prévention, la gestion et le règlement
des conflits en Afrique centrale.
* 23
www.ceeac-eccas.org,
consulté le 23 novembre 2014 à 5h30.
* 24 Jules Dieudonné
MEVONO NGOMBA, La participation de l'armée camerounaise aux
opérations de maintien de la paix : entre la défense des
intérêts nationaux et la recherche d'une paix durable en Afrique
centrale. Mémoire de D.E.A en science politique, Université
de Yaoundé II SOA, 2008-2009.
* 25 Raymond QUIVY ;
Luc VAN CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales,
Paris,EditionDunod, 1995, pp. 42-43.
* 26 Jules Dieudonné
MEVONO NGOMBA, Op.cit.
* 27 ASSILA TSED
La participation des forces de défense camerounaises à
la mission de paix au Darfour (DESS) en Stratégie,
Défense, Sécurité, Gestion des Conflits et des
Catastrophes, Université de Yaoundé II, 2005-2006
* 28 AHOUDOU GARBA
La participation camerounaise à l'opération de maintien
de la paix de l'ONU au Cambodge, (DESS) en Relations Internationales,
option Diplomatie, juillet 2000.
* 29 Manfred François
EKINDI NGWEN L'implication du Cameroun dans la prévention des
conflits en Afrique centrale Master en Stratégie, Défense,
Sécurité, Gestion des Conflits et des Catastrophes,
Université de Yaoundé II, 2005-2006
* 30 Jules Dieudonné
MEVONO NGOMBA, Op. Cit.
* 31Idem, Op.
Cit.
* 32 Yves LACOSTE,
Dictionnaire de géopolitique, Paris, Flammarion, 1999, p.
108
* 33 Jean Louis
MARTRES ; Peter BERGER (dir), penser les relations internationales,
Paris, l'Harmattan, 2008, 472p.
* 34 Emile DURKHEIM, Les
règles de la méthode sociologique, Paris, PUF,
13e éd, 2007, p.109
* 35 Max WEBER, Economie
Société 1, Paris, Pocket, Agora les classiques, 1995, p.
28
* 36 Peter BERGER; Thomas
LUCKMANN, The social construction of reality: a treatise in the Sociology
of knowledge, Garden City, NY: Anchor Books, 1966, p.87
* 37 E. ADLER,
Constructivism and International Relations, W. CARLNES; T. RISSE and
B. SIMONS, Handbook of International Relations, London, Sage
publications, 2002, p. 95-118, T. HOPF, The promise of Constructivism in
International relations, International security, vol. 23, n° 1, 1998,
p.171-200
* 38 Raymond QUIVY ;
Luc VAN CAMPENHOUDT, op. Cit, P. 21-36
* 39 Raymond QUIVY ;
Luc VAN CAMPENHOUDT, ibid., p. 84
* 40 Abel Hubert MBACK WARA,
Op. cit.
* 41Raymond QUIVY;Luc VAN
CAMPENHOUDT, Op. Cit.pp. 128-129.
* 42Madeleine GRAWITZ
« Méthodes des sciences
sociales »,Paris, Dalloz, 11ème Ed,2011, 1019
pages.
* 43Jacqueline
MORAND-DEVILLER,« Cours de droit
administratif »Paris,Montchrestien, 10ème Ed,
p.705
* 44 Michel CROZIER ;
Erhard FRIEDBERG, L'acteur et le système, Paris, Editions du
Seuil, 1977, pp.230-231
* 45 Agenda pour la paix
(1992) et son supplément (1995), résolution 1625 (2005) du
Conseil de Sécurité de l'ONU du 14 septembre 2005 sur l'adoption
de la déclaration sur le renforcement de l'efficacité du
rôle joué par le conseil de sécurité dans la
prévention des conflits en Afrique.
* 46 Elie MVIE MEKA,
Architecture de la sécurité et gouvernance démocratique
dans la CEEAC, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, 2007, p.66.
* 47Ernest Claude MESSINGA,
Les forces armées camerounaises face aux nouvelles formes de menaces
à la sécurité : d'une armée de garde vers une
armée d'avant-garde 1960-2010, thèse de doctorat Ph. D en
science politique soutenue à l'Université de Yaoundé II
SOA, 2011.
* 48 Rufin DIZAMBOU,
« Les mouvements migratoires dans l'espace UDEAC/CEMAC de 1964
à nos jours : une conséquence de la fragilité des
Etats d'Afrique Centrale », Enjeux, Bulletin d'Analyses
Géopolitiques pour l'Afrique Centrale, n° 38, janvier-mars 2009, p.
59
* 49 Yves Patrick MBANGUE
NKOMBA, La dynamique de sécurisation des biens et des personnes dans
la ville de Yaoundé par l'action d'une unité
spécialisée des forces de sécurité
camerounaises : le cas des équipes spéciales d'intervention
rapide (ESIR), Mémoire de master en sécurité
défense et gestion des catastrophes, Université de Yaoundé
II SOA, 2008.
* 50 Philippe CABANIUS,
« Amélioration du transport de transit dans la région
d'Afrique Centrale », première session du comité
intergouvernemental préparatoire de la conférence
ministérielle internationale sur la coopération en transport de
transit, 7 avril 2003, p. 5.
* 51 J. HAMAN, cité
par MEVONO NGOMBA, « commerce illicite, des produits détruits
à N'Gaoundéré », Cameroun Tribune
n° 10383/6584 du 15 juillet 2013, p. 13.
* 52 P. TEWARD, cité
par B. BOUNOUNG FOUDA, « De la fragilité des Etats de
l'Afrique centrale à une pensée reconstructive des Etats en
déconstruction : essai d'analyse », Enjeux, Bulletin
d'Analyses Géopolitiques pour l'Afrique Centrale, n° 38,
janvier - mars 2009, p. 12.
* 53 Robert K. MERTON,
Eléments de théorie et de méthode sociologique,
Paris, Armand Colin, Collection U, 1997.
* 54 Le Grand Robert de la
langue française 1999.
* 55 Ernest Claude
MESSINGA, Op.Cit.
* 56 Eustache AKONO
ATANGANE, « Les problèmes de délimitation des
espaces maritimes en Afrique centrale », in Revue africaine
d'études politiques et stratégiques N° 4, Université
de Yaoundé II, 2007, p. 247
* 57 Stéphane
ROSIERE, Géographie politique et Géopolitique. Une grammaire
de l'espace politique, Ellipses Editions, Paris, 2000, p. 216.
* 58 Pascal BONIFACE, La
géopolitique les relations internationales, Paris, Eyrolles, 2011,
p. 6
* 59
www.toupie.org/Biais/Biais_statu_quo.html consulté le 08/11/2014
à 22h.
* 60 En avril 2013, le
Cameroun et le Nigéria se sont mis d'accord sur la délimitation
de leur frontière maritime ainsi que sur le tracé de 1 893 km de
leur frontière terrestre dont la distance totale est estimée
à environ 2 100 km. Voir le « Communiqué de la
30e réunion de la commission mixte Cameroun
Nigéria », 23 avril 2013.
*
61www.wikipedia.org/wiki/sécurité_nationale,
Consulté le 05/11/2014, à 20h.
* 62Mwahila TSHIYEMBE,
« Les principaux déterminants de la
conflictualité », in La prévention des
conflits en Afrique centrale, Prospective pour une culture de la paix,
(éd.) P. ANGO ELA, Karthala, Paris, 1999, p. 23.
* 63 Alain DEJAMET,
« Que reste-t-il de la sécurité
collective ? », in Faire la paix la part des institutions
internationales, (dir.) Guillaume DEVIN, Paris, Presses de Sciences Po, 2009,
p. 32.
* 64 Le rapport inter
agences sur la situation des réfugiés centrafricains au Cameroun,
couvrant la période du 29 septembre au 05 octobre, commandé par
la Direction de la Protection Civile, indique que sur les sites de Timangolo et
de Gado au Cameroun, les accrochages entre les nationaux et les
réfugiés sont surtout le fait de la raréfaction du bois de
chauffage et parfois de l'occupation de l'espace.
* 65Ernest Claude MESSINGA,
Op.Cit.
* 66 Magazine des forces
armées camerounaises, numéro spécial, mai 2009,
www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-642_en.html.
* 67 Ibid.
* 68 Angela Meyer,
L'intégration régionale et son influence sur la structure, la
sécurité et la stabilité d'Etats faibles, L'exemple de
quatre Etats centrafricains, Thèse de Doctorat en Science
Politique, Institut d'Etude Politiques de Paris, Décembre 2006, p.50.
* 69 Ibid.
* 70Lire
Filip Reyntiens, L'Afrique des grands lacs en crise, Rwanda-Burundi,
1988-1994, Paris, Karthala, 1996.
* 71 Daniel Bach et Luc
Sindjoun, ordre et désordre en Afrique, Bordeaux, Polis, vol.
4, n. 2,1997/11, p. 2
* 72 Yann
Bedzigui, Annuaire
Français de Relations Internationales, Bruxelles, Bruylant, la
documentation française, 2008, volume IX, p.163.
* 73 Ibid.
* 74SalifKâ, La problématique des
conflits en Afrique: le cas de la Somalie, de la Côte d'Ivoire et de la
RDC, Mémoire de Maitrise en science politiques, Université Gaston
Berger de Saint-Louis, 2012, p.17.
* 75Yann
BEDZIGUI, Op.cit,
p.164.
* 76 Ibid.
* 77EliasNorbert,La
société des individus, Paris, Fayard, 1991, 301 p.
* 78McMillan D.W, Sense of
community.Journal of Community Psychology, 24(4), 1996, pp.315-325.
* 79Luc
Sindjoun,lapolitique d'affection en Afrique noire :
société de parenté, 'société d'Etat' et
libéralisation politique au Cameroun, Boston : GRAF, 1998.
* 80 Les circonscriptions
administratives ont généralement essayé de procéder
à un rassemblement spatial des groupes ethniques. Au Cameroun, chacune
des dix régions correspond à des entités culturelles plus
ou moins vastes rassemblant des peuples ayant entre eux certains liens
culturels. De sorte qu'avec la reviviscence des tensions interethniques, les
Mbo, habitants d'un village administrativement situé dans la province de
l'Ouest, peuplée de Bamilékés, revendiquent leur
rattachement à la province du Littoral où se trouvent les autres
tribus voisines. Il convient toutefois de signaler l'exception congolaise,
où, au nom de la révolution marxiste, le pays fut divisé
selon des contours beaucoup plus géographiques qu'ethniques, pour
éviter les polarisations ethniques non compatibles avec le marxisme
(DorierApprill, 1997, 164). Ce qui n'empêcha pas une vaste mobilisation
de l'ethnicité avec la naissance du multipartisme et des
compétitions électoralistes.
* 81 Yves-Alexandre Chouala,
«Patriotes rebelles. Légitimation et civilisation patriotiques des
luttes politiques armées en Afrique», Revue juridique et
politique, n° 4, 2006, p. 563.
* 82 Voir à ce sujet
les travaux d'Olivier Lanotte, Guerres sans frontières, GRIP /
Complexe, Bruxelles, 2003, p. 94.
* 83Laurent Goetschelet
Didier Péclard, « Les conflits liés aux ressources
naturelles. Résultats de recherches et perspectives »,
Annuaire suisse de politique de développement [En ligne], Vol.
25, n°2 | 2006, mis en ligne le 19 mars 2010, Consulté
le 16 novembre 2014 à 12h09. URL: http://aspd.revues.org/255.
* 84 P. Le Billon,
« The Geopolitical Economy of «Resource Wars» »,
dansGeopolitics of Resource Wars, Ph. Le Billon (ed.), London; New
York, Frank Cass, 2005, pp. 1-28.
* 85Luc REYCHLER,
Thania PAFFENHOLZ, (dir), Construire la paix sur le terrain,
Mode d'emploi, Bruxelles, GRIP-Complexe, 2000, p. 32.
* 86 Ibid.
* 87 Idem.
* 88
Charles
TENENBAUM, « Négociations et médiations dans la
résolution des conflits » in Franck Petiteville (dir)
Négociations Internationales, Paris, Presses de Science po,
2013, pp.257-284.
* 89 YERO BA,
« Fléau des conflits et défi sécuritaire en
Afrique » in RJPIC, n° 1, 55e année,
janvier-avril, 2001, p.24.
* 90 Alain FOGUE TEDOM,
« L'Union Africaine face au défi titanesque de la
prévention, du règlement et de la gestion des
conflits », in Juridis, n° 75, janvier-aout-septembre
2008, p.77.
*
91http://www.operationspaix.net/15-fiche-d-information-de-l-organisation-ua.html,
consulté le 21 Novembre 2014 à 11h22.
* 92 Lire la note de cadrage
de la réunion entre la Commission de l'UA, les CER et les
mécanismes de coordination des brigades régionales de l'Afrique
de l'Est et de l'Afrique du Nord, sur la mise en oeuvre du protocole d'accord
de coopération dans le domaine de la Paix et de la
sécurité, tenue à Akosombo, au Ghana, du 9 au 11
décembre 2009, p. 1.
* 93 Voir à ce sujet,
Jean KENFACK, « le Conseil de Paix et de sécurité de
l'Union africaine », in De la Paix en Afrique au XXIe
siècle, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2007, p 147.
* 94 Tel est
l'intitulé exact de ce texte. Par ailleurs, la Commission consultative
est créée sous les auspices des Etats membres de la CEEAC et le
Secrétariat Général des Nations Unies, le 28 mai 1992.
D'où le lien entre ladite Commission et la CEEAC.
* 95 Art.1er du
règlement relatif au MARAC
* 96 Ibid.
* 97 Art.2 du
règlement relatif à la FOMAC
* 98 Angela Meyer,
Op.cit.p.51.
* 99 Anatole Ayissi,
« Le maintien de la paix en Afrique : responsabilité et
responsabilisation du continent », in Paul AngoEla (dir.), La
prévention des conflits en Afrique centrale. Prospective pour une
culture de la paix, Paris, Karthala, 2001, pp. 177-188.
* 100 Thierry TARDY,
Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix, Edition De
Boeck, Bruxelles, 2009, p.16.
* 101Citation de Charles
Schultze, in Pierre Rosanvallon, La crise de l'Etat-Providence,
Editions du Seuil, 1981 France, p59.
* 102Expression issue de la
notion de statolité évoquée par Augustin KontchouKouomegni
« De la statolité en Afrique à la recherche de la
souveraineté » Revue science et technique, vol VI,
n° 3-4, Juillet-Décembre 1989, p. 19-33.
* 103 Expression issue des
travaux de Max Weber sur le monopole de la violence légitime.
*
104AugustinKontchouKouomegni, Op.cit, 21.
* 105DerickBRINKERHOFF,
Capacity Development in Fragile States, ECDPM ,2007,
p.67.
*
106http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/dossier_etats_fragiles_tcm313-108566.pdf,
consulté le 16 Octobre 2014 à 23h51.
* 107 Franck PETITEVILLE,
« Les processus d'intégration régionale, vecteurs de
structuration du système international ? », Etudes
internationales, 28 (3), 1997, p. 512.
* 108 Ernst B. Haas,
The Uniting of Europe. Political, Social, and Economic Forces,
1950-1957, Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1968
(2eéd.), p. 16.
* 109Karl WOLFGANG DEUTSCH,
Political Community and the North Atlantic Area.International Organization
in the Light of HistoricalExperience, Princeton (NJ), Princeton
UniversityPress, 1968.Pour une présentation synthétique de la
théorie internationale de K. W. Deutsch, voir
Dario Battistella, « L'apport de Karl Deutsch à la
théorie des relations internationales », Revue
internationale de politique comparée, vol. 10,
no 4, 2003, p. 567-585 ; et pour une discussion
critique de la notion de communauté de sécurité, voir
Vincent Pouliot, « Communauté de
sécurité », in Alex Macleod, Louis-Blaise
Dumais-Lévesque, Anne-Marie Durocher (sous la dir.), Dictionnaire
des études de sécurité, Montréal,
Athéna (à paraître en 2004).
* 110 Emanuel ADLER,
Michael BARNETT (Eds), Security Communities, Cambridge, Cambridge
University Press, 1998.
* 111Jean-Claude
BERTHELEMY, Jean-Paul AZAM, Calipel Stéphane. Risque politique et
croissance en Afrique. In: Revue économique, Volume 47,
n°3, 1996. pp. 819-829.
* 112 Michel KOUNOU,
Pétrole et pauvreté au sud du Sahara. Analyse des fondements
de l'économie politique du pétrole dans le Golfe de
Guinée, Yaoundé, Clé, 2006, p. 36.
* 113 Cité par
Charles KINDLEBERGER, The world in Depression, 1973.(sur la puissance
hégémonique à chercher dans théories et concepts
des RI et dans le dictionnaire des RI)
* 114 Aicha PEMBOURA,
Le processus de formation de la culture stratégique
camerounaise : Analyse du rôle des Ecoles militaires,
Mémoire de Master2 en Science Politique, Université de
Yaoundé 2-Soa, 2005.
* 115 Voir article 9 du
décret N° 2005/014 du 13 janvier 2005.
* 116 Décret n°
2008/179 du 22 mai 2008 du Président de la République du
Cameroun.
* 117 EIFORCES, Bulletin
Trimestriel d'Analyse Stratégique et Prospective de l'EIFORCES, N°
001, Décembre 2013, p 6.
* 118 Joseph VincentNTUDA
EBODE, La force en attente dans l'architecture de paix et de
sécurité de l'Union Africaine, Actes du Colloque 2011 sur
« 50 de défense et de sécurité en Afrique :
états et perspectives stratégiques », Yaoundé,
2011.
* 119
http://www.afriqueexpress.com/homesafex/pagesaccueil/defensesecurite/247exercicemilitaire.htm,
consulté le 20 novembre 2014 à 17h30.
* 120 Voir
Communiqué de presse SG/SM/9914. AFR/1184. ECO/86 en date du 07 juin
2005.
* 121
http://www.operationspaix.net/3-fiche-d-information-de-l-organisation-ceeac.html
consulté le 20 juin 2014 à 03h 07. Voir également NGUIMBI
(Rahim Jhan), La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et
de sécurité africaine (APSA), Mémoire de Master2 en
Contentieux international, Institut des Relations Internationales du Cameroun
(IRIC), 2012.
* 122 A l'époque
Francisco Pereira Furtado.
*
123http://french.peopledaily.com.cn/International/6994400.html
consulté le 20 juin 2014 à 22h 17.
*
124www.cameroon-tribune.net consulté le 03 juin 2014 à
16h 29.
* 125Jhan Rahim NGUIMBI,
Op.cit.
* 126 Lire dans cette
perspective
CREOLINK Communications, '
SOPECAM
, 16 Septembre 2014 , Rousseau-Joël FOUTE et dans la rubrique
National
-
Politique
, « Hervé Ladsous, SG adjoint aux opérations de
maintien de la paix a été reçu en audience samedi dernier
par le PM ».
* 127 Ibid. p.4.
* 128 Entretien directif
exécuté le 23 septembre 2014 à 12h 15 minutes.
* 129 Entretien directif
exécuté le 23 septembre 2014 à 15h 45 minutes.
* 130 Entretien directif
réalisé le 23 septembre 2014 à 12h30.
* 131 Entretien directif
réalisé le 23 septembre 2014 à 18h 24 minutes.
* 132BORIS BERTOLT,
« Cameroun - Crise centrafricaine: Les 850 soldats camerounais sans
salaires », Mutations, Yaoundé, 12 Février 2014.
* 133 Ibid.
* 134 R. POUTRIER,
« les raisons d'une guerre incivile », Afrique
Contemporaine n°166, avril-juin 1998, p.17
* 135 Ibid.
* 136 Ernest Claude
MESSINGA, Op. cit.
* 137 Luc REYCHLER,
« Les conflits en Afrique : comment les
prévenir ? » in Conflits en Afrique Analyse des
crises et pistes pour la prévention, Bruxelles, coédition
Grip-Editions Complexe, 1997, p.36.
* 138 Lieutenant-Colonel
Didier BADJECK, chef de division de la communication au ministère de la
Défense, www.cameroun-tribune.cm, consulté le 27 novembre
2014.
* 139 Francisco Macias
NGUEMA, (1924-1979), fut le premier Président de la République de
Guinée Equatoriale, (1968-1979).
* 140 Plan
d'opérations par pays de l'UNHCR, 2006.
* 141 Rapport inter agences
sur la situation des réfugiés centrafricains-Cameroun, 18-24
Août 2014.
* 142 Nicolas TENZER,
Qu'est-ce que la politique ?, Paris, PUF, Collection Que
sais-je ? 124 p.
* 143 Pris dans le sens
« westphalien » du terme. Lucien Bély, l'Europe
des traités de Westphalie, Paris, PUF, 2000, 632p.
* 144 Nguyen Quoc Dinh, sur
la bonne foi dans les relations internationales, Droit international
public, Paris, LGDJ, 1975.
* 145 Lire l'article 6 du
pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC qui dispose que
le COPAX est mis en oeuvre lorsqu'il y a une menace grave à la paix et
à la sécurité dans la sous-région, notamment en cas
de conflit armé entre deux ou plusieurs Etats parties au présent
pacte ; conflit interne susceptible de mettre en danger la paix et la
sécurité dans un autre Etat partie ;conflit interne donnant
lieu à des actes entrant dans la catégorie des crimes
internationaux ; conflit interne menaçant gravement l'existence de
l'Etat concerné.
* 146 Norbert ELIAS,
La dynamique de l'Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975.
* 147 Protocole relatif
à la création du conseil de paix et de sécurité de
l'Union Africaine, 9 juillet 2002, Art 2. 2.
* 148 L'Union africaine et
la sécurité collective
www.psi.ulaval.ca/publications/sécurité_mondiale/
consulté le 24 novembre 2014 à 16h.
* 149 Résolution
49/60 du 9 décembre 1994 de l'ONU.
| 


